Migrations, d'Algernon Blackwood
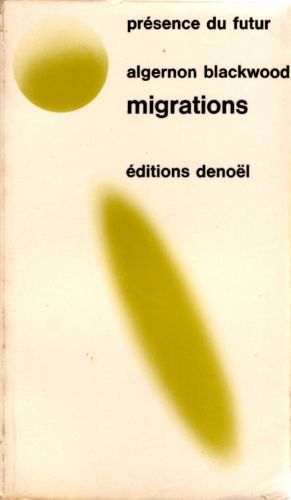
BLACKWOOD (Algernon), Migrations, [Ancient Sorceries – Max Hensig – The Listener – Confession – Wayfarers], nouvelles traduites de l’anglais par Jacques Parsons, Paris, Denoël, coll. Présence du futur, [1967] 1971, 237 p.
Un autre recueil d’Algernon Blackwood – le dernier des quatre « Présence du futur » qui lui avaient été consacrés que je n'avais pas encore lu. Je me suis régalé avec les précédents, et cela vaut pour celui-ci également, même si je crois que j’aurais tendance à le classer un rang en dessous, pour des raisons que je développerai dans cette petite chronique. Quoi qu’il en soit, nous trouvons dans Migrations cinq nouvelles de l’immense auteur fantastique anglais. Comme souvent dans ces recueils, deux de ces récits – les deux premiers – s’avèrent des novellas de bonne taille, là où les trois autres sont d’un format plus modeste.
Le recueil s’ouvre sur une histoire assez souvent citée, « Sortilèges et métamorphoses » (simplement « Ancient Sorceries » en version originale, ce qui claque davantage, je trouve). Figure dans cette nouvelle le personnage récurrent d’enquêteur du paranormal d’Algernon Blackwood, John Silence – mais il est essentiellement un auditeur tout du long, ne prenant véritablement la parole, et pour trancher l’affaire, que dans les toutes dernières pages. Avant cela, il a en quelque sorte la position du lecteur, et écoute attentivement le récit qui lui est fait par un jeune homme anglais du nom d’Arthur Vézin (oui, oui, il est anglais) de ses aventures étranges dans un petit village français où il s’est rendu sur un coup de tête. Là-bas, les chats sont étonnamment nombreux – et les habitants étonnamment félins ; de fait, la nouvelle use et abuse du champ lexical associé, d’une manière qui m’a semblé un chouia grossière – d’autant que John Silence intervient lui-même pour attirer l'attention sur ce point. Quoi qu’il en soit, notre jeune Anglais est sous le charme, et c’est bien le cas de le dire… car une minette est forcément de la partie. Mais sous cette façade simplement troublante se dissimule une histoire plus sombre, un héritage secret d’un passé sordide, à même de faire frémir… Et, en fait de coup de tête, rien, dans le comportement d’Arthur Vézin n’est dû au hasard – et John Silence d’en rajouter une couche à base de réincarnation, thème hyper-blackwoodien que l’on retrouvera plus loin dans le recueil, pour clôturer l’histoire. Des chats partout, un village mystérieux dont tous les habitants ont quelque chose de non humain, des rituels secrets, un « héros » sous l’emprise d’un sortilège et qui se voit révéler sa généalogie trouble… Ouais, Lovecraft aurait attribué un pouce vers le haut à cette nouvelle. Peut-être aussi Tourneur et Lewton, dans un registre différent. Et c’est une bonne nouvelle, mais je dois dire qu’elle m’a tout de même un brin déçu… Il y a peut-être, ici, quelques défauts de construction ? La mise en place est longue, ce qui rend d’autant plus sensible l’abus des allusions félines, et la bascule du charme à la sorcellerie vire au grotesque, ce qui peut être bien comme mal, c’est selon. L’ambiance est intéressante, mais pas à la hauteur, en ce qui me concerne, des plus grands chefs-d’œuvre de Blackwood, tels « Les Saules », « L’Homme que les arbres aimaient » ou « Le Wendigo », ou même de textes un cran en dessous comme « Le Camp du chien » (une autre nouvelle figurant John Silence, tiens).
La novella suivante, « Max Hensig », est assez déconcertante – mais aussi très captivante, probablement celle que j’ai préférée dans ce recueil. Sa distinction essentielle est qu’il ne s’agit pas, cette fois, d’un récit fantastique à proprement parler : le surnaturel en est totalement absent, et Blackwood nous concocte plutôt une sorte de thriller avec quelques bases vaguement scientifiques – mais ça fonctionne très bien ! C’est aussi un récit qui a une part autobiographique poussée, et à son avantage : la vie de Blackwood, et surtout sa jeunesse, a été assez mouvementée et l’a vu exercer bien des professions parfois incongrues – mais, pour un temps, il a été journaliste à New York, ainsi que le personnage point de vue de cette histoire ; pas toujours le plus sympathique des bonshommes, à vrai dire, et par ailleurs quelqu’un qui, comme tous ses collègues, boit probablement trop, car il boit tout le temps et prétend en dernière mesure y trouver la force pour triompher de l’adversité (un discours totalement pathologique mais qui se tient étrangement dans l’atmosphère de cette nouvelle), quand il ne se tourne pas vers la cocaïne. La dépiction précise par Blackwood de ce milieu social et professionnel et de ses à-côtés sordides fait partie des principaux atouts de cette novella – et elle me confirme dans le sentiment que Blackwood avait quelque chose de plus « moderne », dans le ton du moins, mais aussi éventuellement dans le fond, que ses contemporains tels Arthur Machen, M.R. James ou H.P. Lovecraft, plus… « aristocratiques » ? Quoi qu’il en soit, notre journaliste est amené à enquêter sur un médecin d’origine allemande, Max Hensig, accusé d’avoir tué sa femme avec du poison. Il y va à reculons, tout cela l’ennuie profondément, mais il n’a guère le choix, ayant été sommé de pondre un article sur le sujet, dans la veine sensationnaliste (et très éphémère) de la presse new-yorkaise qui l’emploie. Seulement voilà : procès ou pas, Max Hensig inspire bientôt à notre journaliste le plus profond dégoût – il a la conviction que cet homme détestable, cynique, méprisant, qui clame son innocence mais pour les motifs les plus incongrus, tout en affichant sa supériorité intellectuelle justifiant son amoralité, a en lui quelque chose de profondément maléfique, et qu’il serait bon de s’en débarrasser une bonne fois pour toutes… Aussi multiplie-t-il les articles à charge. Mais Max Hensig est acquitté, faute de preuves, il échappe à la chaise et retourne en Allemagne… avant de revenir aux Etats-Unis et d’y tomber « par hasard » sur notre journaliste. Bien sûr, celui-ci sait que la vérité est tout autre : l’empoisonneur est là spécialement pour lui, et il compte bien se venger de la plus horrible des manières ! Oui, « Max Hensig » est une sorte de thriller, mais qui fonctionne magnifiquement bien, pour le coup, avec des scènes dont la tension est palpable, véritablement matérielle, le jeu du chat et de la souris entre le criminel et le journaliste s’avérant d’une perversité fascinante. Je n’attendais pas Blackwood dans ce registre, mais j’ai été conquis.
Puis nous avons « L’Indiscret » (« The Listener »), nouvelle d’un format intermédiaire, et qui est somme toute une classique histoire de maison hantée. Ce qui la distingue et lui confère tout son effet, c’est sa forme épistolaire – plus exactement, nous lisons les entrées d’un journal intime, d’un personnage qui s’affiche d’emblée mentalement instable, et qui vient d’emménager dans un appartement au loyer étonnamment modeste ; là, il espère pouvoir écrire, car tel est son métier, et cet espoir ne se réalisera guère – mais il compte peut-être bien davantage y trouver le moyen de fuir la société londonienne qu’il juge bien trop envahissante ; seulement il reçoit bel et bien des visites ennuyeuses… d’un précédent locataire, peut-être ? La force de la nouvelle réside dans son ambiance très travaillée, et dans cette forme épistolaire – que le narrateur soit souvent désagréable, et un peu ridicule, y contribue beaucoup, dans une veine au fond pas si éloignée de celle de « Max Hensig ». Sous cet angle, cette classique histoire de maison hantée fonctionne bien. J’y mettrais tout de même un bémol : la chute, que l’avant-propos (de Jacques Parsons, je suppose ?) affirme être « particulièrement terrifiante », m’a paru bien fade – au point où je me suis demandé si je n’étais pas passé à côté de quelque chose ; mais a priori, non… Bon. Dernière chose à noter : le motif plus ou moins affiché d’une histoire qui se répète peut nous ramener indirectement à la thématique de la réincarnation, là encore – c’est moins frontal que dans « Sortilèges et métamorphoses » ou, plus loin, « Migrations », mais c’est décidément un fil rouge du recueil comme, au-delà, d’une part non négligeable de l’œuvre d’Algernon Blackwood.
Le recueil se conclut sur deux histoires bien plus courtes – et sans doute plus anodines, si pas inintéressantes. Nous avons tout d’abord « Confession », qui est une histoire de fantômes relativement classique là encore. Sa force réside dans son ambiance, très travaillée, le brouillard londonien lui conférant d’emblée quelque chose de vaguement surréaliste, et c’est certes un climat idéal pour croiser des fantômes. À cet égard, les développements ultimes du récit, qui conduisent le narrateur sur la scène d’un drame, ne me paraissent guère importants, s’ils sont bien tournés, ou professionnellement, en tout cas. Le brouillard et ce qu’on y croise, une femme désespérée en l’espèce, voilà ce qui compte, et qui rend cette nouvelle touchante.
Reste enfin « Migrations » (« Wayfarers »), nouvelle qui met plus que tout autre en avant le thème de la réincarnation. Le personnage point de vue, suite à un accident automobile, a le sentiment de revivre des événements antérieurs, ou bien de voyager dans le temps – en même temps, cette expérience troublante le confronte à ses désirs inavoués portant sur la femme d’un ami… Cette nouvelle me paraît devoir être scindée en deux parties, approximativement : la première, qui voit le héros vivre cette expérience de métempsycose, est remarquable, très habile dans sa manière de susciter l’ambiguïté – et très « moderne », là encore ; mais la seconde, qui affiche plus frontalement cette idée d’un amour maudit de génération en génération, use d’un ton beaucoup plus grandiloquent, baroque même, avec des éclats mystiques, qui pourrait faire penser à un Dunsany en petite forme ou à un Lovecraft tentant de faire du Dunsany en petite forme, et ce contraste ne me paraît pas satisfaisant. Dommage… Mais la nouvelle n’est pas inintéressante, cela dit. Oui, il y a quelque chose, dans son ambiance, dans son dispositif, dans ses personnages…
Migrations est un très bon recueil, à n’en pas douter. Pourtant, je crois donc que je le classerais un peu en dessous par rapport à mes précédentes lectures d’Algernon Blackwood. Même si j’ai beaucoup aimé « Max Hensig », notamment, je n’ai pas le sentiment d’avoir lu dans ce recueil quelque chose d’aussi époustouflant que « Les Saules » ou « L’Homme que les arbres aimaient ». Et, même avec leurs défauts, des nouvelles telles que « Le Wendigo » ou même « Le Camp du chien », me paraissent bien autrement séduisante.
Mais je remarque ici quelque chose : ce qui unit les quatre récits que je viens de citer, c’est leur cadre de nature sauvage – or celui-ci est à peu près totalement absent du présent recueil, si l’on y trouve quelques très vagues allusions dans la dernière nouvelle. De manière générale, tout est plus urbain, ici – même à la mesure d’un petit village français perdu dans les champs. Peut-être cela a-t-il joué, donc – ce cadre sylvestre me manquant. Cela dit, même sans cela, l’ambiance est toujours très travaillée dans ces nouvelles d’Algernon Blackwood, et le smog de « Confession » colporte de beaux mystères, en même temps que le naturalisme, si l’on ose dire, de « Max Hensig », produit à sa manière des pages également fortes.
Alors le constat demeure, de lecture en lecture : Algernon Blackwood était un génie, un grand maître de la littérature fantastique (voire un peu au-delà, puisque « Max Hensig », donc). Je trouve désespérant que son œuvre soit aussi difficile à se procurer en français de nos jours, en dehors du seul (et excellent) recueil L’Homme que les arbres aimaient, chez L’Arbre Vengeur, que je vous engage vraiment à vous procurer si ce n’est pas déjà fait. Il mériterait assurément bien plus !

/image%2F1385856%2F20160114%2Fob_cfb8b0_caligari.jpg)


/image%2F1385856%2F20201027%2Fob_e27ed3_la-guerre-du-pavot.jpg)
/image%2F1385856%2F20200713%2Fob_a414dc_ecran-noir-04.jpg)
/image%2F1385856%2F20200618%2Fob_3ca18a_la-mort-du-fer.jpg)
/image%2F1385856%2F20200612%2Fob_f373f3_les-miracles-du-bazar-namiya.jpg)
/image%2F1385856%2F20150204%2Fob_660a87_georges-abdaloff-croque-par-christell.jpg)
Commenter cet article