"La Tour des damnés", de Brian Aldiss
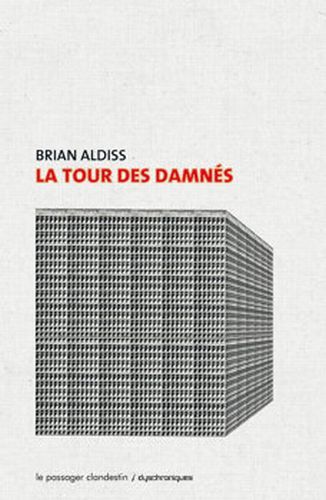
ALDISS (Brian), La Tour des damnés, [Total Environment], traduction [de l’anglais par] Guy Abadia, Congé-sur-Orne, Le Passager clandestin, coll. Dyschroniques, [1968, 1972] 2013, 106 p.
Hop, comme je ramais un peu sur mes lectures, ce qui m’empêchait de tenir ce blog interlope à jour, je me suis accordé une petite pause avec un récit très bref. La toute nouvelle collection « Dyschroniques » du Passager clandestin réédite en effet nouvelles et novellas plus ou moins anciennes, dans un format tout riquiqui. Ce qui ne va pas sans poser problème : on pourrait en effet jaser sur le prix de la chose, surtout pour des textes certes difficilement trouvables (mais ce n’est pas impossible) qui ne sont en outre pas retraduits. Mais quand on aime…
Parmi les premiers titres de la collection, deux m’ont fait de l’œil : en premier lieu, Un logique nommé Joe de Murray Leinster (mais je l’ai déjà dans ma commode de chevet, dans l’anthologie si bien nommée Demain les puces) ; en second lieu, cette Tour des damnés de Brian Aldiss, dont le postulat n’est pas sans évoquer l’excellent roman (plus tardif) de J.G. Ballard I.G.H., même si l’approche comme le propos sont en fin de compte différents. Il s’agit en effet d’un texte bien de son époque, témoignant de la crainte obsédante de la surpopulation (sous cet angle, on penserait peut-être plutôt en priorité à Soleil Vert ou à Tous à Zanzibar, entre autres).
En 1975, 1500 couples de moins de vingt ans, volontaires, sont enfermés dans une immense tour à Delhi. 25 ans plus tard, la population de la Tour atteint les 75 000 personnes… Dans cet habitat unique en son genre, véritable enfer concentrationnaire coupé de l’extérieur, caractérisé par une promiscuité difficilement concevable, les humains subissent de plein fouet les conséquences de leurs conditions de vie : c’est comme si le temps s’accélérait, la puberté comme le processus de sénescence commençant bien plus tôt ; mais il est une autre conséquence qui intéresse bien davantage les observateurs extérieurs : la Tour est en effet une gigantesque expérience de sociologie appliquée, visant à mettre en évidence le développement, dans certaines conditions, de capacités de perception extra-sensorielle…
À l’intérieur de la Tour, nous suivons tout d’abord le destin sordide de la famille de Gita et Shamim, du neuvième niveau (sur dix ; chaque niveau comprend cinq étages), notamment à travers l’enlèvement de la vieille prématurée Malti, fille de Shamim, par le répugnant Narayan, qui la vend comme esclave au puissant Patel, seigneur du niveau supérieur. Ce récit alterne avec un rapport de Thomas Dixit, employé du CERGAFD (Centre ethnographique de recherches sur les groupes à forte densité) qui dirige l’expérience de l’extérieur, sur les conditions de vie dans la Tour.
Dixit, à la double ascendance indienne et anglaise, est horrifié par l’expérience, et entend bien faire fermer la Tour. Une occasion lui en sera peut-être offerte, quand il se fera volontaire pour infiltrer la Tour, et établir un rapport sur le développement ou non de ces capacités de perception extra-sensorielle si désirées. Mais, pour les habitants de la Tour, Dixit est nécessairement un « espion »… et ils comptent bien lui faire entendre qu’ils sont maîtres de leur destin, et qu’ils aiment leur monde si particulier.
Si le texte de Brian Aldiss ne brille guère par la forme, et si l’on peut trouver quelque peu superflu ce prétexte science-fictif daté sur la perception extra-sensorielle, il n’en est pas moins intéressant à bien des égards. La Tour, sorte d’arche stellaire immobile (et là on pense tout naturellement à Croisière sans escale), est un « environnement total » propice à bien des réflexions. D’une part, il y a bien évidemment l’inhumanité du procédé, de cette expérience sociologique en grandeur-nature, dans un cadre qui nous paraît tout naturellement infernal, témoignant non seulement de la thématique obsédante de la surpopulation, mais aussi des pires cauchemars dystopiques à la 1984, sur le contrôle de la population et sa surveillance par une entité extérieure mal définie. De quoi susciter une indignation bien légitime.
Mais le propos de Brian Aldiss se révèle en définitive plus subtil. D’autre part, en effet – et l’on s’éloigne ici clairement de l’atmosphère de guerre ouverte d’I.G.H. –, domine l’idée, chez les habitants de la Tour, que ce monde, aussi horrible puisse-t-il paraître vu de l’extérieur, est leur monde, et mérite en tant que tel, avec ses « défauts », d’être protégé contre toute incursion malvenue du CERGAFD. Aussi, et dans la mesure où la novella se situe en Inde, est-on amené à questionner l’hypocrisie de l’occidental bon teint (façon de parler), entre voyeurisme instrumentalisant et charité mal placée ; de la difficulté de faire le bonheur des autres malgré eux, de l’inanité d’un humanitarisme à bonne conscience qui néglige les besoins réels et les envies des populations concernées pour imposer sa vision incontestable de ce qui est juste et bon…
Pas mal du tout, donc, cette Tour des damnés. C’est un peu cher (8 €, tout de même), mais, pour une lecture vite expédiée, ça n’en est pas moins extrêmement riche et pertinent. La novella de Brian Aldiss est en effet bien plus subtile que ce que l’on pourrait croire à s’en tenir à son postulat ; témoignage d’une science-fiction idéale, à maints égards, qui savait, sur un format bref, sans tirer à la ligne, poser les questions les plus pertinentes et amener le lecteur à s’interroger sur son monde. Ce qui fait du bien, tout de même.
EDIT : Public chéri, Gérard Abdaloff en parle ici.

/image%2F1385856%2F20160114%2Fob_cfb8b0_caligari.jpg)











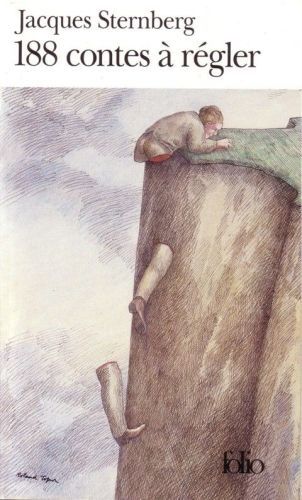





/image%2F1385856%2F20150204%2Fob_660a87_georges-abdaloff-croque-par-christell.jpg)