
Tout Desproges, [s.l.], Seuil, [1981, 1983, 1985, 1987-1988, 1990-1992, 1994-1995, 1998-1999, 2003-2004] 2008, 1449 + [24] p.
C’est horrible, mais on me signale que le jour de gloire est arrivé. Ayé, 20 ans. Hop. Et comme un con, je finis inconsciemment ce gros bouquin (bien évidemment publié tout récemment pour bénéficier de la commémoration) juste là, aujourd’hui, maintenant. Pas l’air con, moi… Et je fais quoi, maintenant ? Je repousse mon compte rendu miteux à demain ? Non, ça serait vraiment petit joueur...
Bien sûr, je pourrais faire dans la chronique-hommage de base, pleine de nostalgie bienveillante, de léchage de boules et d’inconséquence. Le genre de truc qui finirait probablement par un « Etonnant, non ? » de bon aloi. Je parie que je pourrais être aussi nul que le plus diplômé des journalistes. Chiche.
… Ou alors, dans la même lignée, je pourrais faire dans le coup de gueule vaguement réac’ (et, je plaide coupable, c’est pas forcément l’envie qui m’en manque) : dire, avec tout le monde, que rhalalala, on n’en a plus des Desproges et patati, et que l’on est tombé bien bas ma bonne dame et patata. Sans doute, si j’avais la télévision, et pour ce qu’on a pu m’en dire, un coup d’œil sur le Jamel Comedy Club aurait pu me justifier dans cette démarche. Je vais essayer, dans la mesure du possible, d’éviter ce travers (ce serait à vrai dire tomber dans un piège dressé par Desproges lui-même, à certains égards – voir plus bas). D’autant que la date, hein, on s’en bat les coucougnettes, non ? Bon, alors, s’il vous plait (non, non, ne pas employer ce genre de phrases ! trop tard).
Cela dit, dans le concert ambiant de « Vive Desproges », je me permettrais de glisser néanmoins deux petites remarques :
1° Même s’il est peu probable qu’au jour d’aujourd’hui l’on ose clairement l’afficher, le fait est que, non, l’humour de Desproges n’est pas apprécié de tout le monde. Qu’aujourd’hui encore, il s’en trouve beaucoup pour le mépriser, derrière les sourires de façade et les rires gênés. Et je ne parle pas ici des cons habituels téléphages et galaphiles, hein. Non, non : des gens de mon entourage, de mon milieu (aaaargh). Tenez, mes parents n’en démordront pas, par exemple : « … Oui, mais, Desproges, il était vulgaire, quand même… » Ils ne sont pas très fans de son obsession pour la mort, aussi, mais ça doit être l’âge… (heu…) Vite (très vite), un autre exemple, plus édifiant encore, ce jeune homme avec qui je discutais lors d’une soirée légèrement alcoolisée, il y a de cela quelques mois ; un jeune homme sympathique, hein, en dépit de son adhésion aux MJS ; à un moment, pour je ne sais quelle raison, je lui fais part de mon adoration pour Desproges. Le sourire de mon interlocuteur se crispe. La consternation lui fige les yeux. Après un silence gêné, il me dit enfin, avec un embarras visible : « … Oui, mais, Desproges… il était de droite… » Et le sympathique jeune militant socialiste de s’éloigner, coupant court à tout débat. Ben honnêtement, je trouve ça bien, moi, qu’il arrive encore à susciter ce genre de rejet. Dans un sens, pour le coup, peut-être Desproges n’est-il pas tout à fait mort. Et pourtant, non… En effet :
2° Les morts, ça rapporte. Cette réédition en témoigne assez (voyez d’ailleurs les dates de parution des « originaux » compilés dans ce volumineux Omnibus). Je serais bien hypocrite de m’en plaindre : je l’ai acheté, ce gros volume, je l’ai lu, et je me suis régalé. Eh, c’est Desproges, merde, quoi… Cela dit, certaines manipulations nécrophiles me chatouillent tout de même un tantinet le sphincter. Par exemple, sur le très dispensable DVD gracieusement offert avec ce gros bouquin, les reprises de textes de Desproges par divers comédiens qui, sous couvert d’hommage, tendent à vouloir s’approprier son talent… et se foirent méchamment. Prenez André Dussolier, par exemple ; en temps normal, il fait partie des rares acteurs français que je trouve corrects. Mais le voir « interpréter » mollement « L’aquaphile » les yeux rivés sur le prompteur, ça casse un mythe, tout de même. Et pareil pour tous les autres, plus ou moins respectables, multipliant les interprétations fades et chiantes de certains des plus beaux textes de Desproges sur une scène arty à fond noir, avec dispositif scénique minimaliste-pédant, devant une assistance coincée du rectum qui semble considérer comme un blasphème que l’on puisse souiller d’un rire nécessairement vulgaire l’élégante prose du Maître (sauf une fois où il était humainement impossible de résister). Misère… Pire encore : la parution d’un Desproges est vivant ! tout en hommages stéréotypés et mesquins, en tirage de couverture à soi, en « Pierre c’était mon pote aha » (un peu comme la sinistre préface du ridicule Renaud « Société tu m’auras pas aha » Séchan aux dispensables – j’y reviendrai – Fonds de tiroir, pp. 629-632 ; il s’en moque, mais fait exactement la même chose, le bougre). Ben moi, Desproges, je ne le connaissais pas ; d’ailleurs, il est mort en gros à l’âge où j’apprenais à lire, alors bon… Mais tout de même : Desproges est vivant ? Ben non, justement. Il est mort, et bien mort. Et ce ne sont sûrement pas ces vautours qui vont le ressusciter. Ca me rappelle un peu – justement – l’excellent et haineux réquisitoire contre Roger Coggio (pp. 1147-1150)…
Bon, mieux vaut parler du bouquin. Tout Desproges, donc. Enfin, presque tout. Disons presque tout ce qui a été publié au Seuil. C’est-à-dire pas mal de choses quand même, et que du bon, ou presque. Cela dit, ce n’est pas exactement, donc, une édition des œuvres complètes à la Pléiade. Et, sous cet angle, je me permettrais de faire part d’un petit regret personnel : j’ai trouvé dommage que ce gros ouvrage n’ait pas été soumis à un véritable travail éditorial ; ces textes, pour bon nombre d’entre eux, datent un tantinet, ils font souvent allusion à des personnalités et des événements largement tombés dans l’oubli. Or le lecteur ne se voit pas fournir la moindre explication à cet égard, si l’on excepte, dans les Réquisitoires du Tribunal des flagrants délires, une note sur « l’affaire Langlois » (pp. 1307-1308), et, à la fin de chaque réquisitoire, quelques mots sur le prévenu… qui ne sont semble-t-il pas de Desproges, mais dont l’auteur n’est pas précisé. De même, le nom de l’interviewer de Desproges dans La seule certitude que j’ai, c’est d’être dans le doute n’apparaît nulle part ! C’est embêtant. Enfin, pour les fanatiques, quelques précisions concernant la date de composition des textes auraient pu s’avérer utiles (les différents recueils sont présentés dans l’ordre de leur parution, sans autre précision, sauf la date des émissions, le cas échéant)… Bon, on va peut-être trouver que je chipote, que je suis ridicule, ce que vous voudrez ; mais il me semble qu’un minimum de travail dans cette direction aurait rendu cette somme plus intéressante encore.
Cela dit, intéressante, elle l’est déjà. Pas, bien entendu, pour l’admirateur authentique qui a depuis longtemps déjà l’intégrale de Desproges, puisqu’il n’y a ici rien de nouveau. Mais ce n’était pas mon cas : j’avais pu feuilleter chez des gens bien le Manuel de savoir-vivre à l’usage des rustres et des malpolis ainsi que le Dictionnaire superflu à l’usage de l’élite et des biens nantis, j’ai les enregistrements de Desproges en scène, des Chroniques de la haine ordinaire et des Réquisitoires du Tribunal des flagrants délires, j’ai vu pas mal d’épisodes de La minute nécessaire de Monsieur Cyclopède, mais, pour ce qui est des bouquins, je n’avais en tout et pour tout que le bref entretien sus-nommé… Alors j’ai craqué. Et j’ai achetu, j’ai lu, j’ai rus.
Détaillons vite fait. On commence très bien avec le Manuel de savoir-vivre à l’usage des rustres et des malpolis (pp. 7-97), et l’on poursuit immédiatement avec l’encore meilleur (à mon sens du moins) Vivons heureux en attendant la mort (pp. 99-255). Du très grand Desproges, en concentré (plusieurs de ces textes, d’ailleurs, apparaissent dans les Chroniques de la haine ordinaire, les Textes de scène, et plus encore Les réquisitoires du Tribunal des flagrants délires ; je suppose qu’ils ont d’abord été écrits pour la radio, puis repris sous cette forme littéraire, mais je ne saurais l’affirmer pour autant, faute d’indications…). On y trouve tout ce qui fait le talent du clown : un style unique, où la préciosité la plus maladive dérape au tournant d’une ligne pour tomber dans le jeu de mots le plus scandaleux ; un talent rare pour faire rire avec la mort, avec la guerre, avec les militaires, avec les handicapés, avec les Juifs… Pour rire de tout (mais pas avec tout le monde, of course). Que du bonheur : de très belles pages, cinglantes, hilarantes, parfois touchantes, toujours excessives ; tout l’art du (faux) partage en (vraie) couille, celui qui a fait les plus grands sketches de Desproges.
Le Dictionnaire superflu à l’usage de l’élite et des biens nantis (pp. 257-321), en dépit de son titre à rallonge pédantesque qui ne manque pas de faire penser au Manuel de savoir-vivre à l’usage des rustres et des malpolis, est une œuvre radicalement différente. Un jubilatoire foutage de gueule totalement assumé (le plus petit dictionnaire du monde, avec un mot choisi de manière totalement arbitraire pour chaque lettre, d’abord pour les noms communs, ensuite pour les noms propres), qui joue cette fois avant tout la carte de l’humour absurde (pour ne pas dire « l’humour anglais » ; à en croire Les étrangers sont nuls et La seule certitude que j’ai, c’est d’être dans le doute, l’auteur, qui se vantait d’être la plus remarquable incarnation de « l’humour limousin », ne raffolait guère de ce genre de désignations...). Pour le coup, c’est beaucoup moins outrancier et directement drôle que ce qui précède (et que la plupart de ce qui va suivre), mais ça reste parfaitement réjouissant (j’avoue une tendresse particulière pour les noms propres…).
Suit une curiosité (enfin, en ce qui me concerne) : Des femmes qui tombent (pp. 323-417) est en effet un court roman de Pierre Desproges. Je savions même pô que ça existions, moué… Et c’est bien ? Ben faut voir. Le tout est rédigé à la manière des premiers recueils évoqués et des Chroniques de la haine ordinaire : du coup, c’est bien évidemment drôle, cinglant, parfois émouvant... On avouera cependant que le style si particulier de Desproges, avec ses dérapages plus ou moins contrôlés et sa préciosité-prout, n’est pas vraiment approprié au roman. Ceci dit, il se lit très bien, ce petit polar champêtre cynique au possible. Mais ce qui m’a le plus marqué dans tout ça, c’est… bordel… j’ose à peine le dire tellement c’est énorme… c’est que Desproges se montre semble-t-il très désireux de me gâter tout particulièrement, puisqu’il vient étrangement mettre des vrais morceaux de SF dans son roman ! Bon, j’exagère un peu, peut-être… Mais la rencontre de l’extraterrestre bouffeur de pneus m’a néanmoins fait comme un choc. Et plus encore, à vrai dire, la résolution du mystère de ces Femmes qui tombent, que l’on comprend très vite… d’autant que je n’ai pu m’empêcher d’y reconnaître (les yeux exorbités) l’excellente nouvelle de Claude Ecken « Le Propagateur », dans le gros Bifrost n° 42 ; évidemment, le ton est très différent, mais ça m’a fait drôle, tout de même : pure coïncidence ? hommage-que-j’étais-passé-à-côté-comme-un-con ? inspiration plus ou moins consciente ? J’en sais rien ; c’est pas grave, de toute façon. Passons.
A quoi ? Au premier recueil des Chroniques de la haine ordinaire (pp. 419-534). Une des grandes émissions radiophoniques de Desproges, avec son ton très particulier. On ne rit pas toujours, à vrai dire ; ce n’est pas toujours le but… Mais c’est sacrément beau, et sacrément bon, le plus souvent. Quelques superbes pages : « Les restaurants du foie » (pp. 424-425), le fantabuleusement haineux « Criticon » (pp. 433-435), « La démocratie » (pp. 442-444), le réjouissant, fielleux et tout personnel « Au voleur » (pp. 450-451), l’inoubliable « Le fil rouge » (pp. 457-458), le (sincèrement) très émouvant « Misères » (pp. 459-461), l’indispensable « Non aux jeunes » (pp. 475-477), « L’aquaphile » (pp. 478-479), bien sûr, le (à nouveau très sincèrement) très émouvant « Les sept erreurs » (pp. 486-488), le plus que jamais d’actualité « A mort le foot » (pp. 518-520), et, pour finir en beauté, les deux épisodes des « Aventures du mois de juin » (pp. 528-534). Tout d’même, hein…
Ensuite, les Textes de scène (pp. 535-623). Si le premier spectacle contient quelques très bons moments (notamment « Que choisir ? », pp. 544-547, « Haute coiffure », pp. 564-565, et, bien sûr, le « Résumé du spectacle », pp. 568-569), j’avoue cependant ne pas le considérer comme un sommet de Desproges. On le sent un peu hésitant, dans cette première confrontation au one man show ; pas très exubérant, pas très joueur, finalement drôle, oui, mais sans plus, en-dehors de quelques fulgurances… Le deuxième spectacle, par contre, est un festival, un concentrée de génie ! On y sent Desproges bien plus à l’aise ; il tente moins de construire un spectacle entièrement cohérent, à la différence du premier, et peut enchaîner sur des sketches très différents. Mais quels sketches ! Inutile de citer, tout y est excellent. Ah si, juste un ; répétons-le, mes frères, répétons-le : « On me dit que des Juifs se sont glissés dans la salle ? » (pp. 590-592) est un monument, un chef-d’œuvre, un sommet inaccessible, un sketch salutaire, outrancier, terriblement drôle, tout simplement parfait. N’oublions jamais. Cerise sur le gâteau (enfin, dans un sens), on trouvera également en fin de volume quelques textes écrits pour un troisième spectacle annulé pour cause de décès, qui sont pas dégueux, ma foi.
On passe aux Fonds de tiroir (pp. 627-712). Le titre a été choisi par le social-traître Séchan pour rigoler. Effectivement, ce ne sont pas des fonds de tiroir ; dans un sens, c’est pire : plus des trois-quarts des textes figurant dans ce recueil apparaissent dans d’autres ouvrages également repris par cet Omnibus. Passons vite là-dessus.
On y préférera bien davantage Les étrangers sont nuls (pp. 713-774), recueil saturé de préjugés, d’un faux racisme jubilatoire ; cela dit, là encore, quelques textes ont été repris dans d’autres sketches ou chroniques, mais il serait dommage de passer à côté des quelques merveilles que l’on ne retrouve nulle part ailleurs.
Suit La minute nécessaire de Monsieur Cyclopède (pp. 775-863). A la télévision, c’était grandiose ; un sommet d’humour absurde et irrévérencieux comme on n’osait guère en imaginer en France (oui, en France ; des années plus tôt, la perfide Albion avait déjà les Monty Python…). Hélas, à l’écrit, ça ne passe pas vraiment…
Après un petit cahier de photos émaillé de citations, on enchaîne avec La seule certitude que j’ai, c’est d’être dans le doute (pp. 865-900), bref entretien avec l’auteur. Un peu frustrant, finalement ; Desproges s’y montre passablement réservé, il ne parle que peu de lui ou de son travail ; quelques pages intéressantes, ceci dit, sur les Restos du Cœur, sur les cochons… C’est vite lu.
Après quoi, Le petit reporter (pp. 901-1048) est un recueil de brèves publiées par Desproges dans L’Aurore, avant d’être récupéré par Jacques Martin pour Le petit rapporteur qui le fera véritablement connaître. Sûr, dans ce journal très à droite, l’humour déviant de Desproges devait sacrément faire tâche. Mais, pour être honnête, en-dehors de quelques méchancetés anti-MLF parfaitement réjouissantes, c’est du journalisme à l’ancienne, de « l’humour à la papa », tout en calembours subtils et contrepèteries dissimulées ; là, il faut bien le dire, à mon sens, ça a vieilli…
Mais ne désespérons pas. On passe ensuite à un gros morceau, et à ce qui constitue à mon sens (avec le deuxième spectacle) le sommet de la carrière de Desproges : Les réquisitoires du Tribunal des flagrants délires (pp. 1048-1308). Peu importe que la plupart des prévenus soient sombrés dans l’oubli (on notera d’ailleurs que, plus d’une fois, le procureur Desproges se montre très prophétique à cet égard...) : les textes, eux, restent. Et puis, honnêtement, en maintes occasions, Desproges balance tout de go qu’il en a rien à cirer du prévenu, et part dans des délires tous plus hilarants les uns que les autres, mais qui n'ont strictement rien à voir avec l'accusé… Mais il sait aussi à l’occasion se montrer sérieux, charmeur… ou d’un courroux (coucou… désolé) terrifiant : ses réquisitoires tapent méchamment, le cas échéant, et Desproges sait profiter de sa stature comme de son talent pour mettre à mal les cons avec une audace salutaire. Et il y en a, des merveilles, dans ces réquisitoires : Robert Lamoureux et l’armée (pp. 1065-1068), Frédéric Mitterrand et, heu, son oncle ? (pp. 1002-1105), Daniel Cohn-Bendit (pp. 1114-1117 ; l’est d’actualité, celui-là, pour la prochaine commémoration émétique qui va nous être infligée par les anciens pseudo-combattants grabataires réfugiés à l’UMP), Jean d’Ormesson et l’Acacadémie françouèse (pp. 1118-1121), Jean-Marie Le Pen, bien sûr (pp. 1134-1138), Roger Coggio, déjà évoqué (pp. 1147-1150 ; peut-être le plus haineux des réquisitoires…), François de Closets et les chats nantais (pp. 1151-1154), Gisèle Halimi et les femmes (pp. 1167-1170 ; sans surprise, un de mes chouchous…), Jacques Séguéla et, heu, l’hypocrisie ? (pp. 1176-1179 ; adroit et juste dans la perfidie), Patrick Poivre d’Arvor, le romantisme leucémique et l’observation des papillon (pp. 1189-1192 ; indispensable !), Dorothée (pp. 1223-1226 ; la plus belle déclaration d’amour de toute l’histoire des déclarations d’amour), René Barjavel et les vieux (pp. 1248-1251), Siné et la connerie des fafs de gauche (pp. 1256-1259 ; ici, je cite la notice anonyme, p. 1259, de ce réquisitoire particulièrement fielleux : « Ce dessinateur haineux, raciste et borné a foutu des boutons de rage à plusieurs générations de bien-pensants. Qu’il en soit remercié ici et qu’il crève. » Pas mieux.), Claire Bretécher (pp. 1268-1272 ; pour moi la plus belle réussite dans le célèbre cycle des explications radiophoniques du Kama Sutra), Alain Ayache (pp. 1273-1276 ; maintenant que j’y pense, Desproges lui tape dessus au moins aussi fort que sur Coggio et Siné, et judicieusement, en plus…), Gilbert Trigano (pp. 1290-1293 ; avec le jeu de mots le plus génialement capillotracté de toute l’histoire des jeux de mots capillotractés), François Romério, la peine de mort et l’autodéfense (pp. 1298-1301 ; Plaf !)… Je n’ai cité que mes préférés, je vous le jure. Rhaaaaa. C’est grandiose.
Allez, il est temps de finir. Et avec du bon, une fois de plus : Chroniques de la haine ordinaire II (pp. 1309-1449). Voir plus haut, hein… Quelques titres marquants ? Vraiment ? Bon, d’accord, mais c’est bien parce que c’est vous : le plus que jamais indispensable « Gros mots » (pp. 1322-1324), l’inévitable « Pangolin » (pp. 1341-1343 ; version intégrale, bien sûr, pas la version bêtement et absurdement tronquée figurant dans les Fonds de tiroir…), le plaidoyer « Cancer » (pp. 1352-1354), le réjouissant « Les non-handicapés » (pp. 1378-1380), « Petit rigolo » (pp. 1389-1392), « Lettre ouverte aux cuistres » (pp. 1408-1410), ou encore, pour finir sur une note patriotique, « La Marseillaise » (pp. 1447-1449)…
Ca fait du bien, des fois, quand même, ma bonne dame. Oh là oui. Le meilleur hommage que l’on puisse rendre à Desproges est encore probablement de lire ses livres, de regarder et d’écouter ses sketches. Le reste, hein… Mais je maintiens une chose, en tout cas. Oui, il est mort. Quelque part, c’est embêtant. En même temps, qui sait, il aurait peut-être fini par devenir aussi nul que ceux qui vont lui rendre hommage, hein… Mais non, ça va. Il est toujours mort. Ouf.
…
J’ai failli conclure par « Etonnant, non ? », c’est horrible ! Mieux vaut travailler mon cancer, juste au cas où…

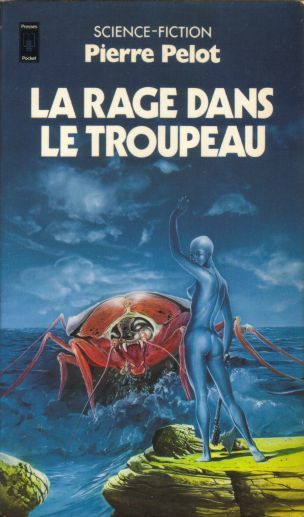

/image%2F1385856%2F20160114%2Fob_cfb8b0_caligari.jpg)







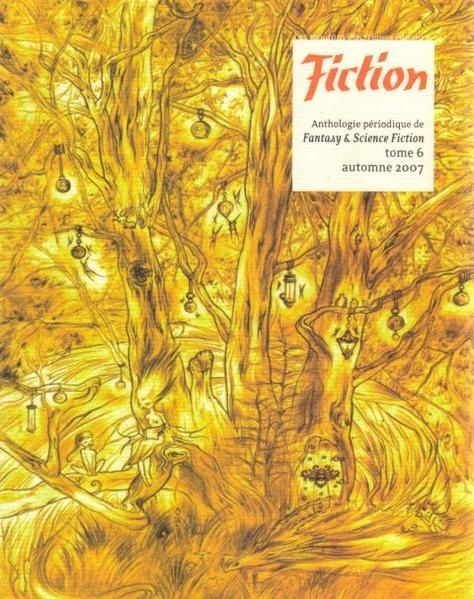
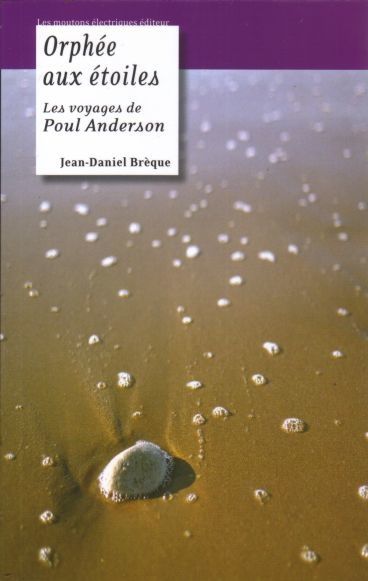









/image%2F1385856%2F20150204%2Fob_660a87_georges-abdaloff-croque-par-christell.jpg)