"Bibliothèque de l'Entre-Mondes", de Francis Berthelot

BERTHELOT (Francis), Bibliothèque de l’Entre-Mondes. Guide de lecture, les transfictions, [Paris], Gallimard, coll. Folio Science-fiction, 2005, 333 p.
Où l’on poursuit l’exploration de livres au contenu assez intéressant derrière une couverture sacrément moche (le coupable est cette fois Eric Scala ; on applaudit bien fort). Dans un genre un peu différent, cela dit, puisqu’il s’agit cette fois, non pas d’une œuvre de fiction, mais d’un essai ; et qui plus est d’un inédit, publié directement en poche chez Folio-SF (une fois n’est pas coutume ?).
Francis Berthelot poursuit depuis quelque temps déjà une double carrière, de chercheur et d’auteur : scientifique de formation, il s’intéresse néanmoins également à la narratologie, qu’il enseigne ; mais il est aussi un auteur souvent récompensé (et que je n’ai jamais lu, bien sûr…), dont la carrière, depuis notamment l’expérience du groupe Limite dont il était un des membres éminents, se situe sur une zone un peu floue à la frontière entre littératures de l’imaginaire (disons SF et fantastique) et littérature générale.
Et c’est de cette zone frontière qu’il entend nous parler avec sa Bibliothèque de l’Entre-Mondes. Francis Berthelot prétend en effet pouvoir déterminer, non pas un nouveau genre, ce qui serait en soi contradictoire, mais au moins un corpus d’œuvres finalement assez proches mais résistant à la classification. Ce que les Américains appellent semble-t-il slipstream, et que l’auteur désigne pour sa part sous le nom de « transfictions » (en abrégé pour « fictions transgressives »), expression qui, depuis, a fait son petit chemin. Entreprise un peu folle visant à classer l’inclassable ; pourtant, on est indéniablement tenté d’établir des liens entre certains ouvrages étranges, rapprochés par leur hétérodoxie : que l’on pense par exemple à l’excellente collection « Interstices » chez Calmann-Lévy… Cette Bibliothèque de l’Entre-Mondes se veut donc un guide de lecture de cette « littérature interstitielle ». Elle se découpe en trois parties : la première (pp. 19-59), purement théorique, vise à définir ces transfictions ; la deuxième (pp. 60-133) inscrit la problématique des transfictions dans un cadre historique et géographique ; la troisième et la plus longue, enfin (pp. 134-312), constitue le guide de lecture à proprement parler, une sélection (passablement arbitraire, inévitablement) de cent fictions transgressives, en provenance du monde entier.
Sur la notion de transfictions, le mieux est sans doute de laisser Francis Berthelot s’expliquer lui-même : bref, lisez le livre ; ou, du moins, écoutez-le nous en parler, par exemple ici, mais surtout, surtout, là. Quelques mots néanmoins : les transfictions telles que les entend Francis Berthelot sont donc des fictions transgressives, entendons par-là que, d’une manière ou d’une autre, elles outrepassent les habitudes de la littérature générale traditionnelle et les codes de la littérature de genre, ce qui tend à les en exclure, ou du moins à leur conférer une certaine spécificité. Francis Berthelot distingue ici deux modes de transgression, dont l’un s’applique plus particulièrement aux œuvres de littérature générale, à savoir la transgression de l’ordre du monde (manipulation du temps, des lois scientifiques, des mythes, etc.), et l’autre plus particulièrement aux œuvres de genre, et qui est la transgression des lois du récit (même si les manipulations de l’écriture peuvent également se retrouver, au-delà des codes propres aux genres, de l’autre côté de la frontière, bien entendu). L’auteur développe ces différentes thématiques, qui l’aident ainsi à établir son corpus.
Je dois avouer, cependant, n’avoir pas été vraiment convaincu par cette méthode, parfois assez arbitraire ; si l’on prend la transgression de l’ordre du monde, ainsi, j’aurais envie de dire que, la plupart du temps, la frontière est d’ores et déjà franchie, soit du côté de la science-fiction, soit du côté du fantastique et de la fantasy. Le classement de certaines œuvres, ainsi, peut sembler déroutant : j’avoue ne pas voir vraiment en quoi Cristal qui songe de Theodore Sturgeon serait une fiction transgressive (la frontière franchie serait plutôt celle, parfois très floue, entre science-fiction et fantastique) ; idem pour Le maître du haut château de Philip K. Dick, etc. Ce sont des œuvres qui se classent volontiers, à la différence, par exemple, du Procès de Kafka, du Festin nu de Burroughs, du Petit Prince de Saint-Exupéry ou encore, pour citer une œuvre non évoquée dans ce corpus, mais qui me semblerait y avoir bien davantage sa place qu’un certain nombre d’autres (mais elle n’était pas encore traduite, certes), « le Quatuor de Jérusalem » d’Edward Whittemore. Autant d’œuvres qui me fascinent, mais résistent à toute classification ; et les critères proposés par Francis Berthelot ne me paraissent pas plus convaincants à cet égard.
J’ajouterais, d’ailleurs, que la subjectivité de l’auteur vient régulièrement parasiter son analyse… et l’affaiblir. Qu’il parle à plusieurs reprises de son œuvre personnelle est bien légitime (qu’il le fasse à la troisième personne est par contre plus risible ; et qu’il s’approprie certaines nouvelles de l’anthologie du groupe Limite va un peu à l’encontre des principes posés par le groupe…) ; mais certaines de ses exclusions, certains de ses jugements à l’emporte-pièce, sont plus agaçants : ainsi son mépris affiché pour Houellebecq (entrevu également ici), qui me semblerait bien pourtant, surtout pour La possibilité d’une île, mais aussi pour Les particules élémentaires, et dans une moindre mesure Extension du domaine de la lutte et Lanzarote (voire, mais c’est sans doute pousser le bouchon un peu loin, son H.P. Lovecraft), parfaitement représentatif de cette littérature transfictionnelle que l’auteur cherche à dégager… Dans la même lignée, on regrettera de même quelques analyses hautement contestables (ainsi la lecture « politique » du Procès de Kafka, anachronisme flagrant, mais que l’on nous ressort régulièrement…).
Je ne suis donc guère convaincu par la méthode de Francis Berthelot, ni, à vrai dire, par ses objectifs : à quoi bon classer l’inclassable ? L’auteur prétend ouvrir des portes entre des zones littéraires de plus en plus refermées sur elles-mêmes. Mais est-ce bien le cas ? Certes, la science-fiction (et ne parlons même pas de la fantasy) n’a toujours pas bonne presse ; pourtant, elle marque de son empreinte notre quotidien, et de plus en plus nombreux, me semble-t-il, sont les écrivains qui, quel que soit leur « milieu » d’origine, n’hésitent pas à tendre un salutaire majeur à la critique établie, et à passer du mainstream à l’imaginaire d’une œuvre à l’autre (enfin, en même temps, tous ne le reconnaissent pas aussi volontiers...). Et au final, la sélection pour le moins « exigeante » (pour ne pas dire savante ou élitiste, voyez ici) du guide de lecture m’a conduit à me demander si la distinction la plus efficiente, finalement, et la plus transfictionnelle à certains égards puisque ne se posant même pas la question des genres mais la transcendant, ne se superposerait pas, tout simplement, à l’opposition traditionnelle entre l’avant-garde et le classicisme…
Je ne m’étendrai pas ici sur la deuxième partie, certes instructive, mais assez peu édifiante à mon sens (une exception peut-être : l’Amérique du Sud, avec la patte de Borges, notamment). Passons directement au guide de lecture, et à ce rassurant constat : quand bien même la démonstration de Francis Berthelot ne m’a pas convaincu, je ne peux que reconnaître mon intérêt pour la plupart des œuvres sélectionnées ici… sans savoir pour autant ce qui peut les rassembler, au-delà de leur audace et de leur hétérodoxie. Alors je peux bien citer ici quelques titres façon catalogue à mon tour, pour vous donner une idée, et aussi façon « 3615 Mavie », puisque nous sommes sur mon blog (miteux), et que je fais TOUT QUE C’QUE J’VEUX, d’abord.
Il y a ceux que j’avais déjà lus : Le Passe-Muraille de Marcel Aymé (pp. 143-145 ; mais c’était il y a si longtemps que j’ai bien envie de le relire…), Crash! de James Graham Ballard (pp. 145-147), Fahrenheit 451 de Ray Bradbury (pp. 167-169 ; son caractère transfictionnel me laisse un peu perplexe…), L’Orange mécanique d’Anthony Burgess (pp. 171-172 ; la transgression y repose surtout à mon sens sur le langage), Le Festin nu de William Burroughs (pp. 173-174 ; là, oui, OK, y’a pas photo !), Le K de Dino Buzzati (pp. 174-176 ; là encore, ça date, et il faut que je le relise…), Substance mort de Philip K. Dick (pp. 198-199 ; admettons, même si j’aurais davantage cité Siva, La transmigration de Thimothy Archer, voire, pour l’écriture et la déconstruction du récit, Glissement de temps sur Mars), Le Procès de Franz Kafka (pp. 234-236 ; mais arrêtez avec la lecture anti-totalitaire de ce chef-d’œuvre, mazette !), Des fleurs pour Algernon de Daniel Keyes (pp. 238-240 ; surtout pour l’écriture, à nouveau), Démons et merveilles d’Howard Philips Lovecraft (pp. 247-249 ; pour moi clairement de la fantasy, le caractère transfictionnel me laisse à nouveau très perplexe…), La ferme des animaux de George Orwell (pp. 258-260 ; admettons, mais dans ce cas-là, toutes les fables ne deviendraient-elles pas des transfictions ?), Le Petit Prince d’Antoine de Saint-Exupéry (pp. 281-282 ; OK ; de toute façon à lire et à relire), et enfin Cristal qui songe de Theodore Sturgeon (pp. 291-292 ; ben pourquoi ?).
Il y a ceux que je comptais déjà lire, soit qu’ils aient d’ores et déjà intégré ma pile à lire (L’Aleph de Jorge Luis Borges, pp. 162-164 ; L’Oreille interne de Robert Silverberg, pp. 287-289 ; Le Berceau du chat de Kurt Vonnegut, pp. 303-304), soit qu’ils étaient supposés le faire depuis un petit moment déjà : Le Grand Meaulnes d’Alain-Fournier (pp. 136-138) ; Le Livre des illusions de Paul Auster (pp. 141-143) ; L’invention de Morel d’Adolfo Bioy Casares (pp. 157-158) ; Contes d’hiver de Karen Blixen (pp. 158-160) ; La Maison des feuilles de Mark Danielewski (pp. 194-196) ; Des milliards de tapis de cheveux d’Andreas Eschbach (pp. 203-205 ; malgré la déception de Jésus Vidéo...) ; Au château d’Argol de Julien Gracq (pp. 217-218) ; Nuage d’Emmanuel Jouanne (pp. 225-227) ; Carrie de Stephen King (pp. 240-242 ; je suis re-perplexe...) ; Malgré le monde, l’anthologie de Limite (pp. 246-247) ; La Nuit de Walpurgis de Gustav Meyrink (pp. 249-251) ; Mother London de Michael Moorcock (pp. 251-253) ; La course au mouton sauvage de Haruki Murakami (pp. 253-254) ; Fight Club de Chuck Palahniuk (pp. 262-263) ; Le Prestige de Chistopher Priest (pp. 274-275) ; Vente à la criée du lot 49 de Thomas Pynchon (pp. 276-277).
Et il y a, enfin, ceux que je ne connaissais pas ou qui ne me tentaient pas plus que ça et pour lesquels Francis Berthelot m’a sacrément donné l’eau à la bouche ou a achevé de me convaincre : La femme des sables d’Abé Kôbô (pp. 135-136) ; La flèche du temps de Martin Amis (pp. 138-140) ; ENtreFER de Iain Banks (pp. 147-148) ; Une soirée à la plage de Jacques Barbéri (pp. 149-150) ; Molloy de Samuel Beckett (pp. 152-154) ; L’Atlantide de Pierre Benoit (pp. 154-155) ; Cœur de chien de Mikhaïl Boulgakov (pp. 166-167) ; Si par une nuit d’hiver un voyageur d’Italo Calvino (pp. 176-179 ; il me le faut, là, tout de suite !) ; La moustache d’Emmanuel Carrère (pp. 179-180) ; Le Démon à la crécelle de Georges Olivier Châteaureynaud (pp. 184-185) ; Or not to be de Fabrice Colin (pp. 186-187) ; Façons de perdre de Julio Cortázar (pp. 187-189) ; Sur les ailes du chant de Thomas Disch (pp. 200-201) ; Les nuits blanches du Chat botté de Jean-Christophe Duchon-Doris (pp. 201-203) ; Je suis le gardien du phare d’Eric Faye (pp. 206-208) ; L’automne du patriarche de Gabriel García Márquez (pp. 210-211) ; Ferdydurke de Witold Gombrowicz (pp. 215-217) ; Lanark d’Alasdair Gray (pp. 219-220) ; L’univers de Hubert Haddad (pp. 220-222) ; Sur les falaises de marbre d’Ernst Jünger (pp. 231-232) ; Le palais des rêves d’Ismaïl Kadaré (pp. 232-234) ; Epépé de Ferenc Karinthy (pp. 236-238) ; Feu pâle de Vladimir Nabokov (pp. 255-257 ; il me le foooooooooo) ; Force ennemie de John-Antoine Nau (pp. 257-258 ; idem…) ; Le Fils du Dieu de l’Orage d’Arto Paasilinna (pp. 260-262) ; Le silence de l’espace de Tomaso Pincio (pp. 270-272) ; Graal Flibuste de Robert Pinget (pp. 272-274) ; La caverne des idées de José Carlos Somoza (pp. 289-290 ; malgré la déception causée par La théorie des cordes…)…
Ca fait beaucoup. Allez, au boulot. Et rien que pour ça, même si je suis assez sceptique pour ce qui est du fond, merci monsieur Francis Berthelot.

/image%2F1385856%2F20160114%2Fob_cfb8b0_caligari.jpg)



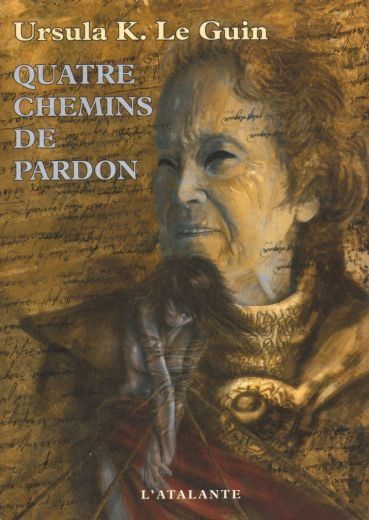

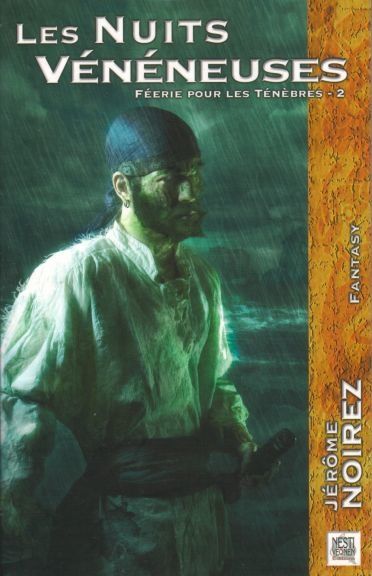

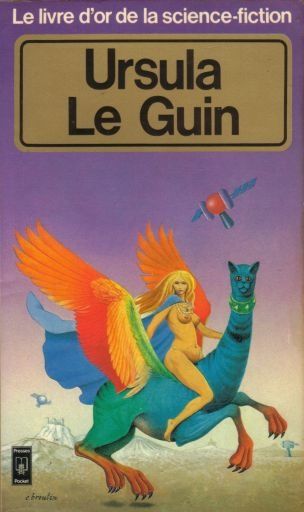









/image%2F1385856%2F20150204%2Fob_660a87_georges-abdaloff-croque-par-christell.jpg)