"Le Marais aux sorcières", de Paul Busson

BUSSON (Paul), Le Marais aux sorcières, suivi de « La Louve blanche » de Friedrich de la Motte Fouqué, édition critique établie par Michel Meurger, traduit de l’allemand par Elisabeth Willenz et Isabelle David, Cadillon, Le Visage vert, [1812, 1923-1924] 2009, 118 p. + [2] p. de pl.
Je m’étais promis, suite à la lecture de la dernière livraison du Visage vert, de jeter un œil aux ouvrages publiés dans la collection éponyme. Il faut dire que les deux dernières parutions m’intéressaient particulièrement… Je vous entretiendrai prochainement du Lamont d’Anne-Sylvie Salzman ; mais, dans l’immédiat, j’ai préféré commencer par ce Marais aux sorcières, qui me paraissait constituer un intéressant pendant au dossier consacré à la sorcellerie dans la littérature allemande du seizième numéro de la revue.
Ce bref ouvrage, émaillé de quelques illustrations, a de même été établi par Michel Meurger, et il s’agit d’un ouvrage composite. Sous ce titre générique de Marais aux sorcières se cachent en effet la nouvelle-titre de l’auteur autrichien Paul Busson, un extrait du roman Der Zauberring de Friedrich de la Motte Fouqué titré ici « La Louve blanche », puis, enfin, un long article de Michel Meurger intitulé « La Comtesse louve en ses paluds. Femmes fauves et marais fantastique en littérature ».
Commençons donc par la nouvelle de Paul Busson (1923 ; pp. 7-56). On ne révélera pas grand chose, eu égard au sommaire, en disant qu’il s’agit là d’une histoire de louve-garou… et plus si affinités. Dans la cabane d’un chasseur vieux comme Hérode, le narrateur, égaré dans ledit marais aux sorcières, entendra en effet parler de plusieurs êtres humains changés en bêtes… Un très beau texte, porté par un remarquable sens de l’atmosphère et une plume fluide et agréable. Le cadre pittoresque et envoûtant, la rivalité du chasseur et du braconnier, le fascinant portrait de la comtesse louve (nécessairement lubrique…), sont autant de bonnes raisons de lire cette excellente nouvelle. Je n’en dirai cependant pas davantage… sous peine de tomber dans la paraphrase de l’analyse de Michel Meurger – j’y reviendrai.
Pris indépendamment, « La Louve blanche », bref conte extrait du roman Der Zauberring de Friedrich de la Motte Fouqué (1812 ; pp. 57-66), me paraît d’un intérêt moindre : le style est assez lourd et le récit sans surprise. Sa place ici se justifie néanmoins parfaitement, en ce qu’il fournit un intéressant miroir au texte qui précède, et autorise l’étude de Michel Meurger qui conclut l’ouvrage en beauté.
« La Comtesse louve en ses paluds. Femmes fauves et marais fantastique en littérature » (pp. 69-118), long article abondamment annoté, constitue en effet l’autre point fort de ce décidément fort sympathique petit ouvrage. L’auteur y fait preuve de son érudition enthousiasmante habituelle, et analyse judicieusement les deux textes qui précèdent, tout en ouvrant des portes vers d’autres lectures intéressantes. J’en ai pour ma part essentiellement retenu l’évocation de l’auteur finnoise Aino Kallas, dont l’œuvre semble du plus grand intérêt.
En somme, voilà donc un petit volume tout ce qu’il y a de sympathique, bien digne du niveau d’excellence de la revue Le Visage vert. Assurément de quoi donner envie de poursuivre plus avant l’exploration du catalogue de ce nouvel éditeur. J’y reviendrai bientôt, cette fois avec quelque chose de contemporain, avec Lamont d’Anne-Sylvie Salzman.

/image%2F1385856%2F20160114%2Fob_cfb8b0_caligari.jpg)


















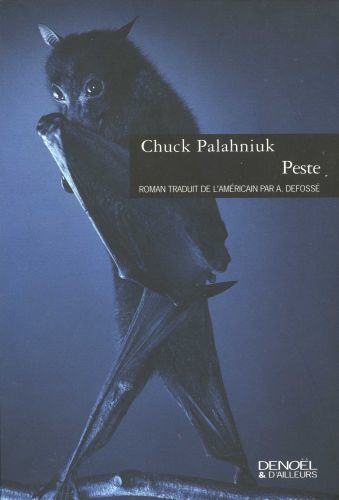
/image%2F1385856%2F20150204%2Fob_660a87_georges-abdaloff-croque-par-christell.jpg)