"Blanche Neige contre Merlin l'enchanteur", de Catherine Dufour

DUFOUR (Catherine), Blanche Neige contre Merlin l'enchanteur, Paris, Nestiveqnen – LGF, coll. Le Livre de poche Fantasy, [2003, 2007] 2009, 667 p.
« Quand les dieux buvaient », suite, après l'excellent Blanche Neige et les lance-missiles. Sous ce titre un peu tarte (et pas vraiment pertinent ; on sent bien la volonté d'accentuer la dimension « cyclique »...) de Blanche Neige contre Merlin l'enchanteur, on retrouve les tome 3 et 0 de la série, à savoir Merlin l'ange chanteur et L'Immortalité moins six minutes (un titre qui en pète quand même ach'ment plus). Ayant déjà dit tout le mal que je pensais de la « préquelle », je me limiterai ici au tome 3.
Adonc. Un roman qu'il n'est pas facile à résumer... Il se compose en gros de trois parties.
Dans la première, Catherine Dufour parodie essentiellement la matière de Bretagne. Merlin y est un ange (un archange, même), et comme il se doit un parfait salopard manipulateur. Face à lui, la Dame du Lac et compagnie, c'est le quatuor de fées que l'on avait déjà eu l'occasion de croiser auparavant, avec leurs noms si pittoresques et leurs manières si délicates.
La deuxième partie joue la carte du vampirisme, et consiste en gros en une longue dissertation sur l'évolution de la religion chrétienne, pardon, chrétine.
La troisième partie, enfin, verse dans la science-fiction, et, en rassemblant tous les personnages, prolonge l'excellent tome 2, L'Ivresse des providers.
Dans sa postface, intéressante annexe, Catherine Dufour explique que Merlin l'ange chanteur est probablement le livre dans lequel elle a mis le plus d'elle-même. Je veux bien le croire, mais, hélas, ça n'en fait pas une réussite pour autant... En effet, le roman souffre à mes yeux de plusieurs faiblesses.
La première, et la plus évidente, est son caractère hybride, pour ne pas dire bancal : cette construction en trois parties ne convainc guère, d'autant que les enchaînements se montrent assez brusques. Aussi Merlin l'ange chanteur est-il un roman pour le moins inégal.
Dans sa première partie, on retrouve tout ce qui faisait la réussite des autres volumes de la saga, et on se régale. Mais c'est hélas un peu moins vrai de la suite, plus grave, nettement moins drôle (voire pas du tout).
La deuxième partie illustre d'ailleurs une deuxième faiblesse, à mon sens : elle croule sous la documentation. Dans sa postface, toujours, l'auteur insiste sur le travail qu'a nécessité ce livre. Il se sent. Un peu trop... C'est souvent fort intéressant et assez pertinent, mais cela ne va pas sans générer à l'occasion un léger ennui...
Ennui qui devient plus prégnant à mesure que l'on avance dans le roman. Et ici, je ne peux qu'avouer ma déception devant la troisième partie, d'autant qu'elle m'a paru un peu expédiée... Elle n'est en tout cas pas à mon sens à la hauteur des fabuleuses idées que l'on y trouve, déjà exploitées ou préparées dans le décidément très bon L'Ivresse des providers...
Pour toutes ces raisons, Merlin l'ange chanteur est à mes yeux plutôt raté... Cela dit, tout est relatif : cela reste un roman de Catherine Dufour. Et donc ça se lit fort bien, la plume si savoureuse de l'auteur y étant pour beaucoup. Il n'en reste pas moins que ce roman m'a déçu, et est clairement à mon sens le moins intéressant des quatre. Et le très bon L'Immortalité moins six minutes, qui suit immédiatement, en témoigne pour le moins.
Petite déception, donc, mais qui ne m'empêche pas d'attendre un éventuel tome – 1 avec impatience.

/image%2F1385856%2F20160114%2Fob_cfb8b0_caligari.jpg)






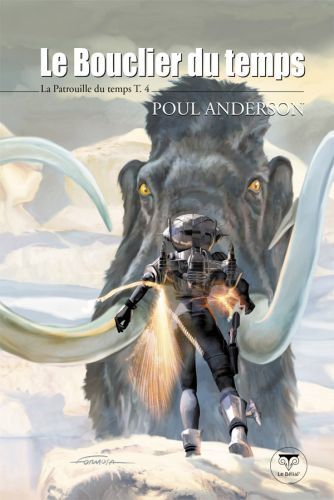

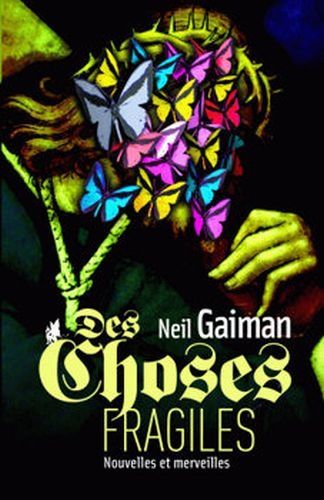







/image%2F1385856%2F20150204%2Fob_660a87_georges-abdaloff-croque-par-christell.jpg)