"Wilderness", de Lance Weller
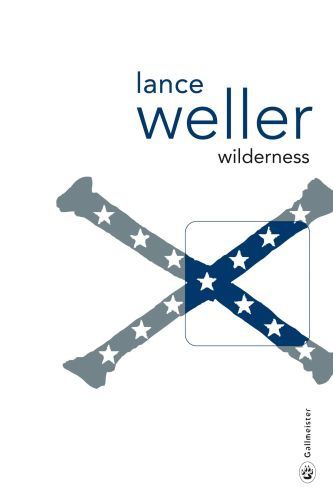
WELLER (Lance), Wilderness, [Wilderness], traduit de l’américain par François Happe, Paris, Gallmeister, coll. Totem, [2012-2013] 2014, 405 p.
On prend les mêmes et on recommence ? Après l’excellente surprise que fut Animaux solitaires, je reviens chez (les décidément très recommandables éditions) Gallmeister pour un autre premier roman qui se déroule (en partie seulement, certes, j’y reviens) tout au nord-ouest des États-Unis et qui, sans être tout à fait un western au sens strict, en conjugue néanmoins certains aspects en les mêlant au nature writing le plus délicat, pour un résultat particulièrement fort. Importance de la violence, là aussi, qui fait particulièrement mal... Mais là s’arrêtent cependant les ressemblances, et le roman de Lance Weller a sans doute quelque chose de plus émouvant, voire bouleversant, que celui, désespéré et brut, de Bruce Holbert. Toujours est-il que ce premier opus me faisait sacrément de l’œil (et cette fois, je me suis jeté dessus dès sa sortie sans qu’on ait besoin de me le mettre entre les mains)… Il était donc bien temps que je m’y mette. Et, autant le dire de suite, même si ça se devinait sans doute à la présentation succincte que je viens d’en faire, je n’ai pas été déçu.
Wilderness– le nom d’une forêt où a eu lieu une terrible (forcément) bataille de la guerre de Sécession, mais l’auteur joue sans doute aussi sur le sens de « sauvagerie » – apparaît vite comme un roman très ambitieux. Non content d’accorder une grande importance au style, irréprochable et qui saisit rapidement le lecteur, béat d’admiration devant la précision des descriptions naturalistes avant même de se prendre, de manière tout aussi remarquable, la violence des homme en pleine face, Lance Weller compose ici une odyssée temporelle sur la mémoire, faite d’annonces et de retours à la structuration parfaite (on a pu parler à bon droit de « roman initiatique à rebours »), et dessinant en outre une fable morale et, osons le vilain terme, philosophique qui développe avec brio et une parfaite cohésion plusieurs thématiques redoutables – notamment la mémoire, donc, la violence (en particulier raciste) et la solidarité (notamment au-delà des limitations « imposées » par la couleur de la peau, en contrepoint subtil – si, j'y reviens – de la thématique précédente).
Le roman commence ainsi – étrangement ? – en 1965, dans une maison de retraite américaine, où une vieille femme d’origine chinoise, aveugle depuis fort longtemps et mélancolique comme de juste, se souvient. Elle se souvient de celui qu’elle appelle son deuxième père, même s’il ne l’a été que pendant deux jours (mais deux jours déterminants : il lui a sauvé la vie). Un Blanc, là où son premier père était chinois, et son troisième et dernier père un Noir qui a épousé une Blanche. Elle se souvient, donc, de ce vieil homme, qui, en ce temps si court, lui a enseigné comment apprécier la nature malgré ses yeux morts ; un homme qui, tel un invité de Michel Drucker (pardon, j’ai craqué), aimait particulièrement les chiens…
Nous passons alors en 1899. Ce deuxième père, le vieux Abel Truman, vit seul avec son chien (eh) dans une minuscule cabane au bord de la mer, tout au nord-ouest des États-Unis (mais on apprend vite qu’il a beaucoup bourlingué, notamment dans le Sud – j’y reviens, oui, encore – quand bien même il était originaire de New York). Abel y mène une vie monotone, faite de rituels sans cesse reconduits et d’harmonie avec la nature sauvage. Pourtant, Abel souffre – et pas seulement de son bras, estropié il y a fort longtemps. Il souffre, parce qu’il se souvient des atrocités vécues lors de la guerre de Sécession – où il s’est battu dans le camp sudiste, simplement parce qu’il se trouvait en Caroline du Nord quand le conflit a débuté –, et notamment du cauchemar que fut la bataille de la Wilderness. Abel, confronté à cette mémoire qui ne le lâche pas, décide un peu sur un coup de tête de quitter son ermitage au bout du monde pour voyager de nouveau à travers les États-Unis. Au cours de son périple, de sa fuite désespérée, nous le verrons croiser la route de plusieurs personnes singulières… et notamment celle de deux enfoirés de première, le nabot Willis et son comparse, un Indien haïda, brutes épaisses qui vagabondent de ci de là en organisant des combats de chiens, et volent le compagnon de notre vieux soldat.
Et du coup, fort logiquement, un chapitre sur deux, nous remontons encore dans le passé, jusqu’en 1864, en pleine guerre civile ; plus précisément, nous revivons avec Abel la terrible bataille de la Wilderness, celle où il a été si gravement blessé, et au cours de laquelle bon nombre de ses camarades sont morts (ainsi le jeune David Abernathy, et le plus jeune encore Ned, ce simplet dont la fin est insupportable et traumatise durablement le lecteur, qui se retrouve dans la peau d’Abel confronté à l’horreur la plus pure – l’auteur ne lésinant pas de manière générale sur le gore, rendu plus éprouvant encore ici par la finesse des sentiments : les larmes se mêlent au sang pour un résultat inoubliable). Tout tourne autour de la bataille : sa préparation, l’affrontement en lui-même, d’une violence stupéfiante, et la difficile survie une fois que les fusils se sont tus – grâce à Hypatia, jeune Noire qui intervient pour une scène bouleversante de pathos bien employé, qui aurait tout pour être ridicule mais émeut le lecteur aux larmes. Et ce jusqu’à ce que le Nord l’emporte, et un peu au-delà, avec l’assassinat de Lincoln.
Le choix du cadre de la guerre de Sécession n’est en rien innocent. La guerre civile, bien sûr, est une occasion de choix pour dresser un portrait impitoyable de l’homme dans ce qu’il peut avoir de plus sauvage, de manière absurde au possible : la violence, encore une fois, est un thème fondamental de Wilderness. Mais Lance Weller joue en outre un jeu dangereux, qui aurait sans doute été fatal à un auteur moins adroit et réfléchi que lui, en revenant à la racine la plus emblématique du conflit (à laquelle on ne saurait pour autant le réduire), avec, derrière la question de l’esclavage, celle du racisme, ou peut-être, plus exactement, de la coexistence entre les races. Le vieux Abel, amené malgré son uniforme encore récent à affirmer son soutien à Lincoln quand celui-ci est abattu par un fanatique de son ancien camp – qu’il n’a intégré après tout que par le plus grand et le plus absurde des hasards, lui le New-Yorkais d’origine – croise ainsi, en 1864 comme en 1899, des Blancs, des Noirs – esclaves ou émancipés –, des Indiens et des Chinois. Cette multiplication des rencontres « colorées » aurait pu être très dangereuse, risquant de verser dans l’arc-en-ciel dégoulinant de bons sentiments. Mais la violence et la solidarité se contrebalancent sans cesse en un équilibre digne du plus adroit des funambules, qui évite à Wilderness de sombrer dans les clichés (en dépit de son utilisation presque caricaturale de la guerre de Sécession) et la guimauve qu’un autre que votre serviteur qualifierait sans doute de « politiquement correcte ». Loin de là, Lance Weller dessine des personnages d’une profonde humanité qui ne peut que saisir le lecteur. La violence insoutenable – et, bizarrement, la violence verbale choque presque autant que la violence physique, pourtant frontale tout au long du roman, qui accumule les atrocités les plus barbares – révulse comme de juste ; mais la solidarité entre les races dont Wilderness est émaillé d’exemples (notamment au travers des soins reçus par Abel, en 1864 par la Noire Hypatia, en 1899 par des Indiens et par le couple Makers – tandis qu’il soigne de son côté la jeune Chinoise que l’on a d’abord vu vieille en 1965) rend une étrange note d’espoir dans un monde que l’on aurait pu croire désespéré. L’Haïda au fusil, en un contrepoint que l’on pourrait à première vue croire caricatural, confirme cependant que la méchanceté n’est pas l’apanage des Blancs dominants – il sonne cependant authentique. Et Abel dans tout ça ? Abel vit dans ses souvenirs éprouvants, et, en définitive, il ne sait pas vraiment où il se situe – d’autant que ses paroles dépassent souvent sa pensée, et qu’il peut lui aussi sombrer (inconsciemment sans doute, ce qui n’en est que plus terrible) dans une forme de violence verbale qui, en le rendant moins sympathique que ce que l’on pourrait croire, lui confère le statut d’humain, si ambigu et si difficile à rendre ; mais Lance Weller y parvient parfaitement.
Wilderness, d’une richesse et d’une ambition rares, a fortiori pour un premier roman, est ainsi presque en permanence sur la corde raide. Il suffirait d’un rien pour que le roman bascule dans le pénible, que ce soit à cause d’une certaine tendance à l’exploitation dans son traitement de la violence, ou au contraire en raison du risque toujours présent de faire dans une naïveté insupportable, dans une candeur lourde de pathos et d’artifices d’un humanisme sirupeux. Mais non : parce que Lance Weller, dès ce premier opus, se montre si adroit et si authentique, tant dans son traitement de la violence que dans celui de l’entraide, il parvient à faire de Wilderness un livre remarquable de justesse et d’intelligence – dans tous les sens du terme. Sans aller jusqu’à parler de chef-d’œuvre (encore que, au sens strict qui évoque le lancement brillant dans une carrière, il y aurait de quoi), on lui reconnaîtra donc d’avoir composé un ouvrage beau et fort comme peu le sont. Une découverte plus que convaincante, et assurément un auteur à suivre.

/image%2F1385856%2F20160114%2Fob_cfb8b0_caligari.jpg)



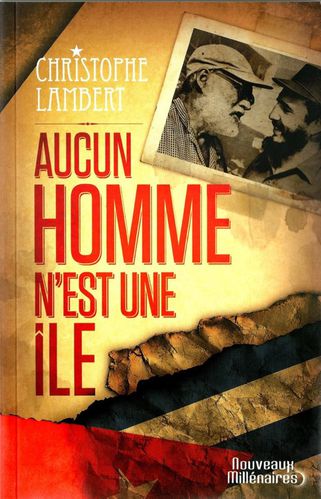



/image%2F1385856%2F20150204%2Fob_660a87_georges-abdaloff-croque-par-christell.jpg)