Pub copinage : "Sur le fleuve", de Léo Henry & Jacques Mucchielli

HENRY (Léo) & MUCCHIELLI (Jacques), Sur le fleuve, Evry, Dystopia Workshop, 2013, 191 p.

HENRY (Léo) & MUCCHIELLI (Jacques), Sur le fleuve, Evry, Dystopia Workshop, 2013, 191 p.
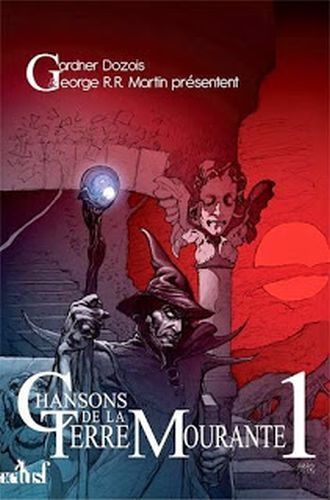
DOZOIS (Gardner) & MARTIN (George R.R.) (dir.), Chansons de la Terre mourante 1, [Songs of the Dying Earth], traduit de l’anglais par Pierre-Paul Durastanti, Florence Dolisi, Emmanuel Chastellière, Célia Chazel et Éric Holstein, préfaces de Dean Koontz et Jack Vance, Chambréy, ActuSF, coll. Perles d’épice, [2009-2010] 2013, 386 p.
Ma chronique se trouve dans le Bifrost n° 72 (pp. 106-107).
Je vais tâcher de la rapatrier dès que possible… mais ça ne sera pas avant quelque temps.
En attendant, vos remarques, critiques et insultes sont les bienvenues, alors n’hésitez pas à m’en faire part…
EDIT : Hop :
« La Terre mourante » est à n’en pas douter une des plus fascinantes créations de Jack Vance, qui nous a hélas quittés il y a peu. Ce Monde magique attendant l’apocalypse sous les éclats rubiconds d’un soleil en fin de vie fut en son temps arpenté par des personnages aussi brillants que Cugel l’Astucieux ou encore Rhialto le Merveilleux. Superbe univers de fantasy, sans doute parmi les plus marquants jamais créés, rivalisant à sa manière unique – et généralement très drôle – avec les plus belles productions de Tolkien, Howard, Leiber ou Moorcock, « La Terre mourante » a inspiré pléthore d’écrivains au fil des années. Et Gardner Dozois et George R.R. Martin ont choisi de rendre hommage à cette œuvre et à son auteur en convoquant pour ce faire la fine fleur de l’imaginaire contemporain, y compris des auteurs franchement inattendus dans ce registre. En est résultée la monstrueuse anthologie Songs of the Dying Earth, sacré pavé dont ActuSF a entrepris, et c’est louable, la traduction… hélas en trois volumes passablement aérés qui risquent de faire mal au porte-monnaie. Mais ne boudons pas notre plaisir : c’est le sourire aux lèvres que l’on entame la lecture de cet hommage fort bienvenu, riche en textes remarquables ; si cette première partie est nécessairement inégale – quelle anthologie ne l’est pas ? –, la qualité est cependant bel et bien au rendez-vous, et l’amateur de Vance retrouvera ici avec plaisir cet univers merveilleux qu’il a en son temps découvert auprès du Maître lui-même, et quelques-uns de ses personnages feront même leur apparition au détour des pages…
Commençons par évoquer le meilleur, tant qu’à faire. Le volume, passé deux préfaces dispensables de Dean Koontz et de Jack Vance lui-même (mais notons au passage que chaque auteur livre également une postface à sa contribution, témoignant de l’enthousiasme suscité par l’univers de la « Terre mourante »), s’ouvre brillamment avec Robert Silverberg qui nous narre avec talent l’histoire du « Cru véritable d’Erzuine Thale » : un poète décadent attend la fin, comme il se doit, en gardant dans ses réserves un breuvage divin, à même de l’inspirer pour un ultime poème en guise de couronnement de sa carrière ; ce qui ne va bien sûr pas sans susciter la convoitise… L’histoire est un brin convenue, mais la plume délicieuse, l’univers bien rendu et les personnages irréprochables. Une bien belle introduction. Autre réussite remarquable, « Abrizonde » de Walter Jon Williams nous amène à côtoyer un jeune architecte plongé par le hasard de ses errances dans une guerre apparemment désespérée ; mais la magie et les démons sont de la partie, et tout le monde ici a plus d’un tour dans son sac. Malgré une conclusion sans doute un peu abrupte, cette nouvelle enlevée et palpitante constitue à n’en pas douter un des grands moments de l’anthologie. Citons enfin parmi les plus brillants participants à cette entreprise un des anthologistes, George R.R. Martin himself. L’auteur du « Trône de fer » nous emmène passer « Une nuit au Chalet du Lac » (« célèbre pour ses anguilles siffleuses »), auberge pas très bien fréquentée. Les personnages hauts en couleurs et la plume adroite de Martin nous ramènent habilement aux meilleurs récits vanciens de la « Terre mourante ».
Deux nouvelles, pour être inférieures à ce beau trio de tête, sont néanmoins tout à fait agréables à la lecture : « La Porte Copse » de Terry Dowling ne manque ainsi pas d’humour, et joue avec malice des sortilèges les plus improbables (jusque dans leur désignation farfelue) employés par les magiciens si hautains de la « Terre mourante » ; un peu trop téléphoné, cependant, pour pleinement emporter l’adhésion, et ça ne fait pas toujours mouche. Le cas de Jeff VanderMeer est différent : l’auteur de l’excellente Cité des saints et des fous livre avec « La Dernière Quête du mage Sarnod » une nouvelle tout à fait séduisante, à l’univers riche et original ; mais peut-être est-elle pour le coup « trop originale », dans un sens : on n’y retrouve pas tout à fait la flamboyance propre aux récits de Vance, malgré des emprunts non négligeables.
Les deux nouvelles restantes sont plus dispensables, sans être d’une lecture trop désagréable pour autant. Glen Cook, avec « Le Bon Magicien », livre un récit ambitieux mais un peu bancal, où la fine fleur des magiciens est convoquée pour faire face à une terrible menace ancestrale. Byron Tetrick se la joue un peu à la « Harry Potter » dans « L’Université de maugie », récit initiatique banal qui se conclut sur une assez regrettable faute de goût, l’auteur ayant succombé à une tentation trop énorme pour ses capacités.
Mais ces deux fausses notes n’enlèvent finalement pas grand-chose à la qualité tout à fait appréciable de ce premier volume des Chansons de la Terre mourante. L’hommage est dans l’ensemble tout à fait réussi, et les amateurs de Vance ne seront pas déçus. Aussi a-t-on hâte de lire la suite, dont on peut espérer sans trop de risque d’erreur qu’elle sera également des plus enthousiasmantes.
EDIT : l'ignoble Gérard Abdaloff en parle ici.

MATHESON (Richard), D’autres royaumes, [Other Kingdoms], traduit de l’anglais (États-Unis) par Patrick Imbert, Paris, J’ai lu, coll. Nouveaux Millénaires, [2011] 2013, 285 p.
Ma chronique se trouve dans le Bifrost n° 72 (pp. 82-83).
Je vais tâcher de la rapatrier dès que possible… mais ça ne sera pas avant quelque temps.
En attendant, vos remarques, critiques et insultes sont les bienvenues, alors n’hésitez pas à m’en faire part…
EDIT : Hop :
Si D’autres royaumes, publié originellement en 2011, n’est pas l’ultime roman du vétéran Richard Matheson, son édition en France quelques mois à peine avant sa mort lui confère quelque peu, par la force des choses, une allure de testament littéraire. Et on ne fera pas de mystère : c’est pour le moins regrettable. On n’y retrouve en effet guère le brillant auteur de, entre autres, Je suis une légende et L’Homme qui rétrécit. Et l’on fait régulièrement la grimace à la lecture de ce livre de trop, qui tient sans doute un peu de la catharsis, mais donne aussi (surtout ?) la fâcheuse impression que son auteur n’y croit pas – et par voie de conséquence le lecteur pas davantage.
Alexander White, plus connu sous le nom de plume d’Arthur Black, sous lequel il a commis des dizaines de romans d’horreur lamentables, a 82 ans. Né avec le siècle, il nous narre ici les étranges événements qu’il a connus quand il avait 18 ans, aux environs de la fin de la Première Guerre mondiale. Engagé dans les forces américaines pour faire bisquer son horrible paternel, Alex connaît l’horreur des tranchées. Et c’est sur le front qu’il fait la rencontre de Harold Lightfoot, un jeune soldat anglais. Les deux hommes se lient d’amitié, et, avant de décéder, Harold suggère à Alex de se rendre dans son village natal, Gatford, au nord de l’Angleterre.
Démobilisé en raison d’une grave blessure, Alex, qui ne tient pas à revoir son père à Brooklyn, obéit bientôt aux dernières volontés de son camarade. Il loue un cottage dans ce village qu’il trouve à première vue somptueux, mais la petite vie paisible qu’il entendait y mener est vite perturbée par d’étranges superstitions locales : on lui dit que la forêt avoisinante est le domaine des fays, du petit peuple autrement dit, et qu’il ne faut surtout pas s’enfoncer dans les bois en quittant le chemin... Mais il fait aussi, lors d’une promenade, la rencontre de Magda, ravissante femme qui fait une mère de substitution idéale... mais qui a la réputation d’être une sorcière. Cartésien comme son horrible père, Alex ne croit guère à ces racontars. Il a tort, comme de bien entendu...
Sur ces bases pour le moins stéréotypées, Richard Matheson tisse dès lors une intrigue cousue de fil blanc, ce qui n’exclut hélas pas quelques incohérences ou invraisemblances ; D’autres royaumes mêle le genre féerique classique, teinté d’horreur, avec le genre sentimental, se complaisant dans la descriptions d’amours aussi ambiguës que pénibles. Tout ça sent le complexe d’Œdipe, pas qu’un peu... et ça ne convainc guère, laissant bien vite une amère impression en bouche.
Le problème essentiel de D’autres royaumes ne réside pourtant pas dans cette dimension. Le roman est prévisible, peu crédible en même temps, pas très bien construit, affligé de personnages en carton-pâte, et donne, à tort ou à raison, l’impression d’avoir déjà été lu cent fois, en mieux. Certes. Mais le véritable drame est ailleurs : en effet, Richard Matheson semble s’y complaire dans le style laborieux d’un écrivain d’horreur gothique à dix balles. Exorcisme ? Peut-être... Mais c’est rapidement insupportable, notamment du fait des incessants appels au lecteur qui parsèment chaque page ou presque de ce roman imbuvable. Arthur Black intervient en effet régulièrement pour commenter ce qu’il écrit, jugeant telle phrase bonne, telle autre mauvaise, quand elles sont toutes affligeantes. Le lecteur est sempiternellement pris à témoin, et bien vite n’en peut plus.
On est très loin, ici, du grand Richard Matheson, conteur d’exception qui a su nous régaler à maintes reprises avec son astucieux sens du récit ; on n’y retrouve pas davantage la finesse dans la caractérisation de ses meilleures productions ; ne reste au final qu’une mauvaise parodie du genre, donnant l’impression que Richard Matheson se moque de lui-même, et par la même occasion du lecteur.
« Comment aurais-je pu écrire ce livre si ma cervelle baignait entièrement dans les eaux du gâtisme ? », demande Alexander White/Arthur Black à un moment ; le lecteur, ici, ne peut pas vraiment s’empêcher de faire la grimace... De même, plus loin : « Arthur Black me collerait d’office dans une maison de repos pour auteur en fin de carrière. » Douloureuse confession...
Disons-le, même si c’est difficile, voire cruel, du fait de la proximité du décès de Richard Matheson : on aimerait se montrer charitable, voir en D’autres royaumes un roman au pire médiocre, mais le fait est que ce livre est calamiteux de bout en bout. La forme est atroce, le fond sonne creux. L’hommage plus ou moins déguisé ne séduit pas, et tourne à la parodie laborieuse. Livre sans intérêt, livre inutile, livre de trop, D’autres royaumes ne sert guère la mémoire d’un auteur que nous avons connu tellement brillant. Aussi vaut-il mieux s’abstenir de lire cette erreur de vieillesse, qui n’aurait probablement jamais dû être publiée.

(Clic.)
… Nous étions une petite bande de réformés, qui errait à travers la France. Il y avait Solange, Hélène, Jacques et moi. Aucun des deux camps n’avait voulu de nous, pour des raisons variées, parfois obscures, parfois évidentes. Mais là n’est pas la question. Peu importe. Ce qui compte, c’est que notre statut de parias nous obligeait à parcourir le pays, des zones rouges aux coins les plus paisibles, sans trêve ni repos. Je n’étais pas vraiment préparé à ce genre de vie – qui le serait ? Mais nous n’avions pas le choix. Et, finalement, ce n’était pas si pire… On s’entendait bien, déjà. Notre position était précaire, il nous était impossible de nous intégrer, mais on a connu quelques bons moments, dans cette vie plus ou moins aventureuse qui nous avait été imposée par les circonstances.
(…)
… Oui, bien sûr. On en était réduit au vol ou à la mendicité, forcément. Choses pour lesquelles nous n’avions pas spécialement de talent. On n’avait pas le choix, c’est tout. Alors on s’adaptait. Bien sûr, cela n’arrangeait pas exactement nos relations avec les engagés. C’était véritablement une guerre totale, on a sans doute du mal à prendre conscience aujourd’hui de ce que cela impliquait. Il fallait, d’une manière ou d’une autre, participer à l’effort de guerre. Tout le monde était engagé, sauf quelques incompétents notoires comme nous autres, incapables de monter au front, mais tout aussi incapables d’exercer une activité utile à l’arrière. Des inutiles, voilà ce que nous étions. On nous traitait régulièrement de parasites – ce qui n’était pas forcément faux, d’ailleurs. Nous ne trouvions pas notre place dans la société en temps de guerre ; mais je ne suis pas certain que nous aurions davantage pu nous intégrer si les circonstances…
(…)
… Non, l’après-guerre ne nous a pas permis de répondre à cette question. Les rescapés étaient des victimes, des handicapés à vie ; encore un statut à part, qui faisait de nous des marginaux. Nous n’avons donc jamais été dans la norme.
(…)
… Oui, j’y reviens. Nous étions quatre, donc. Cela faisait près de deux ans que nous étions contraints de vagabonder à travers le pays. Contrainte qui ne présentait pas que des désavantages, d’ailleurs. Déjà, on pouvait aller où bon nous semblait. Pour nous, les frontières n’existaient pas – les traits sur les cartes officielles, mais aussi les lignes fluctuantes du front. Nous avons tour à tour vécu chez les transhumanistes et chez les conservateurs, tant bien que mal. Ils nous traitaient tous de la même manière, de toute façon, avec ce mélange de mépris et de pitié condescendante qui a toujours été le lot des parias. On ne nous aimait pas, non. On nous chassait, souvent. Il fallait faire avec… D’où cette contrainte du voyage. Il nous fallait vivre sur le pays, mais le pays nous repoussait. Il n’y avait pas de solution. Des fois, on se prenait à rêver d’un havre pour les réformés, une sorte d’utopie où nous trouverions enfin notre place. Rêve absurde, bien sûr. Délire pacifiste. La société de ce temps-là ne permettait certainement pas d’envisager l’existence d’un endroit pareil. Mais, dans les meilleurs jours, on peut dire que cette utopie avait un semblant de réalité ; simplement, elle était mouvante, elle nous accompagnait sur les routes.
(…)
… Oui, je vais arriver à la capture, mais il me semblait important de poser un peu le contexte. Les gens, aujourd’hui, ont sans doute du mal à comprendre ce que c’était alors que d’être un réformé. L’anomalie que cela pouvait représenter. Mais je vais m’arrêter là. La capture, donc.
(Long silence.)
… Excusez-moi. Cela m’est encore pénible de repenser à toute cette horreur… Des fois, je suis pris de l’envie de fondre en larmes, tellement… Je…
(Sanglots.)
… Veuillez me pardonner.
(…)
… Non, non, ça va aller. Il le faut. Il ne faut pas oublier DE FAIRE…
(…)
… Pardon. Juste un instant.
(Soupir.)
… Oui, ça va mieux. Ne vous en faites pas pour moi, je ne suis qu’un vieux croûton obnubilé par le passé. De l’eau a coulé sous les ponts. Mais c’est très bien ce que vous faites. IL NE FAUT… Pardon. Le souvenir. C’est important. Les jeunes d’aujourd’hui doivent savoir. Laissez-moi juste un instant.
(Le témoin boit un verre d’eau ; il tremble.)
… Voilà. Nous étions à l’arrière, dans le camp conservateur. Oh, je ne vous ai pas parlé de mes sympathies ! Oui, même si nous étions réformés, nous avions tous une opinion sur le conflit en cours. Pour ma part, j’étais plutôt transhumaniste, comme Hélène. Solange et Jacques penchaient davantage de l’autre côté. Mais nous n’en parlions pas vraiment. Ce qui nous rapprochait était autrement plus fort que ce qui nous divisait.
(…)
… Oui, sans doute. Bon. Peu importe, alors. Là, nous étions en terres conservatrices. Les deux factions, de toute façon, nous traitaient de la même manière, alors pour nous, quelles que soient nos opinions… Bref.
(…)
… Oui, jeune homme. Inutile de vous excuser. Donc, nous étions à l’arrière, et c’était plutôt une bonne période, pour nous. L’été. Il faisait bon. On pouvait cueillir des trucs, chasser parfois. C’est en cherchant des baies, d’ailleurs, que nous avons franchi le périmètre de sécurité de la base où nous avons été capturés. Une base de drones, conservatrice. On a été pris en plein lancement, un sacré spectacle ! Un instant, il n’y avait rien, et puis, hop ! le sol se soulevait, des trappes s’ouvraient, et d’immenses engins prenaient leur envol… Jacques a failli y laisser sa peau, d’ailleurs – il était sur une trappe quand elle s’est ouverte. Cela aurait sans doute mieux valu pour lui qu’il tombe dans le puits, ou qu’il soit d’emblée pulvérisé par le drone… Pauvre Jacques…
(…)
... Non, non, ça va aller. Merci. Donc… Il y avait cette base de drones. Nous étions pris en pleine alerte. Des soldats n’ont pas tardé à débouler et à nous maîtriser. Mains en l’air ! Il nous était impossible de fuir, nous nous sommes rendus. Nous avons été conduits dans les souterrains jusqu’à une salle d’interrogatoire. Bornés, ces militaires… C’était absurde, mais ils nous prenaient néanmoins pour des espions ! Nous avons passé des heures dans cette pièce, sous-alimentés, sans pouvoir se laver ou se soulager. Un bien rude calvaire… mais ce n’était rien en comparaison de ce qui nous attendait. Mais comment aurait-on pu le savoir ? Il y avait deux officiers, qui jouaient la vieille comédie du gentil flic et du méchant flic. Sans le moindre résultat, bien sûr, puisque nous étions innocents. Ils ont bien fini par comprendre que nous étions bel et bien ce que nous prétendions, et que notre présence sur la base relevait du pur hasard. Alors ils nous ont transféré au complexe… Je pourrais avoir un autre verre d’eau, s’il vous plaît ?
(…)
… Merci. Non, nous n’avons pas été immédiatement séparés. Nous avons fait le trajet ensemble, dans un vieux camion de l’armée, inconscients de notre destination. Nous ne pouvions pas savoir… Personne ne savait. C’était tellement absurde, quand on y repense…
(…)
… Non, je vais prendre sur moi. J’ai accepté votre offre, je vous remercie de travailler sur cette question. On oublie trop souvent DE… Pardon. Les gens ne se souviennent tout simplement pas. Je sais même qu’il y en a pour dire que tout cela n’a jamais eu lieu. Les salauds… Mais je peux les comprendre, dans un sens. Une entreprise aussi vaine, une telle dépense de temps, d’énergie et de moyens pour un résultat si… oui, absurde, oui. C’est complètement fou, quand on y repense. Une telle cruauté…
(…)
… Non, je ne crois pas. Hélas ! Vous savez, avant même ces… événements… j’avais déjà acquis la conviction que l’homme était foncièrement mauvais. Je crois que le sadisme est un constituant essentiel de l’humanité. Que nous sommes tous sadiques. Rien de nouveau à cet égard. Non, ce qui est très particulier, ici, c’est l’organisation scientifique de ce sadisme, si vous me passez l’expression. Il y avait eu des précédents, bien sûr, mais visant généralement à l’élimination pure et simple, à plus ou moins long terme. Pas là. Et c’est bien ce qu’il y a de plus fou dans cette histoire…
(…)
… Je vais y arriver. C’est promis. Le complexe, donc. À l’époque, j’étais bien évidemment incapable de le situer sur une carte. Et, à vrai dire, je m’en moquais un peu ; je pensais que nous serions vite relâchés, et que nous pourrions reprendre notre vagabondage sans but. Jacques et Hélène pensaient la même chose, il n’y avait que Solange pour… Mais c’était Solange. Elle a toujours envisagé le pire. Mais cette fois, elle avait raison.
(…)
… Ne vous en faites pas, jeune homme. Je sais que je donne l’impression de tourner autour du… de… Enfin, vous me comprenez. Je vais vous décrire le complexe, maintenant, tel qu’il nous est apparu alors. Un immense bâtiment gris-blanc, borgne, au milieu d’un parc rieur, littéralement envahi d’écureuils. Un bloc d’austérité qui détonnait dans ce cadre. Mais l’impression donnée était assez juste, celle d’une sorte de clinique psychiatrique à l’ancienne, avec ses hauts murs qui nous coupaient du reste du monde…
(…)
… Oui, j’avais déjà fréquenté de telles institutions. Dépression chronique… Alors j’ai de suite pensé à ça. Sans véritable fantasme pénitentiaire. J’étais déjà passé par là. Conscient de mon statut d’inadapté, je pensais que l’on allait nous imposer à tous quatre un petit séjour en milieu hospitalier, et, pour être franc, ça me paraissait plutôt une bonne chose : de quoi se reposer un temps, avoir le gîte et le couvert… Si j’avais su…
(…)
… Jeune homme, faites-moi confiance. Je vais y arriver. Bon… Nous avons été séparés dès notre arrivée. Enfin, plus exactement, Jacques m’a tout d’abord accompagné, tandis qu’Hélène et Solange étaient conduites dans un autre secteur. Nous avons déambulé le long de couloirs froids et austères, guidés par des sortes d’infirmiers, jusqu’à la salle de réception. Jacques est passé le premier. Je ne l’ai plus jamais revu…
(…)
… Oh, non. Non. Simplement, dès la libération, il s’est suicidé – je ne l’ai appris que bien des années plus tard.
(…)
… Je vous en prie. J’ai attendu environ une demi-heure, et puis on m’a fait pénétrer dans le bureau. Oui, celui du docteur François. Je ne connaissais bien entendu pas son nom, à l’époque, il a fallu attendre le procès. Personne n’avait de nom, dans le complexe. Les docteurs et infirmiers pas plus que les patients. Cela faisait partie du processus de déshumanisation et de confiscation de l’identité. Je n’étais plus « Bertrand », j’étais « Toi ! » pour les infirmiers, « Vous » pour les docteurs. On ne m’a d’ailleurs pas demandé mon nom lors de l’admission ; ils s’en foutaient.
(…)
… Oui. Il y avait une bibliothèque. Plein d’ouvrages très savants, et le guide du docteur François en plein d’exemplaires, avec sa couverture jaune et rouge. La pièce, sinon, était assez dépouillée. Une plante verte dans un coin. Un bureau encombré de dossiers. Et, bien sûr… la comptine…
(…)
… Non, je vais y arriver. Il faut que je le dise. Je me suis entraîné. Il y avait donc un grand panneau au-dessus du docteur, qui disait… qui disait…
(Soupir.)
… « IL NE FAUT PAS OUBLIER DE FAIRE CACA ! »
(Long silence.)
… Non, ça va aller. Merci. Excusez-moi, je… Mais ça va aller. Il fallait le dire. C’est important.
(…)
… Oui, peut-être. À demain, alors…
(Clic.)
* * *
(Clic.)
… Les questions du docteur François étaient absurdes. Et s’y glissaient déjà des thèmes scatophiles. Au détour d’une question innocente – sur mes antécédents psychiatriques, par exemple –, il me demandait, eh bien, si je regardais avant de tirer la chasse, ce genre de choses. La consistance. La couleur… Une demi-heure d’entretien, comme ça. Ensuite, on m’a guidé dans les douches. On m’a déshabillé, puis laissé seul. La pièce était froide, carrelée de blanc immaculé. Je me suis lavé. Je suis allé aux toilettes. Le leitmotiv était bien entendu affiché au-dessus. C’est la seule chose que j’ai pu lire pendant les 90 jours du traitement.
(…)
… Oui, le docteur François m’avait déjà prévenu que la rééducation durerait 90 jours. Je n’imaginais pas alors à quel point ce serait dur… 90 jours. Dit comme ça, ce n’est pas grand-chose… Pourtant…
(…)
… Non, ils ne m’ont pas donné de vêtements. Effectivement, nous étions nus, pendant toute cette période. Les femmes comme les hommes, d’ailleurs. Un jour, à la lisière du périmètre, j’ai vu Hélène. Elle ne m’a pas reconnu.
(…)
… Non, je vous l’ai déjà dit, je n’ai jamais revu Jacques. Le hasard, sans doute… Nous étions sous l’emprise complète du hasard.
(…)
… Les premiers jours, non. Pendant un temps, la seule chose véritablement gênante, c’était la nudité. La perte d’identité, à la limite. Oh, et la comptine qui passait en sourdine en permanence, bien sûr…
(…)
… Non. Non, le pire, très franchement, ce n’était pas les électrochocs. C’était terrible, bien sûr. Mais c’était une torture, comment dire… ponctuelle ? L’angoisse, avant, était insupportable, la douleur affreuse… Mais…
(…)
… Après trente jours, oui. Mais franchement, jeune homme, vous auriez tort d’y accorder trop d’importance. La véritable torture, dans le complexe, n’était pas physique. Non… Non, c’était tout cet ensemble de manipulations qui vous vidaient le crâne et vous ôtaient toute substance. C’est ça que les jeunes, aujourd’hui, n’arrivent pas à comprendre. On se focalise sur les électrochocs, mais le pire… le pire c’était d’avoir tout le temps dans la tête cette comptine stupide, d’entendre et de hurler jour après jour « IL NE FAUT PAS OUBLIER DE FAIRE… »
(…)
… « CACA ! IL NE FAUT PAS OUBLIER DE FAIRE CACA ! IL NE FAUT PAS OUBLIER DE FAIRE CACA ! IL NE FAUT PAS OUB… »
(Clic.)
* * *
(Clic.)
… Je… je vous prie de m’excuser pour hier. Cela ne se reproduira plus.
(…)
… Merci. Les trente premiers jours, donc. Une routine s’est très vite instaurée. Lever à sept heures, toilettes, petit-déjeuner, toilettes, promenade dans le parc, toilettes, déjeuner, toilettes, entretiens et ateliers thérapeutiques, toilettes, dîner, toilettes, extinction des feux à vingt heures. La comptine était diffusée en permanence, même la nuit, bien sûr. Et, au fil des jours, les panneaux se multipliaient, partout, qui reprenaient sans cesse le leitmotiv.
(…)
… Oui, c’était les seuls changements que nous pouvions constater.
(…)
… Nous, oui. Nous formions un petit groupe d’une quinzaine de patients. Nus. Et il nous était interdit de dire nos noms, sous peine de passer au caisson.
(…)
… Bien sûr. D’un tempérament un peu rebelle, j’y ai effectué plusieurs séjours. C’était une sorte de placard, d’un noir d’encre, dans lequel la comptine passait à un volume beaucoup plus élevé. Chaque condamnation au caisson durait huit heures. Huit heures debout, dans le noir, à entendre la comptine. Alors évidemment on se chiait dessus. Littéralement. Direction les toilettes et les douches dès la sortie. Et ça ne vous donnait pas envie de recommencer, croyez-moi. J’y suis retourné, pourtant… Mais il faut dire qu’on nous y envoyait au moindre prétexte. Un pas de travers, un mot de trop, hop ! le caisson.
(…)
… Vous y revenez toujours… Oui. Les électrochocs. Les séances commencèrent à partir du deuxième mois. Dans la salle, la comptine passait très fort.
(…)
… Oh, mais eux ils avaient des casques anti-bruit ! Enfin, le mot n’est pas très juste ; ça filtrait – en tout cas, ils n’avaient pas à supporter la comptine. Sinon, ils seraient devenus aussi fous que nous… Car, oui, nous devenions fous, à force. De la merde dans le crâne. De la merde partout. De la… il… IL NE FAUT P…
(Clic.)
* * *
(Clic.)
… Je vous prie encore une fois de bien vouloir m’excuser. Mais, comme vous pouvez le constater, quarante ans plus tard, ce conditionnement reste des plus efficace…
(…)
… Non. Non, je n’ai jamais compris pourquoi. Personne, d’ailleurs. Lors du procès, on a bien entendu chercher à comprendre les motivations du docteur François, et de ses supérieurs, mais rien. Toute cette débauche semblait… gratuite. Encore que le mot ne soit pas très bien choisi : tout cela devait coûter fort cher. Et cela ne débouchait pourtant sur rien d’autre que la folie. Des dizaines d’individus braillant une comptine inepte à tue-tête. Pourquoi ? Je n’ai pas la réponse. Je ne crois pas que qui que ce soit ait la réponse. Mais les faits sont là…
(…)
… Oui, au bout de 90 jours, comme promis, ils m’ont relâché. J’étais devenu une loque, de même que mes semblables. J’errais dans les rues en gueulant… la comptine. Je suis resté nu plusieurs mois, je crois bien. Les gens avaient pitié…
(…)
… Non, dans un sens, j’ai eu de la chance. Il ne s’est écoulé qu’assez peu de temps avant la victoire des transhumanistes. J’ai alors eu droit à une vraie thérapie, pour me débarrasser autant que possible du conditionnement du docteur François. Cela a duré près de deux ans. Après, il y eut le procès. La commission d’enquête était perplexe, c’est rien de le dire. Mais on ne peut rien contre les faits. Mon témoignage – et celui de bien d’autres, qu’ils aient été « guéris » ou pas – a débouché sur la condamnation du docteur François pour crime contre l’humanité. Ce salaud est toujours vivant. Il n’a jamais fourni la moindre explication…
(…)
Je vous en prie. C’est moi qui vous remercie. C’est important, ce que vous faites, pour les jeunes. Car il… il ne… IL NE FAUT PAS OUBLIER…
(Clic.)
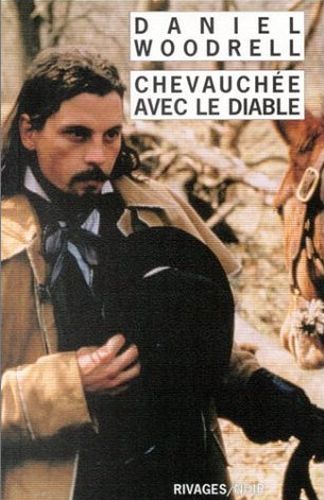
WOODRELL (Daniel), Chevauchée avec le diable, [Woe to Live On], traduit de l’anglais (États-Unis) par Dominique Mainard, Paris, Rivages, coll. Noir, [1987, 2000] 2002, 257 p.
Western encore (bah oui), avec cet impressionnant roman de Daniel Woodrell, adapté au cinéma par Ang Lee (je n’ai donc absolument aucune envie de voir le film en question…), qui lève le voile sur un des pires aspects de la guerre de Sécession.
En effet, si c’est essentiellement à l’Est qu’Unionistes et Confédérés s’affrontent dans un impitoyable bain de sang, dans lequel on a souvent vu le premier avatar de la guerre « moderne », l’Ouest n’est pas épargné pour autant. Chevauchée avec le diable, qui prend place au Missouri et au Kansas, s’intéresse en effet aux horribles exactions perpétrées par les troupes irrégulières des jayhawkers (Nord) et des bushwhackers (Sud), comme le sinistre Quantrill, qui fait d’ailleurs une apparition remarquée dans le roman. Ces hors-la-loi se livraient à une guerre parallèle faite de massacres aveugles et de pillages, aux dépends d’une population plus ou moins impliquée dans le conflit, mais souvent amenée à choisir son camp bien malgré elle, Fédéraux et Rebelles ne leur laissant pas d’autre possibilité.
Le moins que l’on puisse dire, c’est que le roman attaque en force, avec une scène d’une cruauté presque insoutenable : la compagnie de bushwhackers du narrateur, déguisée en soldats de l’Union, lynche gratuitement un pauvre immigrant d’origine hollandaise, qui a eu le malheur de se laisser tromper par les uniformes de la mauvaise troupe. Entrée en matière particulièrement terrible, qui donne le ton de ce roman extrêmement noir, illustration cinglante de l’abomination de la guerre en général et de la guerre civile en particulier.
L’ironie de l’histoire, c’est que le narrateur, fervent rebelle, est lui-même d’origine hollandaise (or Hollandais et Nègres constituent des cibles de choix pour ces irréguliers)… Jake Roedel, à peine âgé de seize ans, a rejoint les bushwhackers avec son « frère de sang » Jack Bull Chiles, probablement en raison de l’assassinat par les Nordistes du père de ce dernier. Et bien que mal aimé en raison de ses propres origines – l’un des irréguliers, dès le début, menace de faire la peau de ce satané Hollandais… –, il n’a aucun doute sur la légitimité de son engagement et la justesse de la cause pour laquelle il se bat, même si cela l’amène à commettre candidement des horreurs sans nom ; ainsi, dès le début, nous le voyons abattre d’une balle dans le dos le fils du malheureux immigrant…
La naïveté de Jake fait froid dans le dos. Ce « patriote » qui ne saurait pour rien au monde remettre son engagement en question est fier du combat mené par les bushwhackers, et chaque abomination commise par les jayhawkers lui semble une justification suffisante, et à vrai dire à peine nécessaire, aux exactions dont lui et ses camarades hors-la-loi sont responsables. Tous les moyens sont bons pour combattre les Nordistes « envahisseurs » ; Jake, qui s’imagine mal intégrer l’armée régulière avec tout ce que cela implique, se satisfait ainsi pleinement des brigandages des irréguliers qu’il a intégrés.
Tableau sinistre et édifiant. Les « petits soldats » (généralement fort jeunes) dépeints par Daniel Woodrell sont une illustration pour le moins parlante de ce que l’engagement peut avoir de plus horrible. Et de plus absurde, aussi : la situation du « Hollandais » Roedel a déjà été évoquée, mais il y a plus paradoxal encore, ainsi dans la liaison fusionnelle qu’il est amené à nouer avec un autre bushwhacker, Holt… qui se trouve être un Nègre. Jake Roedel, Jack Bull Chiles et Holt forment ainsi le trio essentiel de Chevauchée avec le diable, des types qui, finalement, ne doivent leur engagement, quand bien même viscéral, qu’à un hasard consternant…
Le roman est riche en – non, on ne dira pas « morceaux de bravoure », le terme paraît inacceptable devant l’horreur infecte des situations… Disons en scènes choc. Point culminant : le saccage de Fort Lawrence par des bushwhackers sûrs de leur bon droit, qui tuent et pillent des civils innocents parce qu’ils ont eu le malheur de se trouver au mauvais endroit au mauvais moment. Ce n’est qu’alors que Roedel et Holt commenceront, bien tardivement, à se poser des questions…
Mais Chevauchée avec le diable est à vrai dire une sorte de roman initiatique. Le jeune âge de son narrateur (que j’ai franchement du mal à qualifier de « héros », même s’il suscite fort logiquement, de même que ses deux principaux camarades, l’empathie du lecteur) en fait plus qu’un témoin : Jake découvre le monde dans cette guerre atroce ; c’est dans le sang qu’il apprend l’amitié… et même l’amour.
Le roman de Daniel Woodrell n’est pas sans défauts. Il souffre en effet d’une plume assez lourde, même si je ne saurais véritablement dire si c’est le texte original ou la traduction qui est en cause (je penche cependant pour la deuxième possibilité…). Mais c’est au final de peu d’importance devant la force du propos et les terribles situations qu’il met en scène. Roman de guerre d’une cruauté rare (et je n’arrive pas à croire qu’Ang Lee ait pu la restituer à l’écran…), Chevauchée avec le diable fait mal au ventre, mais on en redemande.
Et son actualité ne saurait faire de doute, dans la mesure où les exactions des jayhawkers et des bushwhackers font inévitablement penser à celles dont se rendent aujourd’hui coupables partout dans le monde miliciens, terroristes et autres incarnations d’un engagement violent et rarement réfléchi, les « petits soldats » avec ou sans uniforme qui, sûrs de leur bon droit, infligent leur vision caricaturale du monde à une population qui ne leur a rien demandé.
Roman aussi écœurant que brillant, Chevauchée avec le diable, malgré ses imperfections formelles, constitue donc une lecture plus que recommandable, à même de susciter la réflexion du lecteur sur l’horreur de la guerre sans jamais sombrer pour autant dans le pathos ou les lieux communs du genre. Très fort.

MANCHETTE (Jean-Patrick) & SUSSMAN (Barth Jules), L’Homme au boulet rouge, préface de Doug Headline, Paris, Gallimard, coll. Folio Policier, [1972] 2006, 213 p.
Je l’avoue, je l’avoue : dans mon immonde inculture crasse, je n’avais jusqu’à présent jamais lu de Manchette (à part sa traduction de Watchmen, bien entendu, mais je ne suis pas sûr que ça compte). Et L’Homme au boulet rouge, son unique western, et par ailleurs une commande, travail alimentaire, ne constitue sans doute pas la meilleure des portes d’entrée à son œuvre. Mais voilà : c’est un western. Alors forcément...
Une petite explication s’impose quant aux deux noms au générique. Contexte : fin des années 1960, début des années 1970, le western connaît un important renouveau, cinématographique comme littéraire, notamment grâce à son travestissement transalpin. C’est dans ce cadre que le scénariste (quasi inconnu) Barth Jules Sussman écrit The Red Ball Gang, scénario d’un film qui ne sera finalement jamais tourné, mais dont on demandait déjà une novélisation ; et c’est donc Manchette, alors quasi inconnu lui aussi, qui s’y est collé, ce qui nous a donné L’Homme au boulet rouge.
Le futur auteur de polars sociaux travaille vite, mais renâcle à la tâche (il y a, dans le scénario originel, de nets accents « spaghetti » – forcément ? – et Manchette déteste ça, lui qui éprouve beaucoup plus d’intérêt pour les westerns classiques américains) ; plus tard, quand il reviendra sur les circonstances ayant entouré l’écriture de ce roman de commande, il ne se montrera guère satisfait, évoquant néanmoins des « digressions marxistes » plus ou moins saugrenues, typiques semble-t-il de sa production ultérieure (au début, je craignais un peu cet aspect, mais finalement ça passe plutôt bien).
On est donc loin d’une oeuvre majeure, et c’est sans doute le seul nom de Manchette, sur lequel on a capitalisé (uh uh), qui explique cette réédition tardive, quand le roman était à peu de choses près sombré dans l’oubli entre-temps. Reste néanmoins un western assez atypique, et qui, ma foi, se lit fort bien ; un roman correct, disons, qui sent effectivement la commande effectuée avec plus ou moins d’envie (on n’osera vraiment pas parler de passion...), mais qui reste un divertissement passable ; guère plus, mais ce n’est déjà pas si mal.
Le roman débute en 1871 au Texas (mais Manchette ne peut s’empêcher, dans le premier paragraphe, de faire un détour par la Commune de Paris, ce qui a le mérite de clarifier les choses...). L’insoumis Greene, notre héros, a écopé d’une vilaine peine d’emprisonnement, et se retrouve « loué », avec d’autres prisonniers, à un entrepreneur vach’ment entreprenant, le paternaliste Potts, qui a décidé de planter du coton dans cette zone qui ne lui convient guère. Disons les choses, c’est un véritable bagne. Et Greene, à la première occasion (pas super crédible, au passage), de prendre la poudre d’escampette... Il se fait reprendre, bien entendu : lourde aggravation de sa peine, et il est renvoyé, en compagnie de fort mauvaises graines, dans la plantation qu’il avait eu l’indélicatesse de quitter sans un adieu ; il a désormais, de même que ses « camarades », un boulet rouge au pied... mais ne compte pas pour autant se laisser faire, et plier aux injonctions de Potts ou sous les coups du contremaître Pruitt. Peu importe la surveillance d’un tireur d’élite sempiternellement aux aguets, Greene compte bien à nouveau se faire la malle, tant qu’à faire pour retrouver la douce Callie, charmante prostituée des environs.
En fait de western, L’Homme au boulet rouge est donc plutôt une sorte de roman carcéral. On n’y verra pas vraiment de cow-boys ou d’indiens, tout juste un shérif de passage. À peu de choses près, l’histoire pourrait aussi bien se passer à Cayenne ou dans quelque autre enfer de travail forcé où, au hasard, on aurait déporté des communards... On retrouve cependant, malgré l’auteur sans doute, quelque aspect « spaghetti » dans ce roman, où la morale est pour le moins malmenée, et, s’il y a un héros, c’est dans une version taciturne qui ne manque pas d’évoquer, disons, l’homme sans nom incarné par Clint Eastwood dans la « trilogie des dollars ».
Mais là n’est sans doute pas l’important. La réussite (relative, hein, mais on parlera de réussite quand même) de cette œuvre de commande réside sans doute dans sa critique ouverte du capitalisme, de l’exploitation des travailleurs, et, bien souvent, de leur servitude volontaire. Les « digressions marxistes » annoncées, surtout sensibles au niveau du vocabulaire, ne viennent pas plomber le récit, mais bien au contraire lui donnent toute son ampleur. Mention spéciale, sous cet angle, à la figure très réussie de Potts, salaud sans l’être totalement, capitaliste vaguement condescendant obsédé par ses seuls profits et qui se fout du reste. Le vrai méchant de l’histoire, finalement, est sans doute la brute Pruitt, archétype du maton vicieux qui prend son pied à imposer son autorité à la racaille à grands coups de gourdin dans la tronche. Mais les autres personnages ne sont pas en reste, notamment, mais pas seulement, les autres boulets rouges. Et cela nous vaut quelques séquences ouvertement politiques plutôt intéressantes et assez lucides sans doute – l’épisode de la grève, puis celui de la course aux putes...
Ajoutons que, malgré les plaintes de Manchette à ce sujet, les dialogues, quelle que soit leur réelle paternité, sont assez efficaces, dans le genre cinglant et vaguement gouailleur. Malgré la commande, la plume n’est pas désagréable, plus généralement, et le roman se lit tout seul, rythmé par des chapitres très courts et une narration qui va à l’essentiel.
Aussi est-on tenté de passer sur les inévitables faiblesses du roman, au cadre flou (mais est-ce vraiment un problème ?), pas toujours hyper crédible, et quelque peu desservi par une fin précipitée, cinématographique certes, mais qui donne quand même une vague impression de bâclage. Malgré tout cela, L’Homme au boulet rouge reste un roman correct, qui se lit bien. On n’en fera certainement pas un chef-d’œuvre du genre (et quel genre, d’ailleurs ?), et ce n’est probablement pas ce que Manchette a fait de mieux, mais on ne va pas cracher dans la soupe pour autant : fidèle à sa commande, l’auteur a livré un roman court et très certainement efficace, tout en y infusant un peu de sa personne. Pas si mal, donc.

Titre original : Il Grande Silenzio.
Réalisateur : Sergio Corbucci.
Année : 1968.
Pays : Italie / France.
Genre : Western spaghetti.
Durée : 105 min.
Acteurs principaux : Jean-Louis Trintignant, Klaus Kinski, Frank Wolff, Luigi Pistilli, Vonetta McGee…
Qu’on ne s’y trompe pas : même si je me suis lancé dans un cycle de lectures western, je n’ai qu’une culture très limitée dans le genre, notamment cinématographique. Bon nombre des grands classiques américains me sont totalement inconnus, honte sur moi ; et, malgré une certaine attirance pour leur violence baroque, il en va de même pour les westerns spaghettis : passés Sergio Leone (bien sûr), Django (du même Corbucci que le film qui nous intéresse aujourd’hui) et Keoma, je n’y connais tout simplement rien… C’est dire si j’ai des lacunes à rattraper.
Et parmi ces lacunes, Le Grand Silence se posait un peu là : le réalisateur de Django qui fait tourner ensemble ces deux monstres que sont Jean-Louis Trintignant et Klaus Kinski sur une musique d’Ennio Morricone, avouez, ça a de la gueule… Et cela faisait donc un sacré bout de temps que je comptais voir la chose ; il était plus que jamais nécessaire de franchir le pas : dont acte.
Nous sommes en hiver 1898 dans l’Utah enneigé. Du fait des manœuvres du banquier cupide (pléonasme) incarné par Luigi Pistilli, nombre de paysans se retrouvent réduits à la misère, et deviennent hors-la-loi dans l’arrière-pays. Mais ils deviennent ainsi la proie d’impitoyables chasseurs de primes, parmi lesquels on accordera une place toute particulière au cynique et violent Tigrero (Klaus Kinski, qui fait son Klaus Kinski, et est donc terrifiant). Ils ont cependant un homme pour les défendre, quelqu’un qui a une dent contre les chasseurs de primes : le muet surnommé Silence (Jean-Louis Trintignant, impressionnant de charisme et de pure beauté), fine gâchette qui ne tire cependant qu’en état de légitime défense. Bien évidemment, les deux hommes vont être amenés à s’affronter, à l’instigation de Pauline (Vonetta McGee), dont le mari a été assassiné par Tigrero, et qui compte bien obtenir vengeance… tandis que la nomination d’un nouveau shérif à Snow Hill (Frank Wolff) vient compliquer la situation.
Je ne vous cacherai pas que la première demi-heure m’a paru très rude, et m’a fait craindre le pire, bien loin de l’excellente réputation du film. Si Trintignant et Kinski m’ont tôt paru irréprochables, et si la célèbre musique d’Ennio Morricone est bien entendu superbe, le film me semblait pécher par trop d’aspects pour emporter mon adhésion. Dans sa tonalité très sérieuse, voire carrément noire, je n’ai pas retrouvé le « fun » baroque de Django ou de la « trilogie des Dollars », ce qui m’a tout d’abord quelque peu déconcerté… surtout dans la mesure où l’interprétation par les autres acteurs ne me paraissait pas à la hauteur (Frank Wolff n’étant d’ailleurs pas nécessairement mauvais, mais les aspects « comédie » de son personnage m’ont paru franchement déplacés), et plus encore en raison de ce scénario ultra-lapidaire et simpliste qui, disons-le franchement, m’a fait tout d’abord l’effet d’être con comme un boulon, et il est vrai encore desservi par des dialogues certes typiques du genre, avec moult « punchlines » à la clef, mais qui sonnaient à mes oreilles complètement bidons… La réalisation de Sergio Corbucci, en outre, me paraissait plus ou moins inspirée, avec ses mouvements de caméra parfois hasardeux, et ses tentatives maladroites pour mettre en valeur de bien jolis décors, certes, mais… Bref. Je n’y trouvais pas mon bonheur.
Mais Le Grand Silence fait partie de ces films rares qui, en partant sur des bases qu’on qualifiera charitablement de fragiles, parviennent à construire quelque chose de puissant. Au fur et à mesure que l’on avance dans le métrage, le film se montre de plus en plus convaincant, le resserrement de l’intrigue autour de Trintignant et Kinski y étant pour beaucoup. C’est dingue, mais oui : ça s’améliore progressivement. Et quand vient la fin, cette fin sublime (je parle de la « vraie », bien sûr, pas de la « fin alternative » plutôt risible qui figure également sur le DVD), ben, on est sur le cul, après s’être pris une énorme baffe.
Tout ceci, bien sûr, n’est qu’un témoignage de mon ressenti personnel. J’imagine qu’il s’en trouvera beaucoup pour crier au chef-d’œuvre dès les premières images. Ce ne fut pas mon cas, loin de là. Mais Le Grand Silence m’a bel et bien convaincu, en définitive, la fin rachetant le début, les maladresses que l’on peut toujours y constater étant largement gommées par des atouts indéniables – interprètes principaux, musique, propos et tonalité. Aussi, malgré ma déception initiale, je suis bien obligé de reconnaître que le film de Sergio Corbucci mérite la plupart des éloges qu’on lui adresse couramment, et constitue bien un sommet du western spaghetti.
Bon, j’en ai plein d’autres à voir, moi…

HOOK (Peter), L’Haçienda. La meilleure façon de couler un club, traduction [de l’anglais] de Jean-François Caro, [Marseille], Le Mot et le reste, coll. Attitudes, [2009] 2012, 330 p.
J’aurai mis le temps – bien plus que je ne le pensais – mais voilà donc enfin mon compte rendu de L’Haçienda de Peter Hook, bassiste de Joy Division et New Order (dont j’avais déjà parlé, chez le même éditeur, d’Unknown Pleasures, écrit postérieurement ; notez également la chronique commune de Madame Mao et Gérard Abdaloff pour la Salle 101, qu’on peut entendre ici). Des impératifs divers m’ont effet amené à repousser longtemps cette lecture ; mais ça y est. Et je peux vous dire d’ores et déjà que ce livre fut parfaitement à la hauteur de mes espérances. Malgré une traduction parfois approximative, j’y ai retrouvé toute la verve et la gouaille de Peter Hook avec un plaisir indéniable.
Mais faut dire que le sujet, comme dans le cas d’Unknown Pleasures, m’intéressait tout particulièrement. L’Haçienda, quoi ! (Ne pas oublier la cédille.) Le légendaire club « de New Order » à Manchester, le club par excellence, en fait, qui a importé en Europe les modèles américains pour mieux les dépasser, et, en quinze années tumultueuses (1982-1997), entrer définitivement dans l’histoire de la musique… même si, aujourd’hui, l’Haçienda n’est plus, remplacée par des appartements. Peu importe : en son temps, ce fut LA salle de concert (malgré son acoustique douteuse) et LE club. C’est là qu’ont émergé les courants acid house (via Chicago) et rave, l’antre où les blancs ont appris à danser (l’expression est de Tony Wilson, patron de Factory, et donc lié au club, Fac 51) en gobant des ecstas.
Un projet complètement fou, marqué dès le départ par une gestion calamiteuse, qui aurait dû, en temps normal, tourner très vite au fiasco pur et simple : l’Haçienda était un gouffre (le mot est de Martin Hannet, cette fois), et l’histoire ne pouvait que se terminer par un naufrage ; mais il y a eu ces quinze années de folie, qui ont vu Manchester devenir Madchester, et s’ancrer définitivement dans l’inconscient collectif comme la « Music City » dont parlait John Robb (voyez ici).
Au commencement, il y eut donc New Order, très peu de temps après le suicide de Ian Curtis ayant mis fin à l’expérience Joy Division, et leur manager Rob Gretton. Fascinés par les grands clubs new-yorkais, ils décident de créer le leur à Manchester. « Il faut bâtir l’Haçienda. » Le nom, aujourd’hui, est un peu galvaudé – preuve de l’influence de l’original –, mais, à l’époque, ce mot d’ordre tiré des papiers de l’Internationale situationniste (c’était, je crois, Tony Wilson qui l’avait dégoté) prenait tout son sens. En plein Manchester, les gens de Factory construisent donc leur club (pour une fortune, les dépassements de budget sont énormes dès le départ, et l’Haçienda ne sera jamais rentable, mais ils semblaient tous n’en avoir absolument rien à foutre).
Au début, le succès est pour le moins douteux. Salle de concert pas super bien conçue, l’Haçienda n’attire guère les foules, même s’il s’y produit quelques concerts légendaires. Et là, je ne résiste pas à l’envie de vous citer cette anecdote concernant Einstürzende Neubauten :
« En février 1985, le groupe industriel allemand Einstürzende Neubauten a joué un concert muni d'une foreuse pneumatique, qu'ils ont mise en route durant leur set pour s'attaquer au pilier au centre de la salle. Le public était comme hypnotisé, et nous aussi. Nous aurions très bien pu nous trouver à jouer de la lyre devant le grand incendie de Rome, parce que nous n'avons pas bougé d'un poil pour arrêter le mec – en dépit du fait que ce pilier soutenait le bâtiment à lui tout seul. Nous nous contentions de crier : « Ouais ! Vas-y ! »
« J'étais mort de rire. Plus que Terry Mason, en tout cas. Paniqué, et à juste titre, il s'est précipité sur le propriétaire de l'engin, histoire d'empêcher que le club ne s'effondre. Ces imbéciles n'avaient qu'à pas le laisser entrer avec une foreuse en premier lieu. Finalement, Terry – épaulé d'un videur – a réussi à lui confisquer son instrument. Le groupe n'a rien tenté et a continué le concert sans broncher. À les écouter, l'absence de la foreuse ne se faisait pas sentir. Einstürzende Neubauten en avait préenregistré une dizaine d'autres sur bande.
« Une jeune habituée de l'Haçienda, personnage assez farfelu (elle apportait un train électrique qu'elle installait dans le bar à cocktails et jouait avec des heures durant), a décidé de s'amuser un peu avec le groupe pendant le concert, et les attirait un par un en dehors de la scène pour se les taper dans la cage d'escalier. Trois des membres y sont passés mais le public n'a rien remarqué en raison de l'atrocité du vacarme. Le concert s'est achevé lorsque le chanteur s'est éclaté les cordes vocales à force de hurler, répandant du sang partout sur son micro. Ozzie, notre ingé son, est monté sur scène et l'a assommé. « Je l'avais prévenu », s'est-il justifié.
« Je dois admettre que je ne suis pas très friand de ce genre de musique et d'une telle anarchie. Mais malgré le volume assourdissant, la musique bruitiste que produisait le groupe était fantastique. Extrêmement puissante. Délirante. Quand ils ont sorti un marteau-piqueur, je me suis dit que ces types étaient des génies et que New Order devrait lui aussi s'en procurer un. »
Un exemple des innombrables anecdotes croustillantes et hilarantes qui parsèment ce livre.
Mais le meilleur est à venir, dans les années 1987-1990, en gros, qui marquèrent – enfin – l’âge d’or de l’Haçienda : acid house et ecstasy se répandent parallèlement, et créent une nouvelle culture musicale. Les groupes sont toujours à l’honneur à l’Haçienda (surtout ceux qui font le pont entre les genres, comme les Happy Mondays ou les Stone Roses), mais les DJs deviennent des rois (par exemple, Mike Pickering, Dave Haslam, ou même, plus tard, un tout jeune Laurent Garnier). Des milliers de personnes s’y retrouvent chaque semaine pour danser, dans une ambiance généralement jugée inimitable. Peter Hook était probablement dans un sale état, la plupart du temps, à cette époque, mais on l’a aidé à rebâtir l’Haçienda pour le plus grand plaisir des lecteurs, qui participent ainsi un peu – si peu, certes, mais c’est mieux que rien… – de la grande fête de Madchester.
Mais l’Haçienda devient hélas la victime de son succès. Les flics et la municipalité ont le club à l’œil – malgré l’atout incontestable qu’il constitue pour Manchester, qui devient une destination prisée des étudiants comme des touristes – essentiellement en raison de la drogue. Et à cela s’ajoutent les gangs de la ville et de sa banlieue, qui sèment bientôt la terreur à l’entrée du club, puis à l’intérieur. Manchester, devenue Madchester, vire à Gunchester. Vilaine descente… La sécurité ne peut rien faire contre les gangs… à tel point que les gérants n’ont d’autre choix que de la confier à des criminels notoires !
Et puis, progressivement, ce sera la décadence. L’Haçienda ferme quelque temps ses portes à cause de la violence en 1991, puis tient difficilement la route jusqu’en 1997, année de sa fermeture définitive. C’est le temps des regrets, celui où la fête n’est plus – l’Haçienda, qui a si longtemps été en avance sur le reste du monde, est désormais à la traîne… Et Peter Hook comme les autres finissent par en avoir marre. Fin de l’histoire.
Mais il reste ce livre passionnant, témoignage brillant même si parfois un brin douteux, qui se lit avec un plaisir énorme. C’est généralement très drôle, même si la fin est passablement mélancolique (et il y a toujours en arrière-plan la nostalgie…). C’est en tout cas un récapitulatif réjouissant d’une entreprise aussi dingue que géniale, sans véritable équivalent. Je recommande chaudement.
Cela devait arriver un jour. Malgré la perfidie de l'immonde Raoul Abdaloff, Madame Mao et Gérard ont investi la Salle 101 pour parler de musique mancunienne (eh oui). Ca s'écoute ici.
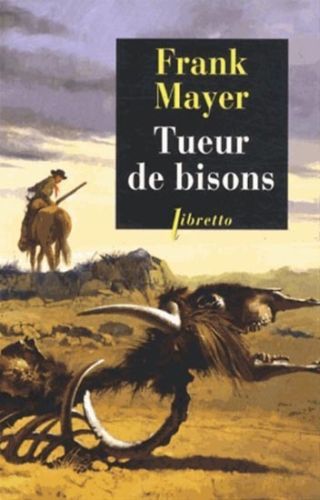
MAYER (Frank), Tueur de bisons, [The Buffalo Harvest], traduit de l’américain par Frédéric Cotton, [s.l.], Phébus, coll. Libretto, [1958, 2010] 2013, 94 p.
Western encore, avec ce récit aussi épatant que navrant d’un « coureur » de bisons lors de la grande « moisson » des années 1870. Frank Mayer, mort plus que centenaire, est en effet à certains égards typique de l’old timer dont on recherchait les récits et anecdotes dans les années 1940-1950, et qui ont ainsi contribué à édifier la légende de l’Ouest. Depuis sa naissance en 1850 à La Nouvelle-Orléans, on a l’impression qu’il a quasiment tout connu des grands événements marquant l’histoire de la Frontière ; il aurait ainsi, très jeune, été clairon durant la guerre de Sécession ; mais c’est à la fin de cette dernière que sa vie va connaître un tournant majeur, en ce qu’il va participer, en en étant plus ou moins conscient, à un des plus grands désastres écologiques causés par l’homme. Son récit de ces années plus ou moins glorieuses a été édité à titre posthume ; il semble cependant authentique, du moins dans la mesure où il s’agit bien des souvenirs de Frank Mayer tels qu’il a pu les confier à un journaliste. D’où ce petit livre passionnant, écrit dans un style oral très gouailleur, et qui participe pleinement de la légende de l’Ouest.
Frank Mayer se présente volontiers, et peut-être avec un certain cynisme, comme un businessman. Il s’agissait pour lui, comme pour tant d’autres, de faire de l’argent, au cours de cet avatar improbable de la ruée vers l’or. Âgé d’une vingtaine d’années à peine, il apprend ainsi le métier auprès des meilleurs, avant de se lancer véritablement. S’ensuivront un peu moins de dix ans de carnage, de « meurtre » bien plus que d’aventure, comme Mayer le reconnaît volontiers.
Tous les aspects de la chasse aux bisons – essentiellement pour leur peau, dans une moindre mesure pour leur viande et leurs langues, plus tard viendra le temps des ossements… – sont détaillés dans cet opuscule parfois très technique (ainsi en ce qui concerne les fusils employés), mais qui sait toujours rester palpitant, Frank Mayer se montrant un narrateur habile et plein de verve. Et il nous offre ainsi une mémorable plongée dans l’univers des « coureurs », part intégrante de la mythologie de l’Ouest, riche en anecdotes croustillantes, que ce soit sur la « bêtise » des bisons, les performances des meilleurs chasseurs, ou leurs rencontres conflictuelles avec les Indiens.
Mais les causes et conséquences de cette « moisson » sont également envisagées. Pour ce qui est des causes, Frank Mayer insiste sur la bénédiction que leur donnaient les autorités (qui approvisionnaient notamment les chasseurs en munitions) : au-delà du seul aspect financier (qui l’a vite fait déchanter, il avait beau être un excellent tireur, les profits étaient considérablement moindres que prévus), il s’agissait selon lui de ruiner le mode de vie des Indiens des Plaines, dépendant dans une large mesure du bison ; et, effectivement, en annihilant les grands troupeaux des pistes du Nord et du Sud, les coureurs ont contribué à chambouler le territoire et le mode de vie des Indiens…
Car c’est bien d’un massacre qu’il s’agissait, même si le narrateur n’en a pris conscience que tardivement (bien trop tard… d’autres se sont montrés plus lucides, il le reconnaît volontiers) : en une dizaine d’années, des millions de bisons ont ainsi été tués, jusqu’à ce que l’espèce disparaisse presque complètement. Les méthodes quasi industrielles appliqué à la chasse ont ainsi eu un effet drastique, difficilement envisageable, et bien rares étaient ceux qui avaient alors conscience du drame en train de se jouer…
Aussi cette lecture est-elle tant passionnante que déprimante. Si Frank Mayer n’a livré cette « confession » qu’au crépuscule de sa longue vie, il y fait néanmoins preuve d’une grande lucidité, et se montre un conteur habile, à même de séduire son public tout en le prenant régulièrement à contre-pied. Au-delà des seules anecdotes – qui valent le détour, hein –, le vieux coureur livre ainsi un fragment de l’histoire de l’Ouest dont l’importance est essentielle. Et il nous offre à l’occasion quelques tableaux fascinants, que ce soit à propos de la chasse en elle-même, ou bien de ses conséquences : l’image de ces grandes plaines autrefois foulées par les bisons et désormais « civilisées » marque durablement ; les bisons et leur herbe ont disparu… de même que les Indiens. Et c’est ainsi une page peu glorieuse de l’histoire de la Frontière qui s’est tournée.
Témoignage exemplaire, fascinant de bout en bout, Tueur de bisons est une lecture éminemment recommandable.