"R.U.R.", de Karel Capek
ČAPEK (Karel), R.U.R. Rossum’s Universal Robots, traduit du tchèque par Jan Rubeš, préface de Brigitte Munier, Paris, Éditions de l’Aube – La Différence, coll. Minos, [1920, 1997] 2011, 219 p.
R.U.R. de Karel Čapek fait partie de ces œuvres que l’on « connaît » sans les avoir lues. Ce nom résonne tout particulièrement aux oreilles des amateurs de science-fiction. C’est en effet dans cette pièce de 1920 qu’est apparu pour la première fois le terme « robot » (robota signifiant « corvée » en tchèque), quand bien même le concept avait précédé le mot servant à le désigner, tout naturellement (il n’est que de songer à Frankenstein ou, pour citer deux œuvres dont j’avais traité, L’Ève future et Ignis – sans même parler du golem, création juive tchèque qui a très probablement infusé dans le texte)… C’est à bien des égards ce fait qui a valu à la pièce de Karel Čapek de rentrer dans l’histoire. Mais, quand je suis tombé sur cette toute récente réédition, il va de soi que je me suis jeté dessus histoire d’en savoir un peu plus…
R.U.R. (pour Rossum’s Universal Robots) est une pièce en un prologue et trois actes. Le prologue, de tonalité plutôt comique (en principe, en tout cas…) à l’inverse de ce qui suit, précède le premier et le deuxième actes de dix ans jour pour jour, tandis que le dernier acte se situe quelques mois plus tard (on ne fait donc pas vraiment ici dans l’unité de temps).
Un savant nommé Rossum a découvert le secret de la vie artificielle. Son successeur a perfectionné le procédé pour créer des « humains » artificiels, les fameux robots, « machines capables de penser qui s’imposent comme une force de travail extraordinairement peu coûteuse, productive et sans prétentions ». La société Rossum’s Universal Robots les produit par milliers, et les robots viennent bientôt remplacer les humains dans la plupart des tâches pénibles – voire toutes.
Le prologue nous explique comment ces événements ont eu lieu, à l’occasion de la visite du siège de Rossum’s Universal Robots par la belle Hélène Glory, plus qu’inquiète au sujet de ces robots qui déboulent sur le monde. Mais elle y rencontre Harry Domin, le directeur de R.U.R., qui s’empresse de la rassurer… et de la séduire, malgré la concurrence des principaux de ses associés. La tonalité de ce prologue est très enjouée, et le ton est clairement celui de la comédie, limite burlesque, même si, on l’avouera, sur le papier en tout cas, ça ne prête pas vraiment à rire…
La suite de la pièce est par contre clairement tragique (de plus en plus, à vrai dire). Dix ans plus tard, jour pour jour, alors que Domin et ses associés célèbrent l’anniversaire de la venue d’Hélène au siège de la R.U.R., les robots sont partout. Et les nouvelles se font rares depuis qu’une rébellion des robots a éclaté au Havre… Bientôt, il n’y aura cependant plus aucun doute : les robots, qui ont été formés à la guerre par les humains, lesquels ont de leur côté sombré dans l’oisiveté la plus totale, se sont lancés dans l’extermination de l’humanité entière – parce qu’ils se considèrent comme plus parfaits et ne veulent plus être commandés. Il leur manque cependant une chose pour que leur triomphe soit complet, une chose qui se trouve au siège de la R.U.R. : le secret de la vie artificielle…
La pièce de Karel Čapek est clairement une œuvre morale… et, du coup, on y retrouve un petit peu les mêmes problèmes que pour La Ville enchantée, dont je vous avais entretenu récemment.
Le thème de la révolte des robots, depuis, est devenu un véritable lieu commun (citons, au hasard, Terminator ; même si, déjà, auparavant, on pouvait parler de « syndrome de Frankenstein » et, une fois de plus, la légende du golem est un prédécesseur à ne pas négliger). Mais, entre-temps, nous avons également eu Isaac Asimov et ses robots positroniques obéissant aux fameuses « trois lois », largement destinées à prévenir une telle révolte et à annihiler la peur que les humains pourraient ressentir pour ces créatures artificielles tellement parfaites. Mais, ici, on en est bien loin, quand bien même il n’est pas toujours facile, pour le lecteur de SF, de faire l’impasse sur cette célèbre idée. Aussi, aujourd’hui plus encore qu’à sa parution sans doute, la révolte des robots dans R.U.R. relève à maints égards de la fable.
On pourrait y voir, de loin, une thématique sociale, sur l’exploitation des travailleurs. Mais ce n’est en fait pas vraiment marqué dans le texte (il y a bien quelques passages qui envisagent la question sous cet angle, mais ils sont finalement assez rares), vécu par des humains apeurés qui regrettent l’existence des robots (enfin, pas tous, d’ailleurs : Domin, malgré tout, incarnation d’un certain positivisme, affirme qu’il recommencerait si c’était à refaire). Aussi le fond de la pièce est-il avant tout moral, voire religieux (au travers de deux personnages essentiellement, l’un burlesque – Nounou –, l’autre tragique – Alquist, qui sera le héros du dernier acte). Les robots sont une manifestation de l’hybris des hommes, qui ont joué à être des dieux. En créant les robots, si parfaits, et en venant d’une certaine manière à les doter d’une âme, ils ont eux-mêmes fait l’étalage de leur anachronisme et de leur inutilité. Ce dépassement se traduit dans la pièce par une chute drastique du nombre des naissances : l’humanité étant de toute façon vouée à disparaître, ne se reproduit plus… Et tout cela, à bien des égards, donne l’impression d’une certaine justice divine, impitoyable : l’homme, en étant chassé du jardin d’Éden, a été condamné par Dieu à gagner son pain à la sueur de son front, et la femme à enfanter dans la douleur ; les hommes comme les femmes ne satisfaisant plus à ces conditions sont « de trop », et destinés à être remplacés par les robots, chez qui on trouvera bien un nouvel Adam, une nouvelle Ève…
Et c’est là que ça coince. Disons-le : si la pièce n’est pas totalement inintéressante aujourd’hui, notamment en raison de sa structure et de l’atmosphère d’horreur apocalyptique qui l’imprègne, et si on ne saurait bien évidemment lui ôter son caractère séminal, il n’en reste pas moins que tout ce discours moraliste voire religieux énerve régulièrement. L’éloge acharné du travail, notamment manuel (voyez Alquist), m’a fait grincer des dents, moi qui tiens plutôt du Droit à la paresse de Lafargue… Et cette « justice » divine me paraît donc foncièrement injuste : je ne me reconnais pas dans la critique de l’oisiveté, et pas davantage dans celle de la science-hybris, même si, je ne le cacherai pas, il est des apprentis-sorciers pour me faire peur. Aussi, à mes yeux en tout cas – mais peut-être cela provient-il justement du caractère séminal de l’œuvre –, le discours moral de R.U.R. a terriblement mal vieilli, et en rend la lecture aujourd’hui un tantinet pénible.
La pièce de Karel Čapek ne présente donc à mon sens d’intérêt que pour les plus curieux, et les exégètes de la science-fiction. Fade sur le plan littéraire, agaçante et datée sur le plan moral, elle n’a qu’un intérêt limité aujourd’hui. Je n’en regrette pas la lecture, mais ne saurais véritablement la recommander.

/image%2F1385856%2F20160114%2Fob_cfb8b0_caligari.jpg)



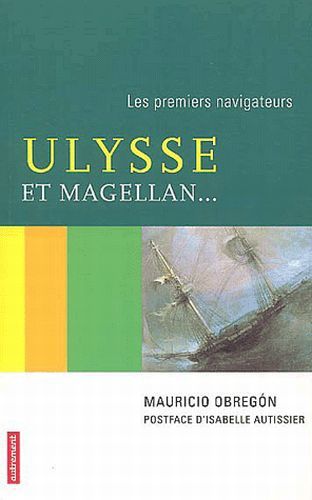

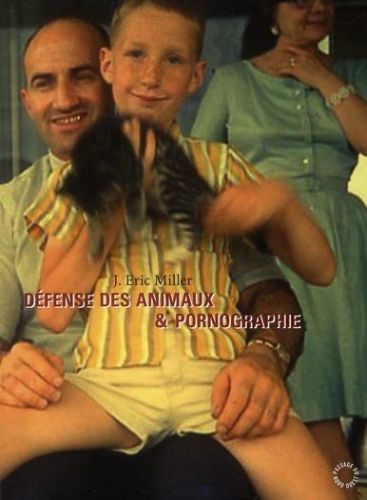

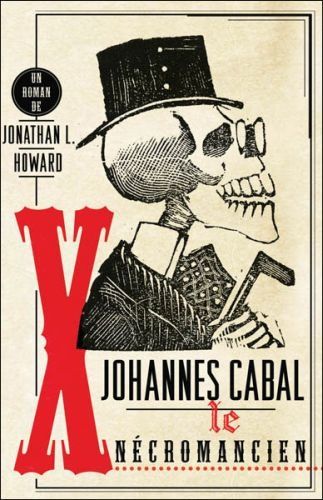


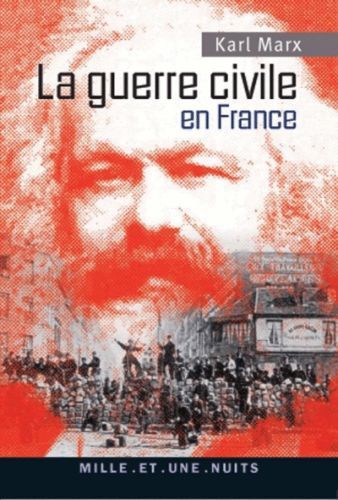

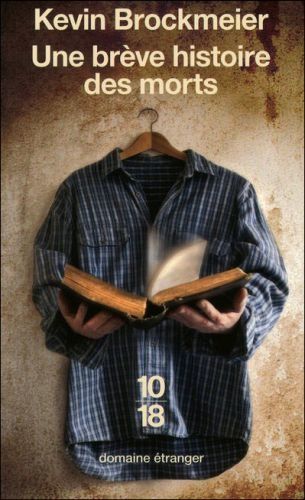





/image%2F1385856%2F20150204%2Fob_660a87_georges-abdaloff-croque-par-christell.jpg)