"Dimension Suisse", de Vincent Gessler & Anthony Vallat (éd.)

GESSLER (Vincent & VALLAT (Anthony) (éd.), Dimension Suisse. Anthologie de science-fiction et de fantastique romande, postface de Jean-François Thomas, Encino, Black Coat Press, coll. Rivière Blanche – Fusée, 2010, 269 p.
D’emblée, Dimension Suisse vient, à mon sens tout du moins, poser problème. Ce qui me paraissait intéressant dans les précédentes anthologies « Dimension » à caractère « géographique », c’était généralement la possibilité de se confronter à un imaginaire radicalement autre, car issu d’une culture radicalement différente. D’où mon attirance pour Dimension URSS et Dimension Russie, et probablement un de ces jours pour Dimension Latino de préférence à Dimension Espagne. Or ici, avec Dimension Suisse, on peut d’autant plus douter de l’altérité que la langue même est partagée… Dès lors, c’est l’intérêt même de l’anthologie qui peut être mis en cause, et Vincent Gessler et Anthony Vallat, dans leur préface, en sont bien conscients.
Mais voilà, c’est la faute à Vincent Gessler, justement. Celui-ci étant venu dédicacer son premier roman Cygnis à l’excellente librairie Scylla, je me suis dit que, tant qu’à faire… car la curiosité était malgré tout la plus forte. Ce qui fait que, si je ne suis pas reparti avec des dessins de marmottes, j’ai eu droit à deux dédicaces (ahahaha !). Et je me suis dit qu’après tout il pouvait être intéressant de voir un petit peu ce que nos voisins écrivaient, là haut sur la montagne.
Je ne m’attarderai pas sur la « Préface » de Vincent Gessler & Anthony Vallat (pp. 7-17) ; ce n’est pas qu’elle soit inintéressante, bien au contraire, elle se montre juste et pertinente, mais ne fait que remplir son rôle de préface. Alors autant se plonger illico dans le vif du sujet : les nouvelles.
… et ça commence mal, avec Sébastien Gollut et « Ceux qui marchent » (pp. 19-29). L’auteur joue la carte d’une certaine SF absurde lorgnant sur la fable ou l’allégorie, ce qui en temps normal n’est pas pour me déplaire, mais il le fait avec une telle lourdeur que le résultat est d’une nullité sans appel. Yeurk.
Le niveau remonte à peine avec André Ourednik et « Cette ville qu’ils appellent Sanzu » (pp. 31-45), récit davantage « transfictionnel » à base d’enfer nippon. Mouais… Pas très convaincant, et là encore un peu lourd…
Heureusement, les choses s’améliorent sacrément avec Sébastien Cevey et « Au-dessus de Shibuya » (pp. 47-63), un texte mêlant hard science à la Greg Egan et cyberpunk à la William Gibson, bourré d’idées très intéressantes (l’inconscient d’une ville !), avec pour seul véritable défaut un trop grand hermétisme à mon goût. Pas mal du tout, cela dit.
On joue au yo-yo avec Thibaut Kaeser et « Puni » (pp. 65-75), un récit fantastique ultra prévisible et qui plus est mal écrit. On passe.
À Robin Tecon, qui, avec « Les Miens » (pp. 77-103), livre une nouvelle de SF très classique, correcte, mais avec un petit goût d’inachevé. Bof, sans plus.
Suit Laurence Suhner avec « Homéostasie » (pp. 105-122) : le style est atroce, et le récit abominablement laborieux ; dommage, il y avait de l’idée dans la chute…
Par contre, on s’amuse plutôt pas mal avec Denis Roditi et « Jay, le basset et le gitan » (pp. 123-141) ; c’est totalement réac, au premier degré en tout cas, mais plutôt rigolo malgré tout, et assez bien écrit.
Lucas Moreno, j’avais déjà eu l’occasion de le lire par deux fois dans Bifrost, et c’était pas mal du tout ; c’est à nouveau le cas ici avec « L’Autre Moi » (pp. 143-168), récit plus subtil et complexe qu’il n’y paraît au premier abord (d’ailleurs, je me dis qu’il mériterait bien une deuxième lecture…), mêlant IA démiurgiques et psychiatrie expérimentale.
Suit une très bonne nouvelle sur le « corps astral » et les « ultramondes », « Divergence » de Daniel Alhadeff (pp. 169-185), avec une très chouette atmosphère délicieusement surannée ; sans conteste une des nouvelles du tiercé de tête du recueil.
François Rouiller livre quant à lui un texte à la fois effrayant et (avant tout) amusant avec « Remugle en neurocratie » (pp. 187-219), et ses manipulations politiques à l’heure des neurosciences. Sympathique.
… ce qui est loin d’être le cas des deux textes de Jean-François Thomas. Et là j’aurais presque envie d’être méchant, groumf… Commençons par la nouvelle, « Partir, c’est mourir un peu » (pp. 221-236), écrite avec les pieds, totalement dénuée de la moindre originalité (c’est peu dire : pour « l’idée » principale, on est à la limite du plagiat, à ce stade…), mauvais space op’ militaire versant SF à papy. Lamentable. J’osais espérer que le bonhomme se rattraperait avec sa postface, « La Science-fiction suisse : alarmes, alertes et dangers ou le charme concret de l’anti-utopie » (pp. 247-266)… Eh ben non. C’est toujours écrit avec les pieds, et d’une telle confusion que c’en est à peu de choses près illisible. Un peu fat, aussi : s’accorder à soi-même un paragraphe, c’est pas mal, quand même… Bref : je suis d’autant plus déçu que j’attendais beaucoup de ce rappel historique, et, au final, me retrouver devant ces vingt pages de torchon, ça m’a fait un peu mal au cul, dois-je dire…
Bon, concluons rapidement sur l’anthologie avec les deux textes qui nous restent, et qui relèvent, dira-t-on pour faire simple, de la polésie ; or vous connaissez mon exécration des pouètes… Du coup le poème en prose « Parfois mon reflet » d’Yves Renaud (pp. 237-242) ne m’a, euh, « guère séduit », et m’a pour tout dire paru un peu vain. Quant au « J’ai croisé des vaisseaux » de Tom Haas (pp. 243-246), je crois que mon exécration des pouètes n’a rien à voir dans mon jugement, et que les amateurs de polésie seront pour une fois d’accord avec moi pour trouver ce texticule d’un ridicule achevé.
Au final, le bilan n’est quand même pas gégé… Trois nouvelles valent vraiment le coup : celles de Sébastien Cevey, de Lucas Moreno et de Daniel Alhadeff. Deux autres sont sympathiques : celles de Denis Roditi et François Rouiller. Le reste est ou médiocre ou mauvais.
Ce qui fait bien peu. Je ne saurais donc véritablement conseiller Dimension Suisse, anthologie plutôt médiocre, et qui n’a pas de spécificité notable. Il semblerait que l’on y voit émerger une jeune génération d’auteurs suisses… mais bon nombre d’entre eux ont encore à faire leurs preuves.

/image%2F1385856%2F20160114%2Fob_cfb8b0_caligari.jpg)


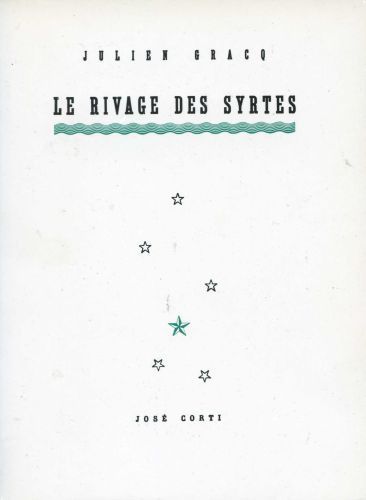















/image%2F1385856%2F20150204%2Fob_660a87_georges-abdaloff-croque-par-christell.jpg)