"Sauvagerie", de J.G. Ballard

BALLARD (J.G.), Sauvagerie, [Running Wild], traduction de l’anglais par Robert Louit, Auch, Tristram, [1988, 1992, 2002] 2008, 119 p.
Octobre ballardien, suite et fin : après La Forêt de cristal et le premier tome de l’intégrale des nouvelles de l’immense auteur de Crash !, parlons un peu de Sauvagerie. Un peu, juste, parce qu’il s’agit quand même d’un très court roman, ou, au choix, d’une longue nouvelle ; n’en disons point trop, donc. Juste deux choses, là, comme ça : il s’agit d’une réédition d’un bref ouvrage autrefois disponible en français sous le titre Le Massacre de Pangbourne, mais avec une nouvelle traduction (saluons encore le très beau travail accompli par Tristram) ; et, accessoirement, c’est l’ouvrage le plus « récent » de Ballard qu’il m’a été donné de lire, puisque je ne l’avais jusqu’à présent pratiqué que pour ses nouvelles des années 1950 et 1960, ses « romans apocalyptiques », la « trilogie de béton » et La Foire aux atrocités, soit des ouvrages remontant au plus tard aux années 1970.
Sauvagerie, c’est déjà autre chose. Un texte écrit en 1988, en pleine Angleterre thatchérienne, et qui prend des allures d’essai politique, ou plus exactement, on l’a dit à juste titre, de pamphlet. Un texte écrit à une époque où Ballard n’est peut-être plus aussi clairement assimilé à la science-fiction qu’autrefois, aussi. Peut-on parler de SF pour Sauvagerie ? Pas vraiment, sans doute, même si l’on peut bien y entrevoir une certaine anticipation, mais à très très court terme. On est en fait en plein dans ce « présent visionnaire » dont Ballard parlait entre autres pour Vermillion Sands. Sauvagerie, quoi qu’il en soit, nous parle bien d’ici et de maintenant. Comme la SF, très souvent, certes. Boarf, débat stérile qui ne m’intéresse pas vraiment... Retenons-en juste une chose : si ce bref volume est à même de plaire aux amateurs de SF, il ne s’adresse clairement pas qu’à eux. Le pamphlet touche bien au-delà de ce seul lectorat, et, si la forme « clinique » du récit – puisqu’il s’agit à bien des égards d’une sorte de rapport psychiatrique – peut rappeler le Ballard de Crash ! et de La Foire aux atrocités, le prétexte, quant à lui, tient indéniablement du polar. Mais il ne s’agit que d’un prétexte : l’identification des coupables ne fait très vite aucun doute (le narrateur lui-même reconnaît avoir été étrangement lent de la comprenette...), et le morceau est de toute façon lâché à mi-parcours environ (bon, je ne vais pas « spoiler », à tout hasard, mais j’avoue que la tentation a été forte, du coup…) ; l’intérêt n’est d’ailleurs probablement pas davantage dans la reconstitution du tragique fait divers.
Ah, oui, il serait peut-être temps que je vous en cause, tout de même… Adonc : dans Sauvagerie, Ballard s’inspire de la tuerie d’Hungerford, le 19 août 1987, quand un jeune chômeur a abattu seize personnes dont sa mère et en a blessé quinze autres avant de se donner la mort. Immanquablement, ce massacre façon « going postal » a fait les gros titres à l’époque… Et Ballard de se baser là-dessus pour poser quelques questions qui fâchent, et renouvellent sans doute à certains égards les thématiques d’I.G.H..
Pangbourne Village, un « enclos résidentiel de luxe » près de Londres, un endroit paisible, où la population est intégralement issue des classes moyennes supérieures. Des gens riches, plutôt libéraux, et heureux, avec une vie de famille idéale, consacrant beaucoup de temps à leurs enfants, lesquels se montrent tous travailleurs et doux : une utopie de l'upper middle class éclairée et progressiste. Mais, dans la matinée du 25 juin 1988, c’est le drame : les parents sont tous assassinés dans des circonstances étranges, de même que les autres adultes présents (gardiens, etc.), et les enfants disparaissent. Deux mois plus tard, le mystère reste entier : qui a tué les parents, et pourquoi ? qui a enlevé les enfants, et pourquoi ? La presse multiplie les théories toutes plus farfelues les unes que les autres, et qui ne font guère avancer le schmilblick… C’est alors que la police décide de faire appel au docteur Richard Greville, psychiatre, pour essayer d’y voir un peu plus clair. Sauvagerie correspond à son « journal » médico-légal, et adopte le ton clinique et froid des rapports d’expertise. Et le bon docteur va bientôt être amené à découvrir la vérité. Une vérité évidente, mais inacceptable.
Derrière la félicité de Pangbourne Village, dans ce havre de gentillesse et de bons sentiments, le docteur Greville va découvrir une horreur indicible, et son rapport va prendre les apparences d’une cartographie systématique d’un Enfer qui n’a jamais été autant pavé de bonnes intentions.
Sauvagerie est un texte éminemment ballardien, au-delà de la seule forme. On y retrouve des obsessions très anciennes, déjà sensibles dans les premières nouvelles de l’auteur notamment (mais aussi, donc, dans I.G.H. et La Foire aux atrocités) : un délire claustrophobe, qui n’est d’ailleurs pas sans évoquer cette fois les « utopies de l’enfermement » typiques du marquis de Sade (la description de certains meurtres, les plus alambiqués essentiellement, a quelque chose de profondément sadien à mon sens) ; et plus largement une dénonciation angoissée d’une forme de « société de contrôle », matérialisée, au-delà des murailles entourant Pangbourne Village, par son impressionnant (et inutile…) réseau de vidéosurveillance (et sa justification « panoptique » nous renvoyant directement à Surveiller et punir et au-delà à Bentham), mais essentiellement traduite par un carcan d’activités imposées, un bonheur sur commande, évoquant les pires formes de totalitarisme. À ceci près que le totalitarisme, ici, non seulement n’ose pas dire son nom, mais va jusqu’à se faire passer pour libéralisme ; le pire étant sans doute que cette imposture est tout ce qu’il y a de plus sincère…
Le résultat est glaçant et profondément dérangeant, et on aurait tout d'abord envie de dire ambigu, au moins en apparence, dans la mesure où il dépasse les clivages politiques habituels. En effet, si Sauvagerie est bien une critique de l’Angleterre thatchérienne (la fin ne laisse plus aucun doute à cet égard), et plus largement de la société de contrôle (la vidéosurveillance n’en étant que l’aspect le plus sensible), ce n’est certainement pas pour autant un pamphlet naïf, se contentant de répéter les critiques les plus courantes (mais non moins légitimes) à l’encontre de ces systèmes. Il va au-delà, cherche la petite bête, démonte plus globalement l’utopie, ébranle les dogmes, et interroge la condition humaine. Dans ce rapport glacé, désabusé, quasi nihiliste, les extrêmes se rejoignent, les impostures, illusions et présupposés de tous les camps sont équitablement exposés et maltraités. Le « bonheur insoutenable » (dans une perspective différente de celle du roman d’Ira Levin, certes, dystopie totalitaire « classique ») génère des monstres, la civilisation accouche de la barbarie, les bons sentiments se galvaudent dans une oppression inconsciente. L'obsession de la sécurité nourrit le crime. Et l'innocence est un leurre. Sauvagerie est un système de contradictions philosophiques, disséquant nos sociétés prétendument « libérales » jusqu’à révéler leur absurdité fondamentale. Un roman « apocalyptique », encore une fois, dans un sens. Mais à l'échelle d'un modèle de société. Et sombre, infiniment sombre.
Sauvagerie n’a rien d’une promesse, si ce n'est celle d'un chaos imminent ; on dira plutôt qu'il s'agit d'un avertissement. Lucide et désabusé. Une anti-utopie cauchemardesque, froide, amorale. Et une leçon, dans toutes les acceptions du terme.

/image%2F1385856%2F20160114%2Fob_cfb8b0_caligari.jpg)





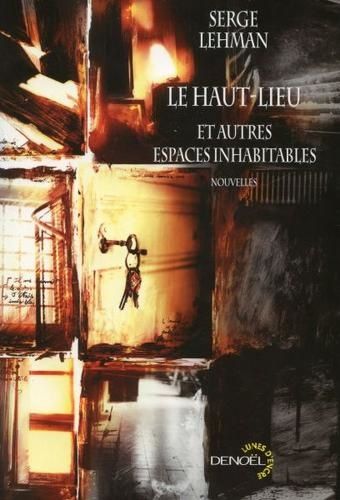

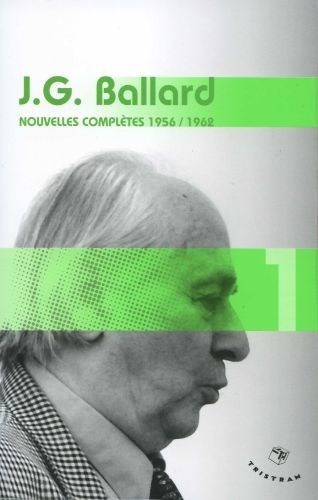









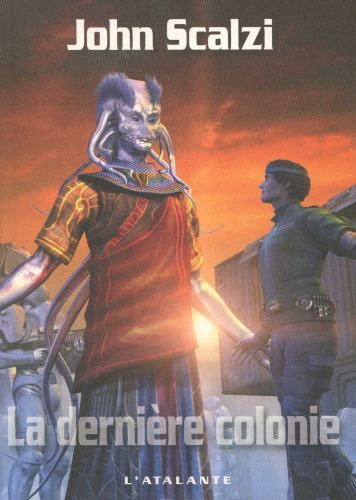



/image%2F1385856%2F20150204%2Fob_660a87_georges-abdaloff-croque-par-christell.jpg)