
DOCTOROW (Cory), Dans la dèche au Royaume Enchanté, traduit de l’américain par Gilles Goulet, [Paris], Gallimard, coll. Folio Science-fiction, [2003] 2008, 229 p.
Voilà un bouquin dont vous avez nécessairement entendu parler. Enfin, « vous »… J’entends par-là les adolescents attardés qui lisent de la SF et autres geeks qui consument leur non-vie sur le ouèbe pendant que là, dehors, en ce moment-même, et par cette chaleur, les gens honnêtes, intelligents et de bon goût travaillent, battent leur femme et, des fois, votent. C’est qu’on en a beaucoup parlé, de ce Dans la dèche au Royaume Enchanté, et plus encore, à vrai dire, de son auteur, l’omniprésent activiste libertaro-internaute Cory Doctorow. Je ne vais donc pas revenir ici sur le monsieur, d’autres en ont très bien parlé (voyez par exemple là, ce qui vous permettra accessoirement d’accéder à ses œuvres complètes – in english in ze text – gratuitement et légalement, elle est pas belle la vie ?). Pour dire les choses autrement, et employer l’expression consacrée : il y a eu un sacré buzz autour de ce bouquin. Enfin, surtout autour de son auteur.
Perso – ça doit être un reste de ma crise d’adolescence tardive –, j’ai tendance à me méfier du buzz. Et, honnêtement, si les idées prônées par le monsieur ne me paraissent pas inintéressantes, loin de là, je n’en ferais pas non plus pour ma part un cheval de bataille ; je ne me sens de toute façon que rarement militant... Bon, tout ça pour dire que, en dépit de la facilité d’accès aux œuvres de Cory Doctorow, je n’en avais jamais lu jusqu’alors, et je ne m’en portais pas plus mal (mais bon : mon anglais est médiocre, et j’aime pas lire sur un écran – ça, c’est bien un des rares aspects par lesquels je suis un vieux réac). Et les critiques que j’ai pu lire ici ou là de ce Dans la dèche au Royaume Enchanté étaient dans l’ensemble plutôt mitigées ; ça sentait la baudruche qui fait « pschiiiiiiiiit », pour citer un ancien haut-fonctionnaire… Sans doute est-ce en fait une des raisons pour lesquelles j’ai finalement fait l’acquisition et la lecture de ce court roman – révolte adolescente toujours – ; ça, et peut-être aussi – j’ai honte – la couverture assez sympa, même si sans grand rapport avec le contenu. Et là…
Comment dire.
Je suis un peu embêté, du coup.
Serais-je moi aussi une victime du buzz ? A priori, non, voyez plus haut. Et puis d’ailleurs, d’autant plus non... que j’ai l’impression d’être beaucoup plus enthousiaste pour ladite chose que bon nombre des critiques autrement plus compétents que votre médiocre serviteur qui ont eu l’occasion de s’exprimer à ce sujet. Et…
Comment dire.
…
Je ne prétendrai pas que Dans la dèche au Royaume Enchanté est un chef-d’œuvre de la littérature contemporaine, ça serait ridicule. Je ne prétendrai même pas, jouant le jeu de la ghettoïsation science-fictionnelle, que Dans la dèche au Royaume Enchanté est un chef-d’œuvre « de la science-fiction ».
Pourtant, j’ai adoré, hein.
Mais ce n’est même pas cela qui importe vraiment.
Non, je suis convaincu que vous devez le lire, parce que…
Heu…
Parce que c’est quelque chose…
…
Voilà : c’est « quelque chose ». Quelque chose d’important, même. En dépit de tout ce qu’on pourrait lui reprocher (j’y viendrai), et au-delà du buzz, Dans la dèche au Royaume Enchanté me paraît être un de ces bouquins que l’on doit avoir lu, que l’on aime ou pas. Quant à expliquer pourquoi, je ne suis pas certain d’en être capable… Bon, on verra bien.
Le cadre, tout d’abord. Un futur relativement proche, vers la fin du XXIe siècle. Le monde tel que nous le connaissons n’est plus : place à la Société Bitchun. Dans celle-ci, la mort a été vaincue : en cas de fâcheux accident, hop, on produit un clone, et il suffit ensuite d’y charger une sauvegarde, comme dans un jeu vidéo. Ou, à la limite, si vous voulez prendre un peu de distance, vous pouvez choisir le « temps mort » : vous vous endormez, et vous vous réveillez quand vous le voulez, dans 10, 20, 30, 100, 1000, 10 000 ans… Le « héros » du roman, Julius, est ainsi un jeune homme en dépit de ses 150 ans et de ses décès occasionnels.
Mais ce n’est pas tout : du fait de nouvelles découvertes dans le domaine énergétique, la Société Bitchun a également vaincu le travail. Les gens – joie ! joie ! – n’ont plus besoin de travailler, ils ne travaillent éventuellement que s’ils en ont envie (remember Fourier, dans un sens) : tout, dans la Société Bitchun, est loisir. Si Julius a obtenu trois doctorats, appris dix langues étrangères, composé plusieurs symphonies, et s’il s’investit aujourd’hui dans le bon fonctionnement de Disney World, ce n’est pas dans une optique carriériste, ou parce qu’il est nécessaire de travailler pour « gagner sa vie », selon l'horrible et stupide expression, mais simplement pour passer le temps, par plaisir, par envie. Ca tient de l’utopie, non ? « Et comment ! », fulmine l’encravaté sarkozyste sorti d’HEC. « Ca ne tient pas ! Et l’argent, alors ? A moins que tout cela ne soit COMMUNISTE ?!? » Mais non ; simplement, l’argent non plus n’existe pas dans la Société Bitchun, qui est une sorte de méritocratie ultime. L’argent a en gros été remplacé par le whuffie. Le whuffie, c’est un peu un « blog rank », « google rank », ou ce que vous voudrez, permanent et attaché à la personne ; ou un score de « réputation », comme dans un jeu vidéo, une fois de plus. Les humains, nécessairement, sont tous connectés en permanence au réseau, et ils ont ainsi en permanence accès à leur propre whuffie et à celui des gens qu’ils croisent. Si vous faites des choses chouettes, si l’on parle de vous en bien, si vous fréquentez des gens qui ont un bon whuffie, alors votre whuffie augmente ; et si votre whuffie est élevé, les gens tiendront compte de votre opinion, vous aurez toujours une table dans les meilleurs restaurants, une chambre dans les meilleurs hôtels, une place réservée dans les navettes spatiales, une voiture, de la bonne bouffe, etc. Par contre, si vous multipliez les boulettes (ou si vous ne faites rien…), si l’on dit du mal de vous ici ou là, si vous fréquentez des gens avec un whuffie faible, alors votre whuffie dégringole, éventuellement jusqu’à zéro. Et là, en gros, vous n’existez pas : vous êtes à la rue, les gens vous bousculent sans vous voir, ou détournent le regard s’ils ont le malheur de consulter votre whuffie… Bref : le whuffie, c’est la vie. Vous voyez l’expression saugrenue récurrente dans les films ricains, « c’est pas un concours de popularité » ? Ben là, si, justement : la vie dans son ensemble est toujours et plus que jamais un concours de popularité ; il n’y a plus de façade mesquine, ni d’alternative : pour exister, vous devez être reconnu, vous devez agir et faire parler de vous en bien (au moins un minimum : certains, après tout, se content de peu). Et le whuffie ne se capitalise pas vraiment, pas plus qu’il ne s’hérite totalement : il est en fluctuation constante, oscillant en permanence du haut vers le bas, ou du bas vers le haut. La Société Bitchun est ainsi, oui, une méritocratie ; le problème, bien sûr, est que le mérite ne s’évalue pas objectivement. Ce sont les autres qui jugent de votre mérite ; ainsi, ce qui fait « l’intérêt » d’une personne n’est en définitive qu’indirectement ce qu’elle fait : ce qui compte avant tout, c’est le regard des autres, ce qu’elles pensent et disent de cette personne. Et cela n’est pas forcément « juste », loin de là, d’autant que le fonctionnement intrinsèque de la Société Bitchun, calibré sur le consensus et l’opinion générale, ne facilite pas exactement l’audace, l’innovation et l’expression personnelle, mais tend plutôt à favoriser le conservatisme et les pures techniques de communication, stratégies médiatiques éventuellement creuses, mais séduisantes.
Et Julius va en faire l’amère expérience, l’utopie de la Société Bitchun devenant peu à peu pour lui un enfer. Car si la Société Bitchun a débarrassé l’humanité de la mort, du travail et de l’argent, autant de données fondamentales de notre société contemporaine, elle n’en a pas moins conservé, par le biais du whuffie, ces autres enjeux déterminants que sont le pouvoir et, indirectement, le cul (cela dit, il n’y a que peu de fesse dans le roman ; eh, les personnages sont des geeks, après tout… mais le whuffie joue son rôle là aussi, bien sûr).
Julius, justement. Parlons-en. Julius, qui a assisté à l’émergence de la Société Bitchun, a vécu pas mal de choses, et a fait pas mal de trucs. Mais il est régulièrement pris d’une puissante et déraisonnable passion pour Disney World (celui de Floride), où il va de temps à autre se ressourcer, concrétisant ainsi un vieux fantasme régressif. Et puis, la dernière fois, il a décidé de prolonger l’expérience, et est finalement resté à Disney World. Il a rejoint une des nombreuses adhocs qui s’occupent de la gestion du parc, et y a rencontré l’amour, en la personne de la charmante Lil. Tout allait bien dans le meilleur des mondes, très Bitchun, avec de la joie et de la barbe-à-papa, et des crétins de cosplayers (bonjour les pléonasmes) en veux-tu en voilà. Et puis Dan a débarqué, comme ça ; Dan, un missionnaire de la Société Bitchun, qui avait voué sa vie à convertir les réacs isolés aux bienfaits de la nouvelle société ; autant dire quelqu’un qui avait un putain de whuffie à l’époque où Julius a fait sa connaissance ! Mais c’est fini, tout ça : la Société Bitchun est partout, et Dan s’ennuie, tourne suicidaire, le whuffie à plat… Bref, pour lui, c’est le moment où jamais d’aller faire un saut à Disney World. Et puis…
Et puis Julius est assassiné.
Bon, c’est pas bien grave, en même temps : il venait de se sauvegarder. Mais voilà : le temps qu’il se « réveille », une nouvelle adhoc, menée par la très efficace Debra qui s’était occupée précédemment du parc Disney chinois, s’est installée à Disney World, et « s’est emparée » du Hall Of Presidents, avec un concept révolutionnaire qui lui fait gagner plein de whuffie. Pour Julius, à l’évidence, les deux événements sont liés ; et il voit clair dans le jeu de Debra : elle compte bien s’emparer de tout le parc, au mépris de l’esprit Disney, esprit d'entraide et de coopération ! Pas question qu’elle mette la main sur la Mansion, la maison hantée. Julius est près à tout pour éviter cela ; à tout, et même et surtout le pire. La paranoïa aidant, s’engage bientôt une « guerre » d’adhocs en plein cœur du Royaume Enchanté, les concepts et philosophies Disney-Bitchun s’affrontant pour une poignée de whuffie… or le whuffie de Julius commence à dégringoler.
J’imagine que vous vous en doutez déjà, mais ça ne coûte pas grand chose de le dire : ce qui fait l’intérêt de Dans la dèche au Royaume Enchanté, ce ne sont ni les personnages, ni l’histoire, ni le style (j’y reviendrai), mais bien avant tout le cadre. Et, sur ce plan, c’est une très grande réussite. Avouons que cela fait plaisir, pour une fois, de tomber sur un roman de SF qui développe autant d’idées extrêmement riches en si peu de pages… Et le whuffie ! Quelle idée géniale… Il y a de cela quelque temps, je vous avais causé du numéro de Yellow Submarine intitulé Envies d’utopie, et j’avais dit plein de bêtises à cette occasion. J’avais aussi fait part d’une certaine déception… Mais voilà, justement : Dans la dèche au Royaume Enchanté est à mon sens le type même de ce que la rencontre entre l’utopie et la science-fiction peut produire de meilleur. J’ai même envie de dire que je n’ai pas lu de variation sur l’utopie aussi riche, lucide et pertinente depuis, disons, la « trilogie martienne » de Kim Stanley Robinson (que je cite d’autant plus volontiers qu’il semble de bon ton, ces derniers temps, de lui casser du sucre sur le dos…). (Note : il y aurait peut-être bien une exception, à ce que j’ai cru comprendre, avec la « Culture » de Iain Banks, mais je n’en ai encore jamais lu le moindre roman, honte sur moi…) Et cela me paraît d’autant plus frappant et indéniable que Cory Doctorow parvient à mêler ici les deux versants du mode utopique que j’avais naïvement distingués, à savoir l’utopie programmatique et l’utopie critique, et à briller dans les deux cas.
La Société Bitchun, à vue de nez, à tout d’une utopie « au sens vulgaire » : si elle est dans un sens ou-topos (du fait de la césure historique : Doctorow, et on le comprend, ne s’étend pas sur les procédés de sauvegarde ou la révolution énergétique), elle apparaît avant tout comme eu-topos, en s’attaquant en priorité à ces éléments fondamentaux de la société contemporaine que sont la mort, le travail et l’argent. Ici, Doctorow emprunte plus ou moins consciemment à Saint-Simon, à Fourier, à Lafargue, parmi tant d'autres, et va plus loin encore ; il nous montre, certes au prix d’un artifice de narration, la possibilité d’une société « idéale », débarrassée des rivalités de classes et de nations, débarrassée des institutions politiques également, une société où la liberté est le maître-mot, sans pour autant (en principe…) générer les inégalités insurmontables et les injustices « pragmatiques » auxquelles semble nous condamner l’ultra-libéralisme économique dominant. J’avoue que – et je m’étais déjà exprimé rapidement à ce sujet – retourner à l’interrogation politique « pure », déliée des prétendus « impératifs » économiques, me paraît particulièrement salutaire, et pour le coup jubilatoire… Et le cadre du Royaume Enchanté, bien entendu, est idéal pour inscrire cette utopie dans le « réel ». Et c’est ici que s’opère le retournement de l’utopie programmatique à l’utopie critique. Le monde que nous décrit Doctorow, à bien des égards, semble une extrapolation de son discours contemporain sur Internet, etc. Mais Doctorow, en même temps, et en dépit de son « whuffie » dont on peut bien dire qu’il est énorme (on a assez répété ici ou là que – pour citer la quatrième de couverture – le magazine Forbes l’a classé « parmi les personnalités les plus influentes du Web »), se montre lucide, et nous tend par ce biais un miroir déformant de certaines dérives que l’on peut d’ores et déjà constater au travers de l’expansion des NTIC, nous renvoyant au fameux dicton – pour une fois pertinent ! – selon lequel l’enfer est pavé de bonnes intentions. La Société Bitchun, entièrement fondée sur le whuffie, est une méritocratie, ainsi que nous l’avons déjà vu ; mais elle porte en elle-même le germe de sa propre décadence (tiens, c'est très grec, ça...), l’importance du paraître et du jugement d’autrui corrompant bientôt la méritocratie en médiacratie, puis en médiocratie… et elle peut, de la sorte, se montrer particulièrement oppressive, en dépit de l’absence d’institutions politiques (il y a bien les adhocs, mais elles fonctionnent sur une base de pur volontariat, et c'est là encore en définitive le whuffie qui domine). Le Royaume Enchanté, clinquant, absurde… et un tantinet beauf tout de même, en est l’illustration la plus parlante que l’on puisse concevoir. D’autant qu’on ne saurait trouver plus geek.
Et c’est pour cette raison que les critiques régulièrement formulées à l’encontre de l’intrigue très « limitée », des personnages creux et du style « journalistique » de ce roman ne me paraissent pas vraiment porter.
L’intrigue est « limitée » ? C’est vrai. J’ajouterai même que le dernier twist était à mes yeux sacrément dispensable (ou peut-être, plus exactement, maladroitement amené). Effectivement, tout au long du roman, on voit en gros une bande de crétins se friter métaphoriquement la cheutron pour le train-fantôme de Disney World : alors on ne s’ennuie pas, non, mais, oui, ça fait léger, comme enjeu… et c’est tant mieux. Non, rien d’apocalyptique ou de déterminant, rien d'héroïque non plus, mais une bonne grosse tranche de médiocre pour laquelle des médiocres s’enflamment. La vraie vie, quoi ; et aussi celle du ouèbe. Devant la mesquinerie des affrontements de Julius et Débra pour le contrôle de la Mansion, j’avoue avoir régulièrement pensé aux ahurissants « débats » qui polluent régulièrement le ouèbe et auxquels, mea culpa, je prends ma part comme tout le monde : prenez, ces derniers temps, « l’affaire » du bouquin de Sylvain Gouguenheim, ou une certaine annulation de mariage (groumf...), voire le retour en France d’une vacancière de longue durée ; le mot magique « Sarkozy », partout et tout le temps ; ou, sur les forums de SF, les mots magiques « Bragelonne », « Van Vogt » (gnihihihihi !), fut un temps « Dantec » ou « Damasio » (sans parler de Houellebecq…), mais aussi « critique/chronique/objectivité/subjectivité », « définition du genre », « mort du genre », « putain de fantasy » et j’en passe… C’est pas plus glorieux, non ? De même pour ce qui est de l’enthousiasme démesuré de certains geeks pour leur sujet de prédilection (voyez les pages hilarantes sur le recrutement de Kim…), dont j’avoue être régulièrement coupable, et peut-être même en ce moment précis… Et, à mon sens, ça n’en rend Dans la dèche au Royaume Enchanté que plus pertinent. Autrement dit : on est quand même une belle bande de crétins, hein…
Et de geeks, bien sûr, pour beaucoup. Comme Cory Doctorow semble-t-il, et comme ses personnages assurément. D’où leur caractère « en creux », à certains égards… Mais, au-delà d’une éventuelle incompétence de l’auteur qu'on stigmatiserait peut-être un peu trop hâtivement, je dois dire que je le trouve parfaitement approprié, dans ce monde où l’homme se retrouve en quête d’être (c’est bien toute la problématique tournant autour du personnage de Dan), et où il n’existe en définitive qu’en tant qu’il est perçu par les autres : peut-on demander à un score de whuffie et à un réseau de connaissances d’avoir de la profondeur ? J’en doute. Et, dans la lignée des archétypes, j’ai tendance à croire que l’on a souvent lu bien pire… voire que l’on fait quotidiennement bien pire : juger un personnage à son whuffie et à son cercle, est-ce vraiment pire que de traduire « Qui êtes-vous ? » par « Quel est votre travail ? », comme cela semble être aujourd’hui la règle ?
Non, franchement, on a lu pire. Et il en va de même à mes yeux pour ce qui est du style « journalistique ». Certes, Cory Doctorow, dans ce roman en tout cas, n’est pas un grand styliste ; en même temps, il ne pique pas les yeux, et c’est déjà pas mal… Avouons qu'en SF notamment, on a souvent encensé bien pire. Et surtout, en fait de phrasé « journalistique », j’y vois surtout un assez remarquable sens de la formule, pour le coup parfaitement approprié. Un incipit tel que celui de Dans la dèche au Royaume Enchanté, personnellement, je ne crache pas dessus ! Et on pourrait citer bien d’autres passages dans ce goût-là. Et puis, honnêtement : voir quelqu’un aborder des thèmes aussi riches et complexes avec un style toujours simple et fluide, et souvent drôle, je trouve ça franchement très appréciable… C’est à vrai dire presque une leçon, que certains obscurantistes pédants prenant prétexte de leur prétendue profondeur, ne dépassant pas toujours le catalogue de citations absconses, pour faire dans l’hermétique écorcheur d’yeux et d’oreilles à défaut d’entendement, pourraient utilement méditer. Je trouve.
Cela dit, Nébal est un con…
Aussi n’ai-je pas forcément été très pertinent dans cette longue note, mea culpa : peut-être ai-je dit des bêtises grosses comme moi, et sans doute y avait-il bien mieux à dire. Sans doute… Raison de plus pour en faire l’expérience, non ? Quand bien même je l’ai adoré, je ne garantis pas que vous aimerez Dans la dèche au Royaume Enchanté. Mais je vous engage fortement à le lire : d’une manière ou d’une autre, c’est « quelque chose ». Et c’est bien plus riche que ça n’en a l’air. Comme une sorte de SF idéale, dans un sens...



/image%2F1385856%2F20160114%2Fob_cfb8b0_caligari.jpg)


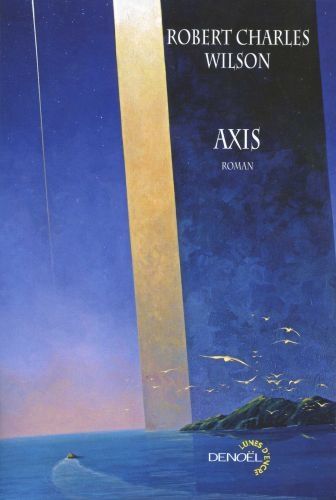

 Un sixième de Michelle Bigot, Claude Mamier, Gudule, Lucie Chenu, et un demi Sébastien Bermès.
Un sixième de Michelle Bigot, Claude Mamier, Gudule, Lucie Chenu, et un demi Sébastien Bermès.
 Sébastien Bermès ; au premier plan à gauche, Claude Mamier.
Sébastien Bermès ; au premier plan à gauche, Claude Mamier. M'âme Martin.
M'âme Martin. M'âme Martin et Jeanne-A Debats.
M'âme Martin et Jeanne-A Debats. Christophe Sivet ; on entrevoit derrière Jeanne-A Debats (debout) et Michelle Bigot (assise).
Christophe Sivet ; on entrevoit derrière Jeanne-A Debats (debout) et Michelle Bigot (assise). Un bout de la tête de Jeanne-A Debats, Christophe Sivet, Michelle Bigot, Claude Mamier, la main de Gudule qui signe, Lucie Chenu, Sébastien Bermès et Nicolas Bally ; debout, Michelle Charrier.
Un bout de la tête de Jeanne-A Debats, Christophe Sivet, Michelle Bigot, Claude Mamier, la main de Gudule qui signe, Lucie Chenu, Sébastien Bermès et Nicolas Bally ; debout, Michelle Charrier. Gudule.
Gudule. Gudule et Lucie Chenu.
Gudule et Lucie Chenu. Au fond, un demi Claude Mamier, Gudule, Lucie Chenu et un tiers de Sébastien Bermès ; premier plan, Sire Cédric et Nicolas Bally.
Au fond, un demi Claude Mamier, Gudule, Lucie Chenu et un tiers de Sébastien Bermès ; premier plan, Sire Cédric et Nicolas Bally. Jeanne-A Debats, Christophe Sivet et Michelle Bigot.
Jeanne-A Debats, Christophe Sivet et Michelle Bigot. Une demie Nicole Hibert, Jeanne-A Debats et Michelle Bigot.
Une demie Nicole Hibert, Jeanne-A Debats et Michelle Bigot. Jean-Daniel Brèque.
Jean-Daniel Brèque. Debout, devant la table, Michelle Charrier, et au fond, Jean-Daniel Brèque ; pour le reste, on ne distingue vraiment que Claude Mamier et Lucie Chenu...
Debout, devant la table, Michelle Charrier, et au fond, Jean-Daniel Brèque ; pour le reste, on ne distingue vraiment que Claude Mamier et Lucie Chenu... Au fond, debout, un demi Jean-Daniel Brèque ; assis, Jeanne-A Debats, Christophe Sivet, Michelle Bigot, Claude Mamier, Gudule, une demie Lucie Chenu, et au premier plan Sébastien Bermès.
Au fond, debout, un demi Jean-Daniel Brèque ; assis, Jeanne-A Debats, Christophe Sivet, Michelle Bigot, Claude Mamier, Gudule, une demie Lucie Chenu, et au premier plan Sébastien Bermès. Jean-Daniel Brèque... heu... ensuite, je savions pas qui... puis Nicole Hibert et Jeanne-A Debats.
Jean-Daniel Brèque... heu... ensuite, je savions pas qui... puis Nicole Hibert et Jeanne-A Debats. Jean-Daniel Brèque, Jeanne-A Debats, Christophe Sivet, Michelle Bigot, Claude Mamier, pas du tout Gudule mais bel et bien Michelle Charrier, et Lucie Chenu ; à droite, une petite partie du fan club de Sire Cédric empêche de le voir, ainsi que Nicolas Bally et Sébastien Bermès (debout, de dos, je suppose qu'il s'agit de David Duquenoy).
Jean-Daniel Brèque, Jeanne-A Debats, Christophe Sivet, Michelle Bigot, Claude Mamier, pas du tout Gudule mais bel et bien Michelle Charrier, et Lucie Chenu ; à droite, une petite partie du fan club de Sire Cédric empêche de le voir, ainsi que Nicolas Bally et Sébastien Bermès (debout, de dos, je suppose qu'il s'agit de David Duquenoy). Michelle Bigot, Claude Mamier, Michelle Charrier, Gudule et un demi Sébastien Bermès.
Michelle Bigot, Claude Mamier, Michelle Charrier, Gudule et un demi Sébastien Bermès. Nicolas Bally, Lucie Chenu et Lise N.
Nicolas Bally, Lucie Chenu et Lise N. Nicolas Bally et Sire Cédric.
Nicolas Bally et Sire Cédric. La même chose, le monsieur à droite je savions pô (... ?), puis un demi Jean-Daniel Brèque.
La même chose, le monsieur à droite je savions pô (... ?), puis un demi Jean-Daniel Brèque. Sébastien Bermès.
Sébastien Bermès. Le rayon mangas / comics où avait lieu la dédicace (les auteurs et illustrateurs étaient entassés dans le fond).
Le rayon mangas / comics où avait lieu la dédicace (les auteurs et illustrateurs étaient entassés dans le fond). On passe au resto, le soir, et... je sais pas qui c'est. Mais j'ai cru comprendre que la dame avait dirigé le Fleuve Noir fut un temps (EDIT : ah ben maintenant je sais, donc : Nicole Hibert et Laurent Delpit).
On passe au resto, le soir, et... je sais pas qui c'est. Mais j'ai cru comprendre que la dame avait dirigé le Fleuve Noir fut un temps (EDIT : ah ben maintenant je sais, donc : Nicole Hibert et Laurent Delpit). David Duquenoy, M'âme Martin, et... heu... je sais pô.
David Duquenoy, M'âme Martin, et... heu... je sais pô. Lucie Chenu et... heu... je sais pas non plus (EDIT : mais si, voyons ! Nienna et Deedlot).
Lucie Chenu et... heu... je sais pas non plus (EDIT : mais si, voyons ! Nienna et Deedlot). Je sais pas pour les jeunes filles à gauche (EDIT : mais si, donc ! Un tiers de Nienna et Deedlot), mais sinon Sébastien Bermès et Jeanne-A Debats.
Je sais pas pour les jeunes filles à gauche (EDIT : mais si, donc ! Un tiers de Nienna et Deedlot), mais sinon Sébastien Bermès et Jeanne-A Debats. 






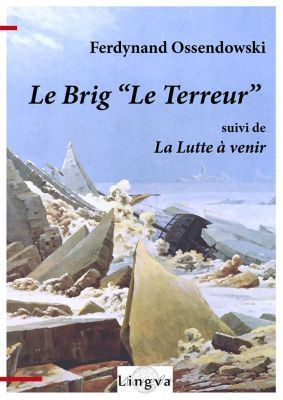


/image%2F1385856%2F20150204%2Fob_660a87_georges-abdaloff-croque-par-christell.jpg)