"Bifrost", n° 53

Bifrost, n° 53, Saint Mammès, Le Bélial’, janvier 2009, 182 p.
Bon, ayant participé – même si ce n’est qu’un chouia – à la chose, il ne me paraît pas honnête d’en faire un compte rendu…
Donc je vais faire ma feignasse, et me contenter de rappeler que s’y trouvent quatre de mes comptes rendus : La Nuit de la lumière de (feu) Philip José Farmer (pp. 77-79), À la pointe de l’épée d’Ellen Kushner (pp. 86-87), Crépuscule d’acier de Charles Stross (pp. 90-91), et enfin Perdido Street Station de China Miéville dans le guide de lecture consacré à l’auteur (pp. 146-149).
…
Mais il y a quand même une partie de ce numéro que j’ai envie de commenter (parce que c’est le jeu) : les Razzies 2009, le prix du pire. Juste quelques remarques en passant, sur ce que j’ai pu en lire.
Je note, parmi les nominés, catégorie « pire nouvelle francophone », Maudit soit l’éternel ! de Thierry Marignac, qualifié à juste titre de « sous Frédéric Dard anti-cureton, une infâme bouillie dure à digérer (mais qui, pour une raison incompréhensible, fait rigoler les mongoliens) » ; il n’a pas eu le prix, c’est donc qu’il y avait du lourd en face…
Rien à dire pour la « pire nouvelle étrangère », je n’ai rien lu de tout ça.
Du lourd aussi, à vue de nez, dans la catégorie « pire roman francophone », mais n’ayant lu aucune de ces horreurs probables, je n’ai rien à en dire.
Par contre, en « pire roman étranger » et « pire traduction », le lauréat est Code source de William Gibson : ça semble se vérifier, je suis le seul à avoir aimé ce bouquin… Franchement, quitte à se payer un gros machin, le dernier G.P.I. (pas lu) m’aurait semblé plus approprié, ou, dans la catégorie « parution longtemps attendue d’un truc qui se révèle nul, en fait », Gravité de Stephen Baxter, pas mentionné (mais, il est vrai, publié au Bélial’). Certes, pour la « pire traduction », l’allusion était tentante ; mais, parmi les nominés, j’aurais pour ma part récompensé Élizabeth Vonarburg pour Les Disparus de Kristine Kathryn Rusch.
Le prix de la pire couverture a été très justement renommé « prix Jackie Paternoster de la pire couverture », ce qui permet de fait un doublé en l’attribuant aux éditions de l’Atalante (il n’est pas cité ici, mais j’avais déjà dit deux mots de ce que je pensais de la couv’ de La Dernière Colonie de John Scalzi, attention les yeux…). Rien à redire.
Du lourd encore pour le prix de la non-fiction, même si je trouve le jury bien dur avec Jeanne-A Debats ; figurait parmi les nominés « l’immense Roland C. Wagner » pour sa croisade anti-Vélum ; je lui aurais volontiers donné le prix, plus généralement pour son comportement sur le ouèbe. J’accorderais dans mon immense mansuétude une circonstance atténuante à ceux qui l’ont suivi, en raison du buzz entretenu (trop longtemps et maladroitement, qui plus est) sur ce bouquin, très bon certes, mais quand même pas si bon que ça.
Sans surprise, j’aurais pour ma part donné le « prix de l’incompétence éditoriale », parmi les nominés, aux Moutons électriques « pour leur célèbre suivi de corrections sur Fiction n° 8 ». En notant cependant que Bifrost, des fois, c’est pas beaucoup mieux, mais bon, quand même...
Le « prix putassier » a toujours été mon préféré : parmi les nominés, Gilles Dumay, Albin Michel, Gérard Klein, Mnémos, Pygmalion, Télémaque et Les Trois Souhaits avaient tous de bonnes raisons d’y figurer. Le prix est revenu à Mnémos, mais je l’aurais pour ma part sans hésiter attribué à Télémaque pour Un peu de ton sang de Theodore Sturgeon (ça m’avait vraiment énervé, cette arnaque…).
Rien à dire sur le « Grand Master Award », je ne suis pas qualifié pour en juger.
Puis vient enfin le « prix des lecteurs ». Je n’ai pas voté, pas plus que l’année dernière. Ce prix me paraît en effet être une erreur. Là où un jury, dont les membres sont connus (malgré le pseudonyme transparent), peut se permettre d’être bête et méchant, la populace ainsi amenée à s’exprimer verse quasi nécessairement dans le lynchage et la vendetta, protégée par son anonymat et l’effet de masse. Ça n’a pas manqué cette année, avec en troisième place le Cafard cosmique ; promis, on fera mieux la prochaine fois. Sans surprise, Milady a gagné, et l’Atalante eu sa deuxième place. Quitte à taper sur les éditeurs, cela dit, j’aurais pour ma part employé le même argumentaire que pour l’Atalante, mais en l’appliquant à J’ai lu, parce que, à ce stade, c’est quand même triste, ma bonne dame.
« Et on s’amuse, et on rigole… »

/image%2F1385856%2F20160114%2Fob_cfb8b0_caligari.jpg)




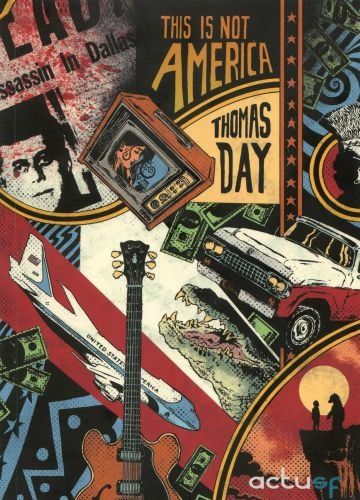









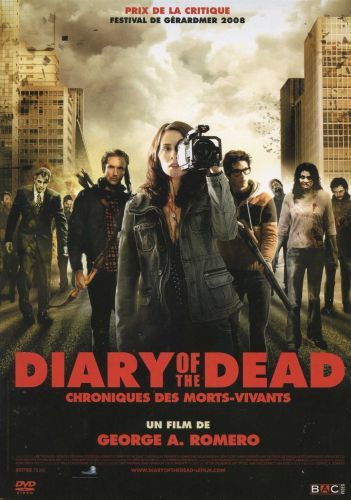





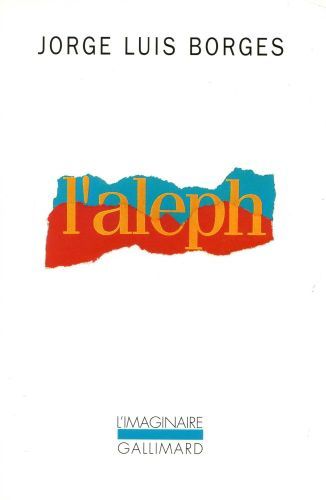

/image%2F1385856%2F20150204%2Fob_660a87_georges-abdaloff-croque-par-christell.jpg)