Black Library Célébration 2019
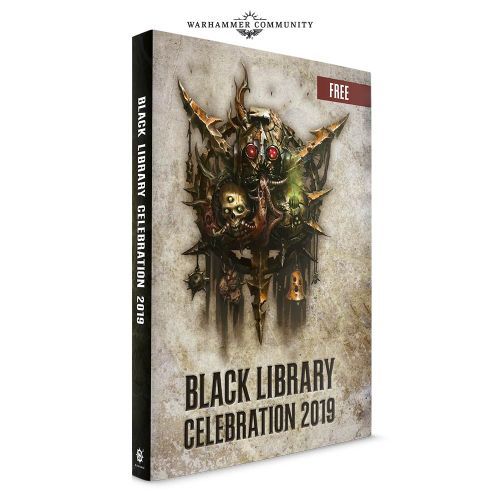
Black Library Célébration 2019, [Black Library Celebration 2019], traduit de l’anglais par Kevin Miane et Matthieu Volait, Nottingham, Black Library, 2019, 199 p.
La Black Library, l’organe éditorial de Games Workshop, produit chaque année un petit recueil gratuit en guise d’appeau promotionnel (compilant sauf erreur des récits déjà publiés en ligne). J’avais rapidement évoqué Black Library Célébration 2020 en chroniquant Le Culte de la Spirale Sacrée, et le bilan n’était pas gégé, mais mon aimable boutiquier Warhammer m’a par la suite offert le présent volume, soit le recueil de 2019.
Et c’était un recueil largement placé sous le signe de Nurgle – remarquable anticipation, parce que là, en mars et avril 2020, le Grand-Père est décidément hyperactif…
Le recueil comprend six nouvelles en tout, de taille variable. Côté Warhammer 40,000, on est assez gâté, au moins en quantité (...), avec quatre nouvelles, dont une associée à « The Horus Heresy » et une autre censément à « The Horus Heresy : Primarchs », mais on verra qu’il y a là comme un petit souci. Les deux nouvelles restantes sont associées à Age of Sigmar, sans plus de précisions.
Procédons dans l’ordre. Le recueil s’ouvre sur la nouvelle de « The Horus Heresy », à savoir « Les Pièces sont en place », de Gav Thorpe. Ce récit se déroule très peu de temps avant le Siège de Terra par les forces d’Horus, et met en scène Malcador le Sigillite, peut-être le plus proche conseiller de l’Empereur. Et le bonhomme n’est pas très confiant, à la veille de la plus cruelle bataille jamais livrée par l’Imperium. Pour préparer ses défenses, le conseiller… joue à un wargame ? Plutôt une sorte de jeu de plateau, incluant des cartes, et la description des combos, fonction de votre background, évoquera le Kamoulox ou un cadavre exquis (je me suis demandé s’il s’agissait du régicide, variante des échecs souvent mentionnée dans cet univers, mais je n’ai pas l’impression que ça colle – n’hésitez pas à me renseigner à ce propos). En tout cas, l’Empereur est ici typiquement l’adversaire chiant – pas forcément parce qu’il est fort, mais parce qu’il plie abusivement les règles à sa volonté et humilie Malcador au nom de la « guerre psychologique ». Bien sûr, il s’agit pour le Maître de l’Humanité de pousser le Sigillite dans ses derniers retranchements pour qu’il se dépasse, mais la cruauté des attaques impériales constitue le meilleur moment de la nouvelle, je suppose – car l’Empereur joue ici sur les doutes de Malcador, avec la possibilité que ses insultes soient fondées et sincères. Hélas, cette nouvelle ne m’a pas paru terrible – mais peut-être pour une bonne part parce que je suis passé à côté des très, très nombreuses allusions qu’elle comprend semble-t-il, ayant trait aux événements récents et tout autant à venir sous peu de l’Hérésie d’Horus. Mais bon, mon gros problème, ç’a été la forme – un vrai crève-cœur, à la traduction très lourde, fait d’autant plus sensible que la nouvelle est saturée de références cryptiques qui ressortent très mal ainsi… Parmi lesquelles, j’imagine, ce surnom (?) de l’Empereur, qui est systématiquement appelé « Révélation » ici ? Là encore, des références me manquent sans doute. Le principe même de la nouvelle autorisait des délires surréalistes qui auraient pu contribuer à élaborer une ambiance correcte, au-delà du principe de base de la nouvelle, somme toute convenu, mais pas inintéressant. En l’état, cependant, cette nouvelle ne m’a donc pas parlé, et vaut bien d'être qualifiée de déception.
Ensuite… Il y a un souci – un bug, si j’ose dire, aha. Une mouche à peste, j’imagine. En effet, la nouvelle suivante, « Le Cadeau du Grand-Père », de Guy Haley, est censée relever de « The Horus Heresy : Primarchs », mais ça n’est clairement pas le cas : sa dépiction de la Death Guard est visiblement bien postérieure à l’Hérésie, et les allusions faites à l’Empereur témoignent bien de ce qu’il pourrit/ne pourrit pas sur le Trône d’Or depuis bien, bien longtemps. Et Mortarion n’apparaît nulle part ici. J’ai cru comprendre, en fait, que le recueil VO contenait une nouvelle différente, et dans laquelle figurait bien Mortarion, si sa temporalité n’était pas certaine ? Bizarre… Et pas sûr ? Quoi qu’il en soit, la présente nouvelle, très courte, ne présente guère d’intérêt : nous y voyons un monde impérial en proie à la peste réclamer, sans savoir de quoi il retourne au juste, le soutien de Nurgle via la Death Guard pour y mettre un terme – le genre de facepalm aux proportions cosmiques bien à sa place dans l’univers impitoyable (Daaaaallaaaaaaas…) de Warhammer 40,000. Mais, pour le coup, cette nouvelle n’apporte absolument rien… Elle évoque le genre de petits textes d’ambiance que l’on trouve régulièrement dans les pages de White Dwarf, et qui ont pour seule fonction d’illustrer à la hâte tel ou tel point de règles ou conseil de peinture. Ça n’est pas désagréable, mais ça s’oublie aussitôt lu.
On passe ensuite aux deux nouvelles se déroulant « officiellement » durant le XLIe Millénaire. La première s’intitule « Endurer », et est due à Chris Wraight. Là encore, la Death Guard est à l’honneur, et les Dons de Nurgle. Le titre de la nouvelle renvoie probablement à la caractéristique la plus typique de la Death Guard, mais avec un twist qui n’en est pas vraiment un, en s’appliquant également aux Space Marines loyalistes figurés en alternance par le récit, et qui en chient depuis bien trop longtemps, mais tiennent encore bon. Toujours. Malgré tout. Est-il vraiment utile, dans ces conditions, de recourir à la traditionnelle balise de spoilers ? Eh bien, non, parce que vous savez très bien de vous-mêmes ce que rapporte cette nouvelle au juste, avec sa temporalité un peu à l’arrache. La pire nouvelle du recueil en ce qui me concerne.
Bilan pas très glorieux pour les nouvelles de Warhammer 40,000 jusque-là, hein ? Mais il en reste une – la plus longue (en fait la plus longue de tout le recueil) : « La Compagnie des Ombres », de Rachel Harrison. Pourrait-elle renverser la balance ? Eh bien, avec quelques réserves non négligeables, je dirais que oui – et que c’est bien la meilleure, ou la seule bonne, nouvelle de Warhammer 40,000 dans cette Black Library Célébration 2019. Faut dire, j’avais un a priori plutôt positif, après avoir lu Marque de Foi de ladite Rachel Harrison, certes pas un chef-d’œuvre, mais un roman honnête, avec des personnages archétypaux mais relativement bien campés, et un style au-dessus de la moyenne. Autant de caractéristiques que l’on retrouve également dans cette nouvelle, antérieure, et liée au premier roman 40K de l’autrice, Dans la loyauté et la foi. La nouvelle met en scène la courageuse commissaire Severina Raine et ses troufions aigris, alors qu’un accident les fait se retrouver derrière les lignes ennemies – la mission passant avant tout, la commissaire élabore un plan la mettant personnellement en danger, et qui ne peut réussir que si elle peut se fier à ses hommes – or celui d’entre eux qui est le plus souvent mis en scène, un certain Wyck, est un sale bonhomme, haineux, borné, qui n’incite vraiment pas à la confiance… Tout cela évoque passablement « Les Fantômes de Gaunt », je suppose – aussi bien pour Severina Raine en alter ego (féminin, c'est pas encore si courant) d'Ibram Gaunt que pour Wyck en variation sur Rawne. C’est une limite de cette nouvelle, je suppose. Cela dit, elle fonctionne, ne serait-ce que parce que l’autrice caractérise bien ses personnages, ce qui atténue l’impact négatif de leur relative banalité. À vrai dire, en ce qui me concerne, la nouvelle fonctionne surtout au regard du personnage de Wyck, vraiment très réussi – c’est cette ordure que j’aimerais bien revoir. Mais, oui, « La Compagnie des Ombres » est bien la nouvelle Warhammer 40,000 (au sens large) la plus intéressante de ce recueil, clairement. Et je vais donc donner sa chance au roman Dans la loyauté et la foi sous peu – peut-être en parallèle avec « Les Fantômes de Gaunt », d’ailleurs, ça pourrait être instructif.
Puis on passe aux deux nouvelles dans l’univers d’Age of Sigmar. Et, ici, je dois faire un aveu : je connais très mal cet univers, et j’ai beaucoup de mal à le visualiser. Si le Vieux Monde était un contexte de fantasy plutôt commun (c’est peu dire, en fait), le complexe multivers des Royaumes Mortels est autrement singulier, et difficile à se figurer, d’une manière ou d’une autre. Tel est du moins mon sentiment à cet égard : trop souvent, lisant çà et là une nouvelle d’Age of Sigmar, j’ai dû me rendre à l’évidence que j’en ratais l’essentiel, parce que je n’en avais pas les codes – parfois au point de l’incompréhension totale. Cela s’était vérifié notamment à la lecture du recueil Black Library Célébration 2020, au point où j’ai lâché l’affaire sur le tard. Mais, dans le cas présent, j’ai tout de même lu ces deux nouvelles, non sans une certaine appréhension.
Pour un bilan contrasté. Concernant la première de ces nouvelles, « Don des Dieux » (décidément…) de David Guymer, mes craintes se sont rapidement confirmées – il faut dire, ai-je cru comprendre depuis, que cette nouvelle s’inscrit dans un cycle de récits courts, qui, pris dans son ensemble, pouvait éclairer cette nouvelle précisément. Mais, en l’absence de ces références… De ce héros très crâneur, je ne savais rien – du lieu de l’action non plus (un plan chaotique semble-t-il), et pas davantage de ses adversaires, des hommes-bêtes pour l’essentiel. Pourtant, j’ai trouvé la dimension horrifique de cette nouvelle relativement convaincante – là où sa dimension martiale m’a vite saoulé. En définitive, je n’en ai pas retenu grand-chose, sinon la conviction renforcée qu’acquérir les bases de l’univers d’Age of Sigmar serait un préalable nécessaire pour en apprécier ne serait-ce qu’un chouia les fictions associées.
Mais peut-être pas dans tous les cas ? En effet, la dernière nouvelle du recueil, plus longue, « Les Fantômes de Demesnus », par Josh Reynolds, s’est avérée une sacrée surprise, ici – et une bonne. Dans le cas présent, le manque de certaines clefs, sinon toutes, ne s’est pas avéré si pénalisant ; peut-être parce qu’il s’agit, au fond, d’une bonne nouvelle, et pas seulement d’une bonne nouvelle d’Age of Sigmar. Nous y suivons Gardus, personnage récurrent, un chevalier qui fut dans une autre vie (littéralement) un saint homme, guérisseur de la lèpre – et qui est toujours adoré comme tel, à son grand dam, bien des siècles plus tard, par des gens dont il ne sait rien, et qui ne savent rien de ce qu'il est devenu. De retour dans sa ville, incognito, l’ex-saint s’interroge sur son passé tandis qu’il partage le quotidien de ses fidèles qui n’ont plus que lui – à ceci près qu’ils ne savent rien de sa véritable identité. Or les terres de ces pieux malades sont convoitées par un fonctionnaire diligent… qui s’avère forcément être un séide de Nurgle – mais beaucoup moins caricatural que d’usage. Les atouts de cette nouvelle résident dans son ambiance très travaillée et, chose rare du côté de la Black Library, dans la psyché complexe de ses personnages, et au premier chef de notre vieux héros. En même temps, cette aventure a quelque chose d’un western, avec Gardus dans le rôle de l’Homme Sans Nom, seulement en moins ouvertement violent (entendre par-là qu'il peut assurément se montrer violent, et redoutable, mais l’action est cantonnée aux toutes dernières pages, assez réussies dans le genre d’ailleurs). Mais, quitte à faire dans la référence clintesque, j’ai surtout pensé à L’Homme des Hautes Plaines, pour ce personnage d’étranger mystérieux déboulant dans une ville, et dont l’aura, au moins, a quelque chose de surnaturel (si le film a quelque chose de démoniaque, ici, qui tranche sur le personnage de Gardus, croisé de Sigmar). On pourrait aussi penser aux chanbara ayant inspiré ces films, bien sûr – davantage Les Sept Samouraïs que Le Garde du corps, pour le coup. Quoi qu’il en soit, ça fonctionne très bien : l’ambiance est irréprochable, les thématiques justes, les personnages incomparablement plus profonds que d’usage dans la Black Library… En dépit de mes préventions concernant les récits d’Age of Sigmar, « Les Fantômes de Demesnus » m’a beaucoup plu – c’est clairement, de très loin, la meilleure nouvelle de ce recueil, en ce qui me concerne, et c’est, au-delà, une bonne nouvelle tout court.
Excellente surprise, donc – et qui, arrivant en dernière position, tempère un chouia mon sentiment au mieux mitigé au regard de ce recueil. Au mieux… J’en retiens essentiellement cette nouvelle, et celle de Rachel Harrison, donc – les deux les plus longues, par chance. Ainsi que dit plus haut, je lirai sous peu Dans la loyauté et la foi de ladite, mais il faudrait aussi que je fouine du côté des productions 40K de Josh Reynolds, je suppose… À creuser.
Si Grand-Père Nurgle veut bien nous lâcher un peu, là. Faisons-lui des doigts.

/image%2F1385856%2F20160114%2Fob_cfb8b0_caligari.jpg)



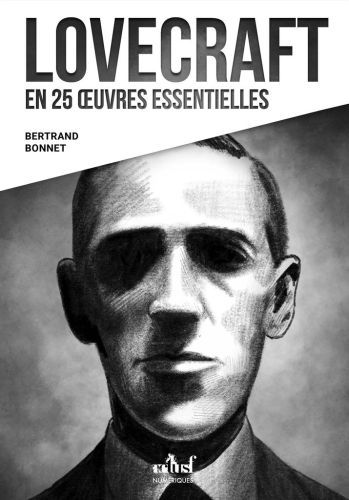

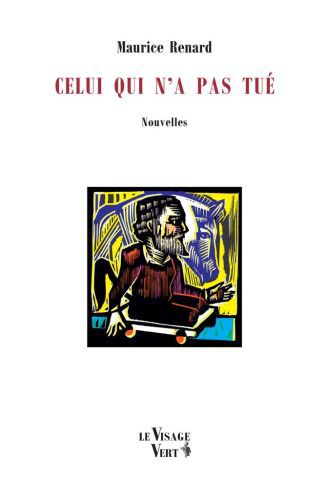





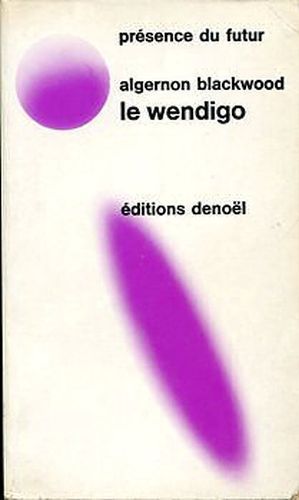
/image%2F1385856%2F20150204%2Fob_660a87_georges-abdaloff-croque-par-christell.jpg)