Infinités, de Vandana Singh
SINGH (Vandana), Infinités, [The Woman Who Thought She Was a Planet and other stories], traduit de l’anglais (Inde) par Jean-Daniel Brèque, Paris, Denoël, coll. Lunes d’encre, [2008] 2016, 277 p.
Je ne vous apprends rien : pour ce qui est de la science-fiction et des autres genres de l’imaginaire, en France en tout cas, il n’y a guère de salut en dehors de l’abondante production anglo-saxonne, pondérée par un quota national de bon aloi. Et c’est sans doute très regrettable, tant je ne doute pas que d’autres pays, d’autres cultures le cas échéant, auraient bien des trésors à nous offrir en la matière. On mettra parfois en avant les difficultés liées à la découverte puis à la traduction, certes… Mais, parfois, cette barrière de la langue disparaît heureusement – ce qui nous amène à l’étonnant recueil dont je vais vous causer aujourd’hui.
Vandana Singh est une auteure de langue anglaise (fille de deux professeurs de littérature), et réside maintenant aux États-Unis – à vue de nez, elle participe donc du modèle dominant évoqué plus haut. Et pourtant pas tout à fait : car elle est d’origine indienne, et c’est bien la culture indienne qui est au cœur des dix nouvelles (et un essai) constituant ce recueil – l’Inde est la plupart du temps le cadre de ces récits et, les très rares fois où ce n’est pas le cas, du moins les principaux personnages en viennent-ils. Et ce simple aspect change considérablement la donne : l’Inde, après tout, n’est probablement pas le premier pays auquel on pense quand on évoque la science-fiction… Ce qui ne veut pas dire qu’elle est totalement terra incognita pour les auteurs occidentaux : dans cette même collection Lunes d’encre, après tout, on ne manquera pas de citer les ouvrages de Ian McDonald consacrés à ce pays, le roman Le Fleuve des Dieux et le recueil de nouvelles La Petite Déesse (que je n’ai toujours pas lus, aheum…). L’intérêt, ici, est cependant d’en déployer une vision de l’intérieur – sans doute plus à même d’éviter les clichés touristiques pour appréhender au mieux la réalité de la culture et de la société indiennes. Aussi la dimension exotique n’est-elle pas absente d’Infinités, loin de là – et le dépaysement est assuré pour le lecteur occidental lambda –, mais sans procéder à un catalogage externe, affadissant les particularismes à la façon d’un cabinet de curiosités… avec éventuellement à la clef le sentiment que tout ceci, pour être « joli » et « curieux », n’en est pas moins quelque peu de la pacotille. Vandana Singh est dans une position tout autre, et procède avec une très grande subtilité, une très grande délicatesse : l’Inde de ses nouvelles bénéficie d’un appréciable effet de réel, notamment dans la mesure où les détails y font sens, et surtout avec un grand naturel – à titre d’exemples récurrents, l’évocation de la cuisine ou de l’habillement indiens participe bien du dépaysement, mais n’apparaît pas dans le texte dans cette seule optique : il s’agit bien davantage de dépeindre une Inde véritable, où la nourriture et les vêtements ont leur place comme éléments nécessaires d’un quotidien dès lors en rien « curieux », mais parfaitement normal.
Sans trop en savoir davantage, j’ai vite été très alléché à l’idée de cette publication – j’avais pu constater qu’elle était globalement bien accueillie, mais sans m’attarder véritablement sur les critiques avant d’en entamer la lecture, histoire d’en préserver tout le sel. La collection, le traducteur, l’illustration de couverture (Aurélien Police, what else ?) ont tous participé de ce préjugé hautement positif. Rien d’étonnant, dès lors, à ce que j’en aie entamé la lecture avec la conviction qu’il s’agirait d’un chef-d’œuvre. Et ça, c’est rarement une bonne idée… À la clef, du coup, une certaine déception – non que le recueil soit mauvais, loin de là ! Il est à n’en pas douter bon, et même plus que cela. Mais passablement déconcertant, aussi – et pas seulement en raison de son cadre… À vrai dire, je ne suis même pas certain que l’emploi de ce terme de « déception » soit véritablement pertinent ; ce n’est en effet pas tant l’œuvre qui est en cause que ma réception – surtout du fait que j’ai régulièrement eu le sentiment de passer à côté de quelque chose…
Cela vient sans doute de l’approche très particulière de Vandana Singh. Le goût de l’auteure pour les littératures de l’imaginaire ne saurait faire de doute : la première nouvelle, « Faim », est assez éloquente à ce sujet, avec son personnage de femme indienne prisant par-dessus tout les romans de SF même les plus cheap, à la plus grande consternation de son entourage ; le bref essai concluant le recueil, « Un manifeste spéculatif », éloge des mythes, de la science-fiction et de la fantasy, achève d’en convaincre (même s’il n’y a sans doute pas grand-chose à dire d’autre de ce texte – je suppose que, si vous lisez ce compte rendu, c’est que vous êtes déjà un convaincu, comme je l’étais moi-même…). Il n’en reste pas moins que son usage de l’imaginaire (pas toujours facile, d’ailleurs, de le ranger précisément, pour chaque texte, dans telle ou telle case précise, science-fiction, fantastique…) a quelque chose de très subtil et souvent discret, au point parfois de s’effacer, ou de ne consister qu’en un discours parallèle à la trame véritable (réaliste) du texte. On est ici très, très loin de la quincaillerie science-fictive (je n’y vois qu’une exception, contestable par ailleurs), et Vandana Singh atténue régulièrement ses effets, pour privilégier la justesse et l’émotion sur le spectacle, disons ; par ailleurs, l’imaginaire donne ici régulièrement l’impression de constituer un prétexte, au sens où Vandana Singh entend avant tout parler de l’Inde, des hiérarchies sociales et des drames qu’elles suscitent, et aussi et même surtout de la condition des femmes. L’apparition dans les rues de New Delhi d’un « Big Dumb Object », la malédiction familiale d’une femme, les visions de temps partagés d’un clochard errant dans la ville tentaculaire… Autant de moyens, finalement, de parler d’autre chose. C’est un trait commun de la science-fiction, je ne vous apprends rien : bien souvent, ses empires galactiques, ses robots empathiques ou ses excursions dans le temps ou les dimensions parallèles n’ont finalement pas d’autre objet que de traiter de notre monde – tarte à la crème, hein. Pas de problème, à cet égard ; le problème, c’est sans doute quand ça se voit un peu trop – et c’est parfois le cas ici… La subtilité globale de ces récits, conjuguée aux éléments que je viens de lister, « explique » enfin à certains égards (le mot est mal choisi, du coup…) un certain hermétisme de bon nombre d’entre eux, leur caractère plus ou moins « obscur »… Sans réclamer que l’auteure me prenne par la main, loin de là, je dois pourtant avouer que Vandana Singh, à l’occasion, m’a un peu (trop) largué – me laissant parfois en bouche la désagréable sensation d’être passé à côté de l’essentiel…
Cependant, cette approche en elle-même n’est pas pour me déplaire – vraiment pas. D’autant que, tout en prenant en compte les spécificités qui lui sont propres, l’auteure ne manque pas, au fil de ses contes, de renvoyer le lecteur à des références précises et souvent plus qu’enthousiasmantes. Elle-même, dans ses remerciements en fin de volume, cite pour l’essentiel des écrivains indiens, mais il y a bien une exception – flagrante et éloquente : Ursula K. Le Guin. Et c’est à bon droit, tant sa manière et plus encore ses thématiques ont quelque chose de tout à fait similaire. La quatrième de couverture, quant à elle, mentionne Ray Bradbury et Theodore Sturgeon, et c’est là encore tout à fait pertinent, tant Vandana Singh livre une science-fiction sensible et empreinte d’émotion, essentiellement humaniste. Dès lors, ses personnages ne peuvent qu’être riches et complexes ; ajoutons enfin qu’elle a un joli brin de plume (sans doute bien rendu par la traduction de Jean-Daniel Brèque) : en dépit de la vague déception évoquée plus haut, plus ou moins justifiable, vous aurez compris que ce recueil mérite amplement d’être lu.
Dans la quasi-totalité de mes comptes rendus les plus récents portant sur des recueils, j’ai adopté la solution de facilité consistant à traiter de chaque texte à la suite, dans l’ordre où ils figurent – ce qui n’est pas forcément très pertinent… Je préfère cette fois « trier » quelque peu, en commençant par les quatre nouvelles qui m’ont le plus séduit.
Ma préférée est peut-être bien « Delhi », nouvelle aussi habile que touchante, et débordant d’empathie au-delà de son prétexte incongru. Nous y suivons un jeune homme qui a bien des soucis, et qui est sur le point de se suicider… Mais un inconnu aux allures de clochard l’en empêche au dernier moment, l’assurant que ce qu’il comptait faire n’a rien d’une solution, et qu’il a par contre une raison de vivre – il lui confie une carte, renvoyant à l’adresse d’une étrange officine évoquant immanquablement une secte, et où un ordinateur tire pour notre jeune homme la photographie d’une femme : il doit vivre pour elle, ils se croiseront un jour, et tout s’éclaircira. Le jeune homme est d’abord sceptique… mais se met finalement assez vite à écumer les rues de la ville tentaculaire, et est amené à son tour à donner de ces cartes à des désespérés dans son genre – ils sont nombreux… La nouvelle se complique en outre du fait que, tandis qu’il arpente la ville, notre héros du quotidien y croise bien des « fantômes », en fait des échos du passé ou du futur, égarés dans un oppressant creuset temporel – tout s’y mêle, absurdement, et pourtant le jeune homme est jour après jour plus tenté d’y voir du sens : il trouvera un jour la femme, et tout s’éclaircira… On devine, bien sûr, une nécessaire boucle de rétroaction sublimant la quête acharnée du jeune homme ; ça n’en est pas moins très bien vu. Outre le traitement de la dépression et du suicide, qui ne pouvait manquer de me toucher, j’ai beaucoup apprécié cette nouvelle pour deux raisons en apparence contradictoires – en apparence seulement : le caractère angoissant et étouffant de la ville, pondéré toutefois par la quête de sens des personnages – l’atout, bien sûr, étant que ce sens, cette raison d’être, n’a sans doute rien d’objectif, mais est intimement construit, comme un outil de choix pour poursuivre le combat, jour après jour…
Au deuxième rang, je vais placer « Infinités », un très beau récit d’un ordre bien différent, et où la dimension proprement imaginaire est finalement discrète, si la science est bien au cœur du propos. On y évoque un vieil homme, ancien professeur et passionné par les mathématiques depuis son plus jeune âge, qui se retrouve confronté à la cruauté absurde d’un monde hostile par essence à tout ce qui diffère. En l’espèce, il s’agit des tensions religieuses divisant l’Inde en opposant les hindous et les musulmans… Le professeur est musulman – mais son meilleur ami est hindou, et a une approche du monde bien différente : pour lui, c’est la poésie qui remplit le rôle des mathématiques… Dans les deux cas, il s’agit de langages complexes, dont l’apprentissage n’est jamais achevé, et qui peuvent, chacun à sa manière, décrire le monde et, de ce fait, toucher au divin, bien davantage assurément que les brutes fanatiques qui, tout en braillant le nom de leur idole, la desservent de la pire des manières en massacrant ceux qui ont eu le tort inacceptable d’en adorer une autre – et ce n’est parfois même pas nécessaire… La fascination pour certains aspects à jamais étonnants des mathématiques – des nombres premiers aux infinis – produit sans autre quincaillerie le « sense of wonder » de la meilleure science-fiction (même s’il a pu me rappeler, dans un genre bien différent, le roman de Yōko Ogawa La Formule préférée du professeur), tandis que l’évocation parallèle de sortes de figures angéliques participant de la réalité du monde louche un peu plus vers le fantastique (et peut-être même son versant psychologique – la santé mentale du professeur pouvant sans doute être remise en question). Au-delà, le texte a quelque chose de fondamentalement triste, peut-être même mélancolique (un sentiment que l’on met souvent en avant en traitant de ce recueil), et le tableau qu’il dépeint avec force d’un monde absurde et cruel touche au cœur ; pourtant, là encore, je n’ai pas eu le sentiment d’un texte dénué de tout espoir : en fin de compte, dans la beauté des langages mathématique et poétique, demeure quelque chose, et peut-être même une forme de rédemption…
La troisième meilleure nouvelle à mon goût est « Le Tétraèdre » (que j’avais en fait déjà lue, dans une autre traduction, dans le n° 8 de Fiction – mais c’était il y a longtemps, et j’avais oublié…). Elle use d’un procédé ô combien classique de la science-fiction : le « Big Dumb Object ». En l’occurrence, un tétraèdre qui apparaît instantanément en plein New Delhi (faisant disparaître les véhicules qui se trouvaient à cet endroit, et leurs occupants avec). Le personnage principal de la nouvelle est une jeune étudiante qui assiste au phénomène, et est fascinée par l’étrange apparition – dont le propos fait débat, d’aucuns y voyant un complot gouvernemental, une arme secrète pakistanaise ou la tête de pont d’une invasion martienne… Quoi qu’il en soit, cet « objet » improbable va bel et bien changer sa vie, et c’est tant mieux : la jeune femme était visiblement oppressée à l’idée du futur que la société indienne ne manquerait pas de lui imposer – notamment un pénible mari, arrogant et condescendant, le genre d’hommes dont sont bien obligées de s’accommoder ses rares camarades de fac (si elle en a) ainsi que ses sœurs… Obsédée par le tétraèdre – au point d’en oublier toutes ses « obligations », dont les études –, elle se met à fréquenter (innocemment) un étudiant qu’elle avait parfois croisé, un astrophysicien qui discute avec elle des implications éventuelles du mystérieux artefact ; parmi elles, la possibilité d’autres mondes, on ne saurait plus éloignés de celui-ci – notamment en raison des dimensions inaccessibles à la perception humaine (on pense forcément à Flatland, lisez Flatland). « Le Tétraèdre » est probablement, des nouvelles du recueil, celle qui accomplit le mieux l’alchimie entre prétexte SF et questionnement de la société indienne et de la condition des femmes, avec une part d’expression intime non négligeable. Le récit est fort et juste ; si « Delhi » et « Infinités » m’ont un peu plus parlé, pour des raisons toutes personnelles sans doute, « Le Tétraèdre » a quelque chose d’harmonieux qui le rend susceptible de toucher bien au-delà (rien d’étonnant si, dans les critiques que j’ai pu parcourir, c’est sans doute le seul texte du recueil à faire totalement l’unanimité).
Une dernière très bonne nouvelle : « La Femme qui se croyait planète » (qui donnait son titre au recueil anglais). Et c’est un texte tout particulièrement étrange, à la mesure de son titre… Nous y voyons une femme, issue d’une « bonne famille », déclarer dans l’enthousiasme qu’elle est une planète – or une planète se passe de vêtements, pour absorber la lumière vitale du soleil… Le personnage point de vue est son mari, austère vieux bonhomme fier de son rang (voire de sa caste), et qui s’avère bien vite autrement affecté par la mauvaise image sociale que pourrait susciter son excentrique de femme si quiconque la voyait succomber à ce délire obscène, que par le phénomène en lui-même… Le comportement de l’épouse, dans les premières pages, a quelque chose de fondamentalement burlesque, mais le texte est bien plus que cela, accumulant en fait les procédés comme les ressentis qui en font quelque chose de très différent. Ainsi, le burlesque est bientôt pondéré par une dimension vaguement horrifique (avec les « habitants » de la « planète »), qui a cependant quelque chose de grotesque, tirant, là encore, délibérément, la nouvelle dans la direction du rire. Mais ce n’est pourtant pas tout, loin de là – et la satire sociale impliquée par la panique de l’époux, au-delà du rire, a quelque chose d’une amertume douloureuse, qui vient considérablement noircir le tableau… Tandis que « l’émancipation » de l’épouse devenue planète porte en elle un improbable espoir. La nouvelle oscille ainsi en permanence entre le rire et l’angoisse, la satire enthousiaste et l’amertume inepte, pour un résultat hautement déconcertant, mais aussi tout à fait convaincant. Ce texte est du coup le plus original du recueil, et ce n’est pas pour rien dans mon appréciation.
Les quatre nouvelles citées sont vraiment de grande qualité, et justifient sans doute la lecture d’Infinités. Je vais moins m’étendre sur la suite, c’est probablement moins nécessaire… Continuons donc de descendre l’échelle, du meilleur au moins bon. Je rassemblerais deux nouvelles au deuxième rang – ce qui en fait des nouvelles plus que bonnes, simplement moins bonnes que celles qui précèdent. Tout d’abord, « Soif » (titre qui entre étrangement en résonance avec celui de la première nouvelle, « Faim », même si je serais bien en peine de dire ce qu’il faut en tirer, et si seulement il y a quelque chose à en tirer…), qui, en traitant d’une femme victime d’une malédiction familiale voulant que l’eau lui sera un jour fatale, comme à ses aïeules, a quelque chose de lovecraftien, que je ne m’attendais certes pas à trouver dans ce recueil (on peut penser au « Cauchemar d’Innsmouth », ou peut-être au « Festival » ; les serpents du texte pourraient aussi avoir un rapport avec « La Malédiction de Yig », mais c’est sans doute un peu trop tordre la référence…) ; par contre, la nouvelle brode encore sur le thème central de la condition des femmes en Inde, avec une pertinence indéniable.
Je placerais aussi à ce rang « Les Lois de la conservation », tout en relevant que c’est probablement la nouvelle la plus convenue (relativement) du recueil. Impression renforcée, sans doute, par le fait qu’elle emploie exceptionnellement la quincaillerie du genre : le récit débute sur la Lune colonisée depuis pas mal de temps déjà, avant qu’un des personnages discutant dans ce cadre narre à son auditoire ce qui lui est arrivé quand il a exploré Mars. La structure, à cet égard, est d’ailleurs un peu déconcertante, avec sa mise en place finalement guère exploitée par la suite… Pour le reste, c’est un récit efficace, non dénué d’une certaine angoisse cosmique là encore – ça passe bien, mais sans remuer outre-mesure.
Troisième rang, trois nouvelles, qui, sans être fondamentalement mauvaises, ne m’ont pas vraiment emballé – que ce soit en raison d’une certaine médiocrité intrinsèque, ou, plus probablement, parce que je suis passé à côté… Je constate par ailleurs que ce sont les nouvelles du recueil où la dimension imaginaire est la plus limitée (voire inexistante). Celle qui s’en tire le mieux est probablement la dernière, « La Chambre sur le toit », avec son artiste entretenant une relation complice avec des enfants, même si c’est la douleur du départ que l’on retient en définitive – ça se lit, oui, et ne laisse pas totalement indifférent. Je suis plus sceptique en ce qui concerne la première nouvelle du recueil, « Faim », pas inintéressante dans sa dimension de critique sociale, ainsi que dans le portrait du personnage féminin (accro, donc, à la SF), mais dont je n’ai finalement retenu rien d’autre. Quant à « L’Épouse », si elle dresse un poignant portrait de femme à l’abandon, exilée qui plus est bien loin de son Inde natale mais sans avoir pour autant de raison d’y retourner, elle me paraît cependant moins forte à cet égard que d’autres nouvelles figurant dans le recueil, abordant elles aussi le thème de la condition des femmes dans une société patriarcale (même si ici le cadre américain rend ce questionnement amèrement ironique), peut-être parce que ces autres nouvelles ont une dimension de « récit » plus affirmée là où celle-ci relève plus de la tranche de vie et de la peinture…
Rien de mauvais cependant. Je ne vois qu’un texte qui pourrait être qualifié ainsi, et encore, sans en être bien certain, et il s’agit du plus court : « Trois Contes de la rivière du ciel. Mythes de l’ère des astronautes » ; comme l’indique assez le titre, ce sont en fait trois histoires différentes qui sont ici associées, dans un cadre extraterrestre, quand bien même on est de ce fait porté à chercher des liens les unissant. Ici, de manière assez flagrante, j’ai le sentiment que Vandana Singh veut faire du Le Guin – mais, à mon sens, elle n’y parvient pas… Sans doute est-ce, là encore, que je suis passé à côté de quelque chose, mais ces petits contes ne m’ont en rien intéressé, et je n’en ai rien retenu…
Reste le bref essai « Un manifeste spéculatif », à propos duquel je ne vois donc pas grand-chose à dire…
Du côté des annexes, mentionnons un glossaire, renvoyant à des expressions indiennes ou à des personnalités (pas toujours indiennes, elles) figurant dans les nouvelles ; pas indispensable à proprement parler, mais appréciable, et ça peut être utile – en fonction des habitudes de lecture de chacun.
Bilan ? Un bon recueil à n’en pas douter – voire très bon. Simplement pas aussi bon que ce que j’en attendais, pour des raisons qui ne me sont pas très claires… Mais Vandana Singh est bien une auteure à suivre, dont l’élégance et l’empathie sont très appréciables, et Infinités un recueil habile et juste, poignant parfois, dépaysant toujours mais tout en demeurant authentique. Très recommandable, donc.

/image%2F1385856%2F20160114%2Fob_cfb8b0_caligari.jpg)




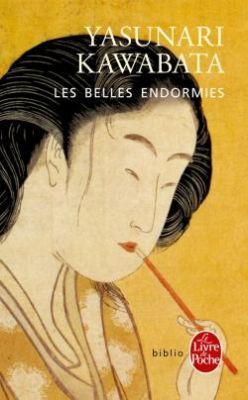

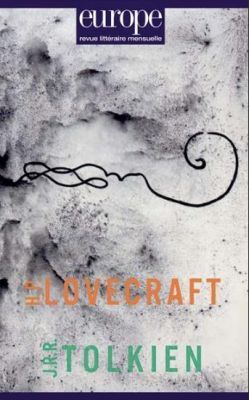





/image%2F1385856%2F20150204%2Fob_660a87_georges-abdaloff-croque-par-christell.jpg)