Il faut croire que c’est mon moment Shirley Jackson ! De l’autrice, je n’avais lu jusqu’à présent (et beaucoup aimé) que le roman Nous avons toujours vécu au château. Mais Rivages a publié tout récemment un excellent recueil de nouvelles sous le titre La Loterie et autres contes noirs, que j’ai chroniqué pour Bifrost. Et j’en ai profité pour lire aussi La Maison hantée, une chose que je voulais faire depuis un bail, et dont j’avais causé il n’y a pas si longtemps en chroniquant la très, très libre adaptation en série The Haunting of Hill House, sur Netflix. Et, tant qu’à faire, je me suis dit que c’était une excellente occasion de revoir la superbe adaptation cinématographique qu’en avait livré Robert Wise en 1963, sous le titre The Haunting, ou, de par chez nous, La Maison du Diable (et, non, je n’ai pas jugé bon de voir le film réalisé par Jan de Bont en 1999, parce que bon). Cette chronique portera avant tout sur le roman de Shirley Jackson, mais avec quelques aperçus du film de Robert Wise.
À vrai dire, il me paraît particulièrement pertinent d’envisager les deux ensemble, car cela a des conséquences notables sur la définition même des deux œuvres – notamment au regard de la question du fantastique « psychologique ». Il est très tentant d’inscrire aussi bien le roman que le film dans ce registre, et je suppose qu’il n’y aurait rien d’outrancier à inscrire Shirley Jackson, ici, dans la filiation du Tour d’écrou de Henry James – outre que l’autrice a eu plusieurs fois recours au procédé emblématique du genre qu’est le narrateur non fiable, comme en témoignent le roman postérieur Nous avons toujours vécu au château, mais aussi certaines nouvelles de La Loterie et autres contes noirs. Ici, La Maison hantée se distingue tout de même, en n’ayant pas recours à la première personne, mais j’y reviendrai.
Quoi qu’il en soit, quand Robert Wise et son scénariste Nelson Gidding ont développé le projet d’adaptation cinématographique, ils ont dérivé du roman une lecture particulièrement orientée dans cette optique – l’idée avait même été évoquée de rendre plus explicite ce traitement, en « révélant » que l’héroïne était internée dans un hôpital psychiatrique, que ses compagnons étaient des soignants ou des patients, ce genre de choses ; finalement, le film n’est pas allé jusque-là, et c’est sans doute tant mieux, car il a pu dès lors jouer avec bien plus de pertinence sur l’incertitude permanente. Mais les deux hommes voulaient en discuter avec Shirley Jackson : à ce qu’il semblerait, l’autrice aurait trouvé que le traitement psychologique de son roman était une bonne idée – mais que, à ses yeux, le roman qu’elle avait écrit était « objectivement surnaturel ». Et ces développements peuvent surprendre, peut-être – car, lisant le roman puis revoyant le film, j’avais à vrai dire tendance à juger le premier plus « psychologique » que le second… outre que mes autres lectures de Shirley Jackson ne jouaient que très exceptionnellement du surnaturel.
Essayons de résumer l’histoire – en mettant de manière générale le roman en avant (et en relevant que, pour quelque raison, les noms des personnages varient parfois entre le livre et le film). Hill House est une riche demeure très fantasque sise dans un coin paumé de Nouvelle-Angleterre (Lovecraft approved), le caprice d’un riche industriel « victorien » du nom de Hugh Crain – et il s’y est passé bien des choses étranges et morbides… Hill House n’a pas manqué de développer la réputation d’être une maisons hantée.
Ce qui suscite l’intérêt du Dr. John Montague (le Dr. John Markway dans le film, où il est campé par Richard Johnson), un scientifique un peu hétérodoxe qui souhaite apporter la preuve de l’existence du surnaturel. Il obtient des propriétaires de Hill House la permission de louer la vieille bâtisse pendant quelques semaines, pour y habiter avec son équipe d’ « experts » triés sur le volet ; les propriétaires lui imposent cependant la compagnie de Luke Sanderson (incarné par Russ Tamblyn dans le film), un jeune homme de leur famille (à leur corps défendant…) qui doit hériter un jour de Hill House, et veillera donc à ce qu’on n’y fasse pas n’importe quoi ; mais sa réputation est plutôt douteuse – celle d’un petit escroc, disons (dans le livre, c’est un personnage spirituel et à vrai dire plutôt charmeur, même si la romancière nous a mis en garde contre ses impostures, ce qui biaise forcément le regard du lecteur d’une manière très amusante ; dans le film, disons-le, c’est un imbécile et un lâche, un matérialiste au sens le plus vulgaire du terme…).
Mais, des « experts » contactés par le Dr. Montague, seuls deux, finalement, ont répondu à l’appel – deux jeunes femmes que tout oppose. Il y a tout d’abord Theodora, ou Theo – car elle se fait un point d’honneur de ne pas porter de patronyme (elle est jouée par Claire Bloom dans le film – qui porte des vêtements spécialement conçus par Mary Quant, ce qui contribue à la distinguer de tous les autres). La très « libre » et jolie demoiselle, à la langue acérée, est supposée bénéficier de dons de perception extrasensorielle – à moins bien sûr qu’elle ne soit qu’extrêmement perspicace. Il me paraît utile de relever une chose : ni le roman, ni le film, n’en font des caisses à ce sujet, mais tous deux font plus que suggérer qu’elle est lesbienne (ou bisexuelle, peut-être, le roman du moins semble plutôt pointer dans cette direction) – ce qui n’était peut-être pas très courant dans la littérature (populaire ?) ou le cinéma de l’époque, du moins dès l’instant qu’il ne s’agissait pas d’en dériver des « antagonistes » caricaturaux. Et ce trait n’est pas gratuit, car il joue un rôle non négligeable dans les relations entre les deux personnages féminins principaux de cette histoire, mais tout autant celles qu’elles entretiennent avec leurs deux comparses masculins. Une anecdote au passage : si le film ne laisse donc guère de place au doute quant à l’orientation sexuelle de Theo (la série Netflix toute récente pouvait bien sûr se montrer autrement explicite, autres temps, autres mœurs), il semblerait toutefois que la production aurait « incité » Wise et Gidding à limiter autant que possible les occasions de « contact physique » entre les deux femmes ; j’avoue ne pas trop savoir qu’en penser, car il y en a tout de même quelques exemples dans le film…
Mais passons à l’autre jeune femme – qui s’avère en fait « l’héroïne » de cette histoire : Eleanor Vance (Eleanor Lance dans le film – où c’est Julie Harris qui joue son rôle). Si Theo est flamboyante, excentrique, très consciente de sa beauté, Eleanor, ou Nell, est discrète, effacée, timide, horriblement mal à l’aise en société à vrai dire, et une collection de névroses. Il y a peu encore, elle vivait avec sa vieille mère, sacrifiant « ses plus belles années » pour l’assister au quotidien – mais la vieille peau, qu’elle en était venue à exécrer, est morte il y a peu, et Eleanor n’a pas encore digéré ce bouleversement de sa situation (et sa responsabilité éventuelle dans tout ça). L’invitation du Dr. Montague (car, enfant, elle aurait été très liée à un phénomène de poltergeist) lui fait l’effet d’une délivrance – des vacances, enfin ! Après s’être accrochée avec sa très condescendante sœur et le mari de cette dernière, Nell fuit avec sa (pour moitié) voiture, et se rend à Hill House.
Là-bas, ces quatre personnages (Montague, Luke, Theo et Eleanor) découvrent une bâtisse totalement folle et proprement hideuse à force de surcharges rococo ou néo-gothiques – un mauvais caprice architectural conçu selon des angles étranges, un vrai labyrinthe, dont les portes se ferment toutes seules, certains endroits étant traversés par de glaçants courants d’air, etc. Mais le petit groupe s’installe, et le Dr. Montague détaille l’histoire de la demeure, ses intentions quant à ce séjour, et la méthode scientifique qu’il entend mettre en œuvre.
Mais Hill House est une maison décidément étrange – et à la hauteur de sa réputation de hantise. Des phénomènes toujours plus étranges se produisent… Mais sont-ils vraiment le fait de la maison ? Ici, le roman comme le film, mais à des degrés divers et selon des procédés qui leur sont parfois propres, sèment le doute. Bon nombre de ces apparitions étranges, ces manifestations souvent sonores par exemple, semblent être « objectives », dans la mesure où plusieurs personnages y assistent en même temps. À ce compte-là, la maison pourrait effectivement en être responsable – et devrait de toute façon être envisagée comme un personnage elle aussi, dans une ronde de relations complexes entre les psychés si différentes des deux hommes, des deux femmes et de leur résidence temporaire. La maison contamine ses antagonistes, éventuellement au point de la possession dans le cas d’Eleanor.
Seulement, le cas d’Eleanor doit être singularisé – car la jeune femme, très anxieuse, entretient d’emblée une relation très particulière avec Hill House, jusqu’à ce que l’horreur architecturale devienne « chez elle ». C’est que Nell, avec toutes ses névroses, est un personnage assurément peu fiable... Eleanor est possédée par un puissant désir de susciter l’attention, et dévorée par un besoin maladif d’amour, y compris, mais pas seulement, au sens de ses romances rêvées, essentiellement avec Luke dans le livre, et plutôt le très attentif et réconfortant Dr. Markway dans le film – là où le Dr Montague est autrement plus distant : lui ne demande jamais à ce qu’on l’appelle simplement « John », il tient à son titre, et cela rejaillit sur son épouse, comme on le verra… Mais, dans les deux cas, une chose est certaine, qui est que la présence de Theo vient parasiter le bovarysme de Nell. Dont les soucis vont bien au-delà : ses remords quant au sort de sa vieille mère, ses rancunes envers sa sœur et son beau-frère, bien d’autres choses encore, tout cela se combine pour fausser le jugement de la jeune femme, et l’incite à de menus mensonges, qui prennent parfois des dimensions inattendues. Eleanor ment (sur son appartement, notamment), à ses interlocuteurs, mais elle se ment aussi à elle-même, aussi ses voix intérieures en viennent-elles en définitive à mentir au lecteur/spectateur – qui le perçoit bien, et subit de la sorte quelque chose comme un malaise intime, qui renforce l’identification pour le personnage tout en la rendant plus problématique et gênante à chaque page (ou scène, car cette ambiguïté vaut tout autant pour le film). Si Hill House contamine ses résidents et au premier chef Eleanor, celle-ci, ses fantasmes (si l’on ose dire), ses mesquineries, ses espoirs forcément déçus, ses remords, tout cela contamine le récit et en définitive le lecteur/spectateur. À la différence notamment de Nous avons toujours vécu au château, La Maison hantée n’est pas un roman à la première personne – mais le point de vue d’Eleanor, même à la troisième personne, produit un effet parfaitement comparable, et peut-être en fait d’autant plus saisissant, de narrateur non fiable.
D’autant que cette éventualité est envisagée par les personnages eux-mêmes, et jusqu'à Eleanor : dans le roman comme dans le film, elle plaisante avec le Dr. Montague/Markway – peut-être tout cela n’est-il que dans sa tête, peut-être même le Dr. Montague, Theo et Luke ne sont-ils que des inventions de son esprit malade ? Elle dit cela avec le sourire, mais le scientifique ne goûte pas exactement la plaisanterie : si Eleanor développe ce genre d’idées, il vaudrait mieux, pour tous, y compris elle-même, qu’elle quitte Hill House au plus vite…
Mais cette ambiguïté n’est pas qu’un tour de passe-passe essentiellement ludique, si cette dimension est sans doute présente – car elle relève en même temps d’un profond malaise, intimement ressenti. Et, cette fois, ce ressenti un peu nauséeux est probablement davantage mis en avant dans le roman. Ce qui n’est pas si étonnant – du moins à en juger par mes autres lectures de Shirley Jackson : ce malaise, intime ou au cœur des relations sociales, est à certains égards comme une marque de fabrique, et en même temps bien davantage, car c’est tout sauf un artifice creux. Le contexte de la maison hantée y incite – et notamment sa dimension de huis-clos, pourtant moins accentuée dans le roman (où plusieurs séquences, et parfois très importantes, se déroulent dans le parc – dans le film, on s’aventure rarement au-delà de la façade de Hill House, tout au plus Eleanor cherche-t-elle l’angle le plus approprié pour observer du dehors la tour de la bibliothèque, mais le parc, en tout cas, est hors-concours… sauf, bien sûr, dans les déplacements en voiture au début et à la fin du film). Quoi qu’il en soit, tout l’art de Shirley Jackson s’exprime dans les relations forcément un peu tendues, voire plus que cela, entre les quatre protagonistes principaux (et quelques autres) : tous leurs échanges sont chargés d’insinuations cruelles (la très perceptive Theo, surtout, étant une orfèvre en la matière – Luke aussi mais de manière moins affirmée, davantage entre deux eaux), de non-dits, de menaces voilées, d’ententes de circonstances, d’accusations blessantes, etc. Et le tableau est probablement plus noir dans le roman, qui souligne tout ce que cette cohabitation forcée, fantômes ou pas, a de malaisant…
Ce qui redouble à vrai dire le caractère tragique de cette histoire, qui ne fait bientôt guère de doute. Les hésitations du Dr. Markway, plus prononcées que celles du Dr. Montague, accentuent à vrai dire cette dimension dans le film. Mais l’identification douloureuse avec Eleanor, dans tous les cas, pèse sur le lecteur/spectateur – et il n’était sans doute pas si évident de forcer un ressenti aussi intime sur la base d’un personnage présenté d’emblée comme étant « sévèrement perturbé ».
Il y a cependant un point sur lequel, je crois, le roman et le film diffèrent assez profondément – et c’est que le livre de Shirley Jackson « relâche » un peu la tension de temps à autre, avec quelques moments humoristiques, qui parviennent pourtant à ne pas dénaturer le récit de manière contradictoire. Les reparties spirituelles de Luke (dans le roman seulement) et de Theo y participent, mais l’autrice en rajoute, de manière à vrai dire tout à fait jubilatoire, au travers de personnages secondaires : tout d’abord, les Dudley, le couple qui entretient Hill House – les menaces de Mr Dudley, sorte de bully bouseux qui en a visiblement après « ceux de la ville », inquiètent tout d’abord, mais le complément apporté par son épouse suscite bientôt le rire nerveux : Mrs. Dudley est un disque rayé, un robot qui répète toujours les mêmes phrases, concernant son emploi du temps rigide, ou l’assurance que personne ne pourra venir au secours des occupants de Hill House « in the night… in the dark... » ; le film choisit là encore de renforcer le côté inquiétant de ce comportement – le sourire de Mrs. Dudley a de quoi glacer le sang ! Même si la situation est assurément assez grotesque pour susciter un rire nerveux. Mais le roman est plus léger, ici, et franchement drôle.
Mais le contraste à cet égard est surtout marqué plus loin dans le récit, à un moment où le roman et le film divergent de manière particulièrement franche (là où, jusqu’alors, l’adaptation était globalement fidèle, si le film donne une impression de narration davantage condensée et précipite résolument les événements inquiétants dans Hill House). En effet, au bout d’un certain temps, dans le roman, deux personnages viennent compléter le petit groupe des résidents de Hill House : l’épouse de Montague, un dragon et une haïssable bourgeoise incroyablement hautaine, et son « compagnon », qu’on devine être une sorte d’amant serviable, même pas dissimulé mais tout bonnement imposé au bon docteur quoi qu’il en pense, un imbécile ridicule du nom d’Arthur Parker. Mrs. Montague humilie dès que possible son époux, c’est visiblement elle qui porte la culotte, comme on dit étrangement, et elle s’impose dans l’expérience scientifique – qu’elle prétend gérer de manière bien plus efficace, car Madame se pique d’être une spirite, communiquant avec les défunts au travers d’une planche oui-ja… Et elle obtient forcément des résultats, à la hauteur de sa personne et de sa science : parfaitement grotesques. L’irruption de ces deux intrus, dans le roman, produit des scènes très drôles – mais c’est là encore un sacré témoignage de l’art consommé de Shirley Jackson de ce que ces variations dans le sentiment d’oppression ne contreviennent pas à la cohérence du récit, et même, d’une certaine manière, renforcent le malaise qui sourd toujours sous les incongruités de Mrs Montague et de son « ami », a fortiori telles qu’elles sont perçues et interprétées par Eleanor.
Ici, le film se montre très différent : Mrs Markway seule débarque à Hill House, sans « compagnon » – et de manière totalement inopinée, là où l’arrivée de Mrs Montague, dans le roman, offrait un exceptionnel repère chronologique à des personnages qui ne savaient autrement plus où ils en étaient, pour avoir passé un certain temps déjà dans Hill House. Mrs Markway a ceci de commun avec Mrs Montague, que, quand elle arrive sur place, elle chapitre de manière assez humiliante son époux, sur le ton de maman qui gronde affectueusement (mais en public…) son petit garçon. Au-delà, les deux personnages sont drastiquement opposés – car là où Mrs Montague est une spirite de seconde zone, parfaitement ridicule, et d’autant plus horripilante, Mrs Markway est quant à elle une sceptique, toute dédiée à faire abandonner à son pauvre époux ses lubies de collégien qui a lu trop de romans… Ce qui l’amène par ailleurs à jouer un rôle plus prononcé dans le film, même avec très peu de présence à l’écran, car, par deux fois, elle est (involontairement) celle qui précipite la catastrophe – de manière sans doute un peu forcée, pour être honnête.
Ce vague souci mis à part, et quelques autres notamment dans l’introduction (le film choisit de montrer d’emblée l’histoire tragique de Hill House plutôt que de la faire raconter ultérieurement par le Dr. Markway – et les morts des deux Mrs Crain successives convainquent plus ou moins, si j’aime beaucoup, dans le second cas, cette caméra qui tombe brutalement au sol, à l’envers…), l’adaptation réalisée par Robert Wise est une immense réussite – et demeure un des plus grands films de l’histoire du cinéma fantastique, et aussi, étrangement ou pas, 56 ans plus tard, un des plus effrayants… probablement bien davantage que le livre, à vrai dire.
Là où le cinéma fantastique de l’époque, via la Hammer, Amicus ou Roger Corman, prisait le flamboiement des couleurs et les brumes gothiques, Wise, qui avait exigé de tourner en noir et blanc (et à bon droit : c’est un très beau noir et blanc), avait probablement d’autres références en tête, plus sobres : le cinéma fantastique à petit budget et essentiellement allusif de Jacques Tourneur et Val Lewton (notons d’ailleurs que le premier film de Robert Wise en tant que réalisateur, The Curse of the Cat People – que je n’ai pas vu, hein –, était une suite à La Féline, et produite par ledit Val Lewton…). En même temps, la manière de filmer Hill House, pour le coup suffisamment dégoulinante pour être gothique, tendait à jouer des angles incongrus dans une perspective renvoyant probablement davantage à l’expressionnisme allemand, je suppose. Et avec succès là encore : la bâtisse est indiciblement mais indéniablement menaçante – ce qui contribue là encore à en faire un personnage à part entière de cette histoire.
Pour ce qui est des autres personnages, le casting s’est avéré plus que concluant : Richard Johnson compose un Dr. Markway un peu grotesque, mais en même temps bien plus sympathique, car empathique, que le Dr. Montague dans le roman ; Russ Tamblyn est parfait dans le rôle de ce petit con de Luke ; la très jolie Claire Bloom, avec ses tenues singulières, est idéale en Theo – et, bien sûr, Julie Harris porte une bonne partie du film sur ses épaules, en interprétant remarquablement une Eleanor fragile et perturbée, qui suscite tour à tour voire en même temps la compassion et… un sacré embarras.
Et c’est merveilleux de constater à quel point ce film, aujourd’hui encore, peut se montrer effrayant – et, à la Tourneur/Lewton, sans débauche d’effets spéciaux. Pour l’essentiel, Robert Wise fait appel au son : le « boum… boum… boum... » qui résonne dans le couloir et terrifie Theo et Nell en est un exemple saisissant, mais tout autant cette autre scène où un visage apparaît dans les frises du mur, tandis qu’Eleanor terrorisée entend comme les geignements d’un enfant sous les marmonnements d’un homme, dont on hésite à supposer qu’il chante, là où le contexte laisse plutôt supposer qu’il récite sur le mode de la litanie quelque passage de la bible destiné à terrifier sa pauvre fille, cette litanie évoquant bien plutôt de la sorte quelque rituel satanique… Rare effet visuel, il faut aussi mentionner cette très oppressante séquence qui voit les murs et les portes de Hill House gonfler et se dégonfler, comme au travers d’une respiration – un effet qui aurait pu se montrer risible dans bien des circonstances, mais s’avère ici incroyablement juste et efficace.
Mais les autres effets visuels du film tiennent uniquement au maniement de la caméra – et Wise est virtuose, tentant des choses très audacieuses, comme cette chute de la caméra mentionnée plus haut, ou son déplacement félin et en même temps vertigineux dans les marches de tel ou tel escalier, notamment celui de la tour. Les jeux d’ombre et de lumière sont bien sûr très travaillés, qui alternent la pleine lumière dans les pièces saturées au point d’en être hideuses qui forment l’essentiel de Hill House, et des ombres qui peuvent renvoyer aussi bien, et de manière très cohérente, aux menaces impalpables qui rôdent entre les murs de Hill House… et à la psyché torturée d’une Eleanor qui entre en symbiose maladive avec l’abjecte demeure. Le montage très sec, avec des cuts brutaux, est une technique récurrente dans le film quand survient l'horreur, mais, en d’autres occasions, Robert Wise a su concocter des plans-séquences remarquables et parfois même virtuoses – souvent en jouant des miroirs, et parfois des « espaces » laissés dans le décor, ainsi quand Eleanor danse devant l’horrible statue de la famille Crain, et que ses pas sont entrevus sous l’aisselle du vieil industriel, ou à hauteur des yeux de la pauvre petite Abigail – en même temps sous le regard austère de « la compagne » de ses vieux jours, que tous tendent à identifier avec Eleanor…
Oui, le film de Wise est un chef-d’oeuvre – à la hauteur du roman de Shirley Jackson, et pourtant en s’en démarquant sur un certain nombre de points non négligeables. La Maison hantée vaut assurément d’être lue encore aujourd’hui, de même que La Maison du diable vaut toujours d’être vue ; les deux conservent leur supériorité sur les tentatives ultérieures de broder sur l’un comme sur l’autre – mis à part le scandaleux dernier épisode, The Haunting of Hill House, la série Netflix, était plutôt une réussite, mais, de toute évidence, avec Shirley Jackson comme avec Robert Wise, nous sommes dans la catégorie au-dessus.
Bien au-dessus.
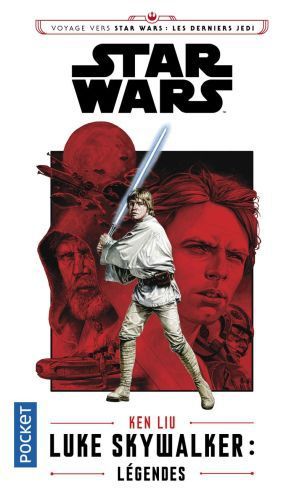

/image%2F1385856%2F20160114%2Fob_cfb8b0_caligari.jpg)


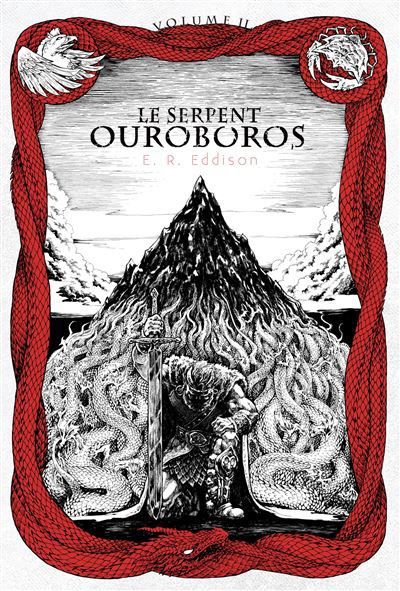



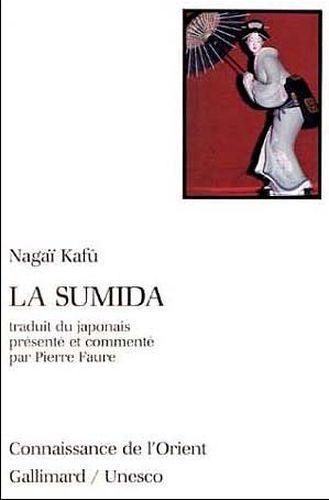
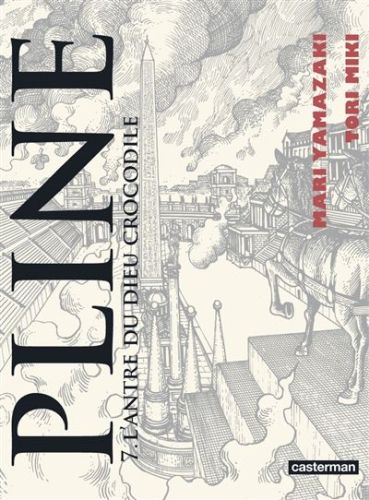





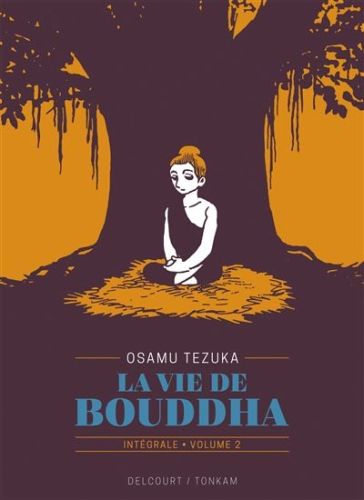
/image%2F1385856%2F20150204%2Fob_660a87_georges-abdaloff-croque-par-christell.jpg)