Le Royaume de Lankhmar, de Fritz Leiber
LEIBER (Fritz), Le Royaume de Lankhmar, [The Swords of Lankhmar], traduit de l’américain par Jacques de Tersac, Paris, Temps Futurs – Pocket, coll. Science-fiction, [1968, 1982] 1987, 316 p.
Cinquième volume du « cycle des Épées », Le Royaume de Lankhmar est (relativement) le plus long, et c’en est par ailleurs, sauf erreur, le seul roman. Et peut-être est-ce tant mieux, car, autant le dire de suite, je n’ai pas été très convaincu, cette fois ; j’ai même un peu peiné à la lecture de cette aventure trop longue et plutôt ennuyeuse…
Pourtant, ça commençait plutôt bien. Au tout début, nous retrouvons (évidemment) Fafhrd et le Souricier Gris, mais ils sont cette fois bien vite aux ordres de Glipkerio Kistomerces, le dirigeant de Lankhmar (notons au passage que, s’il y a décidément beaucoup de Lankhmar dans Ankh-Morpork, Glipkerio Kistomerces, un peu couillon, est par contre aux antipodes du Patricien Vétérini, autrement charismatique). Et, comme souvent finalement, ils ne tardent pas à prendre une fois de plus la mer : ils ont en effet été chargés d’escorter une volumineuse cargaison de grain, occupant plusieurs bons navires, à destination du seigneur Movarl-des-Huit-Cités : les cargaisons précédentes ont en effet disparu corps et biens pour une raison inconnue…
Bien des suppositions sont faites quant aux raisons de ces disparitions – et l’on peut un temps suspecter l’activité de dragons, il y en a même un qui a été dressé par… un Allemand (ils sont partout). Mais la vraie raison est ailleurs, ce que l’on devine très tôt dans la mesure où, parmi les passagers de la petite flotte lankhmarienne, se trouve la belle Hisvet, accompagnée de sa servante Frix, et, surtout, de douze rats blancs étonnament intelligents, capables de bien des prouesses. Ce qui rappelle bien sûr la légende sur les treize rats à même de commander à tous les rats – légende qui se décline pour tous les animaux, treize chats, treize chiens, treize chevaux, etc. Des rats sur un bateau chargé de grain, de toute façon ? Oui, on se doute qu’Hisvet – fille d’Hisvin, le plus grand marchand de grain de Lankhmar… – a quelque rôle à jouer dans cette histoire.
Et, à terme, nos héros devront faire face à une tétanisante invasion de rats, bien destinés à prendre le pouvoir à Lankhmar, et bientôt dans le monde entier… Même si, d’ici là, Fafhrd et le Souricier Gris se seront une fois de plus séparé, seul le second – qui n’a jamais aussi bien porté son nom – se trouvant tout d’abord dans la métropole, en attendant le retour providentiel de son comparse barbare. Et, dans l’ombre, les deux doivent faire appel (ou bien est-ce l’inverse ?) à la magie de Sheelba et Ningauble…
On l’aura compris à la lecture de ce bref résumé : Le Royaume de Lankhmar, en dépit des nombreux drames causés par les rats aussi voraces qu’ambitieux, s’inscrit clairement dans le registre le plus léger, et même humoristique, du cycle. Au début, tout cela marche plutôt bien… mais l’histoire, hélas, se traîne en longueur, et j’ai fini par renâcler à la lecture de ce roman, comme jamais auparavant dans les nouvelles (parfois fort longues, pourtant) composant les quatre premiers volumes du « cycle des Épées ». À force de répétitions, en effet, le récit lasse ; et ce d’autant plus qu’il est assez largement prévisible. Si l’on s’amuse bien, au tout début, devant les avanies du Souricier Gris confronté à la bêtise politique de Glipkerio Kistomerces et à la fourberie menaçante des rats de Lankhmar, ça ne dure pas éternellement, et l’on en vient à tourner les pages dans une accumulation de soupirs…
Une dimension du roman m’a plus particulièrement ennuyé, et c’est la libido exacerbée de nos deux héros. Certes, cela n’a rien de neuf : Fafhrd et le Souricier Gris ont régulièrement été présentés comme des coureurs de jupons ; dans l’avant-propos du premier volume, Fritz Leiber lui-même expliquait l’importance relative du sexe dans son cycle riche de fantasmes, ce qui me paraissait probablement exagéré jusqu’à présent. Mais, ici, les minauderies d’Hisvet et de Frix m’ont vite ennuyé, la drague façon « gros lourds » de Fafhrd et du Souricier Gris plus encore ; et quand ce dernier s’en est allé chercher l’amour chez les rattes (inévitablement ?) et le premier chez les vampires transparents avec l’étonnante Kreeshkra, c’est la lassitude qui l’a emporté chez moi…
Il y a bien des bonnes choses malgré tout dans ce roman : la Plaie Ratière de Lankhmar offre quelques beaux tableaux cauchemardesques, et l’humour de l’ensemble, parfois, fait mouche. Mais pas assez souvent, sans doute… Et, au final, Le Royaume de Lankhmar m’a fait l’effet d’un roman médiocre, étirant plus que de raison une histoire assez quelconque, qui aurait peut-être pu, en concentré, livrer une nouvelle ou novella correcte, mais qui ne tient pas la route dans ce format sans doute guère approprié au cycle. Bon, tant pis…
Prochaine étape : La Magie des glaces.

/image%2F1385856%2F20160114%2Fob_cfb8b0_caligari.jpg)




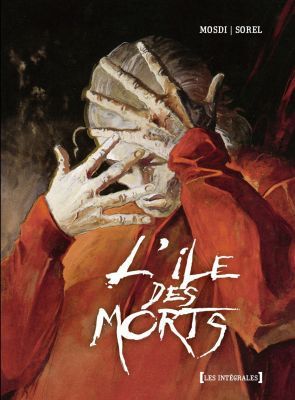


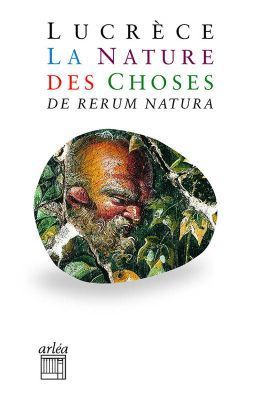
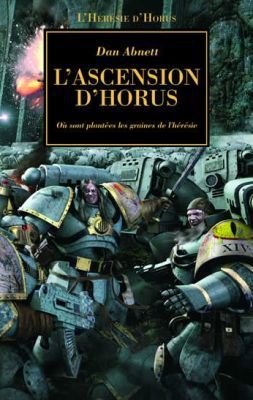



/image%2F1385856%2F20150204%2Fob_660a87_georges-abdaloff-croque-par-christell.jpg)