Lovecraft au cinéma, d'Alain Pelosato
PELOSATO (Alain), Lovecraft au cinéma. Avec la lettre de Pierre Dagon à Ralsa Marsh, Saint-Denis, Éditions Édilivre Aparis, 2011, 129 p.
Elle n'est pas facile, la vie de lovecraftophile compulsif. Pour dénicher très éventuellement un ou deux bijoux – en fait tout au plus des friandises la majeure partie du temps –, elle implique de se farcir quantité d'étrons, « hommages » au Maître dont celui-ci se serait sans doute bien passé. Cela vaut, à l'évidence, pour les très nombreux (trop, trop nombreux) « pastiches » censés participer de la mythologie lovecraftienne (ou plus souvent, hélas, derlethienne) ; mais c'est aussi vrai des essais. À l'évidence, les Joshi sont rares.
Prenez ce livre d'Alain Pelosato, par exemple. Je n'arrive pas à comprendre comment j'ai pu en faire l'acquisition. Bon sang : « édité » chez Édilivre – autrement dit pas édité du tout –, ça aurait dû suffire pour me faire fuir cette bouse indigente, mais non. Compulsion... Le nom d'Alain Pelosato aussi aurait dû me faire peur ; mais à l'époque de mon achat, je n'avais sans doute jamais entendu parler du monsieur. Depuis, cependant, on m'a dessiné à plusieurs reprises un portrait guère flatteur de ce sinistre personnage ; et là, après avoir lu – non, soyons honnête, « survolé », parce que bon – ce torchon, ben je comprends mieux, du coup.
Mais voilà : je me suis senti contraint de jeter un œil à ce machin quand j'ai appris que je devais participer prochainement, à l'occasion de la Necronomi'con lyonnaise (4 et 5 juillet 2015), à une table ronde sur les adaptations cinématographiques de Lovecraft où serait présent le monsieur (en tête d'affiche, même).
Mazette. Risque non négligeable que ça soit sportif, voire violent...
Car ce torchon est à n'en pas douter un des pires « livres » que j'ai jamais lus (et pas seulement dans le domaine fangeux de la lovecraftophilie la plus sordide). Rien d'étonnant à ce que ça ait fini chez Édilivre : aucun éditeur digne de ce nom n'aurait accepté de publier cette horreur.
Ce « livre » (bon sang que ça fait mal de reconnaître que cette abomination est un livre...) tient en effet de la performance scabreuse (et implique chez le lecteur une dose de masochisme franchement déraisonnable). Construit de bric et de broc, il a certes pour thème essentiel les adaptations cinématographiques de Lovecraft, mais comprend aussi un chapitre (dont on se demande franchement ce qu'il fout là) sur le rapport à la nature dans les œuvres du Maître de Providence, dont le moins que l'on puisse dire est qu'il n'est guère convaincant, ainsi qu'une nouvelle absolument dénuée du moindre intérêt, « La Lettre de Pierre Dagon à Ralsa Marsh » (Pierre Dagon étant un pseudonyme de « l'auteur »). Bon, inutile de développer outre mesure sur ces bouche-trous...
Reste Lovecraft au cinéma, donc. L'essentiel, hein. En notant d'emblée, beau témoignage de sérieux et de professionnalisme, qu'un chapitre entier, d'une quinzaine de pages, est consacré aux films que Pelosato... n'a pas vus. Bon... Cela dit, le reste vaut le détour, même si tout cela est largement redondant dans les différents chapitres, qui reviennent sans cesse sur les mêmes films et les mêmes réalisateurs, témoignage supplémentaire mais particulièrement éloquent de l'absence de véritable plan, autant dire au-delà de méthode, caractérisant ce machin (dépourvu par ailleurs de toute réflexion d'ensemble, ne serait-ce que sur la difficulté à figurer, à représenter l'horreur lovecraftienne...). Le lovecraftophile, même très amateur, n'y apprendra somme toute pas grand-chose (à s'en tenir aux films listés), mais aura l'occasion, régulièrement, en tournant les pages les yeux exorbités et la sueur au front, de tomber sur des morceaux d'anthologie, à mourir de rire, ou à vomir, disons les deux, tiens, et en même temps.
Car Alain Pelosato, dans ce bouquin construit n'importe comment, écrit avec les tentacules et à l'évidence pas relu (ça dépasse les simples coquilles : il y a régulièrement d'authentiques fautes, voire, c'est récurrent, des fragments entiers manquants), fait preuve d'un sens critique extraordinaire. Sa synthèse est impressionnante à cet égard ; pour m'en tenir à un exemple, et non des moindres, je mentionnerais la « critique » finale du Re-Animator de Stuart Gordon : « Adaptation des nouvelles Herbert West de Lovecraft. Brrr... » Je vous épargne les autres, ça revient souvent au même. Considérer que ce film dont le gore se veut humoristique puisse faire frissonner, en même temps, c'est assez édifiant. Mais ne lui accorder qu'un « Brrr... » en guise de synthèse finale, même s'il y a eu davantage de développements concernant ce métrage auparavant, relève au choix de l'escroquerie, du je-m'enfoutisme ou de l'incompétence (et peut-être de tout cela à la fois).
Mais Alain Pelosato est à n'en pas douter un authentique cinéphile. Je dirais même un cinéphile punk. Seul un cinéphile punk peut en effet trouver du talent à Uwe Boll (pour Alone in the Dark et pour House of the Dead, « qui n'était pas non plus un si mauvais film que cela... »), ou dire de l'affreux Alien vs. Predator de Paul W.S. Anderson que c'est un « superbe film ! ».
Bon : le manque de discernement de « l'auteur » est stupéfiant, qui opère un nivellement par le bas dont on aurait envie de ricaner, même s'il se présentait sous la forme hélas commune d'un blog complaisant – alors un livre... Car presque tout est bon, aux yeux de Pelosato. Sans même parler de la fidélité à Lovecraft : pour en rester à Stuart Gordon, on peut ici évoquer le cas de son From Beyond, qui a certes bien des fans parmi les bisseux, mais pour une fois je n'en fais pas partie ; là n'est pas la question, et je veux bien jouer le jeu du « les goûts, les couleurs » ; par contre, prétendre que c'est « fidèle » ? Euh... Je ne me souviens plus des passages SM fétichistes dans la nouvelle de Lovecraft, mais ça doit être que j'ai une mauvaise mémoire.
La vision d'Alain Pelosato est à vrai dire plus qu'à son tour perturbante. Et, au-delà des questions d'appréciation, toujours discutables, les erreurs factuelles ne manquent pas : à titre d'exemple, insister, en 2011, sur le caractère « maudit » et « rejeté par l'establishment » de John Carpenter, là où ledit réalisateur est sans doute un des rares à bénéficier d'une reconnaissance critique pour ses films de fantastique ou de science-ficton, même pour les plus B, voire parfois Z, ça témoigne quand même assez de ce que Pelosato a des œillères...
J'imagine que je pourrais encore broder, quant à la pure critique, ou, et c'est encore plus gênant, aux lacunes dans l'énumération des films d'inspiration lovecraftienne, ce genre de choses. Mais ce n'est sans doute pas nécessaire : je suppose que les quelques paragraphes qui précèdent suffisent à reléguer ce Lovecraft au cinéma dans les oubliettes de l'auto-édition pour guignols. Fuyez cette horreur. La lovecraftophilie compulsive ne justifie pas tout...

/image%2F1385856%2F20160114%2Fob_cfb8b0_caligari.jpg)



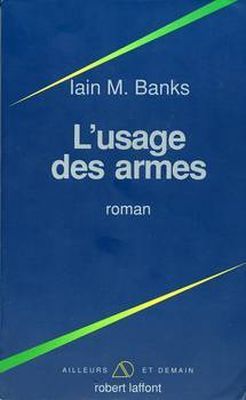

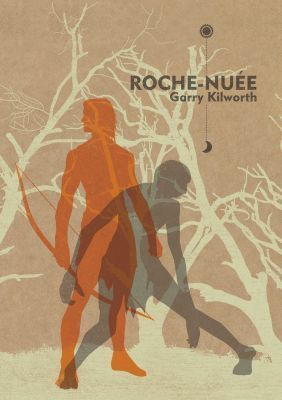


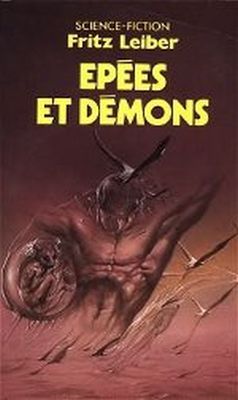

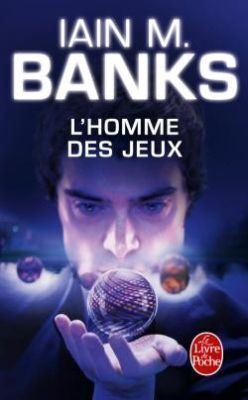
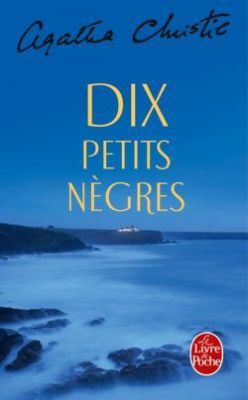
/image%2F1385856%2F20150204%2Fob_660a87_georges-abdaloff-croque-par-christell.jpg)