"Le Temps incertain", de Michel Jeury

JEURY (Michel), Le Temps incertain, Paris, Robert Laffont – Presses Pocket, coll. Science-fiction, [1973] 1979, 252 p.
J’avais pris un mauvais départ avec Michel Jeury, auteur phare s’il en est de la science-fiction frrrrrrançaise, et qui avait a priori tout pour me plaire, dans la mesure où on en a souvent fait un « Dick français ». En effet, je l’ai découvert en lisant au pire moment (pour des raisons toutes personnelles) Soleil chaud, poisson des profondeurs, et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’expérience n’avait pas été concluante : ce troisième tome de la « trilogie chronolytique » (mais chacun peut se lire indépendamment, peu importe l’ordre) m’avait fait l’effet d’un roman imbitable, auquel je n’avais absolument rien panné, et dont la lecture m’avait semblé d’autant plus pénible qu’il était pollué par un ennuyeux et omniprésent jargon SF… Du coup, arrivé à la fin, je n’avais absolument rien à en dire. Aussi est-ce en partie à cause de ce roman (l’autre partie étant l’excellent Yama Loka terminus de Léo Henry & Jacques Mucchielli, que j’avais adoré mais dont je me sentais incapable de parler) que j’avais alors abandonné mon blog pour près d’un an. Ce qui a retardé d’autant plus ma lecture des deux autres tomes de la trilogie, Le Temps incertain et Les Singes du temps… Mais, une fois de plus, c’est la lecture de La Science-fiction en France de Simon Bréan qui m’a décidé à sauter le pas, avec le premier volume, généralement considéré comme le chef-d’œuvre de l’auteur.
Le Temps incertain s’ouvre sur une citation… de Philip K. Dick, donc, influence revendiquée :
« J’ai le sentiment profond qu’à un certain degré il y a presque autant d’univers qu’il y a de gens, que chaque individu vit en quelque sorte dans un univers de sa propre création : c’est un produit de son être, une œuvre personnelle dont peut-être il pourrait être fier. »
Voilà qui annonce la couleur. Les manipulations temporelles de Michel Jeury via la chronolyse (pas évidente à définir, on va s’abstenir…) aboutissent en effet à autant d’univers subjectifs, dotés d’une réalité qui n’est pas moindre que la réalité supposée objective et la même pour tous ; c’est dans ce sens que le temps devient incertain, et que l’on navigue tant bien que mal dans l’Indéterminé.
Le roman s’ouvre sur une scène tout d’abord à peu près normale (pour un roman de SF s’entend) : vers le milieu du XXIe siècle, le docteur Robert Holzach, psychronaute de son état pour l’Hôpital de Garichankar, entre en chronolyse profonde ; il a pour mission de « contacter » un homme de 1966, Daniel Diersant, qui pourrait être d’une importance déterminante pour… on ne sait pas vraiment encore quoi. Et puis, dès la fin du chapitre, ça commence à partir en couille, formellement surtout ; mais fond et forme sont en fait indissociables dans ce roman, ainsi que la suite en témoigne bien vite.
Nous rencontrons donc bientôt Daniel Diersant. Nous sommes en 1966, dans la région parisienne. Diersant est (était ?) chimiste et traducteur technique pour une importante entreprise pharmaceutique franco-allemande (mais, ainsi qu’on nous le rappelle souvent, les chronolytiques n’existaient pas en 1966). Une guerre de succession fait rage dans la boîte, et Diersant, plutôt discret, a néanmoins choisi son camp. Il a rendez-vous avec un ponte de l’entreprise, et s’y rend en voiture.
Et c’est là que les choses dérapent.
Suite à… un accident ? l’absorption d’une drogue ? les deux ? tout autre chose ? Diersant se retrouve en chronolyse, plongé dans le Temps incertain. Ce qui se traduit par la répétition de scènes connaissant de subtiles variations (pour le coup, j’ai beaucoup pensé à Glissement de temps sur Mars de Philip K. Dick) et n’obéissant pas à la linéarité. On ne compte pas les fois où Diersant klaxonne à l’entrée de l’usine, puis, après un bref saut temporel, se retrouve harcelé par la 404 grise du flic de la boîte, Forestier. Sans parler du reste.
Et Diersant, bien malgré lui, de se retrouver ainsi plongé dans un cauchemar circulaire, où les boucles temporelles s’entremêlent sans que ne se dessine la moindre échappatoire (dans un premier temps tout d’abord ; mais peut-être la solution se trouve-t-elle sur la plage aux deux soleils de la Perte en Ruaba ?). En fait, il semblerait que notre « héros » se retrouve coincé dans la guerre que se livrent l’empire industriel HKH (pour Harry Krupp Hitler ?) et les hôpitaux autonomes dont Garichankar ; une guerre impitoyable, prenant place tant dans le Temps incertain que dans l’univers « physique ». Il lui faudra choisir son camp… ou pas.
En attendant, les séquences se répètent, avec d’infimes variations, pourtant fondamentales. Et Diersant, progressivement, d’acquérir un certain contrôle sur son périple dans l’Indéterminé, de faire varier les scènes, en disant ou pas les mots, en croisant ou pas tel ou tel personnage, parfois en s’effaçant devant la personnalité plus aventureuse du marin à la main atrophiée Renato Rizzi…
Bluffant.
On peut craindre, au début, l’exercice de style un peu vain, redouter que l’emboîtement des séquences « aléatoires » et répétitives ne tienne pas la route sur les quelques 250 pages du roman. Et pourtant si. Et c’est tout sauf vain. Et c’est tout sauf lassant. Michel Jeury fait preuve ici d’une dextérité rare, qui rend le roman (accessoirement – ou pas – fort bien écrit) aussi palpitant que fascinant. On pense effectivement beaucoup à Philip K. Dick, mais au meilleur de sa forme ; on peut aussi penser, de manière anachronique sans doute (mais bon, hein, c’est la chronolyse après tout), à Christopher Priest, puisque bien des choses ici se jouent sous l’angle de la perception.
Mais cela n’enlève rien à la singularité du Temps incertain, qui est bien, cette fois je ne prétendrai pas le contraire, le chef-d’œuvre que l’on a dit. Le roman est d’une efficacité redoutable, proprement cauchemardesque, et en même temps teinté d’espoir, avec les Pêcheurs de la Perte en Ruaba. Si la réalité est ici truquée, le « héros » comme le lecteur participent du truquage, et, en fonction des choix, délibérés ou subis, peuvent se dessiner tant des tableaux d’horreur (les incendies d’HKH sont proprement dantesques) qu’une vague utopie, séduisante dans son abstraction.
Roman unique en son genre et visionnaire (Jeury, ici, préfigure aussi dans un sens le cyberpunk), Le Temps incertain colle une sacrée baffe. Je suis bien loin de la déception de Soleil chaud, poisson des profondeurs (qu’il faudrait peut-être que je relise, cela dit, dans de meilleures conditions), et mon enthousiasme pour ce roman ne saurait faire de doute. Brillant, aussi intelligent que beau et efficace, Le Temps incertain a effectivement tout du chef-d’œuvre. De la science-fiction française, certes, mais aussi au-delà. Indispensable.

/image%2F1385856%2F20160114%2Fob_cfb8b0_caligari.jpg)



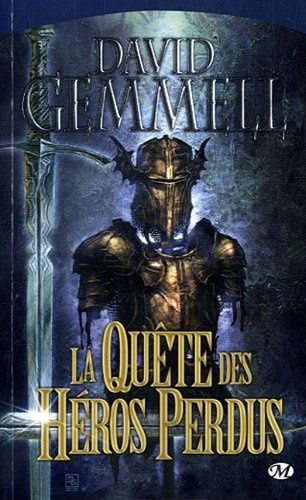

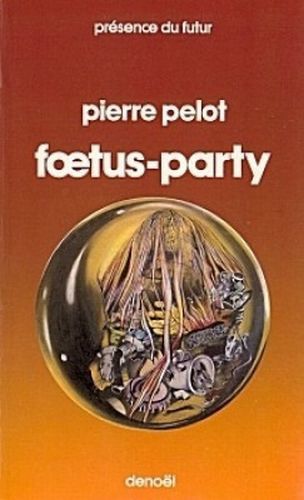





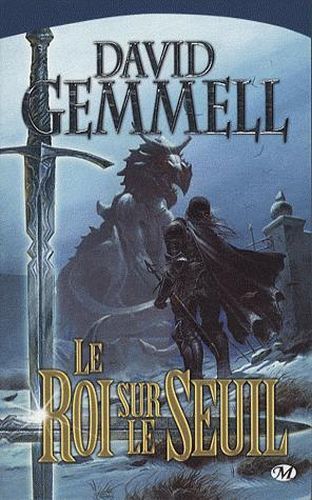

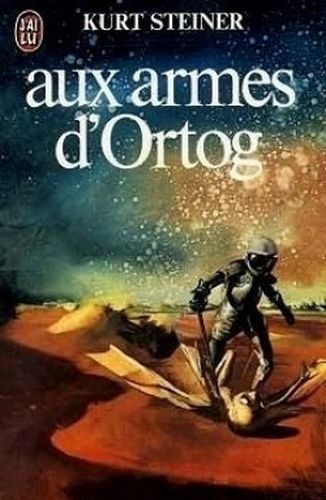

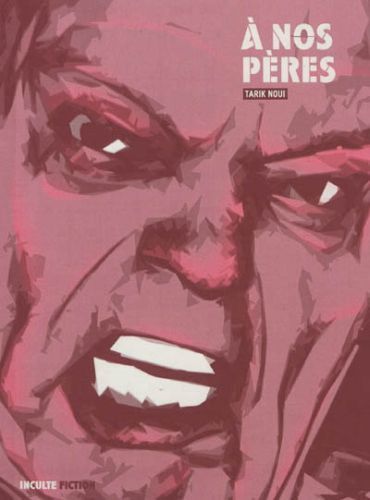



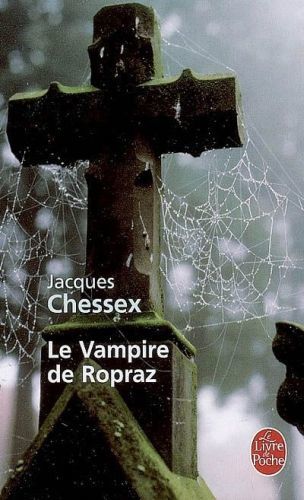

/image%2F1385856%2F20150204%2Fob_660a87_georges-abdaloff-croque-par-christell.jpg)