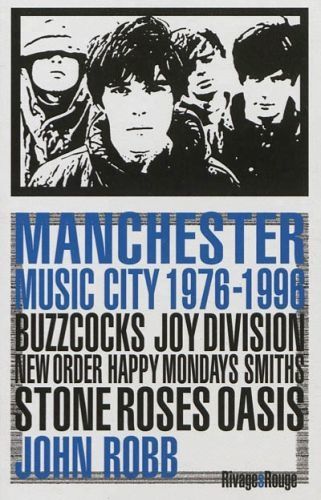
ROBB (John), Manchester Music City 1976-1996. Buzzcocks, Joy Division, The Fall, New Order, The Smiths, The Stone Roses, Happy Mondays, Oasis..., [Manchester Music City], préface de Jean-Daniel Beauvallet, traduit de l’anglais par Jean-François Caro, Paris, Rivages, coll. Rouge, [2009-2010] 2012, 615 p.
Après Control d’Anton Corbijn et 24 Hour Party People de Michael Winterbottom, je poursuis mon périple mancunien avec un livre, cette fois : Manchester Music City de John Robb, qui fut lui-même en son temps un acteur de la scène locale avant de devenir journaliste. Un beau pavé, même en poche, que j’ai pourtant, dans un sens, trouvé trop court et un peu frustrant, tant la matière est passionnante. C’est qu’il y en a, des choses à dire sur Manchester et sa musique. D’autant qu’il ne faut pas se fier à la couverture, une fois n’est pas coutume : le livre commence bien avant 1976, avec notamment les heures épiques de la northern soul dans laquelle d’aucuns ont vu un précurseur notable de la techno et de la house – mais on y reviendra à l’époque de Madchester –, et se poursuit au-delà de 1996, même si ce n’est qu’avec quelques aperçus. De même, Manchester Music City ne se contente pas de parler des Buzzcocks, de Joy Division, de New Order, des Happy Mondays, des Smiths, des Stone Roses et d’Oasis : c’est véritablement toute la scène mancunienne qui y est envisagée, avec d’autres groupes fameux comme A Certain Ratio, The Fall, James, les Inspiral Carpets, 808 State, ou même, plus récemment (et très brièvement, certes) les Chemical Brothers ou encore The Verve… sans compter les dizaines de groupes plus confidentiels qui ont fait partie de l’histoire locale, et que John Robb donne sacrément envie de découvrir.
Manchester Music City est, dans les grandes lignes, construit selon les mêmes principes que Please Kill Me de Legs McNeil et Gillian McCain (ce qui nous renvoie, en science-fictionnie, au très recommandable Outrage et rébellion de Catherine Dufour) : il s’agit pour l’essentiel d’un recueil de témoignages, émanant de dizaines de personnalités, et assemblés de manière à constituer une trame cohérente (même si le résultat final est peut-être parfois un peu confus). Cependant, je n’hésiterai pas à dire que j’ai largement préféré Manchester Music City à Please Kill Me, en ceci, notamment, qu’il est beaucoup moins « racoleur », tourné vers le scandale, et nettement plus intéressé (et intéressant) par la musique en elle-même. Certes, la drogue ne manque pas dans ces pages – au moment de Madchester, ça vire limite à l’apologie –, mais c’est toujours la musique qui est au premier plan (et quelle musique !). En outre, de manière étrange, alors qu’il est à la base supposé se concentrer sur une ville – et c’est bien le cas, il n’y a pas de hors-sujet, ne me faites pas dire ce que je n’ai pas dit –, Manchester Music City est plus « ouvert » que Please Kill Me (qui m’avait un peu gêné par son arrogance américano-centrée), et sait retracer les influences et rivalités dans lesquelles baignait la musique mancunienne.
Manchester est souvent présentée comme la « ville de la modernité » ; elle le fut incontestablement en musique, après avoir rattrapé le punk de Londres – et là, effectivement, 1976 est une année fondamentale, en raison des mythiques concerts des Sex Pistols dans la ville industrielle du nord de l’Angleterre que j’avais déjà évoqués (sous l’angle de la légende…) en traitant de 24 Hour Party People. Le punk anglais fut certes un mouvement très éphémère (deux ans, on va dire…), mais il fit l’effet d’une véritable révolution (trop sous-estimée dans Please Kill Me, donc, qui se montre méprisant à son égard, ne s’intéressant qu’aux scandales gravitant autour de Sid Vicious, et n’envisage le punk que sous son angle le plus « authentique », et donc nécessairement américain…), et les concerts des Sex Pistols générèrent effectivement toute une scène remarquablement inventive (quand bien même elle se composait pour une large part de branleurs).
Ici, il faut accorder une place prépondérante aux Buzzcocks, notamment dans leur première formation emmenée par Howard Devoto et Pete Shelley : avec la sortie de Spiral Scratch, EP auto-produit, ils suscitèrent la vague du « do it yourself », qui eut une influence durable (à cet égard, je ne saurais trop vous conseiller de jeter une oreille sur l’excellente compilation D-I-Y. Do It Yourself. The Rise Of The Independent Music Industry After Punk). Et suivit bientôt ce que l’on considère à juste titre comme l’un des gestes les plus punks de l’histoire du genre : Devoto quitte le groupe au succès embryonnaire… Cela n’empêchera pas les Buzzcocks de poursuivre leur chemin, s’éloignant progressivement du punk sauvage des origines pour se tourner vers une pop énergique et remarquablement efficace, et devenant une incroyable usine à singles d’anthologie. Je n’hésiterai pas pour ma part à proclamer que les Buzzcocks sont mon groupe punk préféré (avec les bien plus excités et ricains Dead Kennedys), loin devant les Sex Pistols ou les Clash (eh oui).
Mais le grand groupe mancunien – celui qui m’a attiré vers cette scène si particulière – est incontestablement Joy Division, groupe très éphémère en raison du suicide de son chanteur Ian Curtis (du coup, il n’a livré que deux albums, tous deux fabuleux, Unknown Pleasures et Closer ; de l’avis des principaux intéressés, le reste, c’est du merchandising – ce qui me paraît un peu exagéré notamment en ce qui concerne Still…), mais qui, lui aussi, bouleversa les mentalités et la musique. Lié à l’existence du label indépendant par excellence, Factory, Joy Division est sans doute le groupe qui a su le mieux saisir l’esprit de la Manchester post-industrielle d’alors. Les pages qui sont consacrées à ce groupe culte entre les groupes cultes sont passionnantes, et on y apprend bien des choses (notamment, j’ai découvert que Ian Curtis et Genesis P-Orridge étaient des amis qui s’admiraient mutuellement… et qu’ils avaient le projet de faire quelque chose ensemble, idée qui me fait baver de frustration, et suscite en moi des rêves uchroniques…).
Après le décès de Ian Curtis, Joy Division se mue en New Order. Je vais être franc : je n’ai jamais été très fan de ce groupe au succès colossal, qui me paraît largement surestimé. Alors, certes, il y a bien quelques chef-d’œuvres dans la production du groupe, comme l’inévitable « Blue Monday » préfigurant la musique électronique de la ville, et notamment l’acid house, ou encore le très bel instrumental « Elegia ». La lecture du livre de John Robb fut cependant l’occasion de me replonger dans la discographie du groupe, et, si le bilan reste sensiblement le même, je ne regrette pas cette nouvelle tentative. Et puis, bien sûr, grâce à la thune de New Order, il y eut l’Haçienda… mais on y reviendra.
En attendant, il est un autre groupe que j’ai redécouvert grâce à Manchester Music City, à savoir les Smiths de Morrissey et Johnny Marr (je ne savais même pas que c’était un groupe mancunien, honte sur moi…). Je n’en ai jamais été très fan (pas plus que de Morrissey en solo, d’ailleurs), ayant quelques soucis avec la voix du Moz (on parla aussi de Mozchester…) et trouvant, pour reprendre les termes d’un camarade, que c’est quand même un peu de la chansonnette, tout ça… J’en ai cependant profité pour écouter le cultissime The Queen Is Dead – qui m’a laissé assez froid, décidément –, ainsi que Meat Is Murder (celui que j’ai préféré) et Strangeways, Here We Come, le dernier album du groupe. Quelques jolies choses, tout de même, mais mon avis global concernant ce groupe n’a pas changé pour autant (ou à peine).
L’arrivée du hip hop (trop souvent négligé) et de l’acid house à Manchester, notamment par le biais de l’Haçienda, donc (avec quelques DJs légendaires tels Mike Pickering, Dave Haslam ou, quand bien même il n’est évoqué qu’en filigrane, un tout jeune Laurent Garnier, si je ne m’abuse), va susciter une nouvelle révolution : à la fin des années 1980, Manchester deviendra Madchester, l’ecstasy aidant, et, des soirées à Fac 51 aux raves plus ou moins improvisées, on parlera d’un nouveau « summer of love ». Cette fois, plus aucun doute ne sera permis : Manchester aura clairement un à deux ans d’avance, au moins, sur Londres et les autres grandes villes britanniques. Et ce mouvement va susciter l’éclosion de nombre de nouveaux groupes, et notamment ceux dits « baggy », parmi lesquels on retiendra surtout deux groupes que j’adore, et qui s’adoraient mutuellement (contre la légende de rivalité qu’entendait leur imposer la presse anglaise…), les Happy Mondays et les Stone Roses.
Les Happy Mondays, emmenés par les frères Shaun et Paul Ryder, et toujours sur Factory, sont sans doute le groupe le plus emblématique de cette période, avec leur musique difficilement qualifiable, parfois dite « indie dance », mêlant influences acid house et rock indé pour un résultat unique en son genre, et qui eut un succès retentissant. De même que dans 24 Hour Party People (ce titre renvoyant, ainsi que je l’avais déjà rappelé, à un des plus célèbres morceaux du groupe, issu de son premier album), les pages consacrées ici aux Mondays sont le plus souvent hilarantes – les interviews de Shaun Ryder y sont pour beaucoup – et tout à fait passionnantes (bon sang, j’y ai même appris que les Happy Mondays avaient fait la première partie de Laibach ! J’ose pas imaginer la gueule du public, dans les deux cas, d’ailleurs…). Une belle histoire de « rise and fall »…
Quant aux Stone Roses, c’est un groupe qui a eu un parcours pour le moins étrange, changeant souvent de formation, voire de style (on les a même qualifiés un temps de « gothiques »… surtout en raison de leurs fringues, à vrai dire ; à noter, d’ailleurs, que tous les intervenants de ce livre, absolument tous, semblent accorder une importance extrême aux vêtements et aux coiffures…), et n’obtenant le succès que tardivement. À vrai dire, les Stone Roses ne sont largement que le groupe d’un seul album (parce que, du coup, j’ai – enfin – écouté Second Coming, accouché dans la douleur, et c’est quand même passablement de la merde…). Mais quel album ! The Stone Roses est incontestablement à mes yeux un des plus grands chef-d’œuvres de la pop, un putain d’album qui enchaîne les tubes, avec une originalité indéniable. Et les Roses, à leur tour, de susciter la création de nouveaux groupes…
Parmi lesquels, Oasis. Bon… J’en cause parce que le bouquin se finit dessus, mais je n’ai vraiment jamais aimé ce groupe, pas plus que la mouvance dite « britpop » (au passage, dans la pathétique guéguerre entre Blur et Oasis, j’ai – malgré tout – choisi mon camp, camarades…). Je ne leur reconnais qu’un seul bon morceau, « Wonderwall » (merci le violoncelle…). Bon, un peu dommage d’achever ce si beau périple avec un groupe de merde, mais il est vrai que, vu le succès d’Oasis, il était difficile de faire autrement…
J’ai négligé bien des choses dans ce compte rendu ; c’est que, encore une fois, il y a tant à dire… Mais je vous engage à découvrir par vous-même l’univers merveilleux de la musique mancunienne. Manchester Music City est un bouquin riche et passionnant, indispensable aux fans de ces divers groupes, et qui permettra aux autres de faire de très jolies découvertes.
Allez, hop, une petite (enfin, pas si petite que ça…) playlist, limitée aux groupes figurant sur la couverture (Désolé pour les liens en blanc, ils fonctionnent, c'est juste Over-Blog qui fait sa pute...).
BUZZCOCKS : Airwaves Dream ; Alive Tonight ; All Over You ; Are Everything ; Autonomy ; Boredom ; Breakdown ; Ever Fallen In Love (With Someone You Shouldn’t’ve?) ; Everybody’s Happy Nowadays ; Friends Of Mine ; I Believe ; I Don’t Mind ; Innocent ; Isolation ; Just Lust ; Libertine Angel ; Lipstick ; Moving Away From The Pulsebeat ; Oh Shit ; Orgasm Addict ; Paradise ; Promises ; Raison d’être ; Something’s Gone Wrong Again ; Soul On A Rock ; Times Up ; Totally From The Heart ; What Do I Get ; Whatever Happened To? ; Who’ll Help Me Forget? ; Why Can’t I Touch It? ; Why She’s A Girl From The Chainstore.
JOY DIVISION : Atmosphere ; Atrocity Exhibition ; Candidate ; Colony ; Day Of The Lords ; Dead Souls ; Digital ; Disorder ; Exercise One ; Heart And Soul ; Ice Age ; Insight ; Interzone ; I Remember Nothing ; Love Will Tear Us Apart ; New Dawn Fades ; Passover ; Shadowplay ; She’s Lost Control ; The Eternal ; The Eternal (Live) ; The Kill ; The Only Mistake ; The Sound Of Music ; Transmission ; Twenty Four Hours ; Walked In Line ; Wilderness.
NEW ORDER : All Day Long ; Angel Dust ; Blue Monday ; Broken Promise ; Ceremony ; Crystal ; Elegia (Full Version) ; In A Lonely Place ; Leave Me Alone ; Lonesome Tonight ; Murder ; Paradise ; Sub-Culture ; Temptation ; Way Of Life.
HAPPY MONDAYS : 24 Hour Party People ; Angel ; Bob’s Yer Uncle ; Dustman ; Fat Lady Wrestlers ; God’s Cop ; Hallelujah (Club Mix) ; Harmony ; Judge Fudge ; Kinky Afro ; Kuff Dam ; Loose Fit ; Mad Cyril ; Monkey In The Family ; Oasis ; Performance ; Rave On (Club Mix) ; Stayin’ Alive (12’’ Mix) ; Step On ; Stinkin’ Thinkin’ ; Sunshine And Love ; Tart Tart ; Weekend S ; W.F.L.
THE SMITHS : Barbarism Begins At Home ; Bigmouth Strikes Again ; Death Of A Disco Dancer ; How Soon Is Now? ; Last Night I Dreamed That Somebody Loved Me ; Meat Is Murder ; Some Girls Are Bigger Than Others ; Stop Me If You Think You’ve Heard This One Before ; The Headmaster Ritual ; The Queen Is Dead ; This Charming Man ; Well I Wonder.
THE STONE ROSES : Begging You ; Don’t Stop ; Elephant Stone ; Elizabeth My Dear ; Fools Gold (Full Version) ; Full Fathom Five ; Here It Comes ; I Am The Resurrection ; I Wanna Be Adored ; Love Spreads ; Made Of Stone ; Mersey Paradise ; Sally Cinnamon ; She Bangs The Drums ; Shoot You Down ; Something’s Burning ; (Song For My) Sugar Spun Sister ; So Young ; Tell Me ; The Hardest Thing In The World ; This Is The One ; Waterfall.
OASIS : Wonderwall.



/image%2F1385856%2F20160114%2Fob_cfb8b0_caligari.jpg)



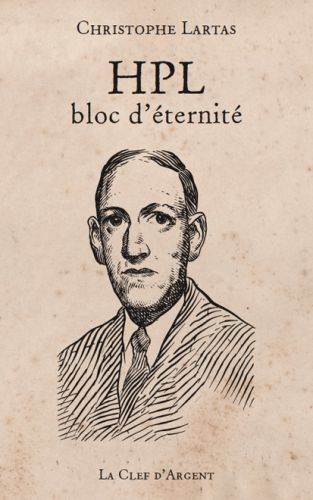
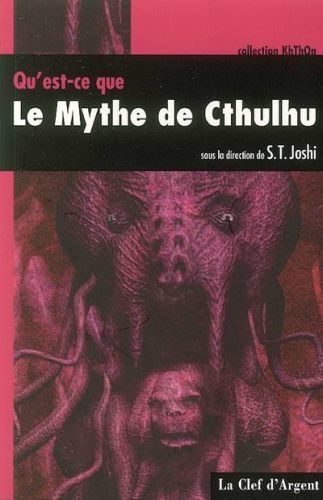

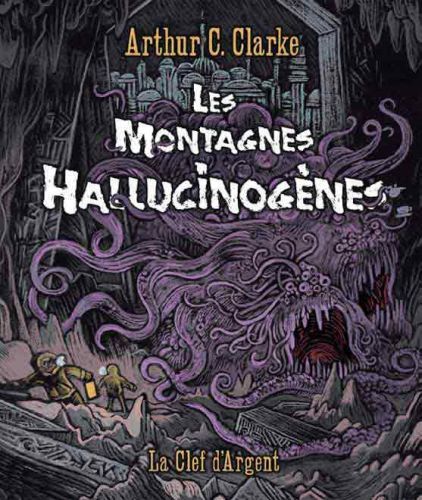




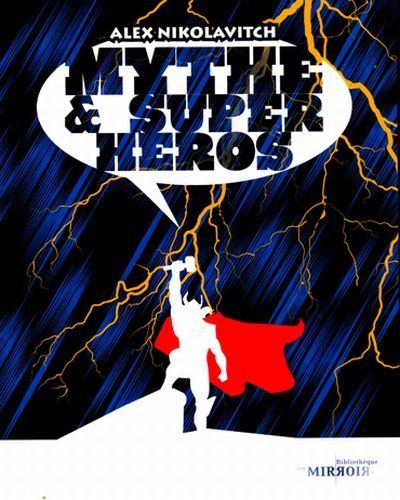




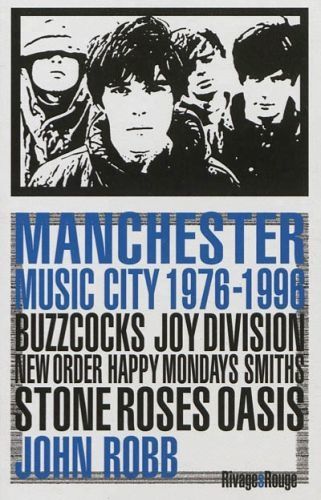

/image%2F1385856%2F20150204%2Fob_660a87_georges-abdaloff-croque-par-christell.jpg)