
CORTI (José), Souvenirs désordonnés, [Paris], José Corti, coll. Les Massicotés, 2010, 255 p.
ÇA Y EST ! J’EN SUIS ENFIN ARRIVÉ AU BOUT !
Non, parce que, c’est pas pour dire, mais les Souvenirs désordonnés du père Corti sont quand même comme qui dirait d’une lecture aride. Intéressante, certes, passionnante même (j’y reviens de suite, ne vous en faites pas), mais aride. À cela, trois raisons :
1/ Il s’agit effectivement de Souvenirs désordonnés : l’auteur se laisse guider par sa plume, passant sans cesse du coq à l’âne sans respecter le moindre plan.
2/ Ceci expliquant sans doute cela, il n’y a pas le moindre chapitre dans tout ce volume : tout s’enchaîne, sans queue ni tête, et sans répit.
3/ Pour cette réédition chez l’éditeur même (le livre, si je ne m’abuse, était autrefois paru en 10/18, et avait semble-t-il connu d’autres éditions auparavant… chez Corti même ?), le choix a été fait d’une police de caractères minuscule qui pique les yeux.
Bref, c’est aride.
Mais, heureusement, c’est fort intéressant, et même souvent passionnant. C’est que l’éditeur, entre autres, de Julien Gracq, en a des choses à dire, sur bien des sujets ; et, qui plus est, qu’il les dit fort bien, avec une verve, un phrasé, un style enfin, tout à fait remarquables, dignes des meilleurs prosateurs. On sent vraiment l’homme de lettres derrière le libraire et l’éditeur.
Alors José Corti raconte. En vrac, comme cela vient. Il raconte sa maison, bien sûr, la librairie Corti, la maison d’édition à la rose des vents, proclamant haut et fort sa devise : « Rien de commun ». C’est le moins que l’on puisse dire. Dans le paysage éditorial français, Corti a toujours fait figure de franc-tireur isolé, publiant peu, et à petit tirage, mais publiant avec un goût sûr. Citons Gérard Guillot dans Le Figaro :
« José Corti : un être rare, inconnu ou presque du grand public. Mais un modèle : l’éditeur qui n’a jamais publié ce qu’il n’aimait pas. Et il n’aimait que l’écriture la plus haute, la création la plus aiguë, la littérature la plus noble. »
(Avec un bémol sur ce dernier point : José Corti se déclare dans ces pages amateur de littérature populaire et notamment des Fantômas.)
Citons encore Jacques de Decker, dans Le Soir :
« Hostile non seulement à tout ce que Gracq avait dénoncé dans son pamphlet La Littérature à l’estomac, mais à toutes les techniques de mercantilisation et de vulgarisation du livre, il apparaissait, dans le milieu éditorial parisien, comme une sorte de dernier des Mohicans. »
Il y eut les surréalistes et les dadas, tout d’abord, qu’il fréquenta et édita à « la grande époque », et à propos desquels il ne manque pas d’anecdotes plus ou moins croustillantes, mais aussi de propos plus graves (il livre de longues et profondes réflexions sur Breton et son « silence », notamment). Et puis Gracq, bien sûr, auteur qu’il a « découvert » (il s’étend notamment sur le Goncourt refusé pour Le Rivage des Syrtes)…
Mais il ne s’arrête pas là, et multiplie digressions et portraits. À travers son livre, c’est tout un monde qui revit, notamment le Paris de l’entre-deux-guerres… et de l’Occupation. Période fatale, dramatique. Corti est un éditeur engagé, son fils est résistant. Mais, du fait des activités d’un sinistre individu, Dominique Corti sera capturé par les Allemands, déporté, et mourra dans les camps. Lourd traumatisme, qui pèse sur l’ensemble de l’ouvrage, et revient sempiternellement, avec la régularité d’un métronome. Et toujours reviennent, parallèlement, la difficulté, pour ne pas dire l’impossibilité du pardon, et la tentation de la vengeance, jusqu’au meurtre…
Il y a bien des passages tragiques dans ces Souvenirs désordonnés. Je retiens notamment l’évocation du suicide de Crevel, effroyablement touchante (et Corti s’y montre impitoyable avec les surréalistes). Mais il en est heureusement d’autres plus souriants, plus savoureux, très drôles, même, parfois ; comme la vie, en somme (pardon pour le cliché…). Il y a surtout toute une collection de portraits extrêmement vivants, plus vrais que nature pour ainsi dire, d’auteurs, de critiques, d’universitaires, de peintres, etc. Pour être franc, je n’avais jamais entendu parler, moi le béotien, des trois-quarts d’entre eux, mais ça ne m’a pas empêché de trouver le tout passionnant.
Bien sûr, il est des fois où Corti agace. On sent le vieillard, « l’anachronisme », l’homme d’une autre époque, d’un autre monde. Souvent à l’avant-garde, il n’en sombre pas moins parfois dans la réaction, et a bien de temps à autre quelques réflexions de, pardon aux familles, vieux con. Il ne manque pas non plus d’une certaine préciosité. Personne n’est parfait…
Reste que la lecture de ces Souvenirs désordonnés est indispensable à qui s’intéresse à l’édition en France au XXe siècle. Certes, avec José Corti, on est à des années-lumière de Gaston Gallimard… Mais c’est justement ce décalage qui fait l’intérêt de la chose, outre ses grandes et indéniables qualités littéraires, qui en font déjà une autobiographie du meilleur tonneau.
Aride, donc, mais fort bon.


/image%2F1385856%2F20160114%2Fob_cfb8b0_caligari.jpg)


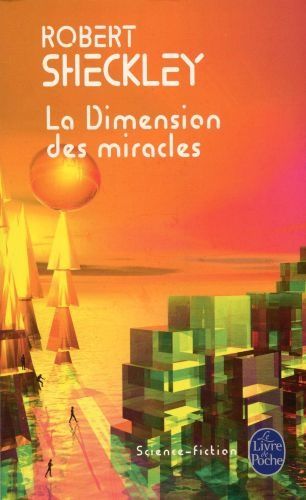







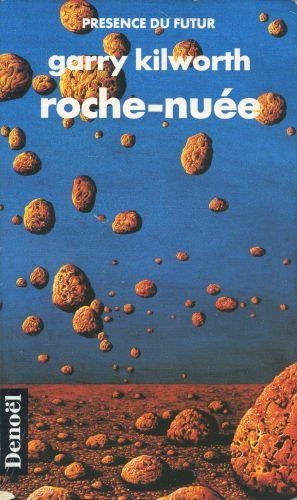

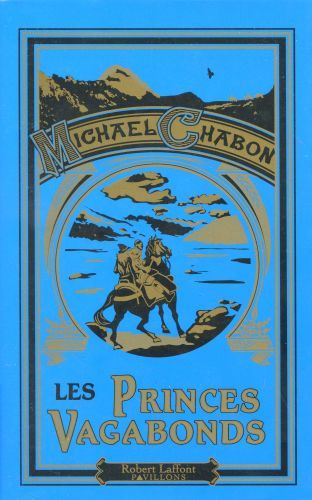

/image%2F1385856%2F20150204%2Fob_660a87_georges-abdaloff-croque-par-christell.jpg)