"Le Paradoxe de Fermi", de Jean-Pierre Boudine
BOUDINE (Jean-Pierre), Le Paradoxe de Fermi, postface de Jean-Marc Lévy-Leblond, Paris, Denoël, coll. Lunes d’encre, [2014] 2015, 184 p.
Mais oui, parfaitement, encore un roman « révisé » par son auteur chez Lunes d’encre (la première édition du Paradoxe de Fermi remontait à 2002 ; au passage, la présente couverture, due à Aurélien Police – ça se reconnaît –, en jette quand même un peu plus…). Et, mais oui, parfaitement, encore un roman de SF-catastrophe chez Lunes d’encre. Enchaîner le présent roman de Jean-Pierre Boudine après Notre Île sombre de Christopher Priest fait un peu bizarre, du coup (hasards du calendrier perso)…
Cela dit, là s’arrête la comparaison : l’approche adoptée par l’écrivain anglais Christopher Priest et par Jean-Pierre Boudine, professeur agrégé de mathématiques avant tout (même si on lui doit un autre roman), est quand même nettement différente… et renvoie probablement à leur occupation première : rien d’étonnant, à ce stade, si Priest prétendait gommer l’aspect « politique » de son roman et n’y accordait de toute évidence pas une fonction prospective, là où Le Paradoxe de Fermi tend quant à lui à adopter une structure argumentaire relevant de la démonstration logico-mathématique sans vraiment s’embarrasser d’une chose aussi superflue que la « littérature »…
C’est un roman, certes. Une fiction, avec des personnages (creux…), et une narration à la première personne. Pourtant, à mon sens en tout cas, ces aspects-là ne sont pas exactement ceux qui se montrent le plus convaincants dans le livre de Jean-Pierre Boudine, aussi passionnant qu’effrayant quand il relève de l’abstraction « essayiste », mais vaguement gênant quand il tente maladroitement de faire dans la « littérature ». Aussi, disons-le d’entrée de jeu, ça évitera des circonvolutions pénibles : en ce qui me concerne, Le Paradoxe de Fermi n’est pas à proprement parler « mal écrit » (ce qui, après tout, ne détonnerait pas tant que ça dans le petit monde de la SF, où on a longtemps accordé une attention minime à la forme ; mais ça a changé depuis pas mal de temps, heureusement, même s’il y a quelques Gaulois qui résistent encore et toujours) ; non, à ce stade, il n’est pas écrit du tout…
L’idée d’écriture est pourtant essentielle ici, même si elle est justement le fait d’un scientifique (un spécialiste de la dynamique des populations, qui s’intéressait essentiellement aux termites), un nommé Robert Poinsot, qui écrit donc parce qu’il en ressent le besoin… dans des conditions qui semblent rendre cette pulsion d’autant plus absurde. En effet, reclus dans l’est des Alpes, du côté de la Hongrie, le narrateur n’a aucune certitude que son manuscrit sera lu par qui que ce soit, et c’est même à vrai dire peu probable ; car la civilisation humaine s’est effondrée, soudainement et de manière irrésistible…
Tout a commencé – ou, peut-être plus exactement, a éclaté au grand jour – un vendredi de février 2022 (ça ne nous laisse pas beaucoup de temps, hein ?), par une vulgaire crise financière résultant de la question de la dette (tiens, c’est d’actualité… inévitablement…). Bien loin de n’être qu’une histoire de pognon n’affectant que partiellement et très indirectement le quidam, cette crise – qui fait passer celle de 1929 pour une petite chose vraiment anecdotique – plonge bientôt le monde dans le chaos. Je ne vais pas vous faire ici le détail de ce qui se produit, ça n’en est pas vraiment la place – et cela serait quelque peu gênant à l’égard du roman, dont le déroulé argumentaire aussi carré qu’effroyable constitue vraiment l'intérêt majeur. L’enchaînement des événements, sous la plume – oui, bon… – de Jean-Pierre Boudine, est d’une logique imparable et, si l’on excepte quelques épisodes peut-être un peu spectaculaires (ou plus exactement précipités ?), non seulement on y croit parfaitement, mais on ne peut s’empêcher de penser, en frissonnant, que les probabilités sont élevées pour que tout se déroule comme indiqué dans cette démonstration mathématique, et très bientôt, encore… C’est là que le livre se montre vraiment très fort, et hautement convaincant : il n’a à vrai dire, à ce stade, pas besoin de jouer sur la « littérature », mais constitue un essai en forme de cri d’alarme désespéré qui noue les tripes, et laisse parfaitement désemparé…
Robert Poinsot, quoi qu’il en soit, se prend cette crise en pleine gueule. Et c’est ainsi que le chercheur parisien, au terme d’un long périple parsemé de scènes d’horreur, trouvera finalement refuge dans les Alpes, à plus de 2000 mètres pour se garantir du contact toujours risqué avec ses semblables, et se mettra à raconter – dans le vide – ce qu’il a vécu, comme témoignage ultime de la folie et de la méchanceté de ce pathétique éphémère qu’est l’homme. Le roman alterne donc entre le récit au passé des avanies subies par le monde en général et le narrateur en particulier, et brefs retours au présent, témoignant des difficultés de Poinsot pour survivre au jour le jour dans une nature qui le dépasse.
Robert Poinsot, avec quelques proches, voyage beaucoup, d’abord dans une France déchue de son piédestal, harcelée par la faim, la maladie et la violence de bandes « anarchistes » au sens vulgaire ; il quitte notamment Paris, désormais invivable, pour se réfugier à Beauvais… jusqu’à ce que l’appel du départ se fasse de nouveau irrépressible. Il part alors vers le nord, et trouve un temps refuge dans la Baltique, où un « ordre » entend préserver contre vents et marées la « civilisation », via les documents littéraires, artistiques, scientifiques et techniques, qu’il s’agit de conserver au cas où, plus tard, quelqu’un serait en mesure de s’y référer à nouveau… Puis l’ordre est amené à se dissoudre, et Robert prend la route des Alpes, perdant tout espoir en chemin.
C’est ici, sans doute, qu’il y a de la « littérature », même si elle ne fait guère, à ce stade, que reprendre des thèmes assez communs dans la littérature de science-fiction, catastrophe puis post-apocalyptique. Ce qui suscite – comme souvent dans le genre, pour peu que l’on s’applique un minimum – quelques tableaux poignants et horribles. Ce n’est cependant pas là, donc, que réside l’atout essentiel du roman de Jean-Pierre Boudine.
Non, la force initiale de la démonstration logico-mathématique fait tout, et revient (dans une forme moins littéraire que jamais, d’ailleurs, comme si l’auteur avait jeté l’éponge entre-temps, même s’il use alors par principe d’une maïeutique renvoyant directement aux dialogues philosophiques antiques) vers la fin, au travers d’une conversation entre les membres de l’ordre de la Baltique sur le « paradoxe de Fermi ». Vous connaissez, je suppose, cette interrogation quelque peu gênée et assurément gênante sur la place de l’homme dans l’univers, se demandant où donc sont ces putains d’extra-terrestres, puisque tout laisse supposer qu’ils existent (l’auteur montrant bien une chose dont je suis convaincu depuis fort longtemps : il n’y a que la mystique, autant dire la religion, pour autoriser à croire que la vie intelligente serait le privilège de l’homme) ; pourquoi n’en avons-nous jamais détecté de traces, sans aller jusqu’à entrer en contact avec eux, ne serait-ce que par ondes radio ou grâce à des sondes ? Et le roman de révéler alors son sens profond, tout ce qui s’y est produit ne constituant que la formulation continue d’une démonstration « expliquant » le « paradoxe de Fermi », ou plus exactement y répondant.
L’idée de base, vous la connaissez déjà, et elle coule de source à la lecture du roman, ou même d’un simple résumé : l’intelligence de l’homme le conduit nécessairement à sa perte, et l’on peut ainsi supposer que toute civilisation quelle qu’elle soit atteignant un certain degré de développement scientifique et technologique s’autodétruit avant d’être en mesure d’entrer en contact avec des civilisations extérieures (a fortiori du fait des distances et durées astronomiques, la démonstration, plus pointue ici, se montre alors impeccable, qui rendent la coexistence de deux civilisations galactiques improbable, ou même la possibilité pour deux de ces civilisations, à peine décalées dans le temps, de laisser des traces détectables par ailleurs, et ce quand bien même la vie intelligente serait répandue, voire banale, à travers la galaxie – mais toujours sur des échelles de temps minimes, puisque quelques siècles suffisent à la civilisation scientifico-technologique pour atteindre le stade où son niveau de développement rend nécessaire son annihilation de l’intérieur). Tout cela est brillant, et convainc amplement sur le papier – même s’il est sans doute possible d’apporter d’autres réponses au « paradoxe de Fermi » (voir l’intéressante postface de Jean-Marc Lévy-Leblond, qui fait intelligemment le point sur la question, tout en arguant de la vraisemblance et même de la probabilité de la thèse de Jean-Pierre Boudine), et si l’on peut s’interroger sur quelques implications de cet argumentaire (je me demande ainsi, mais sans doute à tort – dans la mesure où je n’ai certes pas la culture, mathématique notamment, permettant de pleinement appréhender tout cela –, si, à raisonner ainsi, on n’aboutit pas pernicieusement à un certain historicisme conduisant à réintroduire l’anthropocentrisme dans l’analyse, là où le paradoxe est justement censé le dépasser).
Tout ne se montre certes pas aussi fort, et il est bien quelques points annexes du roman qui ne convainquent pas, voire font légèrement pouffer à défaut d’agacer. La focalisation du roman sur des Occidentaux trentenaires à haut niveau d’études (scientifiques, tant qu’à faire…) est ainsi à l’occasion un brin pénible (je doute d’ailleurs que ces derniers soient les plus aptes à survivre dans ces conditions, ne serait-ce que pour un temps, mais bon…), a fortiori quand elle débouche un peu malgré elle et à demi-mots (et malgré quelques exceptions pour la forme) sur un rejet plus ou moins conscient dans les bas-fonds du chaos bête et méchant pour tous ceux qui n’ont pas l’heur de correspondre à ce profil (des sous-prolos qui font tout péter pour la forme aux obscurs nouveaux barbares en provenance d’un Est mythique…). « L’actualité », par ailleurs, a fait que je n’ai pu m’empêcher de relever ce paragraphe (mal placé dans la structure argumentaire du roman, qui plus est) imputant une part du chaos global à ces salauds de jeunes qui ne respectent plus rien, rendez-vous compte ma bonne dame, putains de punks…
Mais tout cela est accessoire. Le Paradoxe de Fermi, dans l’ensemble, se montre tristement convaincant : non seulement on croit à la possibilité d’un effondrement subit tel qu’il est décrit par l’auteur, qui plus est pour une raison aussi absurde que cette économie dont on fait stupidement l’alpha et l’oméga, à gauche comme à droite, mais on en vient à être persuadé que cela a toutes les chances d’arriver – et très vite… L’interrogation sur la place de l’homme – et au-delà de la civilisation – dans l’univers en rajoute une couche dans la déprime, parallèlement à cette conviction que le savoir, pour légitime et de toute façon inévitable qu’il soit, l’homme obéissant ici à une pulsion qu’on ne saurait de toute façon réfréner (le roman n’a rien d’un délire réac). On en ressort avec la conviction – si tant est qu’on ne l’avait pas déjà, hein… – que non, l’homme n’est rien, et la civilisation n’a aucune espèce d’importance. Youpi !
C’est ce qui fait la réussite du Paradoxe de Fermi : il est intéressant, convainquant, effrayant, déprimant. On regrettera d’autant plus qu’il soit aussi peu « littéraire »…

/image%2F1385856%2F20160114%2Fob_cfb8b0_caligari.jpg)







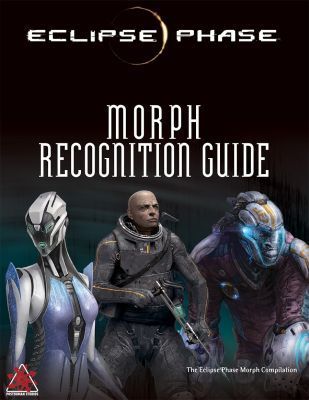




/image%2F1385856%2F20150204%2Fob_660a87_georges-abdaloff-croque-par-christell.jpg)