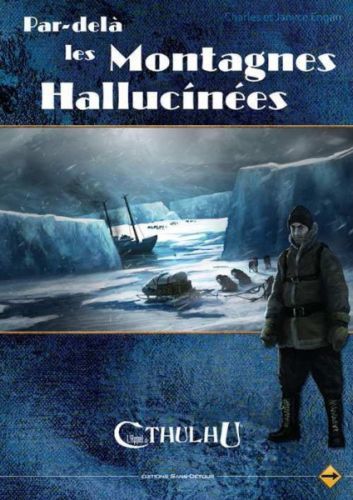


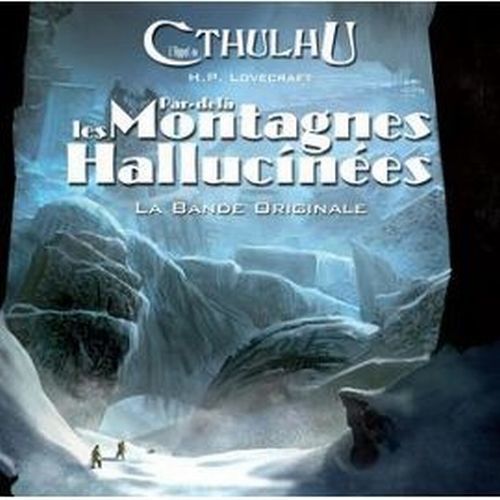
L’Appel de Cthulhu : Par-delà les Montagnes Hallucinées
L’Appel de Cthulhu : Par-delà les Montagnes Hallucinées : Kit d’expédition
L’Appel de Cthulhu : Par-delà les Montagnes Hallucinées : La Bande originale
Tiens, pour une fois, j’ai fait les choses dans l’ordre, moi (ou à peu près…). Du coup, je vous parle de cette monumentale campagne qu’est Par-delà les Montagnes Hallucinées après l’avoir fait jouer. D’où un compte rendu qui va adopter une forme un peu particulière. Dans un premier temps, je vais donc présenter à mon habitude les différents suppléments composant cette campagne (auxquels il faut ajouter le « roman » de Lovecraft Les Montagnes Hallucinées ainsi que celui d’Edgar Allan Poe Les Aventures d’Arthur Gordon Pym) ; dans un second temps, je vais tâcher de résumer la campagne telle que nous l’avons vécue, mes joueurs et moi-même (avec des SPOILERS à la pelle, donc) ; enfin, viendra l’heure du débriefing, qui permettra de faire le bilan de l’ensemble.
I/ Les suppléments
La campagne Par-delà les Montagnes Hallucinées en elle-même se présente sous la forme d’un très gros et très beau volume d’environ 700 pages ; ça pèse son poids, et fait d’emblée prendre conscience du caractère hors-normes de cette campagne, une des plus grosses jamais publiées pour L’Appel de Cthulhu, à même de rivaliser avec les légendaires Masques de Nyarlathotep (notons cependant que le découpage en livrets de cette dernière en rend le maniement autrement plus facile ; ici, au contraire, il faut sans cesse jongler entre de très volumineux chapitres et des annexes énormes – d’environ 200 pages…).
On saluera – une fois n’est pas coutume… – le très beau travail réalisé par Sans-Détour sur ce gros tome (je précise au passage qu’il s’agit ici de la première édition de Sans-Détour ; l’ouvrage a été réédité récemment, avec un certain nombre, semble-t-il, de modifications d’ordre essentiellement cosmétique) : pour une fois, le livre est bien écrit dans l’ensemble (voire trop écrit, mais on aura l’occasion d’y revenir), mais aussi bien traduit et édité, avec étonnamment peu de coquilles, surtout en comparaison de la moyenne générale des produits de la gamme. Le livre est en outre fort beau, avec une iconographie abondante et plus qu’à son tour fascinante (surtout pour un amateur presque fanatique d’expéditions polaires tel que votre serviteur ; on regrettera juste que les personnages soient « dessinés », petite faute de goût dont j’ai cru comprendre qu’elle avait été gommée à l’occasion de la réédition) et un joli portfolio en couleur signé Marc Simonetti.
La campagne débute en 1933, et se focalise sur l’expédition antarctique Starkweather-Moore, évoquée dans Les Montagnes Hallucinées (le « roman » de Lovecraft se présente en effet comme une mise en garde du professeur Dyer pour dissuader de monter cette expédition, censée revenir sur les traces de celle qu’il avait dirigée quelques années plus tôt). Elle se compose pour l’essentiel de cinq grosses parties, elles-même subdivisées en un certain nombre de chapitres généralement de taille assez conséquente. L’aventure débute à New York par une phase d’enquête ; ensuite vient le voyage jusqu’en Antarctique à bord de la Gabrielle ; puis la traversée jusqu’au camp de Lake, théâtre des terribles événements du « roman » ; il sera alors temps de franchir les montagnes Miskatonic ; et de fuir en temps utile… Mais je ne vais pas rentrer dans les détails ici, voyez pour ce faire le compte rendu de campagne ci-dessous.
L’ouvrage se conclut enfin sur environ 200 pages d’annexes, parfois extrêmement détaillées. Sans doute trop, à vrai dire, et c’est valable pour l’ensemble du volume, qui est très écrit : le Gardien se voit ainsi confier bon nombre d’éléments d’ambiance, très intéressants à la lecture, mais qu’il n’est pas forcément évident de mettre en scène en cours de partie, ce qui, là encore, rend le maniement de cette campagne assez délicat ; elle est en effet très bavarde, et parfois trop (des pages et des pages de description pas toujours utilisables en jeu, loin s’en faut, et des annexes extrêmement précises voire techniques d’un usage également douteux). D’un point de vue « littéraire », c’est très agréable… mais il y a de quoi s’y noyer. D’autant que des pages et des pages quasiment inutiles en termes de jeu peuvent être suivies de développements extrêmement importants mais aussi très denses, et présentés très brièvement… Il y a un net déséquilibre à cet égard. Cela dit, si l’ouvrage n’est donc pas toujours hyper « pratique » (ce qui, en cours de partie, n’est hélas pas sans conséquences… surtout si, comme moi, on n’a pas assez préparé la chose, mais j’y reviendrai…), il est donc beau et d’une lecture agréable. Contrairement à bon nombre de campagnes de L’Appel de Cthulhu, il constitue à vrai dire, pour reprendre des termes que je crois avoir lus à l’époque dans JDR Magazine, une « réussite littéraire », qui ne manque pas d’intérêt même si l’on ne joue pas le scénario.
Le Kit d’expédition, par contre, est une véritable escroquerie ; on n’en sauvera que l’écran de la campagne, assez joli, pour les collectionneurs… Mais la carte de l’Antarctique qui est fournie est totalement inutilisable, étant pour ainsi dire vide ; quant au livret… il se contente de reprendre les aides de jeu de la campagne, de toute façon téléchargeables ! Bref : gardez vos sous.
Une curiosité, par contre : la campagne a été accompagné d’une Bande originale signée Erdenstern. J’avoue avoir frémis quand j’en ai entendu les premières notes, très synthé cheap, mais ça s’améliore radicalement par la suite ; si les morceaux vaguement jazzy illustrant les scènes new-yorkaises sont assez dispensables, la suite, entre ambiant et musique de film, connaît quelques beaux moments, qui en font un accompagnement sonore a priori intéressant ; a priori, disais-je : il ne m’a en effet pas été possible de sonoriser la campagne, ce que je n’ai pas manqué de regretter… Aussi, je ne sais pas si l’usage de ces courts morceaux est aisé ou pertinent.
Passons maintenant au compte rendu de la campagne, que je vais tâcher de faire aussi détaillé que possible.
II/ Compte rendu de campagne (avec des SPOILERS à la pelle)
Il y avait du monde autour de la table : outre le Gardien (votre serviteur, donc), il y avait en effet six joueurs (un groupe conséquent, pas forcément très facile à gérer du seul fait de sa taille). Les voici : Nathaniel Coates, maître-chien ; Paul Erickson, cartographe ; Tobias Fünke, géologue ; Nicholas Newton, guide polaire ; Percival Willen Sutton, alpiniste ; Abigail Watkins, pilote. Je les désignerai ultérieurement par leur prénom. Précisons enfin que la campagne a duré pas loin d’un an (avec un rythme de jeu assez souple, cependant – dont une grosse pause pendant l’été ; en tout une quinzaine de sessions de quatre à cinq heures de jeu).
La campagne a débuté le 1er septembre 1933 (je n’ai en effet pas fait jouer les « entretiens d’embauche », ce qui aurait pu être intéressant, mais individuellement…). L’équipe de l’expédition Starkweather-Moore est alors presque au complet ; presque : elle ne comprend pas encore de membres féminins (Abigail rentre donc en jeu un peu plus tard)… Les membres déjà sélectionnés se réunissent et sont présentés ; ils résident ensemble dans un hôtel new-yorkais. On annonce le départ de l’expédition pour le 14 septembre. Il s’agit de rejoindre l’Antarctique du côté de la barrière de Ross, en passant par Panama et l’Australie ; sur place, l’expédition se rendra tout d’abord au camp de Lake, puis franchira les montagnes Miskatonic découvertes par la précédente expédition de 1930-1931. En attendant, il y a encore du travail : Starkweather donne très vite l’image d’un leader incompétent (Moore est plus sérieux), et l’on constate de nombreux dysfonctionnements dans les commandes et le matériel ; Percival, qui est riche et dispose de nombreux contacts, tente à sa manière d’y remédier. Tous sont cependant embauchés pour gérer les arrivées, et assurer le chargement du matériel.
Le lendemain, alors que Starkweather et Moore n’en avaient encore rien dit, la presse annonce que le capitaine Douglas, de la précédente expédition, reviendra sur celle-ci. Dans la journée, les membres de l’expédition travaillent sur les quais et le bateau, la Gabrielle. Mais Tobias est accosté à l’hôtel par un mendiant qui lui remet un mot étrange, visant à le dissuader de participer à l’expédition.
3 septembre : une nouvelle fracassante. Une dénommée Acacia Lexington, que Starkweather qualifie de tous les noms (lourd passif entre les deux personnages…), annonce qu’elle monte elle aussi une expédition antarctique, destinée à partir le 9 septembre ; elle entend bien être la première femme à survoler le pôle sud. Starkweather, furieux, cherche à embaucher à son tour une femme pour que l’expédition ne soit pas en reste : ce sera, très vite, l’aviatrice Abigail (que connaissait déjà Percival, qui suggère son nom à Moore).
4 septembre : le capitaine Douglas est retrouvé mort. Percival, dans un geste inconsidéré, tente de « corrompre » le capitaine de l’expédition Lexington, et se fait rabrouer. Abigail, de son côté, quitte New York pour se rendre à un aérodrome et y tester les Boeing de l’expédition.
Suite à l’annonce de la mort de Douglas, l’expédition est littéralement assiégée par les journalistes, à l’hôtel comme au bateau. Nathaniel et Tobias entrent en contact avec l’inspecteur Hansen, de la brigade des homicides. Paul lance une étrange campagne de désinformation auprès de la presse, répandant les rumeurs les plus saugrenues… Tobias retrouve le clochard qui lui a donné le mot, mais celui-ci n’était qu’un intermédiaire, et il est impossible de remonter au commanditaire. Paul, Nathaniel et Tobias écument ensuite les bars de marins ; dans l’un, ils tombent sur un nain, qui a vu Douglas discuter avec trois matelots peu avant sa mort. Nicholas se rend à l’hôtel de Douglas ; mais sa chambre est surveillée par un policier, et il ne peut y accéder. Paul, Nathaniel et Tobias le rejoignent ; pendant que Tobias occupe le planton et que Paul fait le guet, Nathaniel et Nicholas parviennent à pénétrer dans la chambre ; celle-ci a été fouillée, et les journaux du capitaine relatant l’expédition de 1930-1931 ont disparu. Les investigateurs ne repartent cependant pas les mains vides : ils trouvent des notes de Douglas mentionnant les noms de Starkweather, Moore et Lexington, ainsi qu’une lettre inachevée, adressée à son frère Philip, dans laquelle il évoque son voisin – un Allemand excentrique – et dit clairement ne pas souhaiter prendre part à l’expédition ; il évoque par ailleurs quelques-uns des survivants de cette dernière. Percival cherche justement des renseignements sur les membres de la précédente expédition, et obtient quelques pistes auprès de l’université Miskatonic d’Arkham, mais Dyer et Danforth, notamment, ont disparu (et Danforth a été interné pendant un temps). Abigail contacte de son côté un ancien pilote, mais n’obtient pas beaucoup d’informations supplémentaires. Tobias cherche à rencontrer le voisin allemand de Douglas, mais se fait jeter à la réception ; de toute façon, ledit Allemand est parti… Percival essaye sans succès d’entrer en contact avec Acacia Lexington. Le soir, les investigateurs retournent au bar de marins, mais les amis de Douglas ne s’y présentent pas ; ils récupèrent cependant leurs adresses, mais les matelots ne sont pas chez eux. Paul, de son côté, qui n’est plus à ça près, passe la nuit en cellule de dégrisement…
Le 7 septembre, lors de la traditionnelle réunion du matin, Starkweather et Moore annoncent la mise en place de mesures de sécurité. Paul, qui arrive en retard après sa nuit au commissariat, paye en outre ses bêtises auprès des journalistes, et perd du crédit… On apprend que les trois marins disparus avaient participé à la précédente expédition. Nathaniel tente à son tour d’entrer en contact avec Lexington, mais c’est à nouveau un échec. Percival, en faisant jouer ses contacts, accède au dossier de la police sur la mort de Douglas. Les investigateurs s’intéressent en outre au passé de Lexington ; ils découvrent qu’elle et Starkweather se sont connus quelque temps auparavant, mais aussi que Lexington a hérité de la fortune de son père après le suicide de ce dernier (ou bien était-ce un meurtre ? Elle avait d’abord dénoncé à la presse le vol du manuscrit d’Arthur Gordon Pym à cette occasion, mais s’est rétractée quelques jours plus tard). On apprend aussi qu’elle a côtoyé des groupes extrémistes, de droite comme de gauche.
Le lendemain, c’est l’enterrement de Douglas. Percival y prend contact avec le frère du défunt, Philip, ainsi qu’avec son notaire. Ensuite, Abigail et Paul tentent de fouiller les appartements des marins disparus ; après un premier échec auprès d’un concierge, ils fracturent la porte du second ; tout indique un départ précipité. Mais ils se font serrer par Hansen, et finissent l’après-midi au commissariat… Le soir, lors du dîner sur le bateau (départ précipité pour le lendemain), Tobias montre la lettre de menace qu’il a reçue, et Paul révèle qu’il en a eu une également.
En pleine nuit, il y a une explosion sur les quais ; un entrepôt prend feu, des dockers y sont coincés. Paul et Percival tentent de venir à leur secours. Le feu atteint un container attaché à un treuil au-dessus du bateau, et menace de faire exploser ce dernier ; Abigail et Starkweather utilisent la lance à incendie, tandis que Nathaniel manipule le treuil pour éloigner la menace. Paul repère et poursuit un type portant des bidons d’essence ; il tente de le maîtriser, mais est blessé au couteau et revient bredouille… Et pendant ce temps, le bateau de Lexington prend le large. Percival raconte tout ce qui s’est passé à Hansen ; dénoncé par Abigail auprès des autres investigateurs, il se prend une mandale de la part de Paul…
Le 9 septembre, le départ est repoussé de quelques jours à cause de l’incendie. En lisant le journal, les investigateurs tombent sur un fait-divers qui leur met la puce à l’oreille : l’artiste Nicholas Roerich a été agressé devant la maison de Lexington et enlevé, puis on l’a retrouvé dans un entrepôt près des docks. Percival parvient à le rencontrer à son hôtel ; il apprend que Roerich s’est fait voler un paquet contenant un manuscrit de Dyer destiné aux chefs des expéditions antarctiques (Lexington, donc, mais aussi Starkweather) et censé les dissuader de se lancer dans cette aventure. Les agresseurs étaient trois, l’un d’entre eux avait un fort accent allemand ; ils l’ont interrogé sur Dyer, Danforth et Pym. Pendant ce temps, Paul, Nathaniel et Abigail discutent avec les dockers de l’incendie, mais ça ne débouche sur rien. Tobias et Percival se rendent ensuite à la salle de vente où aurait dû être vendu le manuscrit d’Arthur Gordon Pym ; ils obtiennent une lettre du précédent possesseur, qui le décrit, et fait mention de chapitres inédits, sans rentrer dans les détails mais en doutant de leur authenticité. Paul et Nicholas tentent d’appâter les agresseurs en répandant des rumeurs dans la presse et auprès de bouquinistes sur ledit manuscrit.
La réunion du 10 septembre au matin est houleuse. On apprend ensuite que Starkweather s’est mis Lexington à dos lors d’un safari où il l’avait mise en danger, mais s’était présenté comme un sauveur à la presse. Quand les investigateurs partent déjeuner, ils sont suivis par deux personnes ; Nicholas entraîne à sa suite un policier (qui l’arrêtera un peu plus tard…) ; Nathaniel et Paul discutent avec l’autre, qui se présente comme un acheteur potentiel du manuscrit de Pym (censé être en possession de Tobias), et leur donne rendez-vous un peu plus tard dans un restaurant. Après quelques péripéties (surveillance du restaurant où se trouvent des gros bras, etc.), Tobias et Percival se font enlever. Tobias appelle l’hôtel sous la contrainte des ravisseurs, qui veulent le manuscrit. Hansen envoie une équipe pour retrouver les disparus. Percival apprend que le restaurant appartient à Lexington. Je passe sur les détails, assez complexes, mais les ravisseurs sont prévenus de la descente de la police, relâchent Tobias et Percival dans la rue, et s’en vont sans laisser de traces. Nicholas est libéré.
Le 11 septembre, c’est le départ. Petite fête sur le bateau…
Le 17 septembre, c’est la traversée du canal de Panama. On constate alors une certaine froideur entre les marins et les membres de l’expédition.
Le 25 septembre, le bateau franchit l’équateur. A lieu le « baptême de la ligne » (Abigail est particulièrement « bizutée »). Pendant la fête, la chambre froide de la Gabrielle est sabotée à l’acide. Une bonne partie des réserves est devenue impropre à la consommation. Starkweather refuse de faire demi-tour.
Nathaniel découvre plus tard que les chiens de l’expédition ont été empoisonnés ; bon nombre ont dû être achevés… dont Keira, la chienne de Nathaniel.
Fouille générale du bateau, du coup. Abigail trouve une bombe artisanale près des avions ; le matériel radio est en outre foutu, de même que les radios de l’expédition. Réunion de crise, qui débouche sur une fouille des cabines. Nathaniel (qui tente vainement de lancer une « mutinerie » contre Starkweather et Moore qu’il juge incompétents, et en vient aux poings avec Turlow) trouve des flacons d’acide dans la cabine d’un cuisinier et de deux serveurs, tout accuse le cuisinier (noir…) qui est mis aux fers. Il clame son innocence.
Le lendemain, le vrai coupable, un serveur, est confondu grâce à un stratagème de Nicholas. Il est à son tour mis aux fers. Interrogé, il garde le silence… même quand Nathaniel, Abigail et Paul emploient la manière forte. Il cède le lendemain devant une mise en scène de torture par Nicholas. Il avoue qu’il a été engagé pour saboter l’expédition (il ne sait pas par qui exactement) et dit avoir agi seul pour se venger de Starkweather.
On passe au 12 octobre, avec l’arrivée de la Gabrielle à Melbourne, accueillie par une horde de journalistes et la police, qui embarque le saboteur (on déplore unanimement une « mauvaise chute » pour expliquer les coups qu’il a reçus…). L’escale dure six jours, le temps de refaire les réserves de matériel et de nourriture (problème notamment avec le pemmican). Le bateau quitte enfin Melbourne le 18 octobre.
Tempête le 23.
Le 25, le brouillard tombe et on aperçoit les premiers icebergs.
Nouvelle tempête du 26 au 28 octobre.
Le 4 novembre, entrée dans la mer de Ross.
Le 6 novembre, la Gabrielle tombe sur un baleinier abandonné, disparu depuis six mois.
Le 14 novembre, les membres de l’expédition posent le pied sur le continent antarctique (barrière de Ross). Les jours suivants sont consacrés au débarquement du matériel et à l’installation du camp de base quelques soixante kilomètres plus loin (des fissures imprévues dans la banquise accélèrent le mouvement, et du matériel est perdu).
Le 20 novembre est capté un SOS radio en provenance du camp de Lexington. Une expédition de secours est mise en route. Là-bas, deux « saboteurs », victimes semble-t-il de la « folie des neiges », ont en effet mis le feu au camp, afin de tuer d’immenses araignées qu’ils voyaient partout. Starkweather et Lexington s’engueulent en privé. Percival retrouve Priestley, le cameraman de Lexington, qu’il connaissait déjà avant ; celui-ci leur apprend qu’il y a également eu des sabotages sur le bateau de Lexington, et qu’on en accusait Starkweather.
Le 23 novembre, après avoir rapatrié les deux fous sur le bateau de Lexington, les deux expéditions se réunissent, bon gré, mal gré.
Starkweather part ensuite à l’aventure de son côté. Le 27, le reste des expéditions arrive au camp de Lake. Là-bas, Moore donne carte blanche aux investigateurs (qui se sont montrés curieux…) pour enquêter sur le sort de la précédente expédition. Ils commencent par trouver un cairn à quelque distance du camp, avec onze corps qu’ils exhument : ils ont été disséqués, mutilés, il leur manque des organes…
Le 28 novembre arrivent les premiers éléments de la foreuse. L’équipe se répartit en binômes pour fouiller le camp. On déterre une créature morte (une « chose très ancienne »). L’équipe et Moore s’écharpent sur la question de forer ou pas, de rapporter la créature pour l’étudier ou pas… Le soir, Lexington est surprise à communiquer en allemand avec un certain Dr. Meyer.
Le 29 novembre, les expéditions sont au complet, et la fouille du camp se poursuit. La foreuse est montée sur le site d’excavation. On déterre une autre créature. En dégelant, elles dégagent une odeur insoutenable.
Le 30 novembre, l’exploration se poursuit, englobant cette fois la grotte dégagée par la foreuse. Plusieurs des investigateurs l’explorent, Tobias y rassemble et étudie des spécimens.
Le 1er décembre, des Allemands, membres de l’expédition Barsmeier-Falken, arrivent au camp de Lake. Le chef du détachement, Meyer, donne à Moore le manuscrit rédigé par Dyer (c’est-à-dire, en fait, le « roman » de Lovecraft Les Montagnes Hallucinées).
Le 3 décembre, les investigateurs partent pour un vol de reconnaissance au-delà des montagnes Miskatonic, et découvrent la Cité. Ils franchissent la passe de Dyer sans problème, alors que l’avion de Lexington est contraint de faire demi-tour. Sur un coup de tête, cependant, les investigateurs décident de se poser dans la Cité, ce qui n’était pas prévu… et ont des ennuis mécaniques qui les empêchent de repartir. Ils sont contraints de passer la nuit sur le plateau, et font des rêves étranges.
Le 4 décembre, ils explorent un peu la place où ils ont atterri, et découvrent une immense fresque dans un puits. Finalement, Abigail parvient à réparer l’avion. Ils retournent au camp… mais l’avion se crashe à moitié à l’atterrissage. Les investigateurs s’en sortent, mais l’avion est inutilisable. Ils se font passer un savon, mais Starkweather est en même temps heureux d’avoir damé le pion à Lexington. L’expédition retourne dans la journée à la Cité, et se pose au même endroit. Plusieurs allers-retours sont effectués pour transporter membres de l’expédition et matériel. Débute alors presque instantanément l’exploration des environs. Starkweather, accompagné de Nathaniel, part examiner deux immenses piliers au-dessus de la passe. Les autres explorent la Cité par groupes. Un archéologue commence à étudier la fresque du puits.
Le 5 décembre, suite de l’exploration. Parmi les sites importants, il y a notamment des sortes de « cuves » près du lit d’une rivière, explorées par Paul et Tobias, assurés par Percival. Le Dr. Greene disparaît. Le soir, le pilote de Lexington essaye de saboter l’avion, mais il est repéré par Nicholas, qui lui tire dessus et le tue. Il est bientôt identifié : il s’agissait en fait de Danforth… qui avait auparavant saboté l’avion de Lexington, dont il manquait des pièces – Nathaniel l’avait pisté avec Lexington et Priestley et ils avaient retrouvé les pièces dans une grotte piégée aux explosifs… Nathaniel, qui vouait auparavant une haine mortelle à Lexington qu’il accusait des précédents sabotages – et de la mort de Keira – change radicalement d’opinion sur elle, qu’il juge bien plus compétente que ses chefs, et s’installe dans son camp.
Le 6 décembre, suite de l’exploration. Les Allemands informent Nathaniel qu’ils ont trouvé des choses étranges sur un site baptisé « Hagia Sofia ». Ils sont rejoints par Percival et Nicholas. Le Dr. Meyer déclenche un mécanisme dans la géode du bâtiment et ils sont tous propulsés dans le passé, dans l’esprit d’un anthropoïde serviteur des choses très anciennes. Ils essayent d’en prendre le contrôle mais manquent de pouvoir, et doivent subir la scène. L’anthropoïde, avec d’autres, descend une cargaison dans des souterrains, où des shoggoths s’en emparent… et se nourrissent de quelques-uns des anthropoïdes et de leurs bêtes de somme (Nicholas devient presque fou à ce spectacle). L’anthropoïde se met à paniquer, court dans les souterrains, manque se faire manger par des choses innommables, avant de réussir à remonter en surface, où il est le témoin d’un étrange événement : une immense créature noire, animalcule indéfinissable, rôde autour de la Cité, et les choses très anciennes s’en occupent. Fin de l’expérience.
Le 7 décembre, Starkweather est enlevé par les choses très anciennes. Sous la pression de Lexington et de Moore, deux avions partent à leur poursuite, dont un emportant les investigateurs. Ils suivent la direction empruntée par les choses, et arrivent aux abords d’une immense tour au milieu d’une tempête perpétuelle, suscitant en outre des « secousses » temporelles. Ils se posent dans une vallée non loin ; deux pilotes restent auprès des avions, ainsi que Rilke, visiblement malade. Tobias est atteint du même mal, mais qui ne l’affecte pas encore trop. La tour est construite autour d’un immense puits central ; les investigateurs, accompagnés de Lexington, Priestley et Meyer, en entament l’ascension. Tobias et Abigail tombent bientôt dans un état catatonique : ils entrent en résonance avec la Tour et comprennent qu’il s’agit d’une sorte de « piège divin » renfermant une entité extrêmement puissante, et qu’il ne faut surtout toucher à rien… mais ils sont incapables de communiquer avec leurs camarades. En grimpant, le groupe tombe sur un shoggoth dans une cuve, qui effraie grandement Meyer. Finalement, l’équipe atteint un mur de crânes, où l’on trouve ceux de Starkweather et de Greene. Lexington retire le crâne de Starkweather afin de lui donner une sépulture, mais un tremblement de terre secoue alors la tour ; Meyer panique et s’enfuit ; Abigail et Tobias sortent alors de leur catatonie et tentent immédiatement, sous le coup de la panique, de tuer Lexington ; Priestley, Nathaniel et Paul essayent de calmer le jeu, tandis que Percival bloque ; Nicholas, lui, réagit à l’instinct… et tire sur Lexington. Priestley en vient à blesser Nathaniel et est tué à son tour dans des circonstances un peu confuses, et il meurt dans les bras de Percival. Abigail, Tobias et Nicholas s’emparent du corps de la défunte pour le confier à un shoggoth, afin de le « préparer » pour le mur de crânes et de réparer la faille. Tout le monde se met donc à courir vers les étages inférieurs. Un autre shoggoth « jardinier » vient à toute vitesse des étages supérieurs ; Percival devient fou de terreur à cette vision et saute dans le vide. Abigail s’empare alors de la tête « préparée » de Lexington et va la tendre au shoggoth « jardinier ». Il prend la tête, remonte, et bloque le passage à deux choses très anciennes qui fonçaient à leur tour sur les investigateurs. Tout le monde est très éprouvé par ce qui vient de se passer, et retourne aux avions. Le Boeing a disparu, les Allemands se sont enfuis avec ; le Belle de Lexington est toujours là, marqué d’impacts de balles ; quand l’équipe essaye de s’en approcher, elle est accueillie par des coups de feu : Halperin, le pilote, est devenu fou. Bien évidemment, Nicholas (toujours lui !) le tue… Abigail prend les commandes et décolle ; Tobias et elle expliquent ce qu’ils ont ressenti, mais les autres sont sceptiques. Eux deux sont toutefois obnubilés par la Tour et par le fait que personne ne doit y retourner. Courte escale au camp de la Cité. Moore est brièvement mis au courant de ce qui s’est passé dans la Tour, mais on insiste sur le fait que rien ne doit filtrer. Tout le monde rentre alors au camp de Lake.
Là-bas, le séisme a provoqué un incendie dans le dépôt de carburant. Le camp est sous le choc, et deux scientifiques sont morts. Le Boeing ne s’est pas posé ici. Moore encourage les investigateurs à repartir immédiatement à la poursuite des Allemands. Paul et Nathaniel refusent. Moore accompagne les autres, ainsi que Samuel Winslow. Le Boeing est repéré près d’un dépôt de matériel de l’expédition allemande. Le Belle se pose à proximité. Baumann, le pilote allemand, sort de la tente et accueille les investigateurs avec joie ; ils croyaient qu’ils étaient tous morts. Meyer est dans un état catatonique, et n’a quasiment pas décroché un mot (il n’a en tout cas pas mentionné la mort de Lexington). Rilke est désormais très malade. Les investigateurs s’assurent que les Allemands n’ont pas pu échanger trop d’informations avec leur camp de base. Mais Baumann tente une communication radio ; Abigail l’en empêche ; elle et Moore tentent de raisonner le pilote, et de le convaincre d’oublier tout ce qui s’est passé. Mais Tobias pète un plomb et tire sur Baumann. Brève échauffourée : Baumann est blessé, Nicolas essaye sans succès de maîtriser Tobias… et finit par lui tirer sur la main pour le désarmer. Le Zeppelin de l’expédition allemande survole alors la tente…
Pendant ce temps, au camp de Lake, Paul et Nathaniel s’accordent pour dire qu’il faut empêcher les autres investigateurs de nuire à l’expédition : il faut protéger les échantillons et les rapports, et mettre les fauteurs de troubles au arrêts dès leur retour, au moins le temps d’éclaircir les circonstances de la mort de Lexington. Ils préviennent Packard et Sykes que Moore et Winslow, partis avec Abigail, Tobias et Nicholas, sont potentiellement en danger, sans parler des Allemands. Nathaniel est convaincu que c’est une entité bénéfique qui est emprisonnée dans la Tour, et peut-être bien Dieu…
Au dépôt allemand, Abigail tente de rapatrier les blessés à bord du Belle pour les ramener au camp de Lake. Tobias, de son côté, parvient à mettre le feu à la tente… Malgré le vent, une nacelle commence à descendre du Zeppelin pour porter secours aux Allemands. Nicholas et Baumann portent Rilke vers le Belle, Abigail guide Meyer, et Moore suit le mouvement. Tobias se rue sur le Belle. Là-bas, il saisit une barre de fer et tente de fracasser le crâne de Baumann… mais ne lui fait que peu de dégâts. Abigail change alors de stratégie et court vers le Boeing, Tobias sur ses talons. La nacelle du Zeppelin touche terre. Abigail prépare le décollage en urgence ; Tobias, qui était monté à bord, comprend subitement ce qu’elle manigance et sort de l’appareil. Les Allemands embarquent les leurs dans la nacelle, ainsi que Moore et Winslow (Nicholas est à l’écart, de même que Tobias). Abigail décolle pendant ce temps, commence par s’éloigner en direction du camp de Lake… puis revient et se suicide en se crashant sur le Zeppelin. Nicholas, Tobias et Baumann sont les seuls survivants…
Au camp de Lake, Nathaniel et Paul traitent avec les Allemands (qui sont arrivés avec leurs avions). Ils vérifient leurs informations, et planifient avec eux un éventuel retour à la Tour, et l’évacuation du camp de Lake. L’idée est d’assurer les arrières, et de permettre une nouvelle expédition dans les meilleures conditions.
De l’autre côté, Tobias s’est enfermé dans le Belle, laissant Nicholas et Baumann dehors. Ils parviennent cependant à rentrer en fracassant un hublot, maîtrisent Tobias et l’attachent à l’arrière. Ils rentrent au camp de Lake. Pendant le voyage, Nicholas et Baumann s’accordent sur le fait que la Tour a rendu tout le monde fou, et qu’il ne faut surtout pas y retourner. De retour au camp, l’accueil est mouvementé, Paul et Nathaniel ayant monté le camp contre les autres. Nicholas refuse de parler en leur présence. Tobias hurle au complot, accuse Nathaniel et Paul d’être des saboteurs, et prétend que ce sont les Allemands qui ont tué Lexington ; il est mis sous sédatifs. Les chefs des camps américain et allemand interrogent plus tard Tobias, Nicholas, Nathaniel, Paul et Baumann au cours d’une confrontation… laquelle est mouvementée. Nathaniel et Paul maintiennent qu’il faut retourner à la Tour ou en tout cas préparer une nouvelle expédition. Nicholas suggère quant à lui que tous ceux qui s’y sont rendus soient rapatriés sur le bateau et placés sous surveillance, lui y compris.
Le camp (allemand) de Palmer ne répond plus. Les Allemands décident d’évacuer le camp de Lake et de s’y rendre. Tout le monde proteste, mais ils emportent la décision. Le camp de base allemand est désert, avec des traces de sang et des empreintes de choses très anciennes. Un énorme shoggoth sort d’une caverne près d’une tente et s’en prend à un des avions. Nicholas et Baumann étaient prêts à repartir en vitesse. Tobias, Nathaniel et Paul sautent dans l’avion, tandis que le shoggoth continue son massacre.
Au bateau allemand, Nicholas demande à être déposé en Argentine par l’intermédiaire de Baumann. Tobias, Nathaniel et Paul demandent à rejoindre le Gabrielle. Nathaniel et Paul dressent des plans pour une prochaine expédition, et comptent bien revenir à la Tour. Mais Tobias, à moitié fou, devient une sorte de nouveau Danforth… et est en outre infecté, non seulement par la « mort lente », mais aussi par les animalcules ; il est condamné à devenir un cadavre ambulant, porteur de destruction…
III/ Débriefing façon autocritique
À la fin de la campagne, les joueurs et moi-même nous sommes livrés à un débriefing, d’abord « en direct », puis par mail. Je n’en retiens ici que les éléments concernant directement la campagne (mais il y a eu également d’intéressants échanges sur l’implication des personnages, la dynamique de groupe, les conflits, l’acceptation de l’échec, etc.)
De mon point de vue, donc, j'ai commis je pense deux grosses erreurs. La première, et sans doute la plus handicapante pour moi – je ne sais pas ce que ça a donné pour les joueurs –, ça a été de me lancer dans cette énorme campagne sans suffisamment de préparation, et même sans lire ce (putain de gros) livre en entier au préalable. J'aurais dû... Je me suis laissé emporter par mon enthousiasme pour le récit de Lovecraft, probablement mon préféré, et pour les aventures polaires, et ai foncé tête baissée là-dedans sans forcément toujours savoir ce qui m'attendait. D'où grosse panique à chaque préparation... Et ça a de suite joué sur la deuxième erreur : je reconnais volontiers avoir foiré la toute fin. Un peu paumé après certains événements non prévus dans le livre (en l'occurrence essentiellement la mort de Lexington et de Priestley), j'ai bricolé en improvisant mal une conclusion bancale, en ne voulant pas en outre jouer les chapitres, au choix, 16 ou 16-B, faisant intervenir les animalcules à la Alien dans le Gabrielle, ou à la The Thing dans le camp de Palmer. J'avais le sentiment que ça rajoutait une couche un peu artificielle à la campagne (surtout la version Gabrielle), mais je conçois que ça ait été frustrant, tant pour les joueurs que pour moi à vrai dire. Il aurait probablement été plus convaincant de ne pas faire massacrer les Allemands du camp de Palmer et de jouer le chapitre 16-B. Mais j'ai décidément du mal à conclure les histoires...
D'un point de vue général, je me souviens d'une critique de cette campagne que j'avais lue dans JDR magazine, évoquée plus haut, et qui en faisait « une réussite littéraire, mais un échec rôlitistique ». Je ne serais pas aussi catégorique, mais il y a du vrai là-dedans. J'ai énormément apprécié l'ambiance de cette campagne, et certaines scènes qui m'ont paru très réussies (notamment le premier atterrissage dans la Cité, le retour dans le passé, les témoins muets dans la tour...) ; mais je note que sur ces trois scènes, l'une était largement due à l’initiative des joueurs (un peu couillonne, mais rigolote), tandis que les deux autres étaient fortement dirigistes. C'est là le gros problème de cette campagne à mon avis : elle est, par la nature des choses sans doute, trop linéaire. L'exploration du camp de Lake et de la Cité ont un côté « bac à sable », mais pas suffisamment développé. Pour le reste, on suit une ligne, et une chronologie très stricte (probablement trop stricte).
Un autre souci, peut-être assez typique de L'Appel de Cthulhu, mais particulièrement sensible dans cette campagne, a concerné les personnages, qui ont manqué de corps et d'âme à mon avis, et d'implication émotionnelle : finalement, ils n'ont été que des « techniciens » (dont les aptitudes spécifiques n'ont pas forcément été super utiles, d'ailleurs) ; on ne savait pas vraiment pourquoi ils étaient là (à part en tant « qu'employés »), ce qu'ils voulaient, ce qu'ils avaient vécu, etc. Du coup, j'ai eu le sentiment (pas forcément partagé) que les personnages se sont assez vite effacés, et que ce sont les joueurs qui ont pris le dessus. Mais je pense donc que ça vient en partie du jeu, en partie de la campagne, et aussi de la manière dont j'ai géré tout ça.
Mais, si je me suis ici longuement étendu sur les défauts, tant ceux de la campagne que ceux venant des joueurs et du MJ, le fait est que j'ai pris beaucoup de plaisir à diriger cette campagne, et j'espère que les joueurs également.


/image%2F1385856%2F20160114%2Fob_cfb8b0_caligari.jpg)



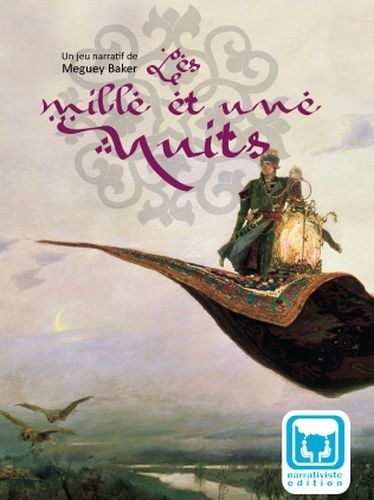
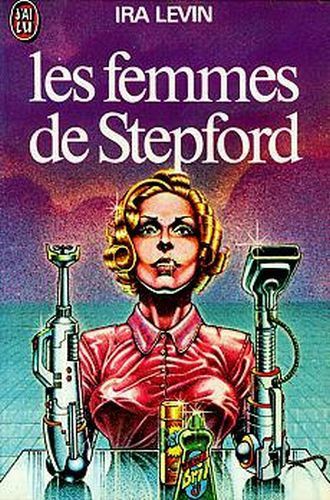


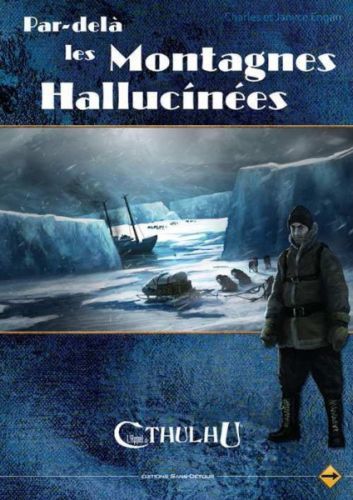


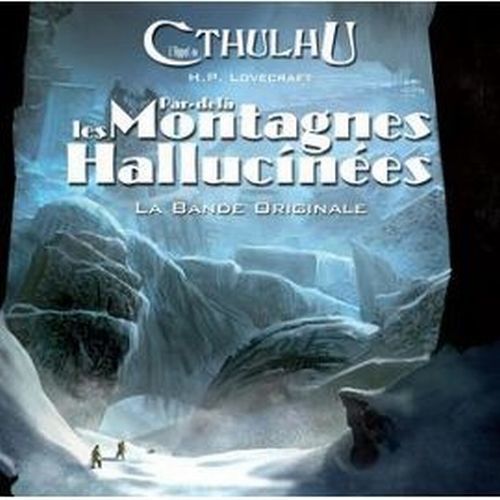



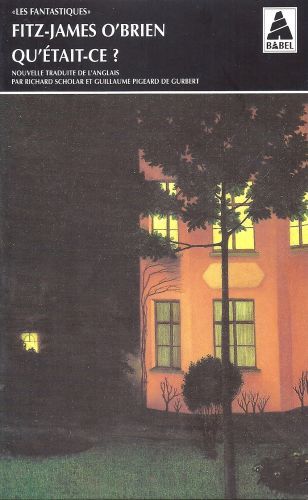



/image%2F1385856%2F20150204%2Fob_660a87_georges-abdaloff-croque-par-christell.jpg)