Crypt of Cthulhu, Vol. 1, No. 8, Bloomfield, NJ, Miskatonic University Press – Crypt of Cthulhu, Michaelmass 1982, 32 p.
Retour à Crypt of Cthulhu, le fanzine lovecraftien dirigé par Robert M. Price – et on fait dans l’archéologie, là, avec ce huitième numéro, guère épais, datant de 1982, et faisant toujours partie du premier volume de publication.
La dernière fois, j’avais évoqué un numéro bien plus récent (fin des années 1990) de Lovecraft Studies, « l’autre » fanzine lovecraftien, entièrement dévolu à la critique, et bien plus « sérieux » dans le ton. Le contraste sera donc particulièrement marqué avec ce numéro très léger (et à vrai dire un peu médiocre) d’une revue de toute façon globalement plus légère, mais aussi plus diverse, et mêlant aux études sérieuses d’autres qui le sont moins, en accordant une place non négligeable à l’humour, et en complétant le cas échéant avec des fictions ou des poésies, voire quelques illustrations ou même des jeux.
Régulièrement, les numéros de Crypt of Cthulhu sont thématiques, mais ça n’est pas toujours le cas – en l’espèce, ce n° 8 est fait de bric et de broc, si l’on compte tout de même deux articles se penchant sur les notions de genre et d’identité sexuelle, ce qui peut paraître commun aujourd’hui mais ne l’était probablement pas autant en 1982.
Le premier est dû à Robert M. Price lui-même, et s’intitule « Homosexual Panic in ʺThe Outsiderʺ ». L’auteur propose une grille de lecture de la nouvelle « Je suis d’ailleurs » venant, disons, compléter celles proposées par Dirk W. Mosig dans un article qui a fait date dans l’histoire de la critique lovecraftienne (hop). L’idée est que le comportement du narrateur, et la symbolique très appuyée dans un récit visiblement allégorique, peuvent évoquer le mal-être d’un homosexuel rejeté par la société et poussé, mais dans la douleur, à faire son coming-out. Maintenant, cet article témoigne d’une tendance récurrente chez Robert M. Price, voire dans Crypt of Cthulhu de manière plus générale (et éventuellement dans Lovecraft Studies aussi, en fait, mais de manière moins frontale) : établir des concordances à l’arrache, en sélectionnant des éléments qui viennent a posteriori appuyer une hypothèse, quitte à faire l’impasse sur d’autres éléments, le contexte, etc. En fait, le problème posé par ce genre de parallélismes était sans doute bien connu de Price lui-même et de ses collaborateurs, car, dans les quelques autres numéros que j’ai lus depuis, et à vrai dire déjà dans celui-ci avec l’article ultérieur de Peter Cannon, j’y reviendrai, les blagues ne manquent pas, qui font la démonstration qu’avec les lunettes munies d’œillères appropriées, on peut défendre absolument n’importe quelle hypothèse, jusqu’à l’absurde. Mes chers sophistes anciens apprécieraient, n’en doutons pas… À vrai dire, Price lui-même, et dès cet article, note bien que cette grille de lecture originale, pour significative qu’elle puisse paraître à certains égards, sans quoi il ne l’aurait pas proposée, ne traduit très probablement pas une intention délibérée de la part de Lovecraft – c’est plutôt du domaine de la coïncidence, disons. Et il ne manque pas de préciser, en fin d’article, que sa petite étude ne prétend en aucun cas faire la démonstration que Lovecraft lui-même était homosexuel, refoulé ou non (on l’a parfois sous-entendu, mais de manière passablement gratuite, rien dans la biographie comme dans la bibliographie de l’auteur ne venant véritablement étayer cette hypothèse – ce discours, pour ce que j’en ai lu, relève d’une psychanalyse de comptoir passablement primaire).
Le deuxième article de cet ordre s’intéresse plutôt à la notion de genre, et est dû à Morgana LaVine : au-delà du thème classique et certes particulièrement édifiant de l’absence des femmes dans le corpus lovecraftien, « Lovecraft and the Male Gender Role » relève que les notions très conservatrices de Lovecraft quant au rôle et aux attributs prétendument « naturels » ou « nécessaires » de chaque sexe, un sujet qu’il a pu aborder à plusieurs reprises dans sa correspondance, ne se traduisent pas vraiment, dans son œuvre, par une dimension « macho » (c’est le terme employé) des personnages lovecraftiens – ce qui opère, on le sait, un sacré contraste avec les personnages de Robert E. Howard, par exemple. Notamment, les personnages masculins lovecraftiens ont une tendance bien connue à s’évanouir, un trait généralement jugé féminin – cela vaut même pour les rares exemples de personnages masculins censément « durs » dans l’œuvre de Lovecraft, incluant les gros-bras de « La Peur qui rôde » ou le détective de « Horreur à Red Hook » ; la seule possible exception serait l’officier allemand du « Temple », mais l’autrice met alors en avant sa passivité ; de fait, face à l’adversité, quand ces personnages ne s’évanouissent pas ni ne deviennent fous, ils fuient ou « laissent faire », en aucun cas ils ne combattent. Quand ils survivent, c’est en raison de leur astuce et de leur détermination. Tout ceci, pris séparément, est vrai. Maintenant, je ne suis pas convaincu, et surtout au regard de l’œuvre lovecraftienne, que le fait pour un personnage masculin de ne pas se montrer aussi « physique » que d’autres, chez Howard et compagnie, suffise à qualifier ses manières de « non masculines » (même si Howard a certes pu s’amuser avec ce trait, par exemple dans « Les Pigeons de l’enfer », et j’en avais causé ailleurs, ici et là). En même temps, Morgana LaVine ne le prétend pas – ce devrait être plutôt « non machistes ». Mais je trouve son discours un peu confus, de manière plus générale, du fait d’une notion changeante, mêlant ou au contraire distinguant, mais sans toujours prévenir, le machisme d’alors et celui d’aujourd’hui, mais aussi, parfois, une simple « masculinité » moins connotée. Mais elle affirme que ces personnages ne sont du coup pas représentatifs de la population mâle en général, et, là, j’ai du mal à la suivre… Elle relève un autre trait qui cette fois est supposé concorder davantage avec les représentations masculines traditionnelles, alors comme aujourd’hui : l’incapacité au care, dirait-on peut-être aujourd’hui, à l’établissement et plus encore à l’entretien de relations solides et désintéressées aux autres, impliquant de leur conférer de la valeur – par exemple au travers des liens d’amitié, essentiellement fonctionnels voire utilitaristes plutôt qu’empathiques dans les histoires de Lovecraft, ou au sein du couple, dans les très, très rares cas où il y en a un ; pour elle, c’est le trait du machisme qui survit par-delà les générations. Et, oui, ça aussi, bon… En même temps, l’autrice suppose que ces traits éventuellement opposés se rassemblent en définitive en permettant davantage aux lecteurs de s’identifier aux personnages de Lovecraft, qu’elle préfère ouvertement aux héros masculins « machos » plus communs, tels Superman ou John Wayne, exemples cités. La rhétorique est peut-être un peu acrobatique, et à débattre ; pour ma part, je concède volontiers que le caractère non surhumain des personnages lovecraftiens facilite l’identification – mais c’est un peu un lieu commun ; pour le reste, j’aurais tendance à dire que cette identification doit en vérité beaucoup… au caractère de coquilles creuses de ces personnages, davantage qu’aux autres considérations développées dans cet article. Que je trouve plus ou moins convaincant, donc – pas des masses en ce qui me concerne. Mais précurseur, peut-être ? Je ne sais pas vraiment ce qu’il en est de cette thématique critique aujourd’hui, ça pourrait être intéressant de se renseigner.
C’en est tout pour cette très vague thématique. La pièce de résistance de ce numéro, de toute façon, est ailleurs – ainsi que l’affiche la couverture : il s’agit de l’article de Colin Wilson sobrement titré « H.P. Lovecraft » (tout simplement parce qu’il s’agit à l’origine d’une entrée dans une coûteuse encyclopédie de la science-fiction, reproduite ici avec l’accord de l’auteur). Colin Wilson se montre tantôt sévère, tantôt intéressé dans cette notule. Il accorde une place conséquente à la philosophie de Lovecraft, sans surprise, mais, sans surprise aussi, s’il la comprend (disons qu’il la comprend bien mieux que Derleth), elle lui répugne tant qu’il ne peut guère en traiter que sous un angle assez méprisant – le pessimisme, ou même l’indifférentisme, lui paraissent par essence puérils et naïfs (comme il se doit, les pessimistes et indifférentistes jugent les optimistes puérils et naïfs, ce qui ne facilite pas le débat). Cela dit, c’est une lecture plutôt intéressante, qui m’a incité à franchir le pas et à lire enfin un roman de Colin Wilson : Les Parasites de l’esprit. Ce fut hélas un échec, et je vous en causerai prochainement.
Autre article de taille conséquente, « In Search of a Mythos Genealogy », signé Bernadette Bosky. Tout ou presque est dans le titre, il s’agit de livrer une, ou plus exactement des, généalogies des créatures mythiques de Lovecraft en y incluant ses pasticheurs/successeurs/etc., et en ne les distinguant pas toujours très bien, sur la base, au mieux, de quelques déclarations (souvent humoristiques) de Lovecraft lui-même ou de ses correspondants, etc. – ce qui peut inclure le fait que Yog-Sothoth et Shub-Niggurath ont enfanté Nug et Yeb, entre autres, etc. Ce qui n’a pas de sens en dehors de la blague. L’autrice le sait, mais persévère – et le reste de ces généalogies est extrapolé sur la base de ressemblances thématiques (ici intervient notamment la navrante dimension élémentaire chère à Derleth)… ou plus largement au doigt mouillé, « parce que c’est plus joli comme ça ». On appréciera le fait que, même avec cette « méthode » qui n’en est pas vraiment une, l’autrice ne sait pas quoi faire de Cthugha (j’aurais bien une réponse, mais…). Bon, cet article est totalement vain – mais j’admets être totalement réfractaire à son propos, oui. S’il avait adopté une approche, disons, historiographique, il aurait pu se montrer intéressant, mais en l’état c’est plus de la mauvaise fanfic qu’autre chose.
Mentionnons enfin un dernier article « critique », avec « The Attestation Formula in the Necronomicon », par Robert M. Price. Au fond, c’est d’une autre généalogie qu’il s’agit ici – mais celle d’un procédé, ce qui est plus intéressant. L’auteur relève comment Lovecraft, de manière plus franche Clark Ashton Smith et plus récemment Brian « Unspeakable » Lumley, ont fait usage, dans leurs citations du Necronomicon ou d'autres ouvrages du même type, d’une même formule ou peu s’en faut, par laquelle le livre maudit affirme la pertinence de ses développements en faisant état de ce que d’autres sources en faisaient également état, au point du consensus : en somme, « il est unanimement attesté que… », ce genre de choses. Ce qui est intéressant, ici, même si je ne suis bien sûr pas certain du crédit qu’on peut y accorder (assez limité probablement, car on pourrait sans doute trouver bien d'autres exemples, avec un procédé aussi commun...), c’est de faire remonter cette formule dans une source possible voire probable de ces auteurs, Ambrose Bierce, en fait dans ses nouvelles où apparaissaient « Hastur », « Carcosa », « le Lac de Hali », etc., termes qui seraient repris par Robert W. Chambers dans son Roi en Jaune, puis à sa suite par Lovecraft (à peine) et Derleth (surtout), pour les résultats que l’on sait. Mais Price va ensuite plus loin, en cherchant où Bierce lui-même a pu trouver ces formules, et on en arrive à quelque chose qui ressemble déjà davantage à un grimoire… Tout ceci est à prendre avec les pincettes habituelles, je n’y reviendrai pas à chaque fois. Mais c’est plutôt intéressant.
Le reste de ce numéro, à l’exception d’une « R’lyeh Review » très mince consacrée à deux livres de James Blish, est de nature humoristique – et c’en est probablement la partie la plus réussie. Même si, disons-le, la nouvelle « Two Burgers to Go… Mad ! », signée Ronald Shearer, n’est d’aucun intérêt ou presque (elle constate simplement que, même à Arkham, il y a un McDo, mais qu’un McDo à Arkham a forcément ses petites particularités et ses rites obscurs).
Beaucoup plus amusant, « Famous Last Words » est une compilation par Robert M. Price de ces fins de nouvelles calamiteuses, dans lesquelles le narrateur écrit jusqu’à la mort. Chez Lovecraft lui-même, on cite forcément « Dagon », ou éventuellement la révision « Le Journal d’Alonzo Typer », mais Price cite d’autres exemples au moins aussi édifiants (et plus encore consternants), chez August Derleth, surtout, mais aussi Robert Bloch et Lin Carter. Il réserve cependant la palme, et je suis tout à fait d’accord avec lui, à la conclusion des « Chiens de Tindalos », par Frank Belknap Long, dans laquelle le narrateur écrit dans son journal son ultime cri de terreur ! « Ahhh indeed », tranche Price. Une compilation très drôle !
Et nous avons enfin la rubrique « Fun Guys from Yuggoth » (j’adore ce titre), cette fois confiée à Peter Cannon, exégète notoire mais aussi auteur de nombreux pastiches souvent hilarants, et qui, cette fois, livre une étude parallèle totalement absurde de Lovecraft… et de John Fitzgerald Kennedy ! « HPL and JFK » est un petit délire très rigolo, et, comme noté plus haut, j’y vois une petite raillerie amicale sur les exégètes lovecraftiens, dont Robert M. Price au premier chef, qui adorent établir des parallèles aux bases guère solides : avec suffisamment d’aplomb, une approche suffisamment biaisée, et suffisamment de mépris pour le contexte, on peut absolument tout démontrer – « Gorgias approved ».
Bon, c’est tout de même un numéro assez moyen. La lecture de l’article de Colin Wilson est intéressante, qu’on y adhère ou pas, mais les autres études critiques de ce numéro sont plutôt faibles. En dernier recours, il parvient à nous faire sourire de manière complice, et c’est déjà quelque chose.
Cependant, la revue peut faire bien mieux. Depuis, j’en ai lu deux autres numéros qui se sont avérés bien plus satisfaisants – et je vous en causerai plus en détail bientôt…
/image%2F1385856%2F20201027%2Fob_e27ed3_la-guerre-du-pavot.jpg)

/image%2F1385856%2F20160114%2Fob_cfb8b0_caligari.jpg)






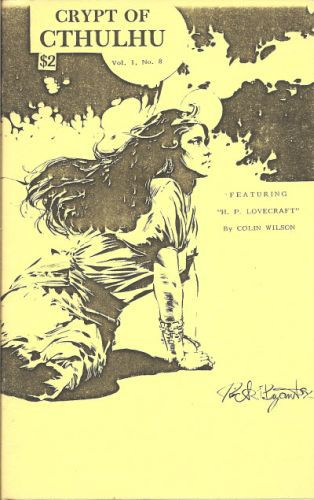
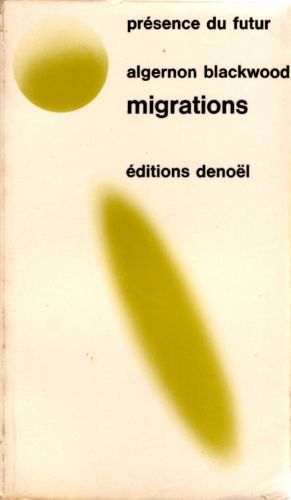
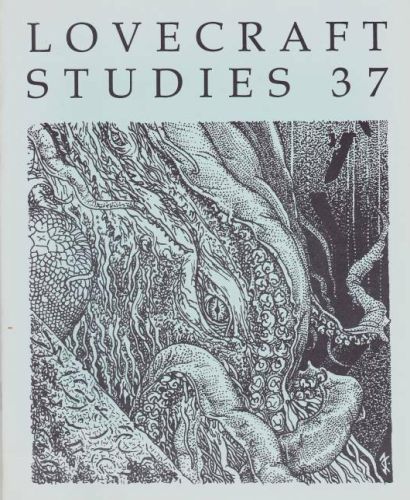

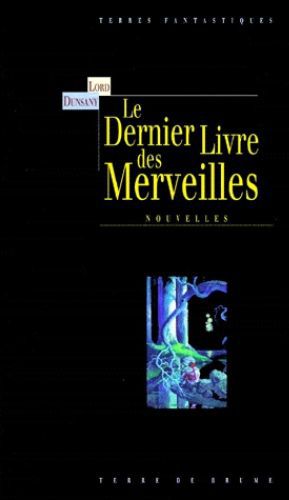
/image%2F1385856%2F20150204%2Fob_660a87_georges-abdaloff-croque-par-christell.jpg)