"Le Roman politique", de Laurence Sterne

STERNE (Laurence), Le Roman politique, [A Political Romance], préfacé et traduit de l’anglais par Serge Soupel, Paris, Cent Pages, coll. Cosaques, [1968, 1984] 2003, 60 p.
On doit au pasteur Laurence Sterne le plus fou, le plus drôle, le plus inventif, le plus extraordinaire des romans, à savoir La Vie et les opinions de Tristram Shandy (à lire de préférence dans la superbe édition publiée par… Tristram). Mon admiration pour cette fantabuleuse, euh, « chose » n’a pas de limites (lisez Tristram Shandy, c’est un ordre). Aussi, quand je suis tombé par hasard (bon, un hasard sans doute manipulé par un salaud de libraire… SALAUD !) sur ce minuscule ouvrage qu’est Le Roman politique, et qui correspondait semble-t-il à l’entrée de Sterne en littérature, quelques sermons et articles exceptés, il va de soi que je n’ai pu résister et que j’ai acquis la bête, tagada tagada.
Le Roman politique, si l’on met à part les dédicaces et lettres qui l’accompagnent, est constitué pour l’essentiel de deux parties : un bref récit sous une forme épistolaire, et une « clef », à savoir un débat pour le moins farfelu sur l’interprétation à donner à ce récit (et c’est à mon sens surtout là que l’on voit Sterne préparer Tristram Shandy, même si d’autres traits d’écriture se retrouvent dès le départ : l’usage abusif des tirets – le fameux tiret shandéen inclus –, les phrases interminables, le jeu sur les italiques et gothiques, etc.).
Le récit (le « roman politique » à proprement parler) nous montre les pathétiques activités d’un dénommé Trim pour s’emparer d’une capote et d’une culotte. La « clef », quant à elle, rapporte que l’ouvrage en question a été trouvé par une société politique et littéraire anglaise, qui s’empresse aussitôt de débattre du sens à donner à ce qui ne peut être qu’une allégorie. C’est dans cette partie franchement délirante que l’on trouve surtout les bases de l’humour si particulier de Tristram Shandy – et c’est donc sans surprise la plus intéressante.
La préface de Serge Soupel nous éclaire sur le véritable sens à donner à cette histoire obscure de capote et de culotte – sens qui n’apparaît bien évidemment pas dans la « clef » (à peine est-il sous-entendu à un moment du débat), mais qui était limpide pour les contemporains et concitoyens de Sterne. Le Roman politique est en effet un pamphlet, qui donne une bien triste image des affaires ecclésiastiques d’Angleterre, à l’occasion d’une dispute entre plus ou moins honorables hommes d’Église pour obtenir des charges (grassement rémunérées, comme de bien entendu). Trim correspond à un sinistre arriviste du nom de Topham, et tous les autres personnages sont des représentations sur un mode trivial de personnalités d’York, connaissances, amis et protecteurs de Sterne, qui s’en donne à cœur joie.
Alors, évidemment, tout ceci nécessite des explications pour le lecteur d’aujourd’hui, lequel, avouons-le, ne trouvera sans doute guère d’intérêt à ce récit qu’on devine cependant vigoureux dans la caricature, outre les traits d’écriture annonçant Tristram Shandy. Aussi est-ce surtout la « clef » qui retiendra notre attention ; et là, c’est un vrai bonheur : Sterne, dans un exposé jubilatoire, multiplie les interprétations toutes plus saugrenues les unes que les autres de ce qui ne peut être, c’est considéré comme acquis, qu’un « roman politique ». Le lecteur complice, qui sait ce qu’il en est, s’amuse vraiment dans ces pages délirantes, critiques acerbes des interprétations littéraires. Ce qui donne évidemment à réfléchir, et constitue un sévère avertissement pour les exégètes en tout genre, votre serviteur inclus.
C’est là ce qui constitue à mon sens le principal intérêt de ce Roman politique. Pour le reste, si les arrivistes n’ont certes pas disparu de notre bonne vieille planète entre-temps, il va néanmoins de soi que le contexte précis de cette affaire nous est bien éloigné, et que l’on n’en rira donc pas autant qu’un habitant de York au milieu du XVIIIe siècle, qui pouvait, lui, sans peine deviner qui se cachait derrière tel ou tel personnage.
C’est pourquoi je ne puis véritablement recommander la lecture de ce tout petit ouvrage qu’est Le Roman politique. Disons que c’est une curiosité, qui pourra ravir les amateurs de Sterne, mais guère plus. On note par contre avec plaisir tout ce qui y annonce Tristram Shandy. Eh oui : on en revient toujours là… Alors, au risque de me répéter (…), je ne peux guère me servir de ce petit compte rendu que pour vous encourager (chaudement, oui) à lire ce monument qu’est La Vie et les opinions de Tristram Shandy (chez Tristram, hein). Lisez cette merveille, et plus vite que ça ! Je ne vois pas comment vous pourriez le regretter.

/image%2F1385856%2F20160114%2Fob_cfb8b0_caligari.jpg)



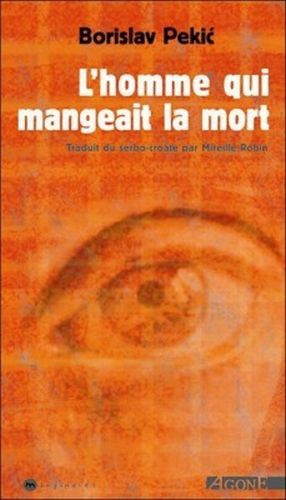








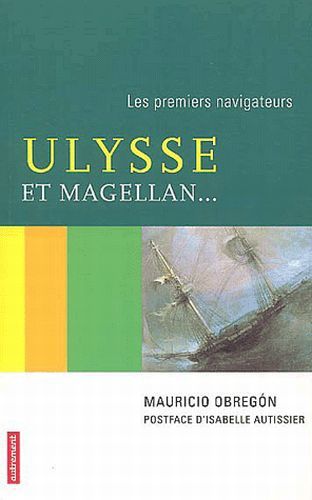

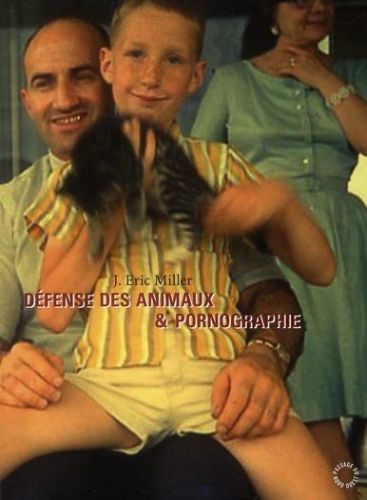

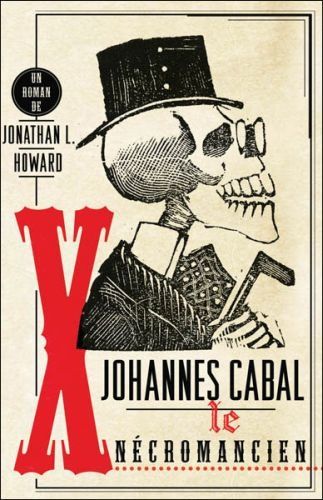

/image%2F1385856%2F20150204%2Fob_660a87_georges-abdaloff-croque-par-christell.jpg)