
DUFOUR (Catherine), L'Accroissement mathématique du plaisir, recueil réuni par Richard Comballot, préfaces de Richard Comballot et Brian Stableford, Saint Mammès, Le Bélial', 2008, 443 p.
Il était une fois, dans un pays pas exactement lointain et il n’y a pas si longtemps que ça d’ailleurs, un écrivain de talent qui s’appelait (et s’appelle toujours, sauf erreur) Catherine Dufour. Catherine Dufour écrivait bien (zob), et des trucs bien en plus (et je suppose que c’est toujours le cas). Ce terrible handicap ne l’empêcha pas de remporter un certain nombres de récompenses nécessairement prestigieuses, et d’accumuler les éloges et autres critiques positives. Mais voilà : Catherine Dufour, comme toutes les artistes et comme toutes les femmes (eh ! si elle se complaît dans l’écriture de pamphlets misandres – p. 432 –, je peux bien m’autoriser cette remarque), était une perpétuelle insatisfaite. Aussi n’a-t-elle pas manqué de faire part de sa jalousie à l’égard de sa consœur Léa Silhol : là où la Tisseuse accumule sur Amazon.fr les commentaires dithyrambiques saturés de superlatifs et d’adjectifs d’un délicieux et déliquescent romantisme juvénile, elle, la pôvre (mais pas lépreuse, c’est une calomnie), devrait se contenter de bêtes et lapidaires « c’est bien », « c’est chouette », voire – et elle n’a pas manqué de s’en offusquer – « et puis zob, c’est bien écrit » ? Je plaide coupable : la dernière formule était de mon fait. Aussi avais-je promis à Catherine Dufour que, pour le prochain compte rendu miteux que je serais amené à faire concernant un de ses sublimes ouvrages, je m’inspirerais des critiques rendues par les fans hardcore de Léa Silhol sur Amazon.fr (voyez sur cette page, y’en a plein). La parution de cette « merveille remarquablement remarquable » (j’aurais dû exiger des droits d’auteur, tiens ; oui, je sais que j’ai une fâcheuse tendance à faire dans ce genre d’abominations quand je succombe à mon tour à l’enthousiasme superlatif…) qu’est L’Accroissement mathématique du plaisir m’en fournit enfin l’occasion. Je vais donc parsemer cette notule – pour le moins exceptionnelle, vous l’aurez compris – d’emprunts aux commentaires susdits, que l’on pourra identifier au soulignement (entre autres). Merci de votre attention.
…
Ah, oui, une autre précision, tant qu’on y est : de l’aveu même de Catherine Dufour, deux des textes composant ce – superbe – recueil lui paraissent « moins bons » que les autres (qui sont tous remarquablement merveilleux) ; je crois en avoir identifié un, mais il y a eu des fuites, alors c’est pas du jeu. Pour le second, je dois dire que je suis doute et questionnement, n’ayant rien rencontré de « mauvais », le pire étant simplement « bon » ; j’hésite entre deux… Je prends les paris, en tout cas.
Lecteur qui te ballade pour trouver quelque chose à lire, arrête ta marche ici un instant, L’Accroissement mathématique du plaisir mérite ton attention. Normal : Catherine Dufour, c’est la plus belle, la plus intelligente, la plus sympathique et la plus talentueuse. Elle a l'art et la manière de vous embarquer dans son monde. J’avoue beaucoup aimer ce qu’elle écrit (et j’avais déjà eu l’occasion de le dire, mais trop mollement sans doute ; en même temps, elle-même me disait de ne pas trop en faire, parce que ça risquait de se voir). Les livres de Catherine Dufour sont toujours une surprise, une révélation, une claque en pleine figure, et ce petit bijou ne fait bien sûr pas exception. D’autant que c’est Un véritable caléidoscope littéraire qui est sorti du laboratoire étrange de Catherine Dufour : L’Accroissement mathématique du plaisir, excellent (donc) recueil composé de vingt nouvelles dont sept inédites choisies par l’éminent Richard Comballot, complétées d’une préface dudit anthologiste, d’une seconde préface de Brian Stableford, d’une postface de l’auteur, d’un entretien avec cette dernière et d’une bibliographie exhaustive (ouf ; sans oublier, bien sûr, la couverture du grand Caza) ; une excellente porte d’entrée à la lecture de ses œuvres complètes. Très à l’aide dans le format de la nouvelle, Catherine Dufour déploie ici les nombreuses facettes de son incommensurable talent, Tout à la fois magique, philosophique et rentrant dans le tas, s’exerçant avec un égal bonheur dans les registres du fantastique, de la fantasy, de la science-fiction, et même – horreur glauque – de la « blanche », multipliant par la même occasion les pastiches les plus adroits, la Divine sachant dans tous les cas susciter le rire comme les larmes de sa plume enchanteresse et vive, de sa verve sombre et puissante, car avec elle, c'est aussi la magie de la nuit que nous épousons (enfin, plus ou moins, et honni soit qui mal y pense), et je viens de mettre tellement d’adjectifs et de participes présents dans des propositions enchevêtrées que je ne sais plus où j’en suis, aussi vais-je m’arrêter là de crainte que les éventuels lecteurs ne meurent d’anorexie d’ici à ce que j’en arrive à la conclusion de ma phrase (pfff…). Je reformule en copiant : Catherine Dufour est une magicienne.Son écriture baroque, précieuse, recherchée, possède une puissance qui vous transporte de façon invariable. Ces vingt textes ne dérogent pas à la règle car ils sont de purs enchantements. Du fantastique, de la fantasy et même de la SF, Dufour intrigue, titille votre curiosité, vous invite à vous poser des questions. Et nous comment réagirions nous dans telle situation ?
…
Parlons plutôt des textes composant ce recueil (un bijou, vous dis-je), qui partent donc un peu dans tous les sens, mais c’est tant mieux. J’aurais pu tenter de les regrouper par genre, par thème (art, filiation, musique…), par procédé (distinguer les pastiches, notamment), mais, finalement, au risque de passer pour une feignasse, je préfère m’en tenir à l’ordre choisi par Richard Comballot. Hop. Décortiquons. Hop, hop.
« Je ne suis pas une légende » (pp. 27-43 ; tiré du Bifrost n° 30, 2003). Ah ben on attaque avec un pastiche, donc. Et du meilleur goût. L’épidémie de vampirisme imaginée par Richard Matheson dans son classique (massacré dans sa dernière « adaptation » pseudo-cinématographique par une invraisemblable bande de gougnafiers criminels, nan mais j’vous jure) touche ici le triste monde tragique des cadres encravatés parisiens, et l’on fera difficilement plus sinistre. Quant à celui qui n’est pas une légende, et qu’on ne saurait davantage qualifier de « héros », c’est un médiocre parmi les médiocres, qui n’a succombé que trop tard à la cravate, et ne se sent pas particulièrement les épaules pour sauver l’humanité, ni même pour faire quoi que ce soit d’intéressant maintenant que l’apocalypse autorise tout. Un texte drôle et amer, une très bonne entrée en matière.
« Le Sourire cruel des trois petits cochons » (pp. 45-59 ; Faeries n° 10, 2003) joue la carte du conte horrifique délirant, pour un résultat proprement jubilatoire. Un bémol, cela dit : si les premières pages sont véritablement excellentissimes, la conclusion m’a paru un chouia plus faible… Mais ça reste très bon.
« L’Immaculée conception » (pp. 61-125 ; Lunatique n° 73, 2006), de très loin le plus long texte du recueil, a reçu le Grand Prix de l’Imaginaire 2008, et c’est mérité. On y suit une jeune femme « un peu » paumée dans les affres d’une bizarre grossesse. Sans les gestes, mais avec un style qui n’appartient qu’à elle, Catherine Dufour nous décrit donc les merveilles de l’accouchement, la version non édulcorée où les gens ne sourient pas bêtement tout le temps, mais souffrent comme jamais. Une novella émouvante et cruelle, mais non dénuée d’humour cependant, un cri du cœur anti-cons, anti-Parents, anti-sage-femmes, authentique et efficace. Comme la lame s'enfonce dans la chair, la plume de Catherine Dufour sait appuyer au plus profond de nous-mêmes et enfoncer des touches qui libèrent des sensations infiniment justes et humaines. Sublime...
« Vergiss mein nicht » (pp. 127-136 ; Faeries n° 15, 2004), derrière ce titre dont l’orthodoxie teutonne me paraît quelque peu douteuse (cela dit, mes cinq années de boche sont bien lointaines, et je suis aujourd’hui incapable d’aligner trois mots dans la langue de Goethe et de Tokyo Hotel), dissimule une courte histoire fantastique dans un cadre légèrement science-fictif. Beau et déprimant, peut-être un peu trop court pour convaincre totalement, mais néanmoins très appréciable.
« La Lumière des elfes » (pp. 139-148 ; inédit). Portrait cruel et douloureux d’un abruti méconnaissant son talent, dans le monde répugnant des hartisteux et de leurs (pétasses) muses. Une ode aux chefs-d’œuvre perdus, une élégie pour tous ceux qui, pour une raison ou une autre, ratent obstinément leur vie. Probablement un de mes textes préférés du recueil, très, très fort.
« Rhume des foins » (pp. 151-158 ; inédit), heu… ben… broumf : L'auteur adopte ici un style poétique surprenant qui fait toute la force du récit et qui le laisse pourtant tout à fait accessible. Heu… Bon, on en tient un des deux, faut croire. La seule vraie fausse note du recueil à mon sens, un texte fantastique lourd d’effluves artificiellement romantiques ; un steak chateaubriand trop cuit, comme on n’en ose plus après 17 ans. Mais on n’est pas sérieux quand on a 17 ans…
« Le Jardin de Charlith » (pp. 159-170 ; anthologie Lilith et ses sœurs, 2001) fait également dans le romantisme juvénile (Catherine Dufour elle-même le dédie « aux hormones démentes de l’adolescence ») et la nostalgie ; mais cette nouvelle, la première de l’auteur à avoir été publiée – dans une anthologie de L’Oxymore, autant dire chez/par Léa Silhol –, me paraît bien autrement intéressante. Si l’histoire est assez plate, une douce atmosphère s’en dégage, pas désagréable ma foi, et le tout constitue bien Un balet envotant. (Champagne !)
« Mater Clamorosum » (pp. 173-181 ; anthologie Magie verte, 2003), toujours chez L’Oxymore, est un conte cruel beau à pleurer. Voilà. vous en reveindrez assurément bouleversés !!
« Confession d’un mort » (pp. 183-207 ; inédit) nous ramène au pastiche. Cette fois, c’est Edgar Allan Poe qui trinque (forcément). L’histoire n’a rien de bien original, mais Catherine Dufour s’amuse bien dans ce style ampoulé, précieux à l’excès, et le lecteur avec. Finalement, si bien des allusions nous renvoient à Poe, les procédés mis en œuvre m’ont davantage évoqué ses disciples du fantastique « fin de siècle » (d’une misogynie délicieuse…), et les décadents à la Huysmans. Je n’ai pu m’empêcher, à la lecture de ce réjouissant pastiche, de me rappeler ce numéro du Visage vert consacré aux « femmes fatales ». Et, pour ceux qui en douteraient, c’est un compliment.
« Valaam » (pp. 209-221 ; inédit) est un court texte étrange et brillant, semble-t-il mêlé d’éléments autobiographiques, décrivant un voyage pour le moins sordide dans la Russie post-soviétique, avec ses mafieux et ses putes, et ses trafiquants d’icônes. Saisissant.
« Le Cygne de Bukowski » (pp. 223-233) nous rapporte un périple à travers les Etats-Unis, à la manière de vous-savez-qui, mais en femme. Et ça marche très bien. On s’y croirait ; n’y manquent que les bourrins.
« Kurt Cobain contre le Dr. No » (pp. 235-260 ; inédit) : en voilà un titre bien débile ! Sauf que la nouvelle l’est beaucoup moins. C’est un beau texte, sérieux et amer, émouvant, avec une belle galerie – inévitable – de stars qui ont tout simplement cessé de vivre. l'auteur "deal" avec une force inégalée les chutes et les failles (célestes?)de l'humanité. Étonnant et bien vu.
« Une troll d’histoire » (pp. 263-275 ; Lanfeust Mag hors-série n° 1, 2003) : en voilà un titre bien débile ! Mais cette fois la nouvelle le vaut bien. Une fantasy burlesque, avec des pirates trolls hargneux. Je ne sais pas si évoque bien la (pathétique) BD, mais on ne manquera en tout cas pas de penser à Pratchett, bien sûr : à peu de choses près, la nouvelle débute au Tambour rafistolé… C’est amusant. Peut-être pas tout à fait à sa place ici, certes ; la deuxième erreur, alors ? Pas en ce qui me concerne, je suis bon public.
« La Perruque du juge » (pp. 277-289 ; anthologie Les Ombres de Peter Pan, 2004) s’attaque cette fois à James Matthew Barrie. Le cruel juge du titre entend bien en effet faire condamner le terrible Peter Pan pour une liste de méfaits longue comme le bras et particulièrement sordide. Très sympa, mais, le plus fort, c’est probablement la fin. À mesure qu’on la voit venir, on se met à écarquiller les yeux, et à marmonner dans un sourire : « Non… non… c’est pas vrai… c’est pas possib’… elle va pas le faire, quand même ! » Et puis vient bien vite la réponse, hystérique : « SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII !!! » Merci, Madame Dufour, pour ce grand moment de bonheur.
« Le Poème au carré » (pp. 291-303 ; anthologie Mission Alice, 2004) est un texte assez proche du précédent dans l’esprit. Le pastiché, cette fois, n’est autre que l’immense Lewis Carroll (avec un détour par les cases Boris Vian et Lewis Padgett, semble-t-il). Et, pour avoir relu tout récemment ces chefs-d’œuvre sans pareils que sont Les Aventures d’Alice au Pays des merveilles et De l’autre côté du miroir, je peux vous assurer que c’est ach’ment bien fait et bien vu. Nous y suivons une Alice un peu plus grande, un peu moins bien élevée, beaucoup moins Disney en somme, dans un nouveau rêve étrange. On y croisera, entre autres, un certain Sergent Poivre, et un sous-marin nécessairement jaune. Tout simplement parfait, un de mes textes préférés du recueil.
« L’accroissement mathématique du plaisir » (pp. 305-323 ; Bifrost n° 36, 2004) inaugure la partie la plus ouvertement science-fictive du recueil éponyme. Un joli texte sur l’art et son addiction, à rapprocher sans doute de « La Lumière des elfes ».
« La Liste des souffrances autorisées » (pp. 325-348 ; Bifrost n° 42, 2006) est la première nouvelle de Catherine Dufour que j’ai eu l’occasion de lire, dans le gros numéro anniversaire de Bifrost. Un texte horriblement noir, et en même temps étrangement drôle (notamment avec ses plats saugrenus empruntés à l’American Psycho de Bret Easton Ellis), et qui m’avait alors tout simplement foutu par terre. Une très bonne idée, de bons personnages, un cadre exemplaire, un traitement qui ne l’est pas moins, une plume vive et forte… Chef-d’œuvre. Un constat renversant sur le chemin qui nous reste à parcourir dans la recherche du « connaît les autres comme toi même ». En plus, j’adore le titre…
« L’amour au temps de l’hormonothérapie génique » (pp. 351-358 ; inédit) est une courte fable sadique et terrifiante. Drôle et horrible, donc lucide, au-delà de la caricature nécessaire des personnages. Bref, très bon.
« Un soleil fauve sur l’oreiller » (pp. 361-370) est un petit texte étrange, et magnifiquement écrit, qui sent le vécu. En le lisant, j’entendais la voix de Catherine Dufour… notamment pour la conclusion on ne peut plus jubilatoire. Un rayon de soleil tranchant sur un fond grave, qui n’a hélas plus grand chose de science-fictif… A lire, à vivre…
« Mémoires mortes » (pp. 373-403 ; Icares 2004, 2003), enfin, est un texte terriblement éprouvant et déprimant, et en même temps palpitant. Je confesserai que la toute fin ne m’a pas paru à la hauteur du reste ; mais il faut dire que ce reste plaçait la barre sacrément haut. Car Catherine Dufour est une artiste ayant la manie de mettre la barre très haut autant pour elle que pour ses lecteurs. Au final, ça reste donc très bon.
Et le recueil dans son ensemble est donc une vraie réussite, extrêmement varié mais toujours personnel. Sans doute un des meilleurs recueils de nouvelles francophones dans les genres qui nous préoccupent, un vrai bonheur qui ne fait que confirmer le talent de Catherine Dufour. Je l’ai déjà dit, mais je le répète (sérieusement et sans arrières-pensées) : elle est bien à mon sens un des écrivains les plus brillants de la scène française de l’imaginaire, et sans doute au-delà. Les fans de la grande Dame seront comblés, et pour ceux qui ne la connaissent pas encore, c’est l’occasion de vous immerger dans un univers hors du commun. Gageons que vous aussi vous serez conquis !
Le bilan est en effet des plus clairs : Encore une fois l’écriture de Catherine Dufour vous envote, vous ensorcèle et vous emmène loin, là-bas… / Ce recueil est un chef-d’œuvre, un incontournable de la Fantasy, de la science-fiction et du fantastique, un petit bijou tout de Grâce auréolé… Il nous plonge au cœur d’histoires où se mêlent splendeur, Fatalité et Amour, où s’entremêlent l’Ombre et la Lumière dans un balet d’une Beauté prodigieuse et poignante. L’Accroissement mathématique du plaisir est un prodige, un petit miracle dont l’éclat et la somptuosité vous émerveilleront. / L’émotion est là, présente dans chacun des morceaux choisis et aussi *entre* les morceaux, derrière chaque visage rencontré. / La preuve éclatante que les enchantements littéraires n’ont rien à envier aux envoûtements de Féerie. / Autant d’histoires qui envoûtent (oui, ça se répète un peu) et vous emportent loin, dans ces contrées pétries de magie. A lire absolument ! / Sérieusement, vous attendez quoi pour succomber ??? / ... mais qu’attendez-vous pour vous ruer sur ce chef d’œuvre de l'une des plus talentueuses auteures d’imaginaire qui soient ? / Ce recueil est l’un des meilleurs ouvrages de l’une des plus grandes auteurs de fantasy (etc.) française. Passionnant, beau, complexe. A lire absolument. / Il y a vraiment de la magie, infusée dans les lignes de ce recueil, du sang et du nerf. Et un souffle […] rarement si palpable en littérature. / Il n’y a pas à hésiter, il *faut* lire L’Accroissement mathématique du plaisir. Un indispensable, déjà. / Bref, un livre que je recommende chaudement, un vrai bonheur et un plaisir pour ceux aimant à explorer les diffèrents niveaux de récits auquel nous a habitué cette auteure. / On retrouve la prose de Catherine Dufour, l’enchantement de mots ciselés comme des sculptures de glace, envoûtants comme la plus noire des nuits (heu…) / A lire ab-so-lu-ment ! / Ce livre est une merveille et un enchantement, un véritable joyau si vous aimez l'Oeuvre de Catherine Dufour (non, « la Tisseuse », c’est réservé) alors vous adorerez cet ouvrage qui est tout simplement fabuleux et qui, dès les premières pages, capture et conquis ! Vous savez donc ce que vous avez à faire, vous jetez sur ce livre au plus vite ! / Comment décrire le bonheur absolu que procure la lecture de L’Accroissement mathématique du plaisir ? Difficile quand on est pas un grand écrivain soi même. Ce recueil vous attrape et ne vous lache plus. C'est un tourbillon d'émotion, de plaisir à lire, à découvrir et à aimer. il est servi par un style magnifique ou chaque mot compte. On peut le relire, l'émotion est toujours là! A se procurer absolument. / comptez également sur la présence d'une Voix, d'un style, d'une vraie recherche en tous ces points et surtout d'un quelquechose d'indescriptible qui vous y ramènera invariablement.
C'est de la *vraie* littérature. Toutes catégories confondues. Rien de moins. / Bouleversant, […] inspirant, et dans un style unique... Un livre qu'il est impossible de lâcher, de la première à la dernière page. Et quand on le lâche, c'est pour le relire. Décidément indispensable. / Voilà un livre qui vous emporte, vous distribue joie,angoisse,frissons et plaisir; le tout dans le style habituellement génial de son auteure. Une fois commencé, vous ne le lâcherez plus! Et une fois terminé vous y reviendrez!!! Un MUST! / Tout ça narré avec des mots qui t’arrachent de ta chaise, t’emportent avec eux et ne te lâchent pas. Oh, des nouvelles de SF, etc. penses tu, lassé d’avance, mais celles là, celle là sont acérées et les croiser c’est ne pas vouloir les quitter, même quand tu arrive la dernière page. Alors songes y un moment, et laisse toi convaincre! / L’Accroissement mathématique du plaisir s'impose comme un véritable chef d'oeuvre, un page-turner: on ne veut pas le lâcher avant la fin et on est déçu d'avoir terminé la lecture, tant on en voulait plus encore. Un livre bouleversant, merveilleux, où l'on croise la féerie, la vraie, celle que le folklore nous conte (entre autres choses). En un mot, un must-have! / Ce livre est une vraie merveille, pareil à un breuvage à boire jusqu'à la lie. Les personnages sont extraordinaires, le style magnifique, et le propos d'une grande finesse. On en redemande, vivement la suite ! / quant aux nouvelles... que dire, sinon qu'elles vous transportent et vous envôutent, avec ces mots si bien choisis? / Ce livre est une perle, beaucoup de plaisir, la découverte d'une auteure d'exception, de personnage qui m'ont arraché rire, larme, une proximité que je n'avais jamais connu. Vous serez propulsez dans un monde sublime et engagé, bien plus qu'en livre, une rencontre. / Un excellent recueil, à l'écriture impeccable et à la précision novatrice. De la légende à la psychologie en passant par une esthétique à couper le souffle, L’Accroissement mathématique du plaisir nous offre une plongée littéraire de toute beauté. Il n'est ici pas question de héros musclés et stupides, ni d'elfes en plastique copiés et recopiés, mais plutôt de choix personnels, de destins à sacrifier ou à modifier... C'est extrêmement bien écrit et structuré, enfin voilà un livre comme on aimerait en lire bien plus souvent ! / Cette auteure manie de verbe avec brio et tisse des histoires au souffle ininterrompu tout au long du récit. Un univers à part, profondément lyrique et intensément profond, ce livre se lit comme l'on déguste une part de bonheur un soir d'été après l'orage. (Bon, là, je sais pas si ça s’applique très bien à Catherine Dufour, mais ça m’a paru indispensable.) / Catherine Dufour nous offre avec ce livre le plus bel ouvrage qu'il m'ait été donné de lire ... Son style inimitable sublime et magnifie les personnages et les lieux qui envahissent nos rêves et notre imagination ... Tout dans cette histoire est magique, fascinant, troublant ... N'hésitez plus une seconde et poussez la Porte de L’Accroissement mathématique du plaisir ... / Tout y est, l'univers, les personnages, une écriture magnifique...Vous serez emportés par ce recueil d'une beauté à couper le souffle! / Ce livre est résolument différent de la plupart des parutions actuelles, et c'est une agréable surprise que de lire autre chose que des histoires maintes fois ressassées et usées jusqu'à la corde. / Un livre enchanteresque qui vous emporte dans un monde que l'on a l'impression de voir, de palper, de sentir du fait de la perfection des descriptions. / une symphonie de couleurs qui n'a pas manqué de toucher mon petit esprit plus habitué à des paysages plus classiques. / Un recueil qui secoue, qui enchante, qui entraîne, on pleure, on rit, on a envie de se dépasser, de hurler, de danser, de sauter...Comme tous les écrits de Catherine Dufour, ce livre vous prend aux tripes et ne vous lâche *plus*. Incontournable! / Mortels qui désirez expérimenter le pouvoir de fascination de l’œuvre de Catherine Dufour, ce livre est pour vous! Loin des mignardises que l'on peut lire en ces temps sur le sujet […] Magie du style, puissance de l'imaginaire, profondeur de la réflexion et des sentiments, tout est réuni […] pour faire de ce chef-d'oeuvre une lecture qui ne vous laissera pas... de glace! (Bon, d’accord la chute est as très appropriée, mais bon…) / Un Recueil (je garde la majuscule de « Roman ») « Hors Genre » Qui m'a fait retenir ma respiration pour me donner un nouveau souffle. Vous ne serez pas décus par ce chef d'oeuvre. Des histoires à plusieurs niveaux de compréhension, des personnages à couper le souffle et le tout servi par l'une des plus belle plume que j'ai eu l'occasion de lire dans ma vie. Juste un chef d'oeuvre, n'hésitez pas. / Ce n'est pa un livre, c'est la VIE, tout ce que devrait être la vie, et donc l' ART.... Je vous le recommande, pas juste pour faire des ventes ( ce livre a rencontré un tel succès qu'il a été en rupture de stock 1 semaine après édition.. ) (heu, pour L’Accroissement mathématique du plaisir, j’en doute ; j’aimerais bien, mais j’en doute…) mais pour vous, L’Accroissement mathématique du plaisir est tout ce que devrait être un livre. Et il y a un avant et un après L’Accroissement mathématique du plaisir, ca je peux vous le garantir.... A lire, a offrir, a partager, a dévorer, bref enfin un livre à VIVRE. (Celui-ci est un de mes préférés, je crois.) / Les textes, eux, sont de vraies merveilles et surtout, ils vous prennent aux tripes, ils vous touchent au plus profond. Vous ne resterez pas de glace: L’Accroissement mathématique du plaisir, c'est de l'émotion à l'état pur, de la vérité, une révélation, de l'intensité. C'est à coup sûr LE livre à lire en ce début d'année (scolaire, on va dire ; mais n’oubliez pas Terreur, Vélum et Lilliputia) ! / où l'art et la vie se rejoignent comme ils devraient toujours le faire, dans la quête de sens, pour la chute, le crash, et la révélation. C'est une exploration, en mots, […] en échos et en reflets, des questions les plus douloureuses qui peuvent nous obséder, voire de celles que l'instinct de survie nous conseille de ne pas creuser. Vraiment un ouvrage magnifique et marquant, qui s'est trouvé une place d'honneur sur ma table de chevet, et au plus profond de moi. Tout simplement indispensable ! / Catherine Dufour nous a habitués à des livres toujours époustouflants. Mais avec L’Accroissement mathématique du plaisir, c’est encore plus fort!!! Ce livre est tout simplement incroyable, il nous emporte loin, toujours plus loin, nous bouleverse, nous émeut, nous renverse...Bref, c'est une expérience unique, à vivre absolument! Un livre qu'on ne va pas quitter facilement, ça, c'est certain... / A lire plusieurs fois ! / L'attente aura valu la peine, ce livre est totalement réussi. Une petite merveille, rare, unique même dont on ne peut que sortir ébranlé, dans sa vision du monde, dans sa perception de la vie ... N'attendez pas pour vous jeter sur (et dans) ce livre !
…
Vous hésitez encore là? Non mais...sérieusement!
D’autant que, zob, c’est bien écrit.
Quand même.



/image%2F1385856%2F20160114%2Fob_cfb8b0_caligari.jpg)





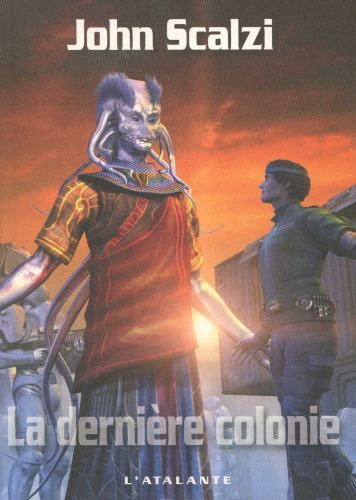







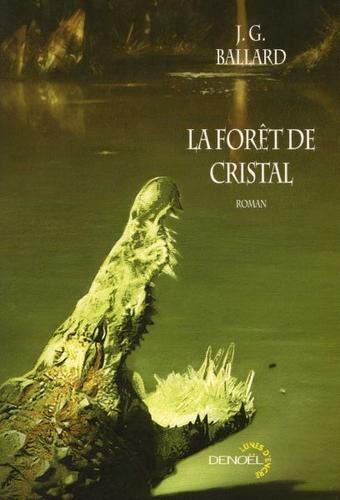





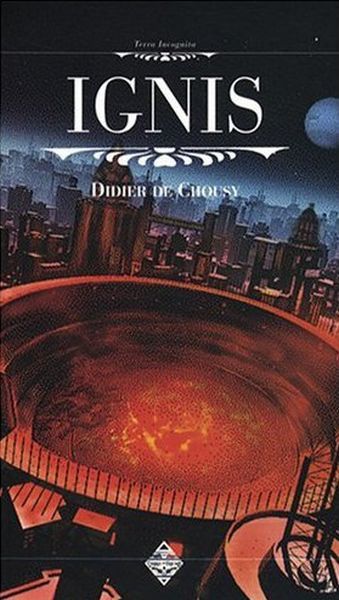

/image%2F1385856%2F20150204%2Fob_660a87_georges-abdaloff-croque-par-christell.jpg)