L'Appel de Cthulhu (V7) : Les Contrées du Rêve
L’Appel de Cthulhu (V7) : Les Contrées du Rêve, jeu de rôle par-delà le mur du sommeil, cinquième édition, Sans-Détour, [1963-1965, 1986, 1992, 1997, 2004, 2008, 2011] 2017, 284 p.
UNE BELLE BOÎTE
Sans-Détour est toujours plus à fond dans les financements participatifs, semble-t-il – et au point où c’en est parfois agaçant ? Je plaide coupable, je n’ai pas été le dernier à râler, ou au mieux à me montrer sceptique – et ce dès le trouvage-de-corbeau de la septième édition de L’Appel de Cthulhu, qui s’est pourtant avéré tout à fait pertinent (mea culpa, con de moi). En outre, j’ai l’impression que l’éditeur a su tirer les leçons d’expériences encore récentes, comme celle des 5 Supplices, avec sa mythique sacoche, pour s’en tenir désormais à du matériel utile, sans trop le parasiter de gadgets malvenus.
Et, ma foi, le crowdfunding dont je vais (commencer à) vous parler aujourd’hui, celui des Contrées du Rêve donc, un beau succès, était pleinement justifié, tout à fait intéressant, et a débouché sur une quantité appréciable de matériel pour un prix finalement tout à fait décent. C’est donc le premier de ces financements à m’avoir botté, et je ne regrette certes pas aujourd’hui d’y avoir participé – ce qui n’exclura bien évidemment pas des critiques dans le détail, hein. Précisons en outre que les délais ont été globalement tenus, ce qui est loin d’être toujours le cas en la matière : combien de financements participatifs rôlistiques qui végètent pendant des années… Je ne citerai pas de noms.
Mais j’ai donc reçu il y a quelque temps de cela un (très) volumineux colis contenant mon « édition Prestige » des Contrées du Rêve pour L’Appel de Cthulhu. Et c’était, ma foi, une très jolie boîte, avec plein de choses dedans, et globalement utiles – dont de très belles cartes, très grand format, et, si la lisibilité est peut-être parfois un peu problématique, j’avoue que le gigantesque poster de la carte des Contrées est absolument de toute beauté ; outre les aides de jeu préimprimées, et sur un format qui les rend lisibles (un beau progrès, combien de fois j’ai pu pester contre les aides de jeu de L’Appel de Cthulhu chez Sans-Détour trop sombres, illisibles et moches…), il faut mentionner un très bel écran adapté à ce cadre de jeu tout de même très particulier, et des cartes de « bestiaire », disons, fort jolies (en couleur, rigides), même si sans doute un poil gadgétoïdes – ceci dit, la seule chose totalement gadgétoïde dans tout ça est la p’tite clef d’argent, et, ma foi…
Mais l’essentiel, c’est que nous avons de la lecture – cinq livres, en fait. Et que je vais chroniquer séparément : cette présentation globale s’imposait sans doute, pour témoigner du contenu général de cette « édition Prestige », mais, à partir de maintenant, je m’en tiendrai au seul volume spécifiquement intitulé Les Contrées du Rêve, constituant plus ou moins une base pour tout le reste. En leur temps viendront les quatre autres suppléments, probablement dans cet ordre : Kingsport, la cité des brumes (contexte et scénarios), puis Le Sens de l’escamoteur (campagne), puis Murmures par-delà les songes (scénarios indépendants), et enfin La Pierre onirique (campagne – en notant que ce dernier livre, le plus court et par ailleurs le seul à ne pas bénéficier d’une couverture rigide, est un contenu exclusif de cette « édition Prestige », indisponible séparément et non numéroté).
EN FORME DE QUOI
Il y a beaucoup de choses à dire, à propos de cette cinquième édition des Contrées du Rêve, adaptée à la septième édition française de L’Appel de Cthulhu (vous suivez ?). Mais, avant d’aborder les complexes questions du genre « c’est quoi, les Contrées du Rêve ? » et « on y joue comment ? », et « pourquoi ? », il me paraît important de commencer par envisager les questions de forme – l’impact visuel, au premier coup d’œil, puis la qualité (?) de la traduction et de la relecture (oups, j’ai dit au moins un gros mot…).
L’impact visuel
Au premier coup d’œil, donc : oui, c’est beau. Ce volume d’un peu moins de trois cents pages est orné, comme les quatre autres bouquins, d’une très belle et très à propos couverture de Loïc Muzy (rigide, mais moins épaisse que dans la gamme de la sixième édition – pas plus mal, on ne se tue plus les bras en cours de lecture), ce qui constitue un ensemble à l’identité graphique pertinente et cohérente. Le livre, notons-le, ose un peu de couleur (c’est pas si courant chez Sans-Détour), dans un beau portfolio en milieu de volume (des variations sur le bestiaire des Contrées, reprises pour les jeux de cartes de « l’édition Prestige »), ainsi que dans les cartes des Contrées du Rêve et du Monde Souterrain des Contrées qui figurent en intérieur de couverture ; la lisibilité n’est peut-être pas irréprochable, donc (car la carte des Contrées, dans sa partie occidentale surtout, est très chargée, et les frontières et côtes du Monde Souterrain ne sont pas toujours aisées à identifier dans toutes ces ténèbres), mais c’est du beau boulot quand même.
Pour le reste, on revient au noir et blanc classique chez l’éditeur et dans la gamme, mais sur un papier de qualité supérieure, agréable à l’œil et au toucher. Les illustrations sont variées, pas irréprochables (j’ai notamment un souci avec celles reprises de produits Fantasy Flight Games, déjà un peu kitsch à la base, mais qui plus est alourdies d’un gros et vilain copyright qui bouffe tout…), mais globalement pertinentes – avec çà et là des reprises des éditions antérieures du supplément, mais globalement surtout du neuf, dans l’ensemble de qualité… en dépit de quelques fautes de goût occasionnelles, pas forcément le fait des seuls graphistes, cela dit – car témoignant du traitement « infligé » aux Contrées du Rêve par d’autres que Lovecraft, et notamment Brian « Indicible » Lumley, j’y reviendrai ; plus généralement, cela traduit le risque non négligeable de transformer les Contrées en un énième univers d’heroic fantasy, là où le matériau est bien davantage propice à d’autres approches de l’imaginaire fantastique, que l’on peut supposer plus pertinentes. Globalement, cela dit, c’est bien fait.
Par contre, j’avoue avoir été surpris par quelque chose – et c’est que ce livre est en fait parfois un peu austère. Comme de juste, la partie « bestiaire » (au sens très large : PNJ, monstres et dieux), est très abondamment illustrée, chaque « créature » étant dessinée (à l’exception des « dieux » pas spécifiques aux Contrées et déjà décrits et représentés dans le Manuel du Gardien ou dans le Malleus Monstrorum V7), et c’est globalement réussi, donc. Les scénarios sont quant à eux illustrés de manière tout à fait correcte, dans les standards de l’exercice, en faisant la part de l’utile et du superflu. Quand je parle d’austérité, c’est en fait dans le cas de la description géographique des Contrées : les deux gros chapitres que sont « La quête onirique de Randolph Carter » et « Index géographique des Contrées du Rêve », et qui comptent tout de même ensemble plus de soixante pages, sont très, très sobres... et peut-être un peu trop ? Disons qu’il y a un décalage entre le chatoiement des Contrées telles qu’elles sont décrites dans le texte, et leur illustration effective, rare et un peu terne. Alors on pourrait justifier ça par le fait que « par essence indescriptible », etc., mais, euh, je ne suis pas sûr que ça serait si pertinent que ça ? Un cas-limite : le chapitre consacré au « Grimoire des Contrées du Rêve » (soit quelques livres plus ou moins maudits, mais surtout une liste de sortilèges adaptés aux Contrées), certes pas si long, ne contient pas la moindre illustration… Entendons-nous bien, je pinaille sans doute, et je fais bien évidemment primer le texte sur le graphisme, en pareil cas. C’est juste que ça m’a… surpris ; et peut-être un peu déçu, oui, dans le cadre de pareille édition de pareil supplément ?
Le vrai problème à cet égard est en fait ailleurs – ou plutôt dans la conjonction entre cette relative sobriété et un autre principe de fabrication de ce volume : sa pagination en trois colonnes, relativement épuisante à la lecture. Là où les illustrations peuvent de manière générale aérer le propos et en rendre la lecture plus agréable, ce volume très resserré, très dense, a, dans les chapitres mentionnés, quelque chose de franchement fatiguant – peut-être encore aggravé par la nature d’ « index » de ces chapitres, déjà pas la plus propice à une lecture suivie. Ici, Les 5 Supplices m’ont trompé, peut-être – avec leur présentation très aérée, d’une lecture très agréable, que j’avais cru à tort constituer le standard de la septième édition de L’Appel de Cthulhu – je n’ai parcouru qu’ultérieurement le Manuel de l’Investigateur et le Manuel du Gardien. Pour le coup, cette pagination en trois colonnes ne me séduit vraiment pas, donc...
Pour conclure sur ce premier coup d’œil, un mot des annexes : on y trouve, et en pleines pages, les cartes des villes de Céléphaïs, Hlanith et Ulthar, assez jolies et lisibles (même si plus ou moins canoniques ? Sur la base des nouvelles de Lovecraft, et tout particulièrement « Les Chats d’Ulthar », j’ai toujours envisagé Ulthar comme un village, au mieux un petit bourg – pas ce genre de métropole marchande croulant sous les monuments cyclopéens ; mais bon…), outre les habituelles aides de jeu, mais donc sur un format plus grand et lisible qu’à l’intérieur du volume – un progrès appréciable.
Traduction et relecture… comme d’hab’ ?
Mais la question de la forme ne s’arrête pas là – il faut maintenant dépasser le stade du premier coup d’œil pour se plonger dans le texte, sinon encore dans le fond. Or la traduction et la relecture ne sont pas exactement les points forts de Sans-Détour, de manière générale…
Ici, ce qui frappe à mes yeux, c’est la disparité des situations. Les crédits mentionnent deux traducteurs, sans se montrer plus précis quant à leurs attributions respectives, mais j’ai quant à moi, peut-être à tort, eu l’impression d’une opposition entre la partie proprement contextuelle (et rarement technique) du supplément, et les six scénarios qui le concluent. Globalement, la première partie m’a paru d’honnête facture – certes pas irréprochable, néanmoins correcte (si l’on ferme les yeux sur quelques difficultés qui tiennent sans doute davantage à une relecture déficiente, et j’y reviendrai très vite). Par contre, les scénarios, dans l’ensemble, m’ont paru bien plus lourds et moches, perclus de répétitions et de maladresses diverses, parfois au point où le texte en devenait… disons, « obscur ». On a lu pire, sans doute – mais ça n’est jamais une excuse. Jamais.
Or ce problème est sans doute accru par une relecture guère plus soignée – même si, là encore, deux correcteurs sont mentionnés… outre la communauté du financement participatif, qui avait reçu les versions bêta des cinq volumes en .pdf, et qui est ici remerciée pour sa relecture bénévole (c’est pratique). Ou peut-être le problème vient-il de ce que tant de monde s’y est mis ? En effet, le principal souci, en l’espèce, ne porte peut-être pas tant sur la qualité de l’expression, les fautes de français, les coquilles, etc. (même s’il y aurait donc des choses à redire à ce propos, tout particulièrement concernant les scénarios), mais sur l’uniformisation.
Dans nombre de cas, on a en fait l’impression d’une correction insérée tardivement et sans grande attention, tout particulièrement en ce qui concerne les toponymes : une traduction se substitue à l’autre, car jugée finalement plus pertinente… mais en générant de nouveaux pains ? Et en oubliant parfois que le même toponyme, par exemple, se trouvait ailleurs dans le bouquin, y demeurant sous son ancienne forme…
L’exemple le plus flagrant concerne peut-être l’escalier onirique qui prolonge la Caverne de la Flamme où veillent les prêtres Nasht et Kaman-Thah – et il est évoqué plus qu’à son tour : on trouve presque systématiquement des choses du genre « la porte du plus sommeil profond », comme un mix malencontreux entre « la porte du sommeil le plus profond » et « la porte du plus profond sommeil », j’imagine (l’évocation de cet endroit mythique dans l’index géographique renforce cette hypothèse – avec les majuscules qui trinquent, de manière très visible).
Mais ce souci d’uniformisation de la traduction des toponymes est décidément un problème récurrent, et particulièrement visible quand on compare les termes employés dans le livre et sur la carte des Contrées du Rêve : très souvent, les deux divergent (c’est énorme) ; ce qui n’est pas forcément dramatique, mais tout de même guère sérieux, et, dans certains cas, même rares, ça ne facilite pas toujours l’appréhension de la complexe géographie des Contrées.
Quelques exemples, simplement en survolant l’index : « Vallée-Qui-Est-La-Nuit » et « Vallée de la Nuit », « Ville Où Il Ne Fait Pas Bon Entrer » et « Cité-Où-Mieux-Vaut-Ne-Pas-Entrer », « Gardiens des Terres Désolées » et « Sentinelles du Désert », « Mer Cérénarienne » et « Mer Cérénérienne », « Château de la Source Sacrée » et « Château du Bassin Sacré », « Grandes Montagnes Lugubres » et « Grandes Montagnes Blêmes », « Steppes d’Ossran » et « Steppes ossaraines », « Plaine des Blocs » et « Plaine des Rochers Éparpillés »… Liste non exhaustive (loin de là).
Je sais, il y en aura pour dire que ça n’est pas bien grave, et que de manière générale je pinaille, que j’abuse, tout ça – il y en a toujours. Je me souviens qu’on m’avait engueulé sur un forum, une fois, parce que je me plaignais de problèmes du genre, coquilles trop abondantes et incohérences diverses – on m’avait répondu qu’on s’en foutait, et que de toute façon faire une vraie relecture coûterait trop cher, alors déjà que les bouquins sont coûteux, hein, on n’allait pas en rajouter une couche pour la seule satisfaction perverse d’un grammar nazi (pardon : alt-write) dans mon genre, etc. Mais, bordel, livrer un produit fini, y accorder cette attention même minime, ça me paraît pourtant la moindre des choses ! Et d’autant plus au vu du prix du bouquin, en fait ! Et, que je sache, des traducteurs et correcteurs figurent dans les crédits de toute façon, il y en a déjà ! J’adorerais qu’on me tienne le même argument en littérature, tiens...
Mais bon, passons – comme d’habitude...
DE H.P. LOVECRAFT À SANDY PETERSEN (ET UN PEU AVANT, ET UN PEU APRÈS)
C’est qu’il est bien temps d’aborder le fond. Les Contrées du Rêve ? C’est une longue histoire…
Chez Lovecraft
À l’origine il y a Lovecraft… ou pas tout à fait ? Bon, pour l’heure, disons que si. On désigne par « Contrées du Rêve », pour l’essentiel, un « cycle » (c’est en fait assez contestable) de nouvelles composées par l’auteur durant les années 1920. Plus précisément, on considère généralement que le premier texte du « cycle » est « Polaris », écrit en 1918, et publié en 1920 ; suivent plusieurs autres nouvelles, disons entre dix et quinze (les avis divergent – c’est énorme, vous dis-je !), généralement assez courtes – et le « cycle » atteint son point culminant, et en même temps son point de non-retour, avec les textes du « cycle de Randolph Carter » (un éventuel « cycle dans le cycle » ; mais mieux vaut sans doute en exclure « Le Témoignage de Randolph Carter », comme on en exclut plus traditionnellement « L’Indicible »), que nous avons longtemps connu en France sous le nom de Démons et merveilles, et centré sur la nouvelle « La Clef d’argent » (1926) et le « roman » La Quête onirique de Kadath l’inconnue (1926-1927, publication posthume) ; du coup, l’ultime texte de l’ensemble serait « À travers les portes de la clef d’argent », en fait une « collaboration » (plus ou moins une « révision ») avec E. Hoffmann Price, en 1932-1933, qui fait une dernière fois figurer Randolph Carter.
Ce denier récit mis à part, comme de juste, nous sommes donc globalement dans un pan de l’œuvre de Lovecraft antérieur à la naissance du (plus que controversé) « Mythe de Cthulhu ». Et, de ce fait, parfois un peu dénigré ? Je crois que c’est en train de changer, petit à petit… Mais on y a longtemps vu une œuvre de seconde zone dans la bibliographie lovecraftienne – tout particulièrement, en fait, August Derleth, qui n’a jamais vraiment goûté La Quête onirique de Kadath l’inconnue, notamment. Mais, ici, le cas français est sans doute différent du cas américain : la parution de Démons et merveilles, via Jacques Bergier, dans les années 1950, parmi les premières traductions françaises de Lovecraft, a eu un impact non négligeable (même avec la traduction… « contestable »… de Bernard Noël : « Si long, Carter ! ») : il n’est qu’à regarder, dans le vieux Cahier de l’Herne consacré à l’auteur, le nombre de communications s’attardant sur le « cycle de Randolph Carter », ou même plutôt sur Démons et merveilles, tant c’était l’édition française qui était discutée avant tout. Finalement bien plus que sur Cthulhu et compagnie ? Mais je m’égare un peu...
Voilà pour les textes, très prosaïquement. Mais que sont les Contrées du Rêve, au-delà ? C’est une question plus compliquée qu’il n’y paraît… En fait, cette désignation même est éventuellement trompeuse – car la dimension onirique du « cycle », si elle constitue son appréhension classique et, sans ambiguïté, celle du présent supplément, n’est au fond pas si évidente que cela. Certes, les personnages de Randolph Carter et de Kuranes, entre autres, sont identifiés comme étant des « rêveurs » ; certes, le premier texte du « cycle », « Polaris » donc, évoque nommément un rêve, etc. Et, bien sûr, on est instinctivement tenté de faire référence ici à la pratique même de l’auteur, qui, dans les années 1920 tout particulièrement, prétendait souvent que ses nouvelles étaient inspirées de ses rêves – mais qu’il s’agisse des rêves chatoyants associés depuis à l’univers des Contrées, ou d’autres choses plus macabres et grotesques (comme « Le Témoignage de Randolph Carter », en fait, l’exemple le plus célèbre sans doute), des pérégrinations historico-fantaisistes (ainsi le fameux « rêve romain » dont Frank Belknap Long a tiré un récit sur la base de ce que Lovecraft lui en avait dit dans sa correspondance), ou des évocations plus abstraites et insaisissables (ainsi la très courte nouvelle « Nyarlathotep », que Lovecraft disait avoir écrite en dormant à moitié) ; or ces derniers textes, avec une ambiguïté malvenue pour « Le Témoignage de Randolph Carter », du seul fait du nom du protagoniste, ne sont généralement pas insérés dans le « canon » des Contrées du Rêve (généralement – mais certaines éditions américaines, qui voient large, les englobent dans cet ensemble, en incluant aussi quelques textes plutôt « décadents » comme « Hypnos » ; et il faut mettre l’accent sur un cas à part, une nouvelle qui fait office de « pont » : « L’Étrange Maison haute dans la brume » – j’y reviendrai bien sûr en traitant de Kingsport, la cité des brumes). Surtout, d’autres récits, cette fois intégrés dans le « cycle », ne mettent pas véritablement le rêve en avant : « La Malédiction de Sarnath », « Les Chats d’Ulthar », etc., sont des récits de fantasy qui n’impliquent pas nécessairement l’onirisme, à la base ; d’autres, enfin, ont un caractère allégorique marqué, ce qui n’est peut-être pas tout à fait la même chose qu’un rêve – ainsi, surtout, du « Bateau blanc », mais, à tout prendre, « La Clef d’argent », même en mettant en scène le rêveur Randolph Carter, relève plutôt de cette dernière catégorie.
Il y a pourtant un lien entre tous ces textes – et qui tient à l’univers qu’ils décrivent, même fluctuant et indécis. Si Sarnath ou Ulthar ne sont pas à la base des visions proprement oniriques, les récits des rêveurs les mentionnent très vite ; le voyage allégorique du « Bateau blanc », de même, introduit nombre de toponymes qui seront ensuite et rapidement repris par divers rêveurs ; et se constitue progressivement un ensemble complexe, fait de références intertextuelles, qui dessine petit à petit un univers cohérent (ou autant qu’il puisse l’être, j’y reviendrai...), entreprise parachevée par La Quête onirique de Kadath l’inconnue, qui rassemble et coordonne tout cela.
Mais s’agit-il à proprement parler d’un univers onirique ? Dans ce supplément de jeu de rôle, sans aucun doute, mais, chez Lovecraft, c’est peut-être un peu plus ambigu que cela. En fait, à tout prendre, la vaste majorité de ces récits ne semblent pas se passer tant dans un univers « parallèle » qui serait celui des rêveurs de la Terre, mais plutôt dans un passé antédiluvien (ce qui le rapprocherait de bien des œuvres de fantasy de l’époque, Âge Hyborien du copain Robert E. Howard inclus, ou certains des univers de l’autre copain Clark Ashton Smith). En fait, même dans « Polaris », premier texte du « cycle », et qui se présente délibérément comme étant un rêve, cette dimension est déjà sensible, cruciale même : la ville rêvée n’est en fait pas « ailleurs », mais surtout « avant » ; et, pour le coup, clairement sur Terre – sans quoi l’ultime allusion sur les esquimaux ne ferait tout simplement pas sens. Il ne s’agit donc pas tant, pour le narrateur, d’un rêve, que d’un souvenir – avec tout ce qu’il peut avoir de névrotique, même au travers de l’idée de « mémoire raciale » ou de métempsycose (que prisait particulièrement Howard, mais les récits de Lovecraft, et tout particulièrement celui-ci, le plus vieux des Contrées, sont antérieurs au début de la correspondance entre les deux auteurs – Howard avait alors douze ans, en fait… C’était un thème dans l’air du temps). Les noms de Sarnath et d’Ulthar, dans cette optique, et parmi d’autres, renvoient régulièrement, mais surtout dans les premiers textes du « cycle », à un passé antédiluvien bien plus qu’à un univers proprement onirique – ce qui justifie d’ailleurs leur mention dans des textes pas le moins du monde oniriques, de ces « contes macabres » qui constituent l’autre pan de l’œuvre lovecraftienne antérieure à « L’Appel de Cthulhu », contes qui n’ont le plus souvent pas été intégrés dans le « cycle », même entendu très largement.
Mais, certes, c’est là un monde magique, foisonnant de dieux, et qui défie les lois de la physique – notamment, c’est à vue de nez un monde plat et fini, où les océans, au-delà des grands piliers de basalte, se jettent dans le vide cosmique (qu’il arrive aux chats de traverser quand ils sautent sur la lune)… Du moins en cas de lecture au premier degré, mais c’est bien celle qui apparaît la plus pertinente à première vue. Je note, un peu gratuitement, que le « Légendaire » tolkiénien, certes pas encore publié, et à vrai dire à peine entamé alors, jouait cependant à la même époque de cette idée d’un lointain passé surnaturel, monde plat inclus, qui ne serait « courbé » que plus tard… Mais je m’égare à nouveau.
Trancher la question n’a donc rien d’évident – et ce serait sans doute un peu absurde, à vrai dire : la quête de la cohérence à tout prix dans les nouvelles de Lovecraft, c’est une des erreurs fondamentales de Derleth après la mort du gentleman de Providence…
Sans doute Lovecraft a-t-il bel et bien construit un univers, et le jeu intertextuel incite le lecteur à y entrevoir une forme de cohérence ; la poser comme un acquis, dans le cadre de ce supplément de jeu de rôle, est dans l’ordre des choses, et finalement guère problématique. Je crois cependant que garder à l’esprit cette ambiguïté fondamentale dans l’œuvre lovecraftienne au sens strict peut s’avérer utile ici – oui, même dans l’optique d’une partie de L’Appel de Cthulhu. Et que, finalement, les dimensions onirique et préhistorique ne sont pas nécessairement incompatibles – loin de là.
Avant, et après
Se pose toutefois une autre difficulté – typique, sinon de l’œuvre lovecraftienne, du moins de l’image qu’on en a longtemps véhiculé, et des nécessités d’une adaptation en jeu de rôle : c’est le problème de la délimitation, et tout particulièrement dans l’optique d’un « univers élargi », constitué par les apports successifs de plusieurs contributeurs, éventuellement fort différents (et plus ou moins talentueux...). Une fois n’est pas coutume, il faut donc envisager « l’après Lovecraft »… mais aussi, figurez-vous, un petit peu « l’avant Lovecraft ».
En effet, « avant », on ne peut pas faire l’économie de mentionner Lord Dunsany. L’aristocrate irlandais, essentiellement dans ses récits (très) courts, avait conçu avant Lovecraft plusieurs univers très proches des Contrées du Rêve dans l’esprit, comme Pegāna dans Les Dieux de Pegāna et Le Temps et les Dieux, puis des choses éventuellement moins précises et ordonnées, dans ses recueils suivants, tels L’Épée de Welleran, les Contes d’un rêveur (qui retiennent forcément davantage notre attention, ne serait-ce qu’en raison de ce titre – y figure notamment une nouvelle d’une importance cruciale, « Jours oisifs sur le Yann »…), et le « Bord du Monde » des deux « Livres des Merveilles ». Les mêmes questions se posaient déjà, quant à l’éventuelle dimension onirique de ces récits – même si elle n’est clairement mise en avant, a priori, que dans le cas des Contes d’un rêveur. Si l’on en croit Lovecraft, il avait rédigé le premier texte de son « cycle » des Contrées du Rêve, « Polaris », donc, avant de découvrir l’œuvre de Dunsany – pourtant, la parenté est flagrante. Mais Lovecraft fait bien vite cette découverte, ensuite ; elle le bouleverse profondément, et il ne s’en cache certes pas, semant même ses écrits ultérieurs d’allusions explicites – c’est vrai dès le deuxième récit du « cycle », « Le Bateau blanc », qui fait forcément penser à « Jours oisifs sur le Yann » (même en se montrant incomparablement plus sombre… et sans doute aussi plus lourd, aheum), influence essentielle encore mise en avant dans « La Malédiction de Sarnath », « Les Chats d’Ulthar », etc. Les deux œuvres ne coïncident pas parfaitement : les parfois très brèves vignettes de l’aristocrate irlandais, dans leur langue riche détournée de la Bible du roi Jacques, expriment plus qu’à leur tour un humour un peu tordu et parfaitement réjouissant, et l’accent est mis sur l’émerveillement ; chez Lovecraft, qui, dans ce contexte, ne rechigne pas au mode de la fable, l’horreur demeure toujours, au moins sous-jacente, et ce qui persiste de l’humour dunsanien prend probablement une tournure plus méchamment ironique… Mais la parenté est là, indéniable – on n’ira pas jusqu’à parler de plagiat, si l’influence ne fait bien vite aucun doute, mais la proximité des deux œuvres est saisissante. À n’en pas douter, un gardien désireux de se documenter en vue d’une campagne dans les Contrées du Rêve, et tout particulièrement en quête de pistes concernant l’ambiance de cet univers, aurait tout intérêt à lire Dunsany en sus de Lovecraft (en fait, tout le monde aurait intérêt à lire Dunsany, un immense artiste dont je déplore qu’il soit aussi marginalisé aujourd’hui…). Cependant, dans cette optique essentielle de délimitation, les auteurs du supplément Les Contrées du Rêve ont décidé de faire l’impasse sur la « préhistoire dunsanienne du cycle » : on ne trouvera pas, dans le présent ouvrage, ces villes chatoyantes telles que Bethmoora ou Carcassonne (pas celle que vous croyez), mais il y en a d’autres, les Céléphaïs ou Dylath-Leen, qui n’ont pas forcément grand-chose à leur envier ; Les Dieux de Pegāna y sont plus absents que jamais, mais d’autres divinités, positives ou pas, elles aussi délibérément ridicules le cas échéant, trouvent encore à danser sur des montagnes inaccessibles et à jouer de sales tours aux habitants des Contrées ; et, à défaut de naviguer sur le Yann, on pourra bel et bien descendre le Skai ou l’Oukranos – ce n’est pas si différent…
Ne pas inclure un auteur antérieur à Lovecraft dans le canon ainsi délimité était parfaitement cohérent. Mais qu’en est-il des œuvres parallèles et ultérieures ? Le cas est différent – et les solutions adoptées sont plus ou moins défendables. Mais c’est en fait le problème général du « Mythe de Cthulhu »…
On trouvera en tout cas dans ce supplément des éléments renvoyant à l’ami (de plume) de Lovecraft, et grand rêveur lui aussi s’il en est, que fut Clark Ashton Smith (au passage, je découvre seulement maintenant son œuvre, en raison d’un autre financement participatif, celui de « l’intégrale » de l’auteur – pas intégrale pour un sou – chez Mnémos, et je me prends une grosse, grosse baffe : c’est proprement excellent ! Je vous en causerai un de ces jours…). Dans ce cas, c’est tout à fait bienvenu. August Derleth, déjà un peu moins ?
Surtout, on trouve aussi, au rang cette fois des « disciples posthumes autoproclamés » (ou adoubés par un Derleth au goût plus que douteux en la matière), le redoutable Brian « Indicible » Lumley. Or ce tâcheron aimait visiblement beaucoup les Contrées du Rêve… Il leur a consacré de nombreuses nouvelles (rééditées récemment chez Mnémos), et son ridicule « cycle de Titus Crow », probablement bien pire (mais non moins réédité chez Mnémos...), y est lié par bien des aspects – en fait, il adopte pour point de départ la « révision » déjà bien dispensable « À travers les portes de la clef d’argent »... Tout cela est globalement d’un goût déplorable – au mieux une fantasy de base, plus lourde qu’enthousiasmante, au pire (et le pire est souvent de rigueur avec Lumley), une succession de viols littéraires parfaitement lamentables (gentille sœur de Cthulhu incluse, sauf erreur). Mais voilà : Sandy Petersen et compagnie ont tenu compte de « l’apport » considérable de Brian Lumley aux Contrées du Rêve, et en ont conservé un certain nombre de références. Bon : admettons-le, ainsi dilué dans l’ensemble du cadre de jeu, c’est sans doute moins nocif que « dans le texte » ; déjà, nous n’avons pas à subir son style désastreux… Certains de ces apports s’insèrent en fait correctement, au point de devenir presque invisibles, la patte Lumley ne les rendant finalement pas rédhibitoires ; d’autres sont hélas plus lourds, et opèrent une vague rupture de ton – ainsi d’un bizarre délire sexuel à base de termites vampires, oui… Mais libre à chacun d’en tenir compte ou pas.
Pour l’anecdote, un autre auteur postérieur à Lovecraft est très régulièrement mentionné ici, à l’origine de plusieurs apports contextuels, et il s’agit de Gary Myers – je ne crois pas l’avoir jamais lu, il faudra peut-être (il a semble-t-il beaucoup publié dans le fanzine de Robert M. Price Crypt of Cthulhu – du coup, rien d’étonnant à ce que ce soit plus obscur que Brian « Indicible » Lumley).
D’autres auteurs pourraient être mentionnés – dont Lin Carter, pas le plus talentueux là encore –, mais voici pour l’essentiel.
En littérature, du moins.
En jeu de rôle
Et en jeu de rôle ? C’est que, là aussi, Les Contrées du Rêve, c’est une vieille histoire. En fait, cela nous ramène aux sources mêmes de L’Appel de Cthulhu, avant même sa parution originale en 1981. En effet, au départ, Sandy Petersen était « simplement » censé écrire un supplément pour le jeu de rôle Runequest décrivant les Contrées du Rêve lovecraftiennes – l’approche était toujours celle d’un jeu de rôle de fantasy, voire plus précisément d’heroic fantasy. Finalement, le projet a été totalement chamboulé, et la fantasy éventuellement donjonneuse un temps remisée de côté pour déboucher sur le jeu d’investigation et d’horreur que vous savez – sans doute une révolution en son temps.
Pour autant, le cadre de jeu des Contrées du Rêve n’avait pas été totalement oublié : le supplément invitant à y jouer – et donc maintenant un supplément pour L’Appel de Cthulhu, non pour Runequest – paraît initialement en 1986, toujours orchestré pour l’essentiel par Sandy Petersen ; ce qui ne fait que renforcer son rôle dans la constitution d’un canon rôlistique de l’œuvre lovecraftienne (je vous renvoie au passionnant article de Tristan Lhomme dans Le Musée de Lhomme). Ledit supplément est traduit en français dès l’année suivante, chez Jeux Descartes. En anglais comme en français, le supplément, qui connaît quelques révisions occasionnelles, dont cette forme « définitive » conçue par Chris Williams, a semble-t-il acquis une forme d’aura « mythique » (aha) : il présentait assurément une manière différente de jouer à L’Appel de Cthulhu...
Toutefois, en France, les vieux suppléments Descartes étaient indisponibles depuis fort longtemps – des décennies, en fait… D’où ce financement participatif chez Sans-Détour – qui s’est avéré un gros succès, et tout le monde n’y croyait pas à la base.
Maintenant, il faut mettre en avant que ce supplément chez Sans-Détour n’est pas à proprement parler « nouveau ». En fait, sauf erreur, le seul contenu inédit, pour qui aurait encore ses vieux suppléments Jeux Descartes, réside dans le chapitre écrit par Tristan Lhomme sur la maîtrise dans les Contrées du Rêve (un ajout très bienvenu). L’approche globale de cette édition se voulait sans doute quelque peu « old school », ce qui est passé notamment par la reprise des six scénarios originaux – qui accusent éventuellement leur âge. Mais ça fait partie du charme… Cependant, je n’aurais pas été contre un chouia de réécriture – mais ça, j’y reviendrai plus tard.
DES QUESTIONS D’AMBIANCE
Mille et Une Contrées...
Mine de rien, ces longs développements sur la perception du contexte des Contrées du Rêve, chez les auteurs littéraires et chez les auteurs rôlistiques, ne suffisent probablement pas à apporter une réponse satisfaisante aux questions : « Quoi ? Pourquoi ? Comment ? ». Mais ils nous donnent des pistes – et j’en retiens avant tout que les Contrées ne sont pas plurielles pour rien. Ce sont, je crois, leur diversité, et leur souplesse, qui en font un cadre de jeu intrigant et fascinant. Le péril ultime consisterait sans doute à en faire un univers de fantasy comme un autre – à ce compte-là, les Contrées n’auraient finalement guère d’intérêt. Par contre, jouer sur l’ambiance, et sur les thèmes, s’avère autrement pertinent à vue de nez.
C’est ici, notamment, que l’article de Tristan Lhomme s’avère intéressant – jusque dans son caractère un peu frustrant, car, de manière délibérée, il s’agit d’y poser des questions, bien plus que d’apporter des réponses : à charge ensuite au Gardien (et à à ses joueurs aussi, en fait) de livrer une ou des lectures d’un univers par essence multiforme et fluctuant, même quand il semble baigner dans une douce léthargie atemporelle (ici – mais, non loin, il y a des monstres). L’article traite aussi de manière judicieuse de thèmes et procédés renvoyant d’une certaine manière à la note d’intentions : maîtriser dans les Contrées du Rêve, cela peut en effet impliquer de questionner le registre de la fable ou du conte, de la tragédie ou plus classiquement de la quête, ou d’envisager d’une manière subtilement différente (et éventuellement plus concrète) le maniement des archétypes autant que des clichés… En fait, ce contexte est propice à l’emploi d’effets narratifs particuliers, que la dimension onirique justifie, et qui ne trouveraient pas forcément leur place dans une partie « classique » de L’Appel de Cthulhu – ou moins instinctivement, disons ; par exemple en jouant sur le temps (en fait, c’est éventuellement un principe de base : le temps ne s’écoule pas de la même manière dans les Contrées – une partie naviguant entre Contrées et Monde de l’Éveil jouera presque nécessairement de ce contraste, à vue de nez), ou, j’imagine, sur le hors-champ (voir le scénario « Le Pays des Rêves Perdus »), ce genre de choses. Et Tristan Lhomme fait utilement appel à des rêveurs « d’un autre ordre » : il cite certes Lord Dunsany et Clark Ashton Smith, mais aussi Lewis Carroll, et, pourquoi pas, Denis Gerfaud…
D’ailleurs, en termes de jeu, l’approche des Contrées s’avère forcément différente selon, par exemple, que l’on fait un scénario opérant la bascule, éventuellement à plusieurs reprises, entre le Monde de l’Éveil et les Contrées du Rêve, ou un scénario se déroulant entièrement dans les Contrées du Rêve (c’est plus rare, mais en rien exclu) ; sachant d’ailleurs que d’autres bascules sont possibles, entre diverses Contrées (j’y reviens de suite après), ou, même dans le seul contexte des Contrées du Rêve de la Terre, entre la surface et le Monde Souterrain – un monde à part entière. Des personnages de « rêveurs » et des personnages « natifs » (des Contrées) n’auront par ailleurs pas le même rapport aux choses. Et les Contrées du Rêve de la Terre, bien loin d’exclure d’autres Contrées, les rendent nécessaires par cette seule dénomination – celles de Yuggoth, par exemple ? Sans même compter avec des variantes bel et bien « terrestres » mais pourtant très spécifiques, telles que l’Alcheringa des Aborigènes australiens (qui intervient sauf erreur dans Les Masques de Nyarlathotep), ou, décrits plus récemment, l’Empire des Ombres et le Rêve d’Opium des 5 Supplices ; en fait, il y a là limite un paradoxe… car, dans plusieurs des scénarios ici présents, les classiques Contrées du Rêve de la Terre cèdent assez vite la place à d’autres « Contrées », en miniatures (dans « L’Élève de Pickman ») ou de manière plus ample (dans « Les Voiles jaunes », pourtant le seul scénario « intégralement dans les Contrées du Rêve » de ce supplément)...
Mais peut-être n’est-ce pas un paradoxe – car l’essentiel est qu’il y a bien Mille et Une Contrées du Rêve. Dans la perspective ultra-onirique du contexte (qui n’est donc pas si évidente que cela, même si elle semble découler des partis pris de Sandy Petersen), on pourrait avancer qu’il y en a autant que de rêveurs ?
… Mais un socle commun
Mais le flou global n’est pas pour autant à craindre, car des éléments communs semblent subsister, constituant une base sur laquelle le Gardien et les joueurs pourront broder d’une manière unique. Quelques traits, dès lors, peuvent être mis en avant – au-delà de la géographie concrète de ces Contrées, que j’envisagerai un peu plus loin.
L’idée est d’abord celle d’un monde archaïque au point d’en être atemporel – en tout cas un monde d’avant la poudre et l’industrie, disons.
C’est un monde chatoyant, qui réjouit les sens par ses excès esthétiques – mais c’est aussi un monde où l’horreur n’est jamais bien loin, pouvant atteindre en fait des niveaux extrêmement rares : l’outrance est à mon avis un caractère essentiel des Contrées – proprement, il s’agit d’un monde de Démons et merveilles, un titre spécifiquement français, mais ma foi fort à propos.
C’est aussi un monde magique et divin : ici, on ne retrouve pas l’ambiguïté essentielle des autres récits lovecraftiens, et tout particulièrement des récits cthuliens ; dans les Contrées, les dieux (de vrais dieux, pas des entités extraterrestres simplement adorées comme tels) ont pleinement leur place – et, loin de n’être adorés que par quelques cultistes déments, ils s’inscrivent dans le quotidien d’un monde où leur réalité est tellement indéniable, tellement évidente, que la foi n’a aucunement besoin de se montrer démonstrative, étant à vrai dire d’une totale banalité ; ces dieux, d’ailleurs, ne sont pas systématiquement « maléfiques » (ou plutôt indifférents sur le plan cosmique) – c’est sans doute ici, et seulement ici, que les divinités « positives », les Nodens et les Bast, ou encore un Oukranos, ont leur place dans l’univers lovecraftien.
Et, dans cette lignée, la magie est à son tour une réalité palpable : moi qui suis globalement peu favorable à l’emploi de la thématique magique, ou, plus exactement, des sortilèges aux effets très concrets (en tout cas dans les mains des PJ), dans le Monde de l’Éveil, je ne peux qu’admettre qu’ils ont pleinement leur place et font pleinement sens dans les Contrées. En fait, il faut sans doute compter avec eux, de manière générale.
Sur la corde raide
Mais tout ceci n’est pas sans danger – car l’ambiance si particulière des Contrées, qu’il vaut mieux cultiver sous peine d’en faire un univers secondaire lambda et en tant que tel sans intérêt, est souvent sur la corde raide : plus encore que dans les récits « du Monde de l’Éveil » signés Lovecraft, la frontière est mince qui sépare le sublime du ridicule, et maîtriser dans ce contexte a quelque chose d’un redoutable exercice d’équilibriste.
Dans les Contrées, après tout, on peut voir l’armée des chats qui bondit des toits d'Ulthar pour gagner la lune ; on peut assister, voire participer, aux longues courses des goules dans le Monde Souterrain – quand on ne chevauche pas un zèbre pour écourter les distances à la surface. Les bateaux qui volent, admettons, mais les zoogs du Bois Enchanté sont déjà plus difficiles à gérer – et ceci sans même s’encombrer des termites vampires sexuelles de D’haz (merci Brian).
Pourtant, tout ceci – bon, peut-être pas les termites vampires sexuelles de D’haz… Presque tout ceci, donc, a son importance. Ces excès à la frontière du ridicule participent de l’ambiance des Contrées, mais aussi de quelque chose de plus profond, de plus intime, tandis que la dimension onirique de cet univers, si l’on entend la faire ressortir, justifie plus qu’à son tour l’emploi de procédés éventuellement surréalistes. Au fond, c’est ce qu’il y a d’amusant dans tout ça – mais à la condition classique de s’amuser avec le contexte, et pas du contexte.
Le dernier scénario de ce volume, « Le Pays des Rêves Perdus », en est à mon sens une bonne illustration – car, dans ses excès, et jusque dans sa dimension allégorique, assez intelligemment dérivée du « Bateau blanc », il n’est pas exempt d’un certain humour tordu, plutôt réjouissant au fond… jusque dans ses implications éventuellement déprimantes du grand finale. Mais gérer tout cela implique sans doute un certain savoir-faire de la part du Gardien comme des joueurs – et le scénario y insiste, d’ailleurs, et à bon droit, je crois.
Le chapitre sur la maîtrise dans les Contrées n’en est que plus important : il pose des questions qui peuvent paraître bien abstraites à vue d’œil, mais le fait de se les poser, et de s’y attarder un peu avant de lancer les hostilités, pourra faire toute la différence entre un grand moment de jeu et une énième itération de fantasy médiocre et plate, sans sève et sans âme, voire grotesque, mais au mauvais sens du terme...
UNE DIMENSION TECHNIQUE LIMITÉE (ET TANT MIEUX)
Les règles spécifiques aux Contrées du Rêve sont globalement très limitées – et tant mieux en ce qui me concerne. 10 %, nous dit la quatrième de couverture… qui monte à 110 % : This Is Dreamlands Tap !
D’autant plus en fait que les chapitres les exposant, et tout particulièrement le premier d’entre eux, contiennent en fait au moins autant d’éléments de contexte que d’éléments techniques – ainsi quand on fait le tour des différents moyens d’accéder aux Contrées, que ce soit effectivement en rêvant (avec la scène canonique de l’escalier et de la Caverne de la Flamme, j’y reviendrai en envisageant le premier « scénario » en fin de volume) ou en employant un portail pour y pénétrer physiquement, par exemple ; divers artefacts (dont une certaine clef...) et sortilèges sont également évoqués, permettant d’entrer dans les Contrées ou de les quitter.
C’est parfois un peu ambigu – il y a, dans l’ensemble du volume, comme une hésitation concernant la règle autorisant ou non le franchissement de la Caverne de la Flamme, impliquant dans sa forme la plus rigide un score de SAN + Mythe de Cthulhu supérieur ou égal à 75, ce que je trouve démesurément élevé – certes, les rêveurs sont censés être rares, mais une règle trop stricte à cet égard me paraît inutilement pénalisante. Le cas de la mort onirique est globalement plus clair, mais non sans ambiguïtés là non plus, à en juger par certains scénarios de ce volume.
Mais les éléments proprement techniques sont donc très limités, et répartis en trois chapitres. Dans le premier, qui évoque les généralités que je viens de mentionner, il faut surtout retenir ce qui concerne les deux « nouvelles Compétences » que sont Rêver et Savoir Ès Rêves, ainsi que la table des Effets de Cauchemar, qui constitue une variante onirique des épisodes de folie temporaire.
Plus loin dans le volume, un bref chapitre (et particulièrement austère) est donc consacré au « Grimoire des Contrées du Rêve » ; il comprend nombre de sorts spécifiques aux Contrées, ou déjà vus ailleurs, dans le Manuel du Gardien en principe, mais qui fonctionnent ici différemment. Comme dit plus haut, le rapport à la magie n’est nécessairement pas le même dans les Contrées du Rêve et dans le Monde de l’Éveil ; dès lors, j’y ai attaché davantage d’importance : ici, ce genre de magie fait bien davantage sens, même et surtout dans les mains des PJ.
La dernière partie technique est reléguée dans les annexes, étrangement (ou pas). Elle donne les règles adaptées à la création d’un personnage natif des Contrées du Rêve, ce qui implique notamment de repenser nombre de Compétences, et tout particulièrement celles d’ordre académique, scientifique ou technique. C’est simple et clair, rien à redire.
LA GÉOGRAPHIE ONIRIQUE
Et nous en arrivons (enfin, oui, j’ai un peu flâné en chemin…) au gros de l’ouvrage, que l’on peut scinder en trois grosses parties. La première porte sur la géographie des Contrées du Rêve, et se répartit en deux gros chapitres (éventuellement austères, disais-je), « La quête onirique de Randolph Carter » et « Index géographique des Contrées du Rêve », qui couvrent un peu plus de soixante pages bien tassées. La deuxième partie porte sur ce que l’on qualifiera globalement les « rencontres », en trois chapitres : « Les personnages des Contrées du Rêve », « Bestiaire des Contrées du Rêve » et « Les dieux des Contrées du Rêve » ; ensemble, ces trois chapitres comptent environ 70 pages, très abondamment illustrées et aérées, cette fois. Enfin, la troisième et dernière partie rassemble six scénarios (ou cinq et demi…), pour quatre-vingt-dix pages environ.
La géographie des Contrées du Rêve est forcément un peu problématique, car elle implique de figer et coordonner des choses qui ne le sont pas chez Lovecraft, bien sûr ; elle est donc en tant que telle une extrapolation, par nature contestable. En tant que telle, elle est donc envisagée sous deux formes différentes. La première s’intitule « La quête onirique de Randolph Carter », et c’est un récit suivi, long et dense, sans intertitres par ailleurs – une vingtaine de pages très resserrées, donc. Unique élément de typographie qui permet de s’y repérer : les lieux, créatures, etc., sont en gras quand on les développe un tant soit peu. À la base, il s’agit d’une reprise du « roman » de Lovecraft La Quête onirique de Kadath l’inconnue, à mi-chemin entre le résumé et la paraphrase – sauf qu’il y a en fait un peu plus que ce matériau précis qui est développé : chaque rencontre faite par Randolph Carter débouche le cas échéant sur des développements empruntés à d’autres récits des Contrées du Rêve, éventuellement mentionnés à la hâte et guère plus dans le roman – la rencontre des chats renvoie tout naturellement aux « Chats d’Ulthar », les personnages récurrents tels que Kuranes ou Atal renvoient à leurs propres récits tels « Céléphaïs », « Les Chats d’Ulthar » à nouveau ou « Les Autres Dieux », etc. En survolant simplement ce chapitre très dense, j’avais un a priori plutôt négatif – en fait, ça me paraissait le pire moyen de présenter les Contrées dans une perspective rôlistique, et non proprement narrative… Après lecture, je me suis demandé si ce n’était pas en fait le meilleur moyen de procéder ! Le fait est que, en dépit de sa densité, ce texte est d’une lecture agréable, et il est de toute évidence très bien conçu. L’atout de cette méthode est sans doute d’appuyer sur l’ambiance d’une manière qu’un index, brutal par essence, ne pourra jamais utilement développer.
Mais ce chapitre doit tout de même être envisagé avec l’index qui suit, donc – c’est la conjonction des deux approches qui permet de vraiment se mettre dans le bain des Contrées du Rêve. L’index est long et dense, mais a un abord évidemment plus pratique que le chapitre précédent. Il opère un classement alphabétique selon plusieurs régions : en surface, on distingue l’Est, le Nord, l’île d’Oriab, les mers, et enfin l’Ouest (de très loin la région la plus peuplée et riche en histoires des Contrées – au point où la carte devient difficilement lisible parfois) ; une deuxième partie englobe « les autres lieux », qui sont le Monde Souterrain (avec sa propre grande carte en couleur), la Lune (eh oui – c’est qu’elle joue plusieurs fois un rôle important, la demoiselle), et, très succinctement, « les mondes au-delà » - en fait, trop succinctement pour qu’on puisse en tirer quoi que ce soit de très utile sur cette seule base… Mais on y évoque entre autres Alcheringa, la Cathurie, la Cour d’Azathoth (allons bon), ou encore Sarrub et Yundu, qui seront toutes deux développées dans le scénario « Les Voiles jaunes », plus loin dans ce volume.
Cette dernière réserve mise à part, et en rappelant pour la forme le souci d’uniformisation que j’avais mentionné plus haut (c’est ballot pour l’ordre alphabétique, parfois), cet index est bien conçu : il en dit généralement assez sans en dire trop, et il est directement utile mais pas au prix de sacrifier les considérations d’ambiance. Un beau boulot, donc, même si je suis persuadé qu’il aurait bénéficié d’une bonne couche de relecture pour assurer davantage encore la cohérence de l’ensemble (si « cohérence » est le bon mot). L’aperçu qui nous est ainsi fourni des Contrées du Rêve sous leurs divers avatars est riche d’idées réjouissantes, et pouvant presque tout naturellement déboucher sur des scénarios.
PLEIN DE NOUVEAUX AMIS
Les trois chapitres qui suivent portent donc sur les rencontres que les PJ peuvent être amenés à effectuer durant leur périples dans les Contrées du Rêve.
Le premier concerne, disons, les PNJ – sous-entendu, en principe pas divins, en principe pas monstrueux (au sens tentacules et yeux nécessairement globuleux). Je ne garantis pas que ce soit d’une utilité folle, mais c’est très amusant à la lecture, même avec ses graphismes « old school » empruntés à l’édition originale du supplément, il y a de cela… longtemps. L’amateur de Lovecraft prendra plaisir à y croiser quelques personnages emblématiques, tels Atal, le grand prêtre d’Ulthar, le gardien de phare Basil Elton, les prêtres de la Caverne de la Flamme Nasht et Kaman-Thah (qui auraient peut-être davantage eu leur place du côté des divinités, mais ça se discute), les rêveurs d’exception Kuranes et Randolph Carter, ou l’artiste Richard Upton Pickman devenu goule… Il y a aussi des personnages extérieurs à Lovecraft, certes – dont l’Eidolon Lathi, la termite vampire sexuelle en chef (merci Brian)… Mais c’est tout de même un chapitre amusant – et je suppose qu’il pourrait, sans garantie, mais il pourrait, oui, s’avérer utile.
Suit le plat de résistance, un gros bestiaire comprenant quatre-vingt bestioles, des enfants d’Abhoth aux zoogs. On y retrouve quelques bébêtes classiques de L’Appel de Cthulhu, mais éventuellement très adaptées dans le contexte des Contrées du Rêve – ainsi les goules, d’ailleurs idéales pour faire le pont avec le Monde de l’Éveil. Et, bon, les chats des Contrées appellent bien quelques précisions… L’essentiel est cependant constitué par des créatures « inédites », même si pas nécessairement spécifiques aux Contrées pour autant. De manière générale, je ne suis pas fan de bestiaires, hein… Cela fait une éternité, en fait, que je n’ai pas maîtrisé un jeu de fantasy (disons…) où ce genre de développements peut se montrer vraiment utile, et, même à l'époque… Maintenant, même avec son ambiance si particulière, le fait est que les Contrées du Rêve sont un univers de fantasy, et qu’à tout prendre la probabilité de rencontrer ce genre de bestioles y est autrement élevée que dans le Monde de l’Éveil. Donc, oui – cela fait sens. Mais la vraie bonne surprise est que ce bestiaire, aéré et abondamment illustré, est d’une lecture agréable – c’est bien avant tout un index dans lequel picorer, mais une lecture suivie n’est pas inenvisageable, et les quelques éléments avancés à chaque fois concernant l’écologie ou plus généralement le mode de vie de ces créatures, éventuellement leurs origines ou leur biologie, suffisent à susciter et entretenir l’intérêt du lecteur : bon boulot, donc.
Dernière partie dans ce registre : les dieux ! Au nombre de 29… mais c’est un nombre trompeur, car il y a un certain nombre de reprises des classiques du domaine, figurant dans le Manuel du Gardien et le Malleus Monstrorum (V7). En tant que tels, ceux-ci n’appellent guère de développements : un ou deux paragraphes sur leur rôle spécifique dans le contexte des Contrées du Rêve, c’est bien suffisant – même pour Nyarlathotep, qui y a tout de même une place notable, et dont quelques « masques » sont envisagés. C’est un peu comme pour le bestiaire qui précède, d’une certaine manière : ces descriptions plus détaillées de divinités font davantage sens dans les Contrées, où leur réalité est palpable par tout un chacun, que dans le Monde de l’Éveil. Cette réalité, par ailleurs, est le plus souvent pleinement divine, sans déformations, comme c’est le plus souvent le cas de par chez nous. À la limite, même la nomenclature complexe (et à mon sens absurde dans tout autre cadre) distinguant Grands Anciens, Dieux Très Anciens, Dieux Extérieurs, etc., peut faire sens dans ce contexte. Et, enfin, on y trouve bien davantage de divinités « gentilles », comme Oukranos, etc., qui seraient totalement hors-sujet de l’autre côté du mur du sommeil, mais qui sont bien loin de l’être dans le contexte des Contrées. Bien évidemment, tout cela est à manipuler avec précaution – il ne s’agit pas d’en faire un répertoire d’ultra-streumons à rencontrer par le menu… Comme dans le Malleus Monstrorum, quoi – et, comme dans ce dernier, pour le coup, leur attribuer des caractéristiques n’est pas forcément très pertinent… même si, à la lecture, ça peut s’avérer rigolo ! L’essentiel est heureusement ailleurs – dans la description, dans le culte, etc.
Et voici pour le contexte et la technique. Maintenant ? Place à l’aventure...
À L’AVENTURE
Les Contrées du Rêve comprend six scénarios, chacun dû à un auteur différent. Ce sont des scénarios qui datent un peu, par ailleurs, issus des éditions antédiluviennes du supplément… Ce qui peut avoir son charme (« old school, people, old school ! »), même si ça sent parfois un peu trop la poussière, peut-être…
Attention, il n’est pas exclu que je SPOILE comme un porc ; en fait, c'est même certain. Un rêveur averti en vaut deux...
Dormir, et pourquoi pas rêver
Le premier scénario s’intitule « Dormir, et pourquoi pas rêver » (une ligne empruntée à Shakespeare, ai-je cru comprendre), et il est dû à Jeff Okamoto. Mais s’agit-il vraiment d’un scénario ? J’en doute, et pas qu’un peu… Ce très bref épisode tient plus de l’aide de jeu qu’autre chose – pas malvenue cela dit, car elle constitue un moyen d’introduire « dans les formes » des PJ du Monde de l’Éveil dans les Contrées du Rêve.
En effet, l’essentiel du soi-disant scénario consiste en un rendu précis et canonique de la descente par les rêveurs des soixante-dix marches les conduisant à la Caverne de la Flamme, puis au-delà… s’ils le méritent. C’est que Nasht et Kaman-Thah leur posent les questions habituelles, mais jaugent aussi le problématique niveau de SAN + Mythe de Cthulhu nécessairement supérieur à 75 pour passer… Au-delà, pour ceux qui ont cette chance, les 700 marches du sommeil plus profond – qui, classiquement, débouchent dans le Bois Enchanté, avec ses zoogs curieux. Les précisions s’arrêtent là, mais le « scénario » est censé se prolonger par un petit voyage vers Ulthar, où les PJ doivent retrouver l’homme qui les a attirés ici – en mourant dans le Monde de l’Éveil.
Pas un scénario, non – mais, en tant qu’aide de jeu, je suppose que cela fait sens.
À noter, par contre : cette approche me paraît particulièrement adaptée pour un jeu en solo – et nous en avons à vrai dire d’autres exemples par la suite, et même immédiatement.
Captifs de deux mondes
« Captifs de deux mondes », écrit par Sandy Petersen himself, est cette fois bel et bien un scénario… mais pour le coup tellement classique qu’il en a presque quelque chose d’un type idéal (ou d'une caricature, en fonction de comment vous êtes lunés).
Les PJ (ou le PJ : dans la présentation du scénario, on avance donc qu’il devrait bien fonctionner en solo) se rendent dans le petit hameau de Bensamin, dans le Vermont, tellement ultra-dégénéré que Dunwich, en comparaison, constitue le pinacle de la civilisation et de l’hygiène sociale. Comme de juste, le seul type, là-bas, à avoir l’air « normal » s’avère en fait un bon million de fois plus guedin que tous les autres – et foncièrement maléfique : il a son plan diabolique pour littéralement remplacer l’espèce humaine ! Passé cette mise en jambes über-conventionnelle mais potentiellement goûtue, surtout si on gère bien l’ambiance de dégénérescence white trash (je serais à vrai dire tenté d’en rajouter des caisses – sans garantir que ce soit pertinent), les choses… eh bien, dégénèrent un peu plus ?
D’une manière ou d’une autre, les PJ doivent être faits prisonniers par le Grand Méchant et ses zélés serviteurs consanguins – mais pas avant que l'Odieux ait lâché, paf, comme ça, dans la conversation, le nom de « Céléphaïs »… Et les investigateurs doivent donc comprendre que le bonhomme est un rêveur, fréquentant notamment la ville du roi Kuranes – ce qui implique à vue de nez qu’ils sont eux aussi des rêveurs, et c’est plus d’une fois le cas dans les scénarios compris dans ce volume.
Les PJ prisonniers sur Terre doivent donc « s’évader » dans les Contrées du Rêve, et trouver à disposer là-bas du Connard de sorte qu’ils puissent être libres à nouveau dans le Monde de l’Éveil. Le scénario, qui semble prendre un certain plaisir à envisager que les PJ soient « assez stupides pour faire ça », « trop stupides pour comprendre que », etc., appuie bien sûr sur le fait que tuer l’Oncle Maléfique dans les Contrées n’est absolument pas une solution, puisqu’il serait toujours vivant dans le Monde de l’Éveil – et d’autant plus en rogne que les PJ l’auraient ainsi privé de sa friandise onirique. Que faire, alors ? Le scénario est cette fois assez libre – même si la probabilité que Kuranes lui-même soit le mieux placé pour arranger les choses est un brin appuyée. Corollaire : non seulement les PJ doivent être des rêveurs expérimentés, mais en plus ils doivent figurer dans les petits papiers du roi ? Mf.
On peut sans doute en tirer quelque chose – et des joueurs inventifs seront probablement à même de trouver une solution narrativement et ludiquement intéressante à cette affaire autrement bien banale. J’ai quand même trouvé ça un peu trop plat, mais, ma foi, peut-être...
L’Élève de Pickman
On passe à mon sens à quelque chose de bien plus roboratif avec le scénario suivant, bien plus long par ailleurs, « L’Élève de Pickman », écrit par Keith Herber. C’est en tout cas un scénario très riche, surtout comparé au précédent ; en même temps, il pèche peut-être justement dans cet atout ? Car il peut facilement donner l’impression d’un patchwork, ce qui peut pourrait nuire à l’immersion et à l’ambiance, je suppose – ou pas…
Là encore, mais tout à fait expressément, les PJ sont supposés être d’ores et déjà des rêveurs expérimentés quand débute l’aventure.
Les investigateurs font la connaissance d’un disciple du fameux peintre Richard Upton Pickman. Enfin, la « connaissance »… Pas vraiment, puisque ledit élève est dans le coma – et se transforme jour après jour davantage en un monstre horrible ! C’est qu’il est coincé dans les Contrées du Rêve, et que le Grand Ancien Ghadamon en use comme d’un portail pour gagner le Monde de l’Éveil… Petit souci éventuel : c’est peu ou prou également le point de départ du « Pays des Rêves Perdus », le scénario qui conclut ce volume.
Quoi qu’il en soit, sur un mode qu’on dirait peut-être aujourd’hui « jeu-vidéo », les PJ doivent d’abord enquêter de ce côté-ci du mur du sommeil, en se lançant sur la piste de quatre tableaux peints par le gloubiboulga en puissance. C’est ici que l’aspect « patchwork » est le plus marqué, sans doute – mais peut-être faut-il s’en accommoder, car cette enquête est l’occasion de rencontrer des PNJ très amusants (mon chouchou est Jacob le fou), mais aussi de vivre des « mini-immersions » dans des « poches » de Contrées du Rêve, une par tableau – mais, à vrai dire, ces « poches » n’ont vraiment pas grand-chose de commun avec ce qui est décrit dans ce supplément… Nous avons droit à une virée sur Yuggoth (avec à la clef une scène horriblement drôle et drôlement horrible, gaffe à l’ambiance), une autre dans une New York morbide envahie par les goules (sans doute la « poche » la plus « pragmatique » du scénario, voir plus loin), une autre encore dans un lieu indéterminé mais qui ressemble énormément à la chambre du comateux, lit à baldaquin inclus (ce qui peut là encore déboucher sur un beau cauchemar), une dernière enfin… à R’lyeh, Grand Cthulhu inclus (et ça, pour le coup, ça me paraît totalement malvenu).
Puis les joueurs se rendront « véritablement » dans les Contrées du Rêve telles que décrites dans ce supplément. Le scénario se montre d’abord ici très libre, il lâche en fait totalement la main du Gardien, lequel est incité, avec ses joueurs, à broder ensemble pour produire une jolie quête, avec un (éventuellement très) long périple dans cet univers fantasmatique, impliquant en tout cas à terme le Monde Souterrain – et ses goules, dont, bien sûr, Pickman lui-même (le tableau new-yorkais peut donc être un moyen d’abréger radicalement tout ça, à voir ce qui est le plus pertinent).
Par la suite, le scénario propose des scènes très intéressantes sur le papier, à base de cimetière très, très mal fréquenté et de forêt de champignons, mais, attention, ces passages sont assez mortifères… Et j’ai l’impression qu’il y a ici une ambiguïté ? Normalement, un personnage qui meurt dans les Contrées ne peut plus y retourner, c’est la règle de base – mais ces scènes, et surtout celle du cimetière, semblent envisager plusieurs tentatives successives, en dépit de l’issue fatale de la première et éventuellement au-delà ?
En fait, on touche là à un problème plus général du scénario – qui aurait bien bénéficié d’une bonne relecture, et si ça se trouve en anglais comme en français : en plusieurs occasions, il ne se montre « pas très clair », ou en tout cas moins qu’il le devrait… Peut-être y a-t-il aussi quelques incohérences ? J’avoue avoir été surpris par cette traduction du Livre d’Eibon mentionnant « Aegyptus » (pour le symbole de l'ankh), alors que l’original est censé être antédiluvien… À moins que cet « Aegyptus » désigne un état antédiluvien de l’Égypte ? Ou qu’il faille y voir une « facilité » de cette traduction anglaise du vieux grimoire ? Vous vous en foutez ? Vous avez sans doute bien raison, mais, que voulez-vous, on ne se refait pas…
Ceci mis à part, j’ai apprécié ce scénario – sans doute en fait le plus intéressant à mes yeux… avec « Le Pays des Rêves Perdus » ; c’est bien pour cela que je trouve un peu fâcheux qu’ils empruntent exactement le même point de départ ou peu s’en faut…
Mais, à condition de bien travailler l’ambiance et de gérer adroitement le patchwork, je suppose qu’il est tout à fait possible d’en tirer quelque chose de très intéressant.
La Saison de la sorcière
Ce n’est pas le cas, à mon avis, concernant « La Saison de la sorcière », scénario dû à Richard T. Launius, que j’ai trouvé fort peu à mon goût.
Ce scénario, comme son nom le laisse assurément entendre, s’inspire énormément, et c’est peu dire, de la nouvelle de Lovecraft « La Maison de la sorcière ». Et ça pose un petit souci de contexte : en effet, on y pompe la nouvelle, donc, mais en y introduisant des variations en fait incompatibles – la sorcière, dont le nom diffère, est morte exécutée, et non disparue ; la maison maudite existe, mais ce n’est pas la même – même si l’immigré polonais qui s’en occupe porte bel et bien le même nom ; le locataire de la mansarde n’est pas le curieux étudiant en mathématiques que nous savons, mais une étudiante en histoire à la même Université Miskatonic, etc. Vous me dites que ce n’est un problème que pour les maniaques dans mon genre ? Vous avez sans doute tout à fait raison. Mais cette incompatibilité avec la nouvelle, pourtant peu ou prou plagiée, se double du coup d’une incompatibilité avec le contenu du supplément consacré à Arkham, postérieur à ce scénario. Bien évidemment, ça ne poserait éventuellement problème que dans le cadre d’une campagne à Arkham, et précise encore : en one-shot, ça n’a sans doute rien d’un souci… Mais un chouia de réécriture aurait peut-être permis d’aboutir à un ensemble plus cohérent ?
Décidément, vous vous en foutez ? OK – disons que moi aussi, alors. Mais le vrai problème est ailleurs – et c’est, comme dans « Captifs de deux mondes », le classicisme extrême de ce scénario noyé sous les toiles d’araignée… L’implication est un peu trop artificielle (défaut récurrent de L’Appel de Cthulhu, certes). L’enquête à Arkham est à vue de nez des plus mollassonne, et la référence à la nouvelle n’arrange rien à cet égard (oui, d’accord, j’arrête !). Comme dans le scénario de Sandy Petersen, une référence aux Contrées du Rêve (cette fois Dylath-Leen) tombe au bout d’un moment comme un cheveu sur la soupe, et elle doit parler aux PJ (donc là encore des rêveurs expérimentés), qui n’ont d’autre choix que de s’y rendre. Comme dans « L’Élève de Pickman », le scénario laisse ici une certaine marge au Gardien et aux joueurs pour faire mumuse avec les Contrées, mais en imposant toutefois quelques éléments guère convaincants, à la limite de la grosse artillerie heroic fantasy, j’ai l’impression, avec moult rencontres de vilaines bébêtes et sortilèges… Sauf qu’en l’état ça m’ennuie plus qu’autre chose.
Je ne prétendrais pas forcément que ce scénario est à proprement parler « mauvais », il est avant tout (trop) « classique », mais en tout cas il ne m’a jamais donné l’envie de le faire jouer – alors...
Les Voiles jaunes
On passe à tout autre chose avec « Les Voiles jaunes », scénario de Phil Frances à part dans ce volume, puisque le seul qui se déroule entièrement dans les Contrées du Rêve – en notant cependant que les personnages ne sont a priori pas des « natifs » pour autant, puisque la raison avancée pour les impliquer dans tout ça est qu’ils sont « différents » des autres, et donc, sous-entendu, de ces rares « rêveurs » qui visitent les Contrées…
C’est pourquoi un personnage non humain, un Sarrubien vieux de dix mille ans et longtemps réduit en esclavage, vient expressément leur proposer une quête : il s’agit de retrouver deux de ses semblables, peut-être les derniers de leur espèce, et de les libérer de leur sort tragique – et peut-être à la clef de ressusciter tout un monde aimable et qui leur en saura gré ? Ça n’a rien d’une certitude, tout dépendra bien sûr des actions des joueurs, mais le scénario semble privilégier un dénouement aussi heureux que possible – ce qui n’est pas forcément la norme en matière de lovecrafteries, hein.
Dans l’absolu, c’est une bonne idée, mais je n’ai pas été vraiment convaincu par son traitement. Pourtant, le point de départ est plutôt intéressant – notamment avec le cycle biologique complexe des Sarrubiens (même si j’ai l’impression que les fiches façon « bestiaire » ne respectent pas tout à fait le cycle tel qu'il est décrit en encart ?). Mais, en l’état, le scénario est un peu trop posé sur des rails – d’autant que le compagnon de nos héros est censé, cette fois, les inciter à ne pas lambiner en chemin, contrairement à ce qui se produisait dans la plupart des scénarios précédents. Par ailleurs, le scénario « purement dans les Contrées du Rêve », passé un premier temps tout à fait intéressant, délaisse en fait les Contrées du Rêve de la Terre pour envisager, mais bien trop hâtivement en l’état, les autres Contrées de Sarrub (OK, pas mal) et Yundu (ces dernières n'ont hélas absolument aucune âme)…
Tout ceci, donc, en l’état – les retours agacés sur ma chronique des 5 Supplices m’incitent à préciser ce qui me paraissait acquis : bien sûr, c’est au Gardien et aux joueurs de s’accaparer tout ça pour en tirer quelque chose d’intéressant – c’est sans doute faisable. Mais il me semble qu’une critique doit d’abord porter sur ce qui est concrètement proposé par le texte – si cela n’exclut bien évidemment pas un travail d’adaptation sans doute nécessaire ultérieurement. Et, sur le papier, ça ne m’emballe pas – je suis fainéant, ça doit être ça.
Le Pays des Rêves Perdus
Ultime scénario de ce supplément, « Le Pays des Rêves Perdus » est sans doute le plus déconcertant. Son auteur n’est bizarrement pas mentionné dans les crédits (un oubli…), mais le camarade Cube Gélatineux m’a expliqué qu’il s’agissait de Mark Morrison. En farfouillant un peu sur le ouèbe, j’ai lu çà et là de très bons échos concernant ce scénario : il semble en avoir marqué plus d’un, et d’aucuns vont jusqu’à le citer comme faisant partie des tout meilleurs de l’ensemble de la gamme de L’Appel de Cthulhu. Mais avec aussi cette remarque, soulignée d’emblée dans la présentation du scénario : il requiert un Gardien et des joueurs expérimentés, car il a son lot de procédés narratifs qui n’ont rien d’évident et s’éloignent éventuellement des canons rôlistiques – ou du moins de ceux de l’époque, je suppose que les choses ont pu changer depuis.
Ah, une autre note préalable : comme dans « La Saison de la Sorcière », nous trouvons ici plusieurs « incompatibilités » de background ; mais, pour le coup, c’est peut-être plus fâcheux ici… car ces incompatibilités concernent des éléments expressément décrits dans ce supplément ! Là encore, m’est avis qu’un peu de réécriture, et un souci d’uniformisation… Bon, je sais, je pinaille.
Comme avancé plus haut, le point de départ de ce scénario est (peut-être fâcheusement ?) très proche de celui de « L’Élève de Pickman », avec un rêveur piégé dans les Contrées, et qui sert bien malgré lui de « portail » destiné à permettre à une entité des Contrées de passer dans le Monde de l’Éveil. Heureusement, les similitudes ne vont guère au-delà – et, globalement, en remplaçant le Grand Ancien Ghadamon, finalement banal, par quelque chose de beaucoup plus insidieux, le scénario décuple tant son potentiel cauchemardesque que sa charge narrative, disons ; et c’est en fait essentiel.
Mais il y a… non, pas un souci, pas du tout, mais, disons, une « difficulté » : de tous les scénarios de ce volume, « Le Pays des Rêves Perdus » est, de très loin, celui qui joue le plus de cette « corde raide » que je mentionnais plus haut – ce qui ressort éventuellement d’un certain humour un peu tordu, qui le parcourt de long en large, et ce alors même que le périple des investigateurs ne manque pas d’horreur pure et de déprimants vertiges métaphysiques ; car ce scénario a finalement, et en même temps, une dimension allégorique marquée, qui emprunte beaucoup à la nouvelle « Le Bateau blanc ». Le rire n'en est que plus tentant, et en même temps redoutable.
Le scénario débute ainsi in media res, avec une scène parfaitement grotesque, qui peut être géniale mais à condition de bien la mener. Sur cette base, nous enchaînons sur une classique enquête préalable dans le Monde de l’Éveil, mais somme toute assez brève – moins d’une journée, en fait, et expressément ; tout juste le temps d’introduire quelques PNJ amusants, et de poser un décor qui aura son sens tout du long, mais n’apparaîtra cependant plus par la suite, et seulement si le Gardien se sent de s’y risquer, qu’en hors-champ, disons – une des stratégies narratives avancées par le scénario pour en faire une expérience essentiellement distincte du scénario type de L’Appel de Cthulhu.
En effet, on passe très vite dans les Contrées du Rêve, mais celles-ci ne se présentent pas ici comme un bloc – on peut sans doute distinguer trois « moments » narratifs, aux implications bien différentes.
L’enquête initiale se dédouble bien sûr dans les Contrées du Rêve, plus précisément à Dylath-Leen. Là, les investigateurs apprennent que leur « cible » se trouve à Xura, patelin maudit s’il en est, et où personne ne les conduira. Personne… si ce n’est ces satanés « galions verts », à la très mauvaise réputation ! Le scénario laisse d’abord une certaine marge, mais pas forcément beaucoup sur ce point : disons qu’il y a dès lors 95 % de chance pour que les PJ montent à bord des galions verts…
Deuxième moment, le voyage – et ses escales éventuelles ? Car, sur la côte, les navires longent d’autres patelins très infréquentables, successivement Zak, Zar et Thalarion. Ici, le scénario emprunte expressément au « Bateau blanc », sur un mode qui peut paraître tout d’abord relativement prosaïque, mais qui révèle petit à petit la matière allégorique de la nouvelle de Lovecraft. En fait, comme dans la nouvelle, ces escales sont plus que déconseillées – encore que, pas par les marins du galion vert, qui ricanent tout du long ! Gérer ces escales, sur le plan narratif, peut s’avérer périlleux… mais aussi très enthousiasmant ; par contre, le Gardien opèrera alors sans filet.
Troisième et dernier moment, Xura – et là le scénario brise tout ce qu’il pouvait avoir de conventionnel jusqu’alors, pour susciter des scènes… « différentes », impliquant émotionnellement les PJ – car tel est le rôle de Xura. D’où des confrontations individuelles des investigateurs avec leur ego, leurs passions, leurs échecs, leurs craintes, leur conception du monde… Et des rencontres censément « notées » par le Gardien, qui a son équation finale pour déterminer comment tout cela se conclura. Et c’est le moment le plus périlleux du scénario – plus que jamais sur la corde raide. Ces scènes, bien gérées, peuvent sans doute déboucher sur des merveilles, et très marquantes pour les joueurs ; mais la moindre incartade risque de faire sonner l’ensemble… parfaitement ridicule.
« Le Pays des Rêves Perdus » est sans doute un bon scénario – je n’irais pas jusqu’aux déclarations d’amour extatiques de certains fans, mais, dans le cadre de ce seul supplément, il est probablement le meilleur. Mais dans les mains d’un Gardien très compétent, et avec une table très motivée ! En fait, je ne suis franchement pas persuadé que je serais capable de mener à bien pareille entreprise – non, disons même que je ne le crois pas un seul instant. Mais d’autres, peut-être…
TOUS À BORD DU BATEAU BLANC
Le bilan, alors ? Eh bien, globalement positif, comme on dit. Mais probablement plus que ça, en fait – en sachant raison conserver, toutefois. Quoi que l’on pense de ce choix, le fait demeure : ces Contrées du Rêve sont passablement « old school », ce qui ressort tout particulièrement de (la plupart de) ses scénarios. Et, à l’évidence, le cadre de jeu des Contrées ne saurait convenir à tout le monde. D’aucuns n’y verront, et c’est leur droit, qu’un énième univers de fantasy, pas spécialement palpitant en tant que tel, et éventuellement « trop » différent de L’Appel de Cthulhu classique pour que l’y adjoindre fasse encore sens. D’autres apprécieront cette opportunité de subvertir un peu le vénérable jeu – même avec des moyens tout aussi vénérables. Et il y aura ceux qui, tout simplement, goûteront la balade ?
Une chose que j’ai tout particulièrement apprécié dans ce supplément, c’est qu’il ne se contente pas de décrire un cadre de jeu – il consacre aussi pas mal de pages à le questionner, à essayer de définir ce qui en fait la sève, ce qui pourrait en faire l’intérêt ; mais ces questions priment comme de juste sur les réponses, en laissant une grande latitude à tout un chacun pour s’approprier ce rêve.
En fait, d’une certaine manière, le lecteur est appelé à devenir lui-même Kuranes – le rêveur qui se lasse de l’Angleterre industrielle et crée par la seule force de ses rêves des villes merveilleuses en un ailleurs idéal… mais qui, à terme, recrée également son Angleterre industrielle dans son rêve, car elle lui manque à son tour. À la différence du roi, le lecteur peut cependant enchaîner les allers-retours – et, en cela, il peut vivre des expériences uniques, de ce côté du mur du sommeil comme de l’autre ; liberté !
Pour ma part, je ne refuserai pas pareille invitation au voyage. Alors, s’il y a une place sur le Bateau blanc, et quand bien même la désillusion serait comme de juste au bout du périple à force de surenchère onirique, je crois que je vais tenter le coup et monter à bord… Le voyage peut après tout constituer sa propre récompense.
Et à bientôt, pour Kingsport, la cité des brumes...

/image%2F1385856%2F20160114%2Fob_cfb8b0_caligari.jpg)






 [0-1 : Gordon Gore : Timothy Whitman] Gordon Gore, c'est notoire, aime à se distraire en enquêtant de manière totalement bénévole (pour lui...) et dilettante sur des affaires intéressant la bonne société de San Francisco. Son nom a pu circuler dans ce milieu, et aboutir à ce que le banquier Timothy Whitman, richissime patron de l'American Union Bank, le contacte pour une affaire nécessitant la plus grande discrétion. Whitman n'a rien de commun avec Gore : grand bourgeois austère et même puritain, il méprise à l'évidence le dilettante dépensier et décadent, mais les références indéniables de ce dernier ont emporté la décision du banquier, qui se veut avant tout un homme de « bon sens », pragmatique.
[0-1 : Gordon Gore : Timothy Whitman] Gordon Gore, c'est notoire, aime à se distraire en enquêtant de manière totalement bénévole (pour lui...) et dilettante sur des affaires intéressant la bonne société de San Francisco. Son nom a pu circuler dans ce milieu, et aboutir à ce que le banquier Timothy Whitman, richissime patron de l'American Union Bank, le contacte pour une affaire nécessitant la plus grande discrétion. Whitman n'a rien de commun avec Gore : grand bourgeois austère et même puritain, il méprise à l'évidence le dilettante dépensier et décadent, mais les références indéniables de ce dernier ont emporté la décision du banquier, qui se veut avant tout un homme de « bon sens », pragmatique. [0-2 : Gordon Gore : Timothy Whitman ; Clarisse Whitman] Lors de leur première entrevue à ce propos, la veille au soir, en privé, Whitman a rechigné à se montrer très précis sur ce qu'il attendait au juste. Gore lui a fait la remarque qu'il aurait besoin de davantage d'éléments pour accepter l'enquête, et Whitman a commencé, à regrets, à évoquer quelques éléments plus précis – il s'agit de retrouver sa fille cadette, Clarisse, qui a disparu depuis plusieurs jours ; et qui sait dans quel guêpier elle a pu se fourrer... Mais, pour lui, c'est davantage qu'une simple fugue : il n'a rien lâché de plus précis, mais il dispose sans doute d'éléments en ce sens, et c'est bien pourquoi il considère qu'une enquête s'impose, une enquête n'impliquant pas la police, ni, directement du moins, un ou des détectives privés, affiliés à Pinkerton notamment, car il n'a pas confiance... Le profil de Gore, par contre, le rend approprié pour régler cette affaire au mieux.
[0-2 : Gordon Gore : Timothy Whitman ; Clarisse Whitman] Lors de leur première entrevue à ce propos, la veille au soir, en privé, Whitman a rechigné à se montrer très précis sur ce qu'il attendait au juste. Gore lui a fait la remarque qu'il aurait besoin de davantage d'éléments pour accepter l'enquête, et Whitman a commencé, à regrets, à évoquer quelques éléments plus précis – il s'agit de retrouver sa fille cadette, Clarisse, qui a disparu depuis plusieurs jours ; et qui sait dans quel guêpier elle a pu se fourrer... Mais, pour lui, c'est davantage qu'une simple fugue : il n'a rien lâché de plus précis, mais il dispose sans doute d'éléments en ce sens, et c'est bien pourquoi il considère qu'une enquête s'impose, une enquête n'impliquant pas la police, ni, directement du moins, un ou des détectives privés, affiliés à Pinkerton notamment, car il n'a pas confiance... Le profil de Gore, par contre, le rend approprié pour régler cette affaire au mieux. [0-3 : Gordon Gore : Timothy Whitman] Gore sait qu'il manque encore d'éléments, mais, sur la base de ces premiers échanges, il a néanmoins pu constituer une équipe qu'il juge adéquate, et qu'il compte bien imposer à Whitman quoi qu'il en soit, d'où ce rendez-vous à l'American Union Bank, dans Financial District, le lundi 2 septembre 1929, à 10 h. Whitman, mis devant le fait accompli, n'en sera que plus furieux, suppose Gore, mais le banquier devra admettre qu'il n'a pas vraiment le choix, et accueillir tout ce petit monde dans son bureau.
[0-3 : Gordon Gore : Timothy Whitman] Gore sait qu'il manque encore d'éléments, mais, sur la base de ces premiers échanges, il a néanmoins pu constituer une équipe qu'il juge adéquate, et qu'il compte bien imposer à Whitman quoi qu'il en soit, d'où ce rendez-vous à l'American Union Bank, dans Financial District, le lundi 2 septembre 1929, à 10 h. Whitman, mis devant le fait accompli, n'en sera que plus furieux, suppose Gore, mais le banquier devra admettre qu'il n'a pas vraiment le choix, et accueillir tout ce petit monde dans son bureau. [0-4 : Gordon Gore : Eunice Bessler, Zeng Ju, Bobby Traven, Trevor Pierce, Veronica Sutton ; Clarisse Whitman, William Randolph Hearst] Pour Gore, il allait de soi que sa compagne du moment, la très délurée et active Eunice Bessler, serait mêlée à l'affaire – et d'autant plus, mais cela il le garde pour lui, qu'elle pourrait ressembler d'une certaine manière à Clarisse Whitman ? De même en ce qui concerne son vieux domestique chinois, Zeng Ju, dont il sait qu'il dispose de ressources insoupçonnées au regard de sa fonction de majordome... À plusieurs reprises, Gore a eu recours aux services du détective privé Bobby Traven et du journaliste Trevor Pierce ; il pense qu'ils pourraient être utiles en cette affaire, tout en étant suffisamment discrets – Pierce n'est ainsi pas du genre à susciter un scandale de mœurs, ce sont les affaires politico-financières qui l'intéressent, et il déteste Hearst... Bien sûr, ces deux-là doivent être payés – Traven n'est pas regardant, mais, pour Pierce, il a fallu davantage que de l'argent : la promesse de confidences sur les filouteries de certains membres de la bonne société san-franciscaine – et à la mairie... Ce « paiement » aura lieu à la fin de l'affaire. Enfin, Gore a eu l'occasion de constater qu'une approche plus « intellectuelle » était souvent fructueuse, et le profil de Clarisse l'a incité à requérir les services de sa propre psychiatre, Veronica Sutton ; celle-ci était extrêmement réticente au départ – ce genre d'enquêtes, ce n'est absolument pas son monde, et Gore est son patient ! Mais il a su lui faire miroiter des sujets d'étude intéressants (la personnalité de Clarisse au premier chef), et se montrer vraiment très généreux financièrement... Sutton n’a rien de cupide, mais l’idée de disposer de fonds suffisants pour mettre en place une institution psychiatrique d’avant-garde n’a pas manqué de la séduire, aussi a-t-elle bien voulu remiser, au moins temporairement, ses préventions de côté, et participer à l'entretien à l'American Union Bank, sans pour autant s'engager plus avant ; cela convient très bien à Gore, qui ne doute pas qu'une fois accrochée, elle s'intègrera d'elle-même et volontairement dans leur petit groupe d'investigateurs…
[0-4 : Gordon Gore : Eunice Bessler, Zeng Ju, Bobby Traven, Trevor Pierce, Veronica Sutton ; Clarisse Whitman, William Randolph Hearst] Pour Gore, il allait de soi que sa compagne du moment, la très délurée et active Eunice Bessler, serait mêlée à l'affaire – et d'autant plus, mais cela il le garde pour lui, qu'elle pourrait ressembler d'une certaine manière à Clarisse Whitman ? De même en ce qui concerne son vieux domestique chinois, Zeng Ju, dont il sait qu'il dispose de ressources insoupçonnées au regard de sa fonction de majordome... À plusieurs reprises, Gore a eu recours aux services du détective privé Bobby Traven et du journaliste Trevor Pierce ; il pense qu'ils pourraient être utiles en cette affaire, tout en étant suffisamment discrets – Pierce n'est ainsi pas du genre à susciter un scandale de mœurs, ce sont les affaires politico-financières qui l'intéressent, et il déteste Hearst... Bien sûr, ces deux-là doivent être payés – Traven n'est pas regardant, mais, pour Pierce, il a fallu davantage que de l'argent : la promesse de confidences sur les filouteries de certains membres de la bonne société san-franciscaine – et à la mairie... Ce « paiement » aura lieu à la fin de l'affaire. Enfin, Gore a eu l'occasion de constater qu'une approche plus « intellectuelle » était souvent fructueuse, et le profil de Clarisse l'a incité à requérir les services de sa propre psychiatre, Veronica Sutton ; celle-ci était extrêmement réticente au départ – ce genre d'enquêtes, ce n'est absolument pas son monde, et Gore est son patient ! Mais il a su lui faire miroiter des sujets d'étude intéressants (la personnalité de Clarisse au premier chef), et se montrer vraiment très généreux financièrement... Sutton n’a rien de cupide, mais l’idée de disposer de fonds suffisants pour mettre en place une institution psychiatrique d’avant-garde n’a pas manqué de la séduire, aussi a-t-elle bien voulu remiser, au moins temporairement, ses préventions de côté, et participer à l'entretien à l'American Union Bank, sans pour autant s'engager plus avant ; cela convient très bien à Gore, qui ne doute pas qu'une fois accrochée, elle s'intègrera d'elle-même et volontairement dans leur petit groupe d'investigateurs…
 [I-1 :
[I-1 : 
 [I-3 : Gordon Gore, Bobby Traven : Daniel Fairbanks ; Timothy Whitman]
[I-3 : Gordon Gore, Bobby Traven : Daniel Fairbanks ; Timothy Whitman] [I-4 :
[I-4 : 

 I-7 : Gordon Gore : Timothy Whitman,
I-7 : Gordon Gore : Timothy Whitman, 
 [I-9 : Gordon Gore,
[I-9 : Gordon Gore, 

 [I-12 : Gordon Gore, Zeng Ju,
[I-12 : Gordon Gore, Zeng Ju, 

 [II-1 : Gordon Gore, Eunice Bessler, Zeng Ju, Veronica Sutton, Bobby Traven, Trevor Pierce : Clarisse Whitman, Timothy Whitman]
[II-1 : Gordon Gore, Eunice Bessler, Zeng Ju, Veronica Sutton, Bobby Traven, Trevor Pierce : Clarisse Whitman, Timothy Whitman]  [II-2 : Gordon Gore, Bobby Traven : Timothy Whitman, Clarisse Whitman, Dorothy Whitman, Louise Whitman]
[II-2 : Gordon Gore, Bobby Traven : Timothy Whitman, Clarisse Whitman, Dorothy Whitman, Louise Whitman] [II-3 : Veronica Sutton : Montgomery Phelps, Dorothy Whitman, Louise Whitman ; Clarisse Whitman]
[II-3 : Veronica Sutton : Montgomery Phelps, Dorothy Whitman, Louise Whitman ; Clarisse Whitman]  [II-4 : Gordon Gore, Veronica Sutton, Eunice Bessler : Dorothy Whitman]
[II-4 : Gordon Gore, Veronica Sutton, Eunice Bessler : Dorothy Whitman]  [II-5 : Bobby Traven, Gordon Gore : Dorothy Whitman, Montgomery Phelps]
[II-5 : Bobby Traven, Gordon Gore : Dorothy Whitman, Montgomery Phelps] [II-6 : Veronica Sutton : Dorothy Whitman, Louise Whitman ; Clarisse Whitman, Timothy Whitman]
[II-6 : Veronica Sutton : Dorothy Whitman, Louise Whitman ; Clarisse Whitman, Timothy Whitman]  [II-7 : Trevor Pierce, Eunice Bessler : Dorothy Whitman, Louise Whitman ; Clarisse Whitman]
[II-7 : Trevor Pierce, Eunice Bessler : Dorothy Whitman, Louise Whitman ; Clarisse Whitman]  [II-8 : Gordon Gore, Bobby Traven, Eunice Bessler : Dorothy Whitman]
[II-8 : Gordon Gore, Bobby Traven, Eunice Bessler : Dorothy Whitman]  [II-9 : Gordon Gore, Eunice Bessler : Dorothy Whitman ; Clarisse Whitman, Timothy Whitman, « Johnny »]
[II-9 : Gordon Gore, Eunice Bessler : Dorothy Whitman ; Clarisse Whitman, Timothy Whitman, « Johnny »]  [II-10 : Gordon Gore : Dorothy Whitman, Louise Whitman]
[II-10 : Gordon Gore : Dorothy Whitman, Louise Whitman] [II-11 : Bobby Traven, Gordon Gore : Louise Whitman, Dorothy Whitman ; Clarisse Whitman]
[II-11 : Bobby Traven, Gordon Gore : Louise Whitman, Dorothy Whitman ; Clarisse Whitman] [II-12 : Bobby Traven : Dorothy Whitman ; Louise Whitman, « Johnny », Clarisse Whitman]
[II-12 : Bobby Traven : Dorothy Whitman ; Louise Whitman, « Johnny », Clarisse Whitman] [II-13 : Trevor Pierce, Eunice Bessler, Veronica Sutton : Dorothy Whitman ; Clarisse Whitman]
[II-13 : Trevor Pierce, Eunice Bessler, Veronica Sutton : Dorothy Whitman ; Clarisse Whitman]  [II-14 : Zeng Ju, Gordon Gore, Bobby Traven : Dorothy Whitman ; Clarisse Whitman, « Johnny », Louise Whitman]
[II-14 : Zeng Ju, Gordon Gore, Bobby Traven : Dorothy Whitman ; Clarisse Whitman, « Johnny », Louise Whitman] [II-15 : Gordon Gore, Veronica Sutton : Dorothy Whitman ; Clarisse Whitman]
[II-15 : Gordon Gore, Veronica Sutton : Dorothy Whitman ; Clarisse Whitman]  [II-16 : Trevor Pierce, Gordon Gore : Dorothy Whitman ; Timothy Whitman, Clarisse Whitman]
[II-16 : Trevor Pierce, Gordon Gore : Dorothy Whitman ; Timothy Whitman, Clarisse Whitman]  [II-17 : Eunice Bessler, Gordon Gore : Dorothy Whitman ; Clarisse Whitman, Louise Whitman]
[II-17 : Eunice Bessler, Gordon Gore : Dorothy Whitman ; Clarisse Whitman, Louise Whitman]  [II-18 : Veronica Sutton, Eunice Bessler : Dorothy Whitman, Montgomery Phelps ; Clarisse Whitman, Louise Whitman]
[II-18 : Veronica Sutton, Eunice Bessler : Dorothy Whitman, Montgomery Phelps ; Clarisse Whitman, Louise Whitman] [II-19 : Eunice Bessler, Veronica Sutton : Dorothy Whitman ; Clarisse Whitman]
[II-19 : Eunice Bessler, Veronica Sutton : Dorothy Whitman ; Clarisse Whitman]  [II-20 : Veronica Sutton : Louise Whitman, Timothy Whitman, Dorothy Whitman]
[II-20 : Veronica Sutton : Louise Whitman, Timothy Whitman, Dorothy Whitman]  [II-21 : Eunice Bessler : Dorothy Whitman ; Clarisse Whitman]
[II-21 : Eunice Bessler : Dorothy Whitman ; Clarisse Whitman] [II-22 : Eunice Bessler, Veronica Sutton : Clarisse Whitman, Dorothy Whitman, Bobby Traven]
[II-22 : Eunice Bessler, Veronica Sutton : Clarisse Whitman, Dorothy Whitman, Bobby Traven]  [II-23 : Bobby Traven, Gordon Gore, Trevor Pierce : Montgomery Phelps ; Dorothy Whitman, Clarisse Whitman, Timothy Whitman]
[II-23 : Bobby Traven, Gordon Gore, Trevor Pierce : Montgomery Phelps ; Dorothy Whitman, Clarisse Whitman, Timothy Whitman] [II-24 : Eunice Bessler, Veronica Sutton : Dorothy Whitman, Montgomery Phelps, Louise Whitman ; Clarisse Whitman]
[II-24 : Eunice Bessler, Veronica Sutton : Dorothy Whitman, Montgomery Phelps, Louise Whitman ; Clarisse Whitman]  [II-25 : Gordon Gore : Dorothy Whitman, Montgomery Phelps ; Clarisse Whitman]
[II-25 : Gordon Gore : Dorothy Whitman, Montgomery Phelps ; Clarisse Whitman]
 [III-1 : Eunice Bessler, Bobby Traven, Trevor Pierce, Gordon Gore : « Johnny »]
[III-1 : Eunice Bessler, Bobby Traven, Trevor Pierce, Gordon Gore : « Johnny »]  [III-2 : Gordon Gore, Zeng Ju : Clarisse Whitman]
[III-2 : Gordon Gore, Zeng Ju : Clarisse Whitman]  [III-3 : Gordon Gore, Veronica Sutton : Louise Whitman, Dorothy Whitman]
[III-3 : Gordon Gore, Veronica Sutton : Louise Whitman, Dorothy Whitman]
 [IV-1 : Bobby Traven : Eugénie ; Francis]
[IV-1 : Bobby Traven : Eugénie ; Francis]  [IV-2 : Bobby Traven : Francis ; Clarisse Whitman]
[IV-2 : Bobby Traven : Francis ; Clarisse Whitman] 
 [V-1 : Zeng Ju : Xiang Hai]
[V-1 : Zeng Ju : Xiang Hai]  [V-2 : Zeng Ju : Xiang Hai ; Gordon Gore, Ling, Clarisse Whitman, Timothy Whitman, « Johnny », Lin Chao]
[V-2 : Zeng Ju : Xiang Hai ; Gordon Gore, Ling, Clarisse Whitman, Timothy Whitman, « Johnny », Lin Chao]
 [VI-1 : Gordon Gore, Eunice Bessler, Trevor Pierce]
[VI-1 : Gordon Gore, Eunice Bessler, Trevor Pierce]  [VI-2 : Gordon Gore : Howard Sanford ; Jonathan Colbert]
[VI-2 : Gordon Gore : Howard Sanford ; Jonathan Colbert]  [VI-3 : Gordon Gore, Eunice Bessler, Trevor Pierce : Jonathan Colbert]
[VI-3 : Gordon Gore, Eunice Bessler, Trevor Pierce : Jonathan Colbert] 
 [VII-1 : Trevor Pierce : Howard Sanford, Jonathan Colbert, Gordon Gore]
[VII-1 : Trevor Pierce : Howard Sanford, Jonathan Colbert, Gordon Gore] 

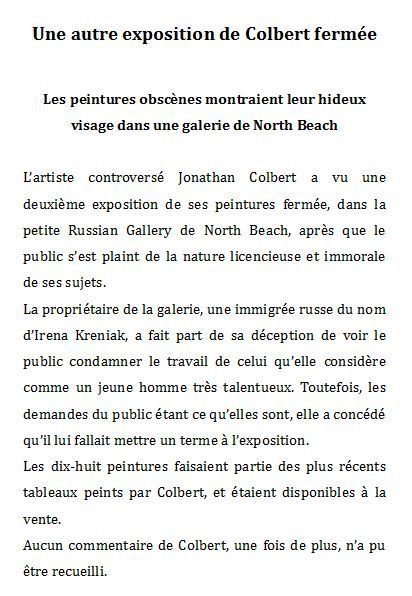

 [VIII-1 : Gordon Gore, Zeng Ju, Eunice Bessler]
[VIII-1 : Gordon Gore, Zeng Ju, Eunice Bessler] [VIII-2 : Veronica Sutton, Gordon Gore]
[VIII-2 : Veronica Sutton, Gordon Gore]  [VIII-3 : Gordon Gore, Bobby Traven, Trevor Pierce, Eunice Bessler : Daniel Fairbanks, Jonathan Colbert, Timothy Whitman, Dorothy Whitman]
[VIII-3 : Gordon Gore, Bobby Traven, Trevor Pierce, Eunice Bessler : Daniel Fairbanks, Jonathan Colbert, Timothy Whitman, Dorothy Whitman]  [VIII-4 : Trevor Pierce, Eunice Bessler, Bobby Traven, Gordon Gore : Irena Kreniak, Jonathan Colbert, Nicolas Robinson]
[VIII-4 : Trevor Pierce, Eunice Bessler, Bobby Traven, Gordon Gore : Irena Kreniak, Jonathan Colbert, Nicolas Robinson]  [VIII-5 : Bobby Traven, Eunice Bessler, Gordon Gore : Clarisse Whitman]
[VIII-5 : Bobby Traven, Eunice Bessler, Gordon Gore : Clarisse Whitman] 
 [VIII-6 : Gordon Gore, Eunice Bessler, Veronica Sutton, Bobby Traven, Zeng Ju, Trevor Pierce : Clarisse Whitman, Lin Chao, « Johnny », Irena Kreniak, Daniel Fairbanks]
[VIII-6 : Gordon Gore, Eunice Bessler, Veronica Sutton, Bobby Traven, Zeng Ju, Trevor Pierce : Clarisse Whitman, Lin Chao, « Johnny », Irena Kreniak, Daniel Fairbanks] [VIII-7 : Gordon Gore, Eunice Bessler, Zeng Ju, Veronica Sutton, Bobby Traven, Trevor Pierce]
[VIII-7 : Gordon Gore, Eunice Bessler, Zeng Ju, Veronica Sutton, Bobby Traven, Trevor Pierce] 
 [IX-1 : Bobby Traven, Trevor Pierce : Clarisse Whitman]
[IX-1 : Bobby Traven, Trevor Pierce : Clarisse Whitman] 
 [X-1 : Bobby Traven, Trevor Pierce : Eugénie ; Clarisse Whitman, Jonathan Colbert]
[X-1 : Bobby Traven, Trevor Pierce : Eugénie ; Clarisse Whitman, Jonathan Colbert]  [X-2 : Bobby Traven, Trevor Pierce : Eugénie]
[X-2 : Bobby Traven, Trevor Pierce : Eugénie] 






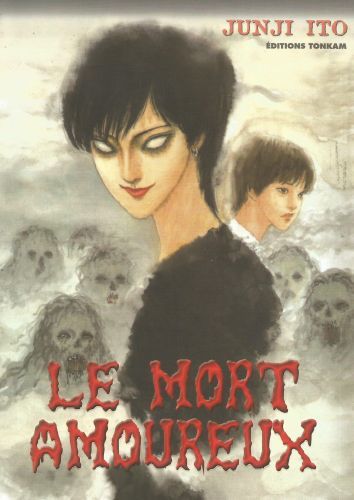
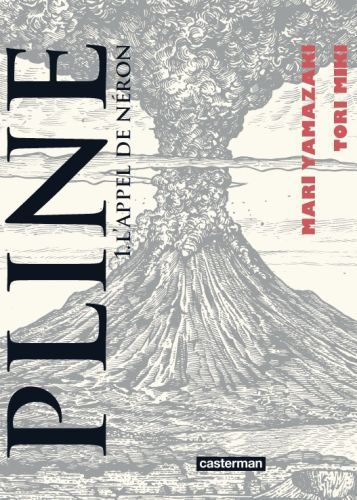


/image%2F1385856%2F20150204%2Fob_660a87_georges-abdaloff-croque-par-christell.jpg)