"Les Dieux de Bal-Sagoth", de Robert E. Howard
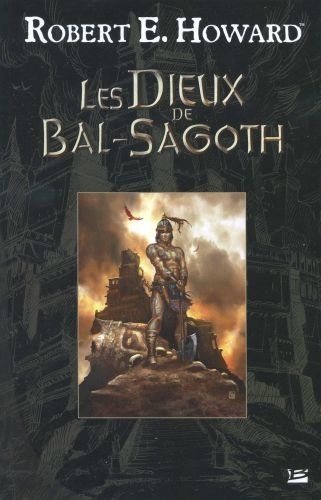
HOWARD (Robert E.), Les Dieux de Bal-Sagoth, illustrations de Didier Graffet, traduit de l’anglais (États-Unis) par Patrice Louinet, Paris, Bragelonne, 2010, 476 p.
Pour ma part, et quoi que l’on puisse reprocher par ailleurs à ladite maison (c’est un sport national), je ne remercierai jamais assez Bragelonne et Patrice Louinet d’avoir poursuivi l’édition des œuvres de Robert E. Howard au-delà de l’intégrale de Conan. Merci, merci, merci. Certes, cela a pu donner du très bon (Bran Mak Morn), du bon (Solomon Kane), et du moins bon (Le Seigneur de Samarcande) ; mais c’est en tout cas une occasion unique de redécouvrir un auteur sans doute plus varié et moins caricatural que ce que l’on a longtemps voulu croire, et qui, tout au long de sa courte carrière, a régulièrement pondu des textes fort intéressants.
Certes, il s’agit de littérature populaire, mais de bonne littérature populaire ; aussi est-ce toujours avec une certaine impatience que j’attends les nouvelles parutions howardiennes chez Bragelonne, que je m’empresse d’acheter dès leur sortie. Après, c’est un peu la roulette russe… mais en parlant d’Howard, c’est sans doute de mauvais goût, alors on préfèrera pasticher Forrest Gump, et dire avec lui que Howard, c’est comme une boîte de chocolats : on ne sait jamais sur quoi on va tomber.
Las, autant le dire tout de suite, avec Les Dieux de Bal-Sagoth, premier tome d’une intégrale en trois volumes des récits de fantasy et d’horreur « hors-cycle » (du moins est-ce ainsi que je l’ai compris... ?) de Robert E. Howard, on tombe dans l’ensemble sur du « pas très bon ». Des vieux machins un peu moisis, d’autres qui sentent pas bon, quelques-uns d’un peu trop liquoreux. Pas tous, heureusement : il y en a de tout à fait mangeables, et même de bons ; mais dans l’ensemble, c’est quand même l’amertume qui domine…
Nous commençons par retrouver (donc, en fait de « hors-cycle », déjà, ça coince un peu) Turlogh O’Brien, un personnage de paria irlandais, fort intéressant, que l’on avait déjà pu croiser dans deux (si je ne m’abuse) très chouettes nouvelles du très chouette Bran Mak Morn – et en tout cas dans « L’Homme noir », excellent récit dudit recueil. « Les Dieux de Bal-Sagoth » (pp. 11-60) en constitue d’ailleurs la suite, et c’est plutôt une réussite que ce récit d’heroic fantasy totalement frénétique, dans lequel, comme Patrice Louinet en fait la remarque (p. 460), l’accumulation des événements en moins de vingt-quatre heures est telle que Jack Bauer himself pourrait en prendre de la graine. Ça commence plutôt pas mal, donc. Et plutôt bien, même
Et ça se poursuit pas mal, quoique de manière un peu trop confuse, avec « Le Crépuscule du Dieu gris » (pp. 61-105), nouvelle contant la bataille de Clontarf (1014) et en faisant le « ragnarok personnel » d’Odin. Turlogh O’Brien n’y est qu’un des très nombreux personnages secondaires, dans ce texte qui se situe chronologiquement avant son bannissement. Parfois intéressant et animé d’un certain souffle épique, ce texte indéniablement documenté se révèle quand même dans l’ensemble un peu trop lourd pour convaincre véritablement. Patrice Louinet a sans doute raison (mais bien sûr qu’il a raison !) quand il dit que, si ce texte a eu une influence sur les récits ultérieurs de Conan, ce n’est pas tant parce qu’on y trouve un personnage qui s’appelle Conn et qui jure par Crom, que, a contrario, parce que Howard avait éprouvé là toute la difficulté et la lourdeur imposée par les recherches dans un cadre historique, ce dont la création de « l’Âge Hyborien » allait le soulager.
On retrouve Turlogh O’Brien dans deux fragments en appendice. Le premier, non titré (pp. 427-430), est trop court pour que l’on puisse vraiment en dire quoi que ce soit – si ce n’est que le personnage y apparaît bien fourbe. Le second, bien qu’éminemment bancal, est plus intéressant à mes yeux : « L’Ombre du Hun » (pp. 431-453), avec son [sic] général, est un récit inachevé totalement foutraque, qui commence très mal, et part dans toutes les directions, mais contient quelques beaux moments ; je retiens notamment une belle scène de bataille navale, et une invraisemblable épopée russe de Turlogh O’Brien, où notre héros se voit décerner le titre de bogatyr (mais je reviendrai là-dessus très bientôt…).
Revenons maintenant en arrière, et abandonnons l’Irlandais et sa hache dalcassienne. Nous allons enchaîner sur quelques textes de jeunesse de Robert E. Howard, parmi les premiers publiés dans Weird Tales.
…
Et là, on se dit que Farnsworth Wright, le rédacteur en chef, n’était pas très regardant, parce que fouyayaye ! C’est quand même pas bon du tout. Ainsi du tout premier, « Lance et croc » (pp. 107-118), un récit préhistorique didactique, maladroit et convenu ; le suivant, « Dans la forêt de Villefère » (pp. 119-125), que Wright qualifiait de « bijou » (?!?), est un récit de loup-garou très maladroit dans la forme, qui ne vaut donc guère mieux. Certes, Howard est bien jeune, alors on l’excusera…
Et puis il fait des progrès rapides. « La Tête de loup » (pp. 127-156), sorte de suite à « Dans la forêt de Villefère », pour être un peu foutraque, et un peu grotesque dans tous les sens du terme, n’en est pas moins un récit d’horreur gothique relativement convenable, bien plus fréquentable en tout cas que les deux abominations qui précèdent.
Cela-dit, elles avaient au moins pour elles d’êtres courtes. Ce n’est hélas pas le cas de celle qui suit, « Le Crâne vivant » (pp. 157-283), loooooooooooongue nouvelle (enfin, rendue un peu artificiellement longue par des sauts de page incessants, aussi…) pastichant Sax Rohmer et son terrible docteur Fu Manchu. Mais à la Howard, et mâtinée de Lovecraft. Ce qui nous donne au final une loooooooooooooooooooongue variation sur le péril noir et jaune et brun et pas blanc, en fait, quoi, qui s’explique sans doute par l’époque, le contexte, oui, on est d’accord, mais qui passe quand même difficilement pour un lecteur contemporain, qui hésite du coup entre le sac à vomi et le franc éclat de rire (parce que, comme le dit le Philosophe, « mieux vaut en rire que s’en foutre »). J’avoue avoir ris aux larmes à ce passage (p. 262, souligné par l’auteur) :
« Une foule impressionnante se pressait sur ce toit. Ils étaient assis, accroupis ou debout… et sans exception il ne s’agissait que de Noirs ! »
Et un peu plus loin (p. 281) :
« […] les centaines de Noirs qui ont dû mourir à ce moment-là.
« – Tous les Noirs de Londres devaient s’y trouver.
« – Je le pense. Tous sont, au fond d’eux-mêmes, des adorateurs du vaudou […] »
Mais là, vous me direz que chez Lovecraft, dans le fond, c’est pas mieux, et vous n’auriez pas tort. N’empêche qu’il s’agit là d’une nouvelle longue, nauséabonde et chiante, et qui plus est mal documentée (Londres selon Howard, c’est un peu bizarre ; quant à sa perception des drogues, n’en parlons pas…).
Suit « Le Moment suprême » (pp. 285-291), courte nouvelle misanthrope et dépressive. Ça n’est pas bien bon, mais il est vrai que, quand on sait la fin de l’auteur, ça prend une résonance particulière…
On passe à quelque chose d’un peu plus intéressant avec « Le Feu d’Asshurbanipal » (pp. 293-323), récit mêlant aventures orientales et horreur lovecraftienne avec un certain talent. Moui, ça passe plutôt bien.
Au passage, on évoquera le dernier « Fragment sans titre » (pp. 455-457) des appendices, qui contient la seule évocation conjointe, en mauvais allemand, des Unausprechlichen Kulten de Von Juntzt faisant le lien avec l’Âge Hyborien.
Mais revenons au corps du livre, avec « Les Guerriers du Valhalla » (pp. 325-369), texte un peu problématique, mais dans l’ensemble plutôt intéressant. C’est la première apparition de James Allison, et avec lui du thème de la réincarnation. James Allison, handicapé, se souvient d’une vie antérieure « sur-virile », où il était Hialmar, une sorte de pré-Viking parti pour une immense marche de massacre autour du monde, qui l’amène finalement aux portes d’une cité pré-texane (on pense beaucoup, au début, aux « Dieux de Bal-Sagoth »). L’image de ce trek sanglant est très forte, et les scènes de bataille sont réussies. En même temps, le récit est un peu convenu, et sa fin un peu abrupte (en raison de sa complexe histoire éditoriale, sans doute). Et puis, là encore, il est certains passages dont on aurait pu se passer (p. 349) :
« Un homme ne vaut ni plus ni moins que les sentiments qu’il éprouve à l’égard des femmes de son sang, ce qui constitue le seul et véritable test de la conscience raciale. Un homme peut posséder une femme étrangère et s’asseoir à la table du compagnon de celle-ci, étranger lui aussi, sans éprouver le moindre élancement de conscience raciale. Ce n’est que lorsqu’il voit un étranger posséder, ou sur le point de posséder, une femme de son sang, qu’il prend pleinement conscience de la différence de race et de souche. »
Ouch.
Suivent deux brefs récits de « western fantastique ». Tout d’abord, « Les Morts se souviennent » (pp. 371-383), ou la vengeance posthume d’une Noire assassinée avec son époux par un Blanc ivre. Rien que de très convenu dans le fond, mais la forme, multipliant les pièces à conviction, n’est pas inintéressante.
Après quoi l’on passe à « Querelle de sang » (pp. 385-393), nouvelle pour laquelle Patrice Louinet s’enthousiasme, mais qui m’a pour ma part laissé assez froid… car c’est là encore assez convenu, trouvé-je. Mais bon.
Reste « La Maison d’Arabu » (pp.395-424), fantasy mésopotamienne non dénuée d’un certain charme, mais tout de même un peu confuse, et qui finit quand même carrément en queue de poisson…
Et il faut bien entendu ajouter à tout cela une « Introduction » (pp. 7-10) et une postface (« Entre haine et oubli », pp. 459-477) tout à fait passionnantes de Patrice Louinet (comme d’hab’, quoi).
Il n’en reste pas moins qu’au final c’est un sentiment de déception qui domine une fois refermé Les Dieux de Bal-Sagoth. Ce recueil fait de bric et de broc se révèle inégal en qualité, et, si l’on y croise régulièrement le pire d’Howard, on ne le sent que rarement à son meilleur. Ce qui ne m’empêchera certainement pas de faire l’acquisition et de lire le tome suivant, hein… Mais il faut bien dire ce qui est : celui-ci est sans doute à réserver aux fans hardcore.

/image%2F1385856%2F20160114%2Fob_cfb8b0_caligari.jpg)



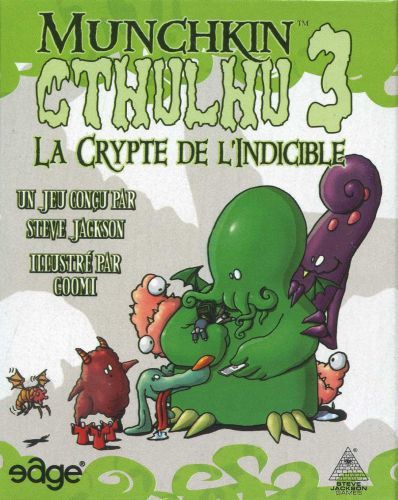

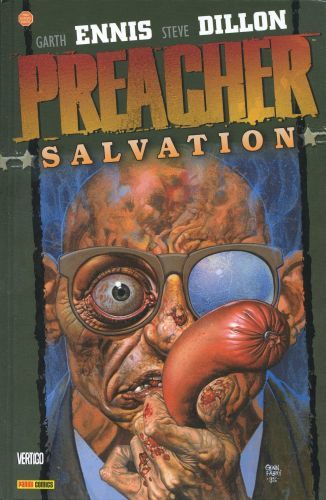
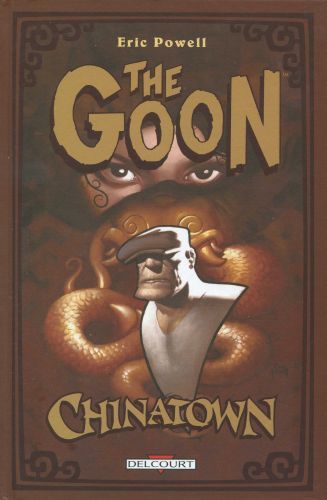
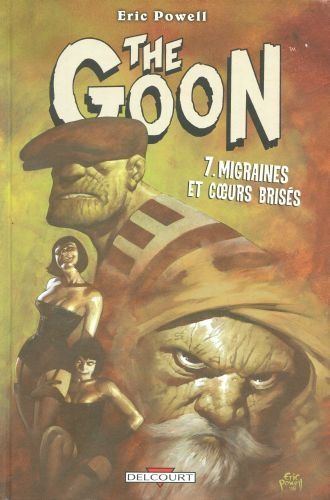


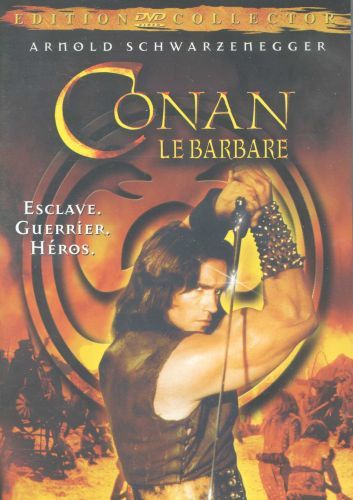

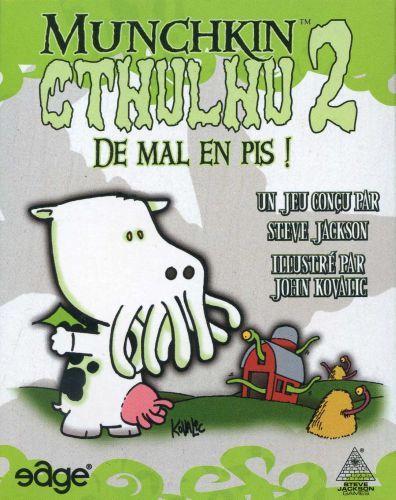

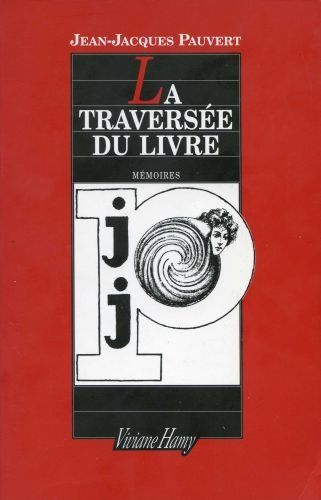

/image%2F1385856%2F20150204%2Fob_660a87_georges-abdaloff-croque-par-christell.jpg)