"The Wizard of Oz", de L. Frank Baum
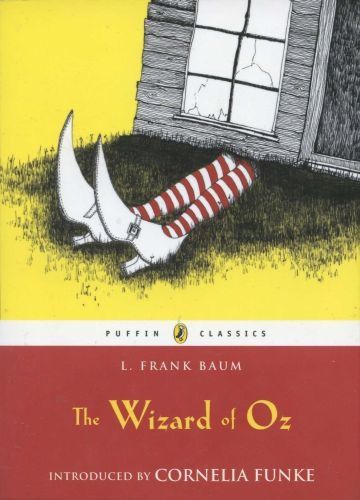
BAUM (L. Frank), The Wizard of Oz, introduced by Cornelia Funke, illustrations by David McKee, London, Penguin Books, coll. Puffin Books, [1900, 1982] 2008, VII + 187 p.
Cornelia Funke entame son introduction – par ailleurs fort dispensable – à cette édition de The Wizard of Oz de L. Frank Baum par ce simple constat : en Allemagne, où elle est née, les enfants ne lisent pas Le Magicien d’Oz. Constat que l’on peut étendre sans problème à la France, et sans doute au reste de l’Europe, y compris – du moins j’ai tendance à le croire – aux îles britanniques. Le « vieux monde » a d’autres classiques de la littérature enfantine, et ce même en langue anglaise, où l’on pensera avant tout à Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll et à Peter Pan de James Matthew Barrie. À l’évidence, Le Magicien d’Oz est un mythe spécifiquement américain.
Aussi, pour ma part, n’en connaissais-je finalement pas grand-chose, pour n’avoir jamais lu le livre de L. Frank Baum, publié en 1900, ou vu le célèbre film qui révéla Judy Garland en 1939 – même si j’étais bien conscient, cela va de soi, de l’existence de ces deux œuvres. En fait, ce que je connaissais du Magicien d’Oz venait de réinterprétations ou réappropriations plus modernes et plus ou moins outrées : sans parler du Zardoz de John Boorman, j’évoquerais ici la génialissime bande-dessinée pornographique Filles perdues d’Alan Moore et Melinda Gebbie… ou le documentaire foldingue accompagnant le concert des Scissor Sisters sur le DVD We Are Scissor Sisters… And So Are You (le groupe ayant par ailleurs signé un morceau éloquemment titré « Return to Oz »). C’est d’ailleurs afin de lire sereinement une de ces réappropriations – le CosmoZ de Claro – que je me suis finalement décidé à lire Le Magicien d’Oz (me reste à voir le film…).
Donc je connaissais les principaux personnages de l’histoire, mais sans en connaître totalement les tenants et les aboutissants. Il était temps de combler cette lacune.
Tout commence au Kansas, terre grise, où des champs uniformément gris et plats s’étendent à l’infini. La petite Dorothy y vit auprès de son oncle Henry et de sa tante Em, avec son chien Toto. Mais, un jour, la maison où ils vivent est emportée par un cyclone alors que Dorothy et Toto se trouvent à l’intérieur, sans avoir eu le temps de se réfugier dans la cave. Cela n’empêche pas Dorothy de s’endormir… Mais quand elle se réveille, c’est dans un monde bien différent du Kansas.
Une terre magnifique, fleurie et boisée, riante, où la petite fille est accueillie en héroïne par les Munchkins. C’est que sa maison a eu la bonne idée de tomber sur la Méchante Sorcière de l’Est, la tuant sur le coup, et libérant les Munchkins de l’esclavage. En guise de récompense, Dorothy obtient les souliers argentés de la Méchante Sorcière de l’Est, et un baiser protecteur de la Gentille Sorcière du Nord, amie des Munchkins. Mais voilà : ce pays a beau être magnifique, Dorothy est obnubilée par une idée : retourner au Kansas, où son oncle Henry et sa tante Em doivent s’inquiéter… Mais comment faire ? Seul le Grand Magicien d’Oz, c’est-à-dire Oz lui-même, doit pouvoir faire quelque chose à ce sujet ; le mieux, pour Dorothy, est donc de suivre la route pavée de briques jaunes qui mène à la Cité d’émeraude, pour demander à Oz de la renvoyer au Kansas.
En chemin, Dorothy multiplie les rencontres. C’est, tout d’abord, l’Épouvantail qui l’accompagne, après qu’elle l’a libéré de son champ. Il se plaint de n’avoir pas de cervelle, et se dit que le Grand Oz pourrait sans doute lui en donner une, ce qui ferait de lui un être intelligent. Puis vient le Bûcheron d’étain : lui, c’est d’un cœur qu’il se languit, et il rejoint la compagnie pour la même raison. Arrive enfin le Lion peureux, qui entend bien demander à Oz du courage. Et tous de suivre la route de briques jaunes pour rencontrer le Grand et Terrible Oz… mais ce n’est que le début de leurs aventures.
Évidemment, une chose saute très vite aux yeux du lecteur adulte – et probablement aussi à ceux d’un enfant : c’est que les compagnons de route de Dorothy, ironiquement, partent en quête de ce qu’ils ont déjà sans le savoir. L’Épouvantail, ainsi, pour avoir une tête remplie de paille, n’en est pas moins le personnage le plus astucieux de la petite troupe, et fait preuve à maintes reprises de son esprit brillant ; de même, le Bûcheron d’étain se révèle très vite un être sensible – trop sensible, sans doute, lui dont les larmes entraînent la rouille… Le lion peureux, enfin, fait montre régulièrement d’une bravoure sans égale. On se doute, dès lors, que Dorothy aussi se voit réserver une petite surprise du genre… Et c’est avec humour et astuce que L. Frank Baum joue de ces paradoxes.
Il n’en reste pas moins que Dorothy, la conne, alors qu’elle se trouve dans un endroit aussi merveilleux, veut retourner dans la grisaille horizontale du Kansas. Pourquoi ? Telle est sa réponse à l’Épouvantail (p. 27) :
« ‘No matter how dreary and grey our homes are, we people of flesh and blood would rather live there than in any other country, be it ever so beautiful. There is no place like home.’
« The Scarecrow sighed.
« ‘Of course I cannot understand it,’ he said. ‘If your heads were stuffed with straw, like mine, you would probably all live in the beautiful places, and then Kansas would have no people at all. It is fortunate for Kansas that you have.’ »
On le voit, Le Magicien d’Oz ne manque donc pas d’humour… Mais c’est aussi et avant tout un livre d’une grande inventivité, d’une féerie remarquable, d’une – lâchons le mot – fantasy étonnante et fourmillant d’idées, très en avance sur son temps – telle est du moins l’impression que ce court roman pour la jeunesse m’a laissée. On y trouve en effet mêlés les modes du conte façon Alice au pays des merveilles, avec notamment une succession de saynètes souvent très courtes et passablement surréalistes, et, en même temps, un mode de la quête, empruntant aux récits de chevalerie, et annonçant, si ce n’est encore Le Seigneur des anneaux, au moins Bilbo le Hobbit, et ce avec un luxe de détails : l’aventure est très précisément détaillée, au point de pouvoir être rendue sur une carte au jour près (les haltes pour les repas et le repos sont toujours mentionnées), et, si les saynètes sont toutes plus folles les unes que les autres, à la différence de ce qui se produit chez Carroll, où c’est la « logique illogique » des rêves qui prédomine, l’enchaînement des séquences est ici très rigoureux, obéissant à un plan. Nous avons vraiment une « compagnie » qui effectue une quête, découpée en trois actes, et c’est une chose qui m’a paru assez visionnaire.
Je ne m’étendrai guère sur le style, extrêmement simple – d’aucuns, à l’époque, le jugèrent « trop simple »… –, ce qui rend la lecture en anglais de The Wizard of Oz extrêmement aisée.
Sur le pur plan du simple plaisir de lecture, Le Magicien d’Oz est à n’en pas douter une très grande réussite, et mérite bien ses lauriers de classique de la littérature enfantine. Sous cet angle, il vaut bien à mon sens le cruel mais néanmoins excellent Peter Pan, et l’on ne peut que regretter la méconnaissance de cette œuvre chez les bambins français. Mais si l’on s’éloigne de ce seul plan pour accéder à celui du sens, de la symbolique, je dois avouer, ici, y préférer largement Peter Pan et plus encore les Alice du pourtant très austère Lewis Carroll, en raison d’un certain moralisme imprégnant Le Magicien d’Oz, et dont nous avons eu un aperçu tout à l’heure. J’ai failli écrire un moralisme « typiquement américain », mais je craignais les attaques contre mon supposé anti-américanisme primaire (ou secondaire, ça dépend des jours)… Loin de moi toute velléité de ce genre, mais je pense, oui, que sur le plan symbolique, The Wizard of Oz est bien un livre « définitivement américain » : son optimisme, sa morale, ses personnages et leur destin, tout ou presque en somme, me paraissent typiques de conceptions propres au « nouveau monde », et cela explique peut-être pourquoi ce livre, pourtant fort réussi, n’a finalement pas trouvé son public en Europe.
Qu’importe. J’ai passé un excellent moment en compagnie de Dorothy, de Toto, de l’Épouvantail, du Bûcheron d’étain et du Lion peureux. Me reste plus qu’à lire CosmoZ…

/image%2F1385856%2F20160114%2Fob_cfb8b0_caligari.jpg)


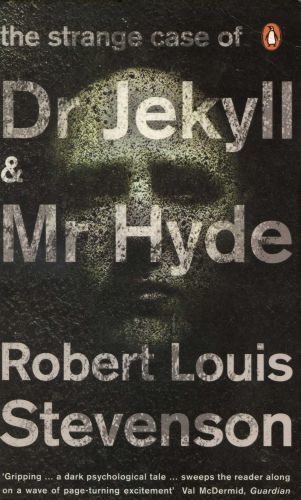
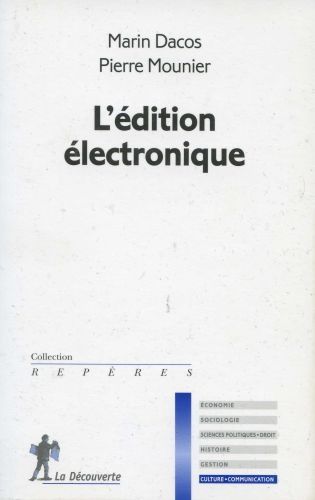




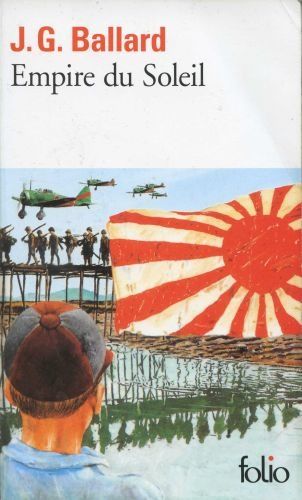


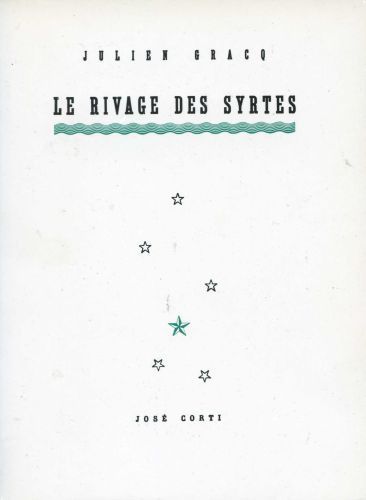


/image%2F1385856%2F20150204%2Fob_660a87_georges-abdaloff-croque-par-christell.jpg)