"Inflorenza"

Inflorenza
Tiens ? On me propose de recevoir des jeux de rôle en service de presse, maintenant ? Ah mais je suis pour, hein ! N’hésitez pas, les gens ! Surtout en ce moment, dois-je dire, où, parallèlement au travail qui m’empêche de tenir à jour ce blog autant que je le souhaiterais, je suis pris de frénésie rôlistique aiguë. Aussi, quand le sieur Thomas Munier, créateur entre autres de cet Inflorenza, m’a proposé de recevoir un exemplaire (façon artisanale), de son dernier opus, je me suis certes renseigné sur le contenu de la chose histoire de, mais n’ai dès lors guère hésité longtemps : c’est que tout cela m’avait l’air diablement intéressant, et, autant le dire de suite – je suis nul pour le suspense –, intéressant ce fut en effet ; intriguant, mais aussi fascinant… et enthousiasmant. Encore que le mot « stimulant » serait peut-être plus juste : il y a là-dedans de quoi se triturer les neurones à grands renforts de concepts novateurs et audacieux (ou du moins qui m’ont semblé tels).
Jeu de rôle bicéphale, Inflorenza peut certes ressembler un minimum à ersatz « traditionnel » de notre loisir adoré (quand bien même on est effectivement très loin de Donj’…), si l’on adopte le mode dans lequel le « confident » devient une sorte de meneur de jeu, mais, une fois n’est pas coutume, c’est dans son approche la plus radicalement « narrativiste » (mais je ne suis jamais sûr d’employer ce terme à bon escient) qu’il se montre le plus inventif, déconcertant et intelligent. C’est à vrai dire la première fois qu’un jeu « à narration partagée » (cette appellation serait sans doute plus exacte) me paraît aussi bien foutu ; aussi, j’y ai retrouvé l’enthousiasme qu’avaient suscité chez moi (sur le papier…) Fiasco ou Mnémosyne, sans les quelques préventions qui avaient pu perturber mes comptes rendus pour ces lectures édifiantes ; et ce quand bien même Inflorenza n’est pas exempt de tout reproche, ne me faites pas dire ce que je n’ai pas dit, hein.
D’ailleurs, si le projet m’intriguait suffisamment pour que je m’avoue intéressé par ce service de presse, je n’étais pas pour autant certain d’y trouver mon plaisir. Il est vrai que je ne connais pas grand-chose au jeu de rôle « indépendant » ou « amateur » (comme vous voudrez), et que mon premier contact avec le genre – Monostatos, pub en fin de volume – m’avait laissé au mieux perplexe. Or de perplexitude il est encore question à l’égard des deux autres jeux plébiscités par Thomas Munier, œuvres de ses petits camarades, à savoir Prosopopée et Sens (je suis plein de préjugés…). Mais l’approche d’Inflorenza me paraît à la fois plus pertinente et séduisante. On y trouve en effet aussi bien la description d’un univers très riche et bien conçu – Millevaux, qui peut également servir de cadre pour Sombre – que des principes de jeu novateurs et de toute évidence amplement mis à l’épreuve ; c’est même probablement la première fois qu’un jeu « narratif » me paraît aussi bien foutu, que le système (terme horrible, dans ce cadre précis ?) me paraît aussi convaincant.
Bon, et si j’arrêtais de tourner autour du pot, moi ?
Millevaux, donc. Une Europe post-apocalyptique (suite à un gros délire conspirationniste qui est bien la seule chose à me laisser de marbre, au mieux, dans toute cette histoire), où la forêt a repris ses droits, et en a même usurpé pas mal d’autres. Millevaux, dans un sens, c’est La Forêt d’Iscambe, mais en glauque ; c’est Malevil qui se prolonge, aussi. Un enfer vert, un monde hostile débordant de bébêtes dangereuses (les Horlas), où la corruption et l’égrégore suscitent le surnaturel. Pas vraiment un petit coin de paradis, donc, d’autant que – et là je ne peux m’empêcher d’en faire mention sur ce blog interlope, ça rejoint une autre de mes passions que je ne cache guère – Shub-Niggurath (surtout), Hastur et même le Necronomicon sont de la partie…
Inflorenza nous propose donc de jouer des « héros, salauds et martyrs » dans Millevaux (environ en 2400 après Jean-Claude). Passons à la création des personnages.
… Y en a pas.
Hein ?
Ben non. Dans cette sorte de « psychodrame » (voyez le décevant De Profundis), On crée les personnages en cours de partie. Et ça ne pose aucun problème, puisqu’il n’y a pas vraiment de feuille de personnage non plus.
HEIN ?!
Ben non. En lieu et place du machin bizarre et compliqué avec plein de cases et de chiffres qu’on nous sert traditionnellement en rôlistie, une feuille vierge tout d’abord, puis sur laquelle on écrit des phrases (mais attention, Thomas Munier nous dit qu’il ne s’agit pas pour autant d’un « jeu littéraire » ; ce en quoi, dois-je dire, il me paraît peut-être ne pas aller tout à fait au bout de sa démarche, mais je dis sans doute des bêtises). Il n’y a véritablement de contrainte que pour la première de ces phrases, qui doit contenir le verbe « vouloir » et être en rapport avec un autre personnage.
Ces phrases remplissent plusieurs usages, au moins trois. D’une part, elles contribuent donc à la définition du personnage ; d’autre part, elles déterminent sa marge d’action (pour agir – pour jeter les dés, dirait le barbare –, le joueur doit mettre en avant autant de phrases qu’il le souhaite : il faut qu’elles soient adaptées à la situation de jeu, et c’est tout ; on peut ainsi – et je trouve ça très bien vu – choisir de mettre en avant une phrase constituant un handicap) ; enfin, elles constituent en quelque sorte les « points de vie » du personnage, j’y reviens de suite.
Je tente de résumer (ce que je crois avoir compris : les exemples de parties sont ici très utiles). Lors des « conflits », et donc lors de l’utilisation de ces phrases, le joueur jette un dé (à douze faces en principe) pour chaque sentence mise en œuvre. Sur un résultat de 1 ou 2, on dit que c’est un dé de « sacrifice » : l’action réussit, mais au prix d’un sacrifice, et il faut rayer une phrase, qui devient obsolète ; si le joueur n’a plus de phrases à sa disposition, le personnage est retiré de la partie (mais pas nécessairement mort pour autant). Si le résultat est de 11 ou 12, on parle de dé de « puissance », et l’action réussit sans sacrifice. Si le résultat est compris entre ces deux extrêmes, on parle de dé de « souffrance », et l’action échoue (mais, si je ne m’abuse, on écrit une phrase ; on rejette alors le dé pour déterminer un thème orientant sa rédaction). Il y a donc une part de « tactique » dans l’utilisation des phrases, surtout dans la mesure où un dé de sacrifice « tue » les autres dés (dont on ne tient pas compte), et où plusieurs dés de sacrifice « contaminent » le reste de la poignée (arrêtez-moi si je dis des bêtises, ce n’est pas exclu…), ce qui peut très vite susciter une pénurie de phrases, et donc faire gicler le personnage, au moins temporairement.
La notion de « sacrifice » est donc essentielle dans Inflorenza, jeu qui fait autant la part belle aux personnages qu’à l’histoire, au sens de « dramaturgie » (le « fusil de Tchekhov »). Et voilà qui me paraît très intéressant, surtout, à vrai dire, au regard de parties récentes dans lesquelles votre serviteur s’est retrouvé impliqué, que ce soit en tant que MJ ou en tant que joueur, sur des jeux autrement plus traditionnels, et où l’on a fini par dégager l’idée d’une certaine « beauté dans l’échec ».
Je ne vais pas m’étendre au-delà sur les subtilités du système (les différentes sortes de conflits, les pouvoirs, etc.) ; procurez-vous Inflorenza et voyez par vous-mêmes, ah mais. Il ne me paraît pas non plus utile de développer ici le background plus que de raison, mais c’est assez bien fait (notamment en ce qui concerne les croyances religieuses) ; et ça appelle semble-t-il des développements ultérieurs dans de prochains suppléments (chouette, faudra que je me tienne au courant).
L’essentiel est là : l’univers est bon, mais, une fois n’est vraiment pas coutume, c’est le système qui me paraît surtout séduisant en l’espèce. À vrai dire, de tous les systèmes « de narration partagée » que j’ai pu lire (il n’y en a pas beaucoup, certes), c’est de loin ce jeu de rôle « amateur » qui emporte la palme de la pertinence. Et ce n’est pas rien, tout de même.
Le bilan est donc sans appel, et Inflorenza s’avère encore meilleur que ce à quoi je m’attendais. Nous avons là un jeu mûrement réfléchi, intelligent et stimulant, sans oublier d’être un jeu pour autant. Mine de rien, c’était une gageure. Félicitations, donc, à Thomas Munier, et longue vie à Inflorenza, que je suis bien curieux d’essayer un de ces quatre (auquel cas je me livrerai peut-être à un compte rendu de partie, on verra).

/image%2F1385856%2F20160114%2Fob_cfb8b0_caligari.jpg)


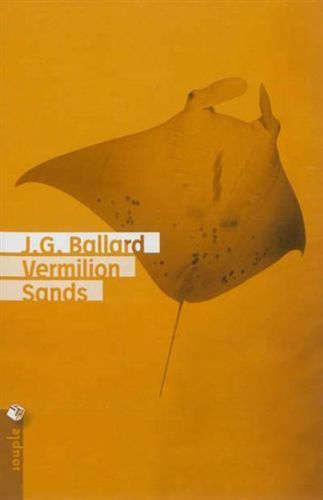



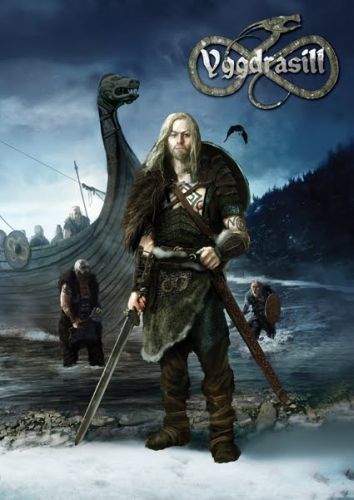
/image%2F1385856%2F20150204%2Fob_660a87_georges-abdaloff-croque-par-christell.jpg)