Deadlands Reloaded : Stone Cold Dead
Deadlands Reloaded : Stone Cold Dead, Black Book Éditions,[2013] 2015, 159 p.
Avertissement préalable SPOILERS : je vais ici causer d’une campagne pour Deadlands Reloaded, sans me gêner pour révéler des machins, même si je ne vais certainement pas me montrer exhaustif. Voyez donc ça comme une base pour une éventuelle discussion entre MJ et curieux – les joueurs, et mes joueurs tout particulièrement, ouste ! Il n’y a aucune certitude que je maîtrise cette campagne, mais ça n’est pas exclu. Alors...
DERNIER SURSAUT
Stone Cold Dead est peu ou prou (avec l’exception toujours singulière de l’Écran du Marshal) l’unique supplément à ce jour de la gamme française de Deadlands Reloaded, et je suppose qu’à ce stade, deux ans plus tard, on peut dire sans trop de risques de se tromper qu’il sera également le dernier ? En fait, c’est une impression d’autant plus sensible au sortir de cette lecture, et j’aurai bien des occasions d’y revenir… C’est fâcheux, parce que ce jeu a un potentiel énorme – impression qui ressort d’ailleurs de ce supplément, sympathique par un certain nombre d’aspects… mais bâclé, aussi. C’est bien le problème.
[EDIT : on m'a fait remarquer qu'il y a quelque temps de cela, Black Book a annoncé avoir trois, puis non, quatre, campagnes de prévu. Je serais ravi de voir ces suppléments paraître, auquel cas je ferai mon mea culpa - mais j'y croyais (crois ?) tellement plus... Bon, on verra - et mes excuses si jamais.]
Stone Cold Dead se présente comme une campagne (c’est éventuellement à débattre) de création française (signée Guillaume Baron, plus précisément), sans équivalent donc en VO, où le cadre de jeu, la ville de Crimson Bay en Oregon, avait pu être mentionnée mais sans faire l’objet d’une description plus approfondie. En fait, l’intérêt de ce supplément, et bizarrement ça me renvoie à ma précédente lecture du genre, Coffin Rock, encore que sur un format plus ample, réside sans doute dans l’approche de Crimson Bay comme un « bac à sable », à partir duquel on peut broder, notamment mais pas exclusivement en jouant « la campagne », laquelle peut être considérablement resserrée ou au contraire étendue, fonction des attentes et des retours de la table. Mais, dans tous les cas, le supplément montre assez vite ses limites…
Par ailleurs, il faut se rappeler que Stone Cold Dead avait été financé par crowdfunding – il lui avait donné son titre, mais le financement portait en fait tout autant sur l’Écran du Marshal et les Cartes d’aventure (et les exemplaires du Crimson Post censément utiles à cette campagne, mais pas reproduits ci ?) : l’impression de fourre-tout destiné à se débarrasser de l’encombrant machin n’en était que plus forte. Mais, jugements de valeur mis à part, cette genèse explique sans doute la présence de quelques « compléments » dans le livre, et notamment un bestiaire... qui pour le coup n’a absolument rien à voir avec la « campagne » Stone Cold Dead ou même avec la ville de Crimson Bay. Ce qui ne veut pas dire que c’est inintéressant ou inutile, mais cela témoigne tout de même de ce que ce bouquin, c’est un peu tout et n’importe quoi.
JOLI, MAIS UN PEU TARABISCOTÉ… ET PAS FINI
Ceci dit, le premier contact, le contact visuel, est assurément positif, en ce que les illustrations intérieures, signées David Chapoulet et Simon Labrousse, sont très belles – beaucoup plus que celles du livre de base, ou que la couverture du présent supplément, d’ailleurs (ils n'en sont pas responsables). Il y a une patte, une ambiance, de l’application… Le résultat est vraiment irréprochable, et même admirable.
Côté graphisme, un autre aspect est davantage problématique – et qui porte sur les cartes et plans. Au premier coup d’œil, on remarque que, mise à part une carte en deux planches de Crimson Bay, on n’a pas grand-chose à se mettre sous la dent… À ce stade, impossible d’en déduire quoi que ce soit, on s'en passe souvent très bien, mais, après lecture, oui : il y a cette fois un problème sous cet angle. Et qui concerne notamment cette unique carte de Crimson Bay… C’est qu’elle est incomplète, au regard des nécessités du jeu – des endroits cruciaux, et pour lesquels un plan aurait été très utile (je pense notamment à la communauté des anciens esclaves) n’y figurent pas et ne figurent nulle part ailleurs – on peut s’accommoder, j’imagine, de l’absence d’éléments sur l’usine de munitions, ou les puits à la limite, mais il y a quand même un certain vide regrettable ici ; d’autant que la carte, ai-je l’impression, ne correspond pas toujours aux indications du texte ? Une question d’échelle, notamment : le port devrait être plus éloigné, par exemple, non ?
Mais le problème le plus éloquent, ici, concerne l’après Crimson Bay – car, à terme, la campagne s’éloigne de la florissante ville de Gamblin’ Joe Wallace : on est censé se rendre à Shan Fan, avec un certain nombre d’événements en route (à la discrétion du Marshal) ; aucun plan de quelque sorte que ce soit, à l’échelle de la carte ou approprié à la figuration de l’action – et, à terme, cela peut devenir problématique, tout particulièrement quand on arrive à Shan Fan, ville importante mais dont nous n’avons certainement pas assez d’éléments ici pour la présenter aux joueurs : cela dépasse l’absence de carte, à ce stade – il n’y a peu ou prou rien sur cette ville ! Une « annexe » (?!) est supposée décrire un endroit important du scénario, pour le grand finale, mais difficile d’en retirer grand-chose ; et s’il y a bien un ersatz de plan concernant ce moment de l’histoire (mais présenté dans la campagne en elle-même, pas dans cette annexe ?), bonne chance pour en faire quoi que ce soit… Autant d’éléments renforçant cette tenace impression d’avoir entre les mains un produit « pas fini », ou, pour ainsi dire, bâclé.
Mais je reviens au premier coup d’œil, car il est une autre chose qui frappe d’emblée, ou du moins peut rendre légitimement suspicieux, et c’est que le plan du livre n’est pas hyper cohérent. Dans les grandes articulations, on commence par la campagne, on poursuit avec la description de la ville et des PNJ, et on finit avec… n’importe quoi. J’ai naïvement supposé que ce plan avait sa raison-d’être, et l’ai donc suivi, mais le constat se fait bien vite de ce que la lecture des éléments de description de la ville de Crimson Bay et plus encore des PNJ devrait se faire au préalable – pas mal d’éléments de la campagne sont obscurs, ou semblent incohérents voire incompréhensibles, sans ces informations essentielles. Il faut avoir une idée préliminaire de qui sont Gamblin’ Joe Wallace, le shérif Drent, les figures de Chinatown, etc., pour comprendre comment s’articule le récit. Ajoutons que quelques points sont précisés dans les « annexes » (accroches de campagne et description de la résidence de Leï Pan surtout), qu’il aurait été plus utile de trouver à leur place dans la campagne, et qui en sont ainsi séparés, ainsi que de la description de Crimson Bay, par un bestiaire qui n’a absolument rien à voir et des PJ prétirés génériques, pas le moins du monde associés à ce cadre de jeu (des pages totalement inutiles, pour le coup ?).
Tout cela n’est sans doute pas dramatique, et je suppose que d’aucuns me reprocheront une fois de plus, à me voir pester pour ces broutilles, d’être un MJ fainéant, OK, mais mon impression de bâclage n’en est pas moins renforcée : quand j’achète un bouquin de jeu de rôle, sans préjuger de ma charge de travail personnel d’adaptation, etc., qui s’impose de manière générale, j’apprécie quand même d’avoir entre les mains un produit relativement fini… Et c’est un gros souci, concernant ce supplément.
UNE HISTOIRE DE VENGEANCE
Bon, dans le cadre de ce compte rendu, je vais m’en tenir au plan du bouquin, et donc commencer par la campagne Stone Cold Dead à proprement parler. Elle peut être décomposée en trois parties : la première et la plus longue (et de très loin la plus intéressante…) se déroule à Crimson Bay, la deuxième, éventuellement très brève et très anarchique en même temps, correspond au voyage entre Crimson Bay et Shan Fan, et la dernière, donc, se déroule à Shan Fan.
Ah, une note temporelle, de manière générale : nous sommes en 1876, dans ce supplément, soit un peu avant le cadre de jeu présenté dans le livre de base, qui se situe quant à lui en 1879. Cela a une conséquence de taille : la guerre de Sécession n’est pas terminée ! En Oregon, on est sans doute loin des champs de bataille, mais la guerre est une raison essentielle à la prospérité de la ville, via l’usine de munitions de Wallace, et cela peut peser sur des PJ éventuellement rattachés à tel ou tel camp (par exemple, des membres de l’Agence ou des Texas Rangers).
Le fond de l’affaire
Je ne vais pas rentrer dans les détails, hein – notamment en ce qui concerne les grands marionnettistes derrière tout ça. Esquissons hâtivement l’arrière-plan : la ville portuaire de Crimson Bay, en Oregon, pas très loin des limites du Grand Labyrinthe, est des plus prospère, sous la houlette de Gamblin’ Joe Wallace, un industriel de Boston qui a fait sa fortune dans l’armement : à Crimson Bay, il a installé une fabrique de munitions qui approvisionne les forces de l’Union. Tout le monde sait que la ville doit tout à son « maire », un personnage haut en couleurs et finalement assez sympathique – beaucoup plus en tout cas que son homme de main, le shérif Drent, qui terrorise tout le monde ; mais les plus conciliants, dont Wallace lui-même, supposent que c’est le prix à payer pour le taux de criminalité extrêmement bas dans la bourgade… Et l’homme d’affaires « compense », d’une certaine manière, en finançant l’église, l’école, etc. Même si les saloons et bordels captent sans doute davantage l’attention.
Quoi qu’il en soit, la ville attire du monde, et de plus en plus, et Wallace aimerait accentuer encore le phénomène – d’où l’organisation par ses soins d’un grand tournoi de poker, avec une récompense conséquente, et qui peut être la raison pour laquelle les PJ se rendent à Crimson Bay (une autre raison « facile » est d’avoir une dette envers Wallace ; en annexe, on trouve d’autres suggestions d’implication des PJ dans la campagne, qui valent ce qu’elles valent, mais c’est de toute façon bienvenu).
Mais Wallace a un problème, en parallèle – et qu’il garde secret : la prospérité de Crimson Bay, il le sait, implique le développement du chemin de fer ; une ligne d’une petite compagnie passe en ville, mais il faut la rattacher à un réseau plus ample (dans l’optique sans doute des guerres du rail ? La campagne n’est pas très explicite à ce propos, mais la région est censée être sous la coupe de la Iron Dragon de Kang, ce qui peut faire sens pour la suite des opérations…). Problème, donc : les rails doivent passer par… eh bien, le seul endroit de la région qui n’appartient pas à Wallace, en fait : une communauté d’anciens esclaves, résultat d’un legs d’un philanthrope antérieur à l’arrivée du Bostonien dans la région… La situation juridique des anciens esclaves, et plus encore leur statut de propriétaires, sont relativement flous pour le quidam, et peu nombreux sont ceux qui savent ce qu’il en est – Wallace en fait partie, qui a fait, discrètement, plusieurs offres, très généreuses, pour racheter le terrain, toutes refusées (par respect pour le testament ?), mais Drent aussi le sait… et ses méthodes sont tout autres : il compte profiter de l’agitation du tournoi de poker pour mettre en place un véritable complot désignant les anciens esclaves comme des boucs-émissaires, moyen de les faire dégager une bonne fois pour toutes – Wallace ne sait rien des intentions de son shérif, mais les deux hommes sont bien liés à des intérêts supérieurs, et notamment, à Shan Fan, le très puissant Leï Pan, qui approvisionne l’usine de Crimson Bay en poudre (noter au passage que la communauté chinoise est importante en ville, il y a une « Chinatown » à Crimson Bay – triades, opium, arts martiaux et sorcellerie seront très probablement de la partie).
Les PJ à Crimson Bay
Et les PJ, dans tout ça ? Bonnes poires ou redresseurs de torts, ils auront leur rôle à jouer… même si un peu, eh bien, sur des rails.
La campagne débute ainsi, à Crimson Bay, et cela peut durer, le cas échéant – car tout n’est pas « nécessaire » dans les pages consacrées aux événements survenant dans la ville, il y a plein de « petites aventures » pas à proprement parler indépendantes, mais que l’on peut jouer ou dont on peut faire l’économie, à la discrétion du Marshal (dont, par exemple, une embrouille tentaculaire au port que je me vois mal concilier avec le reste).
Les PJ arrivent en ville pour quelque raison, et il y a fort à parier, après une éventuelle mise en jambes incluant tiques de prairie et dégénérés cannibales, que Wallace et/ou Drent les invitent à participer à la sécurité de Crimson Bay à l’occasion du tournoi de poker. Qu’ils l’acceptent ou pas, ils sont de toute façon aux premières loges quand le complot de Drent commence à se mettre en place – en fait, il s’agit peut-être même, dans un premier temps, de détourner leur attention avec une sordide affaire de meurtre dans Chinatown.
Après quoi le tournoi débute, avec ses joueurs hauts en couleurs, etc. – mais l’événement crucial, ici, est le vol de la prime du tournoi, qui y met un terme de manière précipitée. Forcément, l’enquête de Drent ne tarde guère à désigner des coupables idéaux en la personne des anciens esclaves – au prétexte d’arrêter le coupable, le shérif et sa troupe (et les PJ, le cas échéant...) se rendent dans la communauté, et, comme vous vous en doutez, cela tourne à l’expédition punitive, au massacre pur et simple, contraignant les survivants à la fuite…
Sauf qu’il y a parmi eux Fedor – pas le chef de la communauté des anciens esclaves, néanmoins un de ses membres les plus charismatiques… Et un prêtre vaudou qui avait fait beaucoup d’efforts, depuis des années, pour ne plus faire usage de ses dons surnaturels. L’assaut sur la communauté des anciens esclaves réveille sa rancœur, et il entend se venger – de Crimson Bay, de Wallace, de Drent (il ne fait pas de différence), et aussi de celui qu’il en vient à supposer se trouver derrière tout ça, après avoir mené son enquête en ville : Leï Pan, une des sommités de Shan Fan.
La vengeance de Fedor commence par un empoisonnement des puits assurant l’approvisionnement en eau de Crimson Bay, procédé qui fait déjà des dégâts… mais, comme de juste, une armée de zombies prend bientôt le relais !
Au-delà de Crimson Bay…
Et c’est ici, à mon sens, après ce climax qui n’est donc pas censé en être totalement un, que la campagne, jusqu’alors des plus sympathique finalement, même si guère originale sans doute, commence à sérieusement patiner. Il y avait déjà quelques pains, oui (incluant l’absence de cartes et de contexte pour l’expédition punitive ou pour l’empoisonnement des puits dans la tempête, etc., scènes qui ont pourtant un sacré potentiel, contrairement au « supplément de tentacules » un peu trop gratuit déjà envisagé plus haut), mais ça se tenait bien, c’était cohérent, il y a avait pas mal d’opportunités aussi bien de roleplay que d’horreur ou d’action… C’était assez linéaire, j’imagine, mais en usant des ressorts du bac à sable, il devrait être possible d’atténuer cette dimension, je crois.
Mais quitter Crimson Bay est problématique, pour au moins deux raisons : la première, décisive, c’est que les motivations des personnages me paraissent totalement incompréhensibles. Concernant Fedor, l’idée de ne pas tuer Wallace mais plutôt de l’affecter financièrement, parce que ça lui ferait bien plus de mal, OK, mais faire le lien entre ce principe et la virée tranquilou bilou à Shan Fan pour se farcir rien moins que Leï Pan, franchement, je n’y arrive pas – que Fedor prenne conscience du bousin est déjà un peu douteux, mais ce coup de tête ne me convainc vraiment pas du tout. D’autant, en fait… que Leï Pan n’a pas forcément grand-chose à voir avec tout ça, et n’est même pas le grand marionnettiste de l’histoire – une enflure assurément, mais bien lointaine pour le coup… Au niveau des motivations, l’affaire se complique en outre concernant Wallace – car c’est lui, et seulement lui, qui peut mettre les PJ sur la piste de Fedor en comprenant que Leï Pan est sa cible... et qu’il s’agit donc pour nos héros de « protéger » le criminel chinois, impitoyable, cruel et surpuissant ? Je n’arrive pas vraiment à comprendre les raisons qu’ont Fedor et Wallace d’agir ainsi, et encore moins pourquoi les PJ devraient, dans cette optique, gagner Shan Fan… Vraiment, ça ne me paraît pas tenir la route. Le dilemme moral censé accompagner et légitimer tout cela guère plus.
La deuxième raison, c’est que, soudainement, nous n’avons plus de contexte. Du tout. Crimson Bay très détaillée, avec ses nombreux lieux et PNJ, cède la place à un grand vide – ce qui pourrait se tenir dans l’absolu pour le périple entre Crimson Bay et Shan Fan, sans doute (encore que... Le Grand Labyrinthe est tout de même bien singulier), mais certainement pas pour Shan Fan en elle-même. Cette ville est forcément différente des autres, elle est aussi beaucoup plus grande et plus peuplée, incomparablement plus complexe à première vue, mais le livre ne nous fournit pas assez d’informations, à mon sens, pour pouvoir vraiment jouer ce cadre bien particulier : dire « Il y a des Chinois » et « Leï Pan est très puissant », ça n’est vraiment pas suffisant…
Et ces deux raisons débouchent sur un vilain écueil, très révélateur à mes yeux de l’incohérence du scénario et de son caractère bâclé à ce stade : le fil rouge s’avère très ténu, quand bien même toujours un peu plus linéaire au fond, et, en route pour Shan Fan, on nous propose plusieurs petites aventures qui, à tout prendre, ne servent à rien, ne sont d’aucun intérêt hors de toute mise en contexte – ce qui inclut le shoggoth dans un fort abandonné : j’ai beau priser la lovecrafterie, je ne vois pas pourquoi je jouerais un truc pareil. À la limite, la séquence « Bad Moon Rising » pourrait être amusante, même s’il n’est pas facile de l’intégrer dans le récit – on y trouve le personnage de Cordell, chef de la communauté des esclaves en fuite, mais je me suis dit qu’on pourrait peut-être le remplacer par Fedor, bidouiller un truc avec les Manitous, et ainsi faire l’économie des scènes à Shan Fan…
Parce que Shan Fan, en l’état… Non. J’imagine que ça peut être un super cadre – mais justement : pas envie de bâcler tout ça faute de contextualisation ! Et, plus on avance, plus les motivations de Fedor concernant Leï Pan ne me paraissent pas tenir la route, et la détermination des PJ à sauver le Chinois encore moins. Je n’ai pas envie de conclure sur un enchaînement falot car « nécessaire » conduisant à une méga-baston en mode « bon, expédions et passons à autre chose » ; et ça, pour le coup, ça me bloque le début de la campagne – j’aime bien ce qui se passe à Crimson Bay, mais je sais que je ne jouerai pas tout ça tant que je n’aurai pas bidouillé une fin satisfaisante ; et tout ce qui se passe à Shan Fan, ici, me paraît foireux et, oui, encore une fois : bâclé.
C’est tout de même embêtant...
CRIMSON BAY EN MODE BAC À SABLE
C’est d’autant plus regrettable que Crimson Bay, dans sa dimension bac à sable, est un contexte plus que correct, tel qu’il ressort des deux chapitres assez détaillés consacrés aux lieux et aux PNJ.
Oh, rien de bien original ici : la litanie habituelle de shérifs pourris et d’adjoints pires encore, des saloons et des bordels pour toutes les bourses, le croque-mort qu’on évite de trop fréquenter, le prêtre qui n’est pas ce qu’il prétend, le médecin sympa mais instable… Rares, finalement, sont les personnages qui se hissent au-dessus du cliché – mais, bizarrement, c’est peut-être bien le cas de Gamblin’ Joe Wallace, plus complexe qu’il n’en a l’air, au plan moral notamment : c’est décidément la figure qui attire l’attention. Un point peut-être aussi pour les figures de Chinatown ? Pas spécialement inventives, non, mais sourdement inquiétantes, et c’est déjà ça. Mais, pour le reste, on s’accommode sans trop de soucis des clichés, au fond : dans un jeu aussi codé que Deadlands Reloaded, ils ont leur place – et il peut suffire, parfois, d’une petite marotte, au détour d’une ligne, pour conférer à ces personnages, finalement, un semblant d’âme, hôteliers délateurs ou fanatiques de la chasse à l’ours.
Lieux et PNJ sont bel et bien développés avec un certain soin – qui contraste avec l’impression générale de bâclage pour quasiment tout le reste. C’est, finalement, l’atout de ce supplément, je suppose – un cadre « bac à sable » qui contient pas mal d’éléments d’intrigue, à même d’épicer la campagne Stone Cold Dead pour la rendre moins linéaire, ou, à vrai dire, utilisable en tant que tel, comme contexte indépendant. Il y a de quoi faire, oui.
LE FOURRE-TOUT FINAL
Après quoi, c’est un peu le foutoir… Du fait de « bonus » débloqués lors du financement participatif, pour partie, mais avec d’autres témoignages d’une conception globale assez hasardeuse.
Le bestiaire
La partie la plus intéressante est probablement le bestiaire – mais il est d’autant plus regrettable qu’il soit totalement indépendant de la campagne Stone Cold Dead.
En fait, pour certaines des créatures ici décrites, il me paraît assez difficile de les intégrer dans une campagne de Deadlands Reloaded quelle qu’elle soit : les Clockwork Men notamment, très liés à l’est et même surtout aux grandes villes, New York en tête. Dommage, parce que leur description (très détaillée, comme pour les autres créatures de ce bestiaire – c’est un format totalement différent par rapport au bestiaire du livre de base) est assez intéressant. Même chose ou presque pour les joueurs morts-vivants du Mary-Ann’s Lucky Guess, le bateau fantôme ne naviguant en principe que sur le Mississippi, soit en gros la limite orientale de l’ère de jeu traditionnelle.
Le Bataillon de la Mort du colonel Amos, ou l’Homme de boue, sont plus classiques, mais pas inintéressants et plus aisés à mettre en scène.
On trouve deux grosses bestioles aquatiques, en outre : le Carcharodon Mégalodon, ou « Terreur Grise », est un requin colossal qui sème la zone dans le Grand Labyrinthe, Les Dents de la mère de Godzilla, en gros, OK, mais la Créature de Cold Lake Bay n’est qu’une énième variation sur Nessie, sans plus d’intérêt.
Reste deux créatures sans caractéristiques : les Étalons funestes peuvent être très intéressants, même s’ils impliquent sans doute un jeu dangereux avec les PJ – je suis plus sceptique concernant l’Arbre aux mille visages, finalement convenu et qui aurait gagné à se voir consacrer davantage d’attention.
Un bestiaire plus ou moins utilisable, donc, mais joli et pouvant, par le seul biais d’une créature, générer assez aisément un scénario – je suppose donc que c’est malgré tout un bon point.
Les prétirés
Suivent sept PJ prétirés : un bagarreur en fait fana de dynamite, un « combattant » sans rien de spécial, une « courtisane », un disciple des arts martiaux, une huckster lambda, un pistolero pété de thune et une savante folle.
C’est d’un intérêt plus que douteux. L’historique des personnages est expédié en un paragraphe et ne suffit que rarement à leur conférer une épaisseur de départ ; ces PJ sont éventuellement un peu des redites des prétirés du livre de base, d'ailleurs.
Mais le souci… Enfin, ce n’est pas à proprement parler un souci, c’est un regret : il y avait là une occasion de livrer des prétirés d’emblée associés à la campagne Stone Cold Dead, ce qui aurait considérablement simplifié le travail d’implication des PJ, toujours délicat… Mais rien de la sorte, non. Un bonus inutile.
Broutilles autour de Stone Cold Dead
Après ces deux éléments totalement indépendants de Crimson Bay et de la campagne Stone Cold Dead, on y revient une dernière fois pour quelques annexes (je passe sur le nouvel exemplaire de journal).
En trois pages, on revient sur la résidence de Leï Pan à Shan Fan – comme dit plus haut, ça n’est pas forcément très évocateur. On y trouve les caractéristiques des Tigres Noirs, les gardes de Leï Pan, et de leur chef Kao.
Entre deux eaux, un tout petit texte sur les conséquences éventuelles pour les PJ de leur comportement à Shan Fan – d’une utilité très limitée.
Enfin, mieux, dix raisons de venir à Crimson Bay – ça, OK.
PAS FINI…
L’impression demeure, tenace, d’être en présence d’un supplément un peu bâclé. Peut-être le projet avait-il été lancé avec les meilleures intentions du monde, et cette idée d’une campagne de création française était bienvenue ; il en reste heureusement quelque chose : un cadre de bac à sable pas bouleversant d’originalité mais très sympathique, une campagne qui démarre assez bien en dépit d’une vague linéarité à vue de nez aisée à contourner, et, dans un autre registre, des illustrations de qualité.
Mais, dans la campagne, à l’heure de quitter Crimson Bay, c’est comme s’il y avait soudainement beaucoup moins d’implication : le voyage jusqu’à Shan Fan consiste en séquences totalement indépendantes, le cadre de Shan Fan n’est en rien détaillé et ce qui s’y produit est d’un ennui mortel – que la cohérence douteuse de l’intrigue depuis quelque temps déjà n’arrange pas le moins du monde. Les aides de jeu en ont fait les frais depuis bien plus longtemps sans doute, avec des absences regrettables çà et là.
Le fourre-tout final, même si pas dénué d’éléments intéressants dans l’absolu, accentue encore cette impression, et c’en devient navrant ; c’est comme si le livre, ou l’éditeur derrière lui, lâchait dans un soupir à la face du lecteur : « Bon, passons à autre chose... »
C’est vraiment dommage. Mais je n’exclus pas d’en faire usage quand même – en y changeant pas mal de choses. D’aucuns diront donc que c’est de toute façon le boulot du MJ – au risque de me répéter, je tends tout de même à croire que ce travail nécessaire, inévitable et même bienvenu gagnerait à se développer sur des bases plus solides que cela, c’est-à-dire sur un supplément qui soit, grosso merdo, « fini ». Et Stone Cold Dead ne fait vraiment pas cette impression.

/image%2F1385856%2F20160114%2Fob_cfb8b0_caligari.jpg)




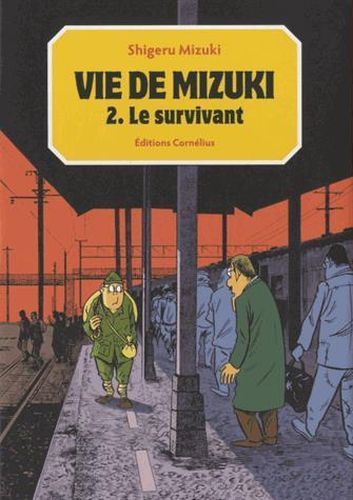








/image%2F1385856%2F20150204%2Fob_660a87_georges-abdaloff-croque-par-christell.jpg)