Les Notes de l'ermitage, de Kamo no Chômei
KAMO NO CHÔMEI, Les Notes de l’ermitage, suivi de Histoires de conversion, [Hôjôki 方丈記 ; Hosshinshû 発心集], présentés et traduits du japonais par René Sieffert, calligrammes de la couverture par Sôryû Uesugi, Paris, Publications Orientalistes de France, coll. Tama, [1212] 1995, 94 p.
RELECTURE : LA QUESTION DE LA TRADUCTION
Énième relecture d’un très court texte, splendide, et dont je ne me lasse pas… Du coup, j’avais déjà eu l’occasion d’en parler sur ce blog, sous le titre Notes de ma cabane de moine – l’essai classique de Kamo no Chômei, datant de 1212, était alors traduit par le Révérend Père Sauveur Candau, et accompagné d’une abondante postface de Jacqueline Pigeot. Je l’avais brièvement mentionné à nouveau lors de ma relecture de l’anthologie Mille ans de littérature japonaise, éditée (et traduite) par Nakamura Ryôji et René de Ceccatty – c’était en fait dans cette édition, sous le titre Écrit de l’ermitage, que j’avais découvert cette merveille, il y a de cela presque une quinzaine d’années… Mais, entre cette première lecture et celle que j’avais chroniquée ici même, j’étais régulièrement repassé par ce texte, dans une autre traduction française – et pour le coup la meilleure, je crois : celle de René Sieffert, sous le titre Les Notes de l’ermitage ; et c’est à cette version que je retourne aujourd'hui.
René Sieffert, éminent japonologue, était sans doute le plus important traducteur français de la littérature japonaise classique : rien que sur ce blog, je peux ainsi renvoyer au premier tome des Tragédies bourgeoises de Chikamatsu, aux dits de Heichû, de Hôgen, de Heiji et (surtout) des Heiké, ainsi qu’aux Contes de pluie et de lune de Ueda Akinari – mais on lui doit aussi d’autres traductions que j’ai pu aborder sans que cela ne ressorte sur ce blog, par exemple du Man.yôshû, du Conte du coupeur de bambou, ou encore (et surtout ?) du Dit du Genji, de Murasaki Shikibu, et il y aurait sans doute bien d’autres titres à mentionner (y compris dans une littérature plus contemporaine – voyez, ici, Les Belles endormies, de Kawabata Yasunari) ; je vous dirai bientôt quelques mots, d’ailleurs, de l'anthologie poétique classique De cent poètes un poème – c’est toujours du René Sieffert.
Ce traducteur méticuleux, extrêmement précis, a toutefois, ai-je l’impression, un trait caractéristique qui peut s’avérer problématique, à l’occasion : désireux de rendre au mieux la langue japonaise classique, il fait souvent le choix d’un français un peu (ou pas qu'un peu) archaïque – quitte à perdre en spontanéité ce qu’il y gagne en élégance… Des décisions mûrement réfléchies, certes, mais qui n’en sont pas moins des partis-pris, admis comme tels – voyez, dans Le Dit du Genji, ce moment important de la préface où le traducteur explique avoir pris pour modèle Saint-Simon disséquant la cour de Versailles. Dans certains cas, je crains que ce ne soit un peu trop pour ma pomme – tout spécialement quand c’est de poésie qu’il s’agit ; j’aurai l’occasion d’y revenir, donc, en traitant de De cent poètes un poème, mais c’est aussi vrai du Man.yôshû, etc. (ou, d'ailleurs, et peut-être plus encore, des passages chantés des Tragédies bourgeoises de Chikamatsu) – et on peut ici l’opposer, par exemple, à Gaston Renondeau, je suppose, traducteur incomparablement moins précis, mais dont le rendu simple et sobre, par exemple dans les Contes d’Ise ou l’Anthologie de la poésie japonaise classique, parle davantage au cœur, plutôt qu’à l’intellect…
Mais, pour le coup, les choix de Sieffert traduisant le Hôjôki de Kamo no Chômei s’avèrent absolument pertinents – et, cette fois, les circonvolutions affectées de la langue n’obscurcissent jamais le propos, qui demeure limpide et sûr de bout en bout. Citons, par exemple, ces premières phrases du bref essai – que tous les Japonais connaissent par cœur, dit-on (p. 17) :
Le cours de la rivière qui va jamais ne tarit, et pourtant ce n’est jamais la même eau. L’écume qui flotte sur les eaux dormantes tantôt se dissout, tantôt se reforme, et il n’est d’exemple que longtemps elle ait duré. Pareillement advient-il des hommes et des demeures qui sont en ce monde.
Sur la grosse vingtaine de pages constituant Les Notes de l’ermitage au sens strict, la langue, d’une infinie pureté, est toujours belle et toujours juste – et finalement d’un abord simple, limpide, ce qui était bien le propos. Et c’est toujours pertinent, dans les deux temps pourtant très distincts de l’essai.
CATASTROPHES : LA MAISON COMME IMAGE DE L’IMPERMANENCE DU MONDE
Je ne vais pas rentrer excessivement dans les détails (mais un peu quand même...) – d’autant que j’avais déjà mentionné pas mal de choses dans ma précédente chronique, et qui globalement demeurent « vraies » après cette nouvelle relecture, ce qui n’est certes pas toujours le cas… Je vous y renvoie donc si jamais vous désirez d’autres commentaires nébaliens sur ce texte que j’adule.
Rappelons simplement que l’essai, passé l'image initiale envisagée plus haut, s’ouvre sur une litanie rapportant les catastrophes essentiellement naturelles qui, en l’espace d’une dizaine d’années à peine, ont affecté voire détruit encore et encore la capitale, Heian (future Kyôto) : un immense incendie, un redoutable typhon, deux années de famine faisant des dizaines de milliers de morts dans la seule capitale impériale (les chiffres avancés par Kamo no Chômei paraissent semble-t-il crédibles aux exégètes), et enfin un terrible tremblement de terre, sans précédent nous dit l’auteur, et dont les répliques se sont fait sentir pendant trois mois…
À ces catastrophes naturelles, toutefois, Kamo no Chômei adjoint étrangement (ou pas...) la tentative très malvenue du tyran Taira no Kiyomori, alors au faîte de sa puissance, de déplacer la capitale – et c’est la seule véritable allusion au chaos politique du Japon d’alors, qui basculait de la société aristocratique de Heian à la civilisation médiévale des guerriers, et d’abord celle de l’époque du shogunat de Kamakura (en 1212, quand Kamo no Chômei écrit son classique, on est en plein dedans) ; désir, peut-être, de ne pas trop se mouiller ? La littérature du temps en est pourtant bien autrement affectée, dans l’ensemble – des Histoires qui sont maintenant du passé visant à convertir le peuple à la foi bouddhique, en ces temps troublés qui ne peuvent être que ceux de la « fin de la loi » prophétisée par le Bouddha historique (j'y reviendrai), aux premiers états (car il ne serait fixé par écrit que bien plus tard) du « cycle épique des Taira et des Minamoto »… En même temps, le lien se fait tout naturellement avec la pièce maîtresse de ce dernier, Le Dit des Heiké ; la métaphore de l’eau représentant le temps, et de la maison représentant l’impermanence de toute chose (mujô – c’est la notion-clef, d’inspiration bouddhique), chez Kamo no Chômei, trouve un écho dans les premières lignes de la chronique guerrière, qui en déroulent le propos en guise d’avertissement – citons-les à nouveau (traduction de René Sieffert là aussi, donc) :
Du monastère de Gion le son de la cloche, de l’impermanence de toutes choses est la résonance. Des arbres shara la couleur des fleurs démontre que tout ce qui prospère nécessairement déchoit. L’orgueilleux certes ne dure, tout juste pareil au songe d’une nuit de printemps. L’homme valeureux de même finit par s’écrouler ni plus ni moins que poussière au vent.
La gloire et la décadence des Taira illustrent donc exactement le même propos que les maisons sans cesse bâties, sans cesse détruites, dans le Hôjôki.
LA SÉRÉNITÉ DE L’ERMITAGE (OU : KAMO NO CHÔMEI 1 – THOREAU 0)
Toutefois, Kamo no Chômei ne s’en tient pas là – la deuxième partie de son essai est consacrée à sa vie en tant qu’ermite (il s’est « retiré du monde », et sans doute un peu par dépit et rancœur, vers l’âge de cinquante ans) dans une minuscule cabane, et même de plus en plus petite à mesure que les années passent (le titre originel de Hôjôki renvoie à une unité de mesure des surfaces, dimension qui ne ressort pas des traductions françaises) ; Kamo no Chômei nous parle alors des bienfaits du détachement… Mais avec une extrême simplicité, quelque chose d’un peu bonhomme, qui le rend extrêmement sympathique. Moine mais pas dévot (il prie le Bouddha et prononce le saint nom d’Amida… quand il y pense, de son propre aveu), Kamo no Chômei n’a (ici, du moins...) rien d’un prédicateur intransigeant, blâmant la moindre faute chez son « semblable » et lui promettant plus qu’à son tour l’enfer ou une mauvaise renaissance… Non que ces questions ne le préoccupent pas : les Récits de conversion qui concluent cette édition montrent assurément qu’il y attachait de l’importance – mais sur un ton finalement assez doux, et, peut-être surtout, lumineux ; sans se faire non plus d’illusions sur son propre cas – on l’imagine sourire un brin, quand, en dernier recours, il fait cet aveu que sa cabane lui plaît bien, beaucoup même, et que cela démontre qu’il n’est pas suffisamment « détaché » ; on devine qu’il pourrait aussi s’adresser ce reproche pour continuer, dans ces conditions, de jouer de la musique (on sait qu’il était un musicien accompli), de composer de la poésie (il n’était ici pas sans talent, mais tout de même davantage médiocre dans ce registre), ou, bien sûr… d’écrire Les Notes de l’ermitage.
La sérénité l’emporte pourtant – une sérénité finalement souriante, oui, même après la litanie des catastrophes : le plaisir tout simple de contempler de beaux paysages – ne pas craindre la mort, ne pas être pressé non plus de mourir – observer les animaux, discuter avec un enfant… On a souvent comparé, et sans doute à bon droit, Les Notes de l’ermitage de Kamo no Chômei au Walden de Henry David Thoreau – mais le ton du premier est bien plus charmant que celui du second, en ce qui me concerne ; l’expérience de l’Américain, bien moins « totale » (il ne restait en fait pas dans sa cabane, se rendait régulièrement en ville ou recevait chez lui, il y avait un biais d'emblée du fait du projet littéraire, etc.), suscite certes de fort belles pages consacrées à la nature, qui relient les deux œuvres, mais, dans sa « philosophie », Thoreau a souvent quelque chose d’un pénible donneur de leçons – pas Kamo no Chômei, et ce quand bien même c’est peut-être (voire probablement) son aigreur qui a décidé de son retrait du monde. Il a le sourire aimable et complice d’un bouddha. La litanie des catastrophes, dès lors, ne s’avère pas si apocalyptique, peut-être – voire pas si pessimiste qu’elle en a l’air ? C’est un constat, empreint de tristesse et de douleur assurément, et pourtant il demeure une échappatoire accessible à tous, dans ce détachement tout philosophique qui peut nous ramener, nous Occidentaux, à un Épicure. Et c'est toujours un constat, davantage qu'une leçon, mais à un deuxième niveau, car essentiellement intime : Kamo no Chômei communique une expérience – mais c’est au lecteur de décider qu’en faire, un lecteur que l’on ne brusquera pas. Finalement, peut-être Kamo no Chômei est-il ici inspiré, d’une manière ou d’une autre par d’autres courants philosophico-religieux de l’Extrême Orient classique – le taoïsme, tout spécialement, et son principe de non-intervention ? Je n’ose pas m’avancer davantage sur ce terrain dont je ne sais au fond rien…
UN APERÇU DES RÉCITS DE CONVERSION
René Sieffert, cependant, a complété ici le très bref Hôjôki par une sélection d’autres textes de Kamo no Chômei – une cinquantaine de pages (soit deux fois plus que Les Notes de l’ermitage à proprement parler) d’extraits de son Hosshinshû, ce que le traducteur rend par Histoires de conversion. Je ne m’étendrai pas sur la question, j’y reviendrai probablement un de ces jours en vous parlant de l’œuvre entière, car elle a été éditée depuis, sous le titre Récits de l’éveil du cœur, aux éditions du Bruit du Temps (où l’on trouvait donc aussi le Hôjôki, sous le titre de Notes de ma cabane de moine).
C’est un texte plus difficile à aborder : la limpidité du Hôjôki est telle que, même si c’est un produit de sa culture et de son temps, comme toute œuvre littéraire, il acquiert bien vite une dimension universelle pouvant dispenser le lecteur de se référer sans cesse à d’érudites notes de bas de page. C’est (beaucoup) moins vrai pour le Hosshinshû, dont les quelques extraits sélectionnés ici m’ont souvent paru hermétiques…
Comme mentionné plus haut, je suppose que l’on peut faire un lien entre ces récits et ceux contenus dans un autre ouvrage compilé approximativement à la même période : les Histoires qui sont maintenant du passé (Konjaku monogatari). Le chaos de la fin de l’époque de Heian (soit pour nous la seconde moitié du XIIe siècle) apparaît, pour beaucoup, comme l’illustration de ce que, disons, « la fin des temps est proche ». Il s’agit donc de « sauver » les hommes, en leur enseignant la loi bouddhique – car le bouddhisme, jusqu’alors, avait essentiellement touché l’aristocratie : dans les campagnes, cette foi avait bien moins pénétré, et les paysans s’en tenaient pour l’essentiel au shintô, alors pas le moins du monde constitué et peut-être même pas désigné ainsi.
Noter au passage que Kamo no Chômei était le fils du desservant d'un important sanctuaire (shintô, donc), auquel il n'a pu succéder pour de complexes raisons politiques ; il s'est fait ermite (bouddhiste) tardivement, car il avait d'abord cherché à obtenir d'autres charges du même ordre, sans succès ; la biographie de l'auteur illustre ainsi le syncrétisme japonais.
Mais revenons aux Histoires qui sont maintenant du passé : les moines au biwa, itinérants (et qui joueraient plus tard un rôle fondamental notamment avec Le Dit des Heiké, colporté et transmis de la même manière), prirent donc sur eux de prêcher l'enseignement bouddhique au peuple. Pour ce faire, ils avaient recours à des histoires, souvent voire systématiquement merveilleuses, destinées à l’édification – des récits conçus de toutes pièces, que l’on disait s’être produits il y a bien longtemps en Inde (un pays où aucun Japonais n’avait jamais mis les pieds, ce qui autorisait toutes les fantaisies), en Chine ou au Japon (avec, dans ce dernier cas, abondance de références historiques et culturelles supposées garantir « l’authenticité » des miracles rapportés). On y vantait les vertus du Sûtra du Lotus, et plus généralement des Trois Joyaux : le Bouddha, son enseignement, les moines qui le transmettent.
Kamo no Chômei me paraît s’inscrire dans cette tendance avec son Hosshinshû : il y narre nombre de brèves histoires visant à l’édification, et illustrant les principes fondamentaux du bouddhisme, la causalité et la bienveillance, ainsi que, plus précisément, de la doctrine amidiste (comme souvent les Histoires qui sont maintenant du passé), assurant à tout un chacun le salut à la condition de prononcer en toute sincérité au moins une foi dans sa vie le Namu Amida-butsu. Rappelons, de manière plus générale, que c’est alors une époque d’intense activité religieuse – où deux courants majeurs du bouddhisme japonais, l’amidisme et le zen, quand bien même tous deux originaires du continent, acquièrent des traits propres à la culture religieuse de l’archipel (je vous renvoie si jamais à l'Histoire du Japon médiéval de Pierre-François Souyri, qui contient de passionnants développements relatifs à cette question fort complexe). Mais, contrairement aux Histoires qui sont maintenant du passé, les Récits de l’éveil du cœur de Kamo no Chômei, ai-je l’impression, ne sont pas systématiquement merveilleux – même s’ils le sont souvent.
Je crains cependant de ne pas pouvoir en dire plus ici – car le propos de nombre de ces récits m’échappe. Certains sont très explicites : ici, la jalousie, là, la vanité, font que telle femme ou telle homme, qui présentait pourtant aux yeux de tous un véritable caractère de sainteté, se réincarne en un tengu ou une sorte de serpent en punition de ses mauvais penchants ; par contre, la sincérité, la générosité, la bienveillance, assurent à tous, même à ceux qui ont d'abord mené une « mauvaise vie » (litote, on parle régulièrement de criminels), « une heureuse renaissance » dans la Terre Pure, le paradis d’Amida, situé à l’ouest.
Mais d’autres textes sont bien davantage ambigus, et d’une morale plus difficile à trancher… À moins que ce ne soit d’emblée une erreur de les envisager ainsi ? Après tout, même le Konjaku monogatari, dans son ultime partie japonaise, délaissait en dernier ressort les Trois Joyaux pour narrer des histoires dites « vulgaires » (au sens de « profanes », mais parfois bien crues, oui...) – de ces récits qui enchanteraient, plus tard, un Akutagawa Ryûnosuke (on en a des exemples dans Rashômon et autres contes, surtout, ainsi que dans La Vie d’un idiot et autres nouvelles, si je ne m'abuse, et ailleurs aussi je suppose). Mais est-ce cela ici ? Je n’en suis franchement pas persuadé, en fait…
À l’évidence, ces récits ne m’ont pas autant parlé que le Hôjôki – de manière générale, ils sont forcément plus « dévots », et donc moins universels, ou en tout cas touchent bien moins un agnostique dans mon genre… Si je saisissais davantage le propos de l’auteur, histoire par histoire, peut-être cela me toucherait-il davantage ? Un de ces jours, je compte bien lire les Récits de l’éveil du cœur, et de manière plus… « scientifique » ? Bon, on verra.
TOUJOURS AUSSI BEAU ET FORT
Qu’importe : pour l’heure, c’est le Hôjôki qui m’intéresse. Et ce très court texte me paraît toujours aussi beau, toujours aussi fort.
Non que je compte m’en inspirer pour guider ma bien navrante vie, hein ! Je ne me retirerai certainement pas dans un ermitage, quant à moi – même si mon appartement n’est certes pas exactement un lieu de passage. Et le détachement, bon... Pas vraiment. Et, bien sûr, je ne suis pas le moins du monde bouddhiste.
Mais justement : je ne suis pas en train de vous vendre, là, une merdouille « spirituelle », ou, ce qui revient au même, un de ces affreux machins que l’on range sous l’enseigne « développement personnel » ! Les Notes de l’ermitage valent assurément bien mieux que ça. Au-delà du propos, il y a la pure grâce de la plume, resplendissante d’une authentique sérénité qui n’a absolument rien de la pacotille parfois bêtement qualifiée de « zen » (au sens le plus pseudo, simpliste et donc vulgaire) et compagnie qui encombre les rayonnages des librairies : le Hôjôki est un témoignage, pas un guide – et c’est une œuvre d’une extraordinaire poésie. Sa simplicité apparente le rend plus appréciable encore, et il n’a pas grand-chose à voir avec ces prêches invasifs que nous assènent régulièrement les trop nombreux ersatz de la soldatesque du penser-juste-et-vivre-bien. Il parle au cœur – suscitant la douleur, puis l’apaisement. On peut le lire sur un mode pessimiste, ou sur un mode optimiste – une question de focale ; il parlera dans les deux cas.
Et, huit siècles plus tard, le bref essai de l’ermite Kamo no Chômei brille plus que jamais d’une sagesse universelle et intemporelle.

/image%2F1385856%2F20160114%2Fob_cfb8b0_caligari.jpg)





























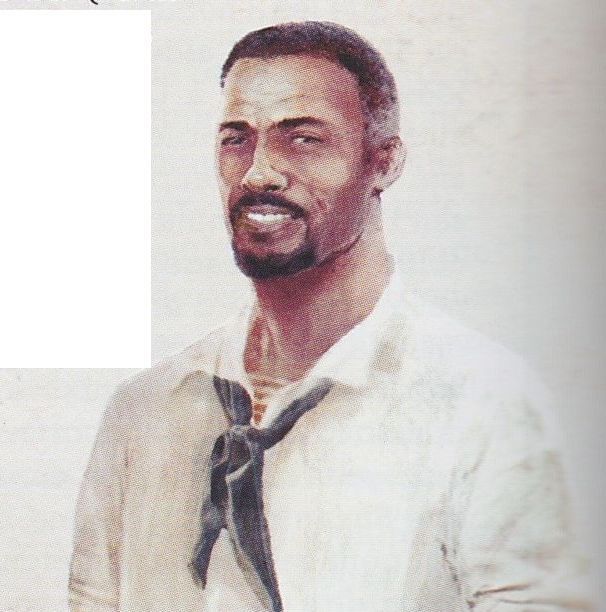





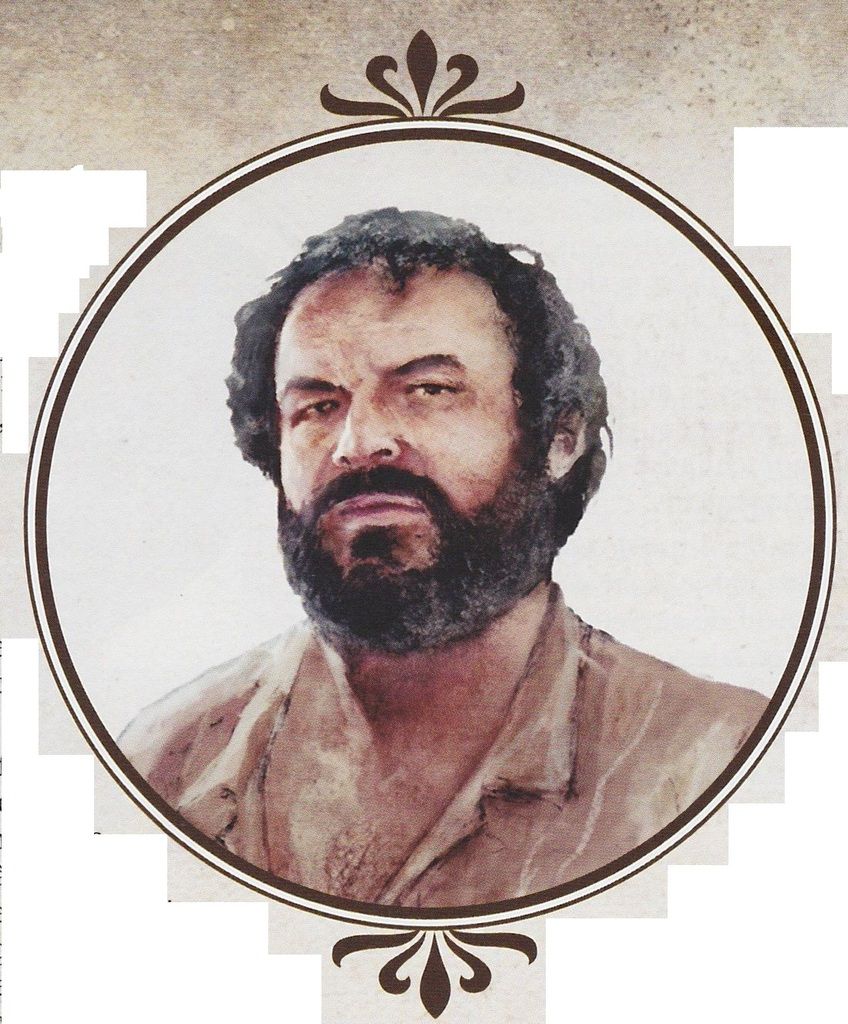








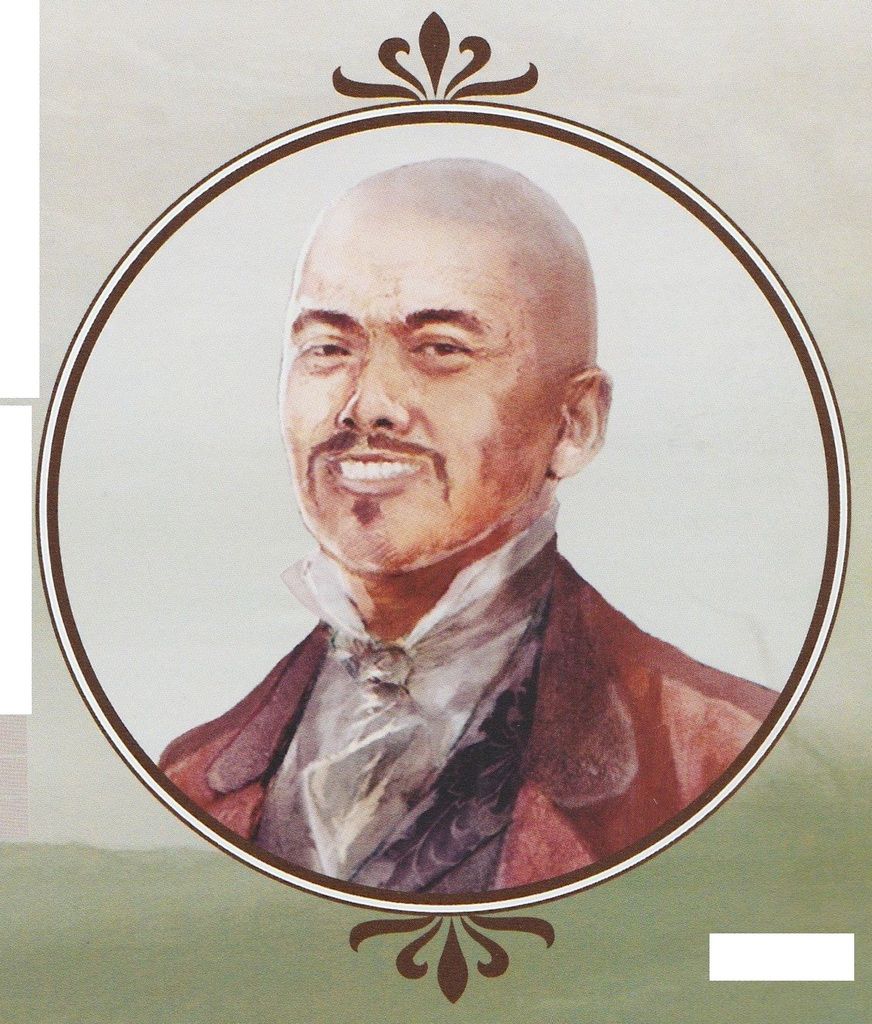







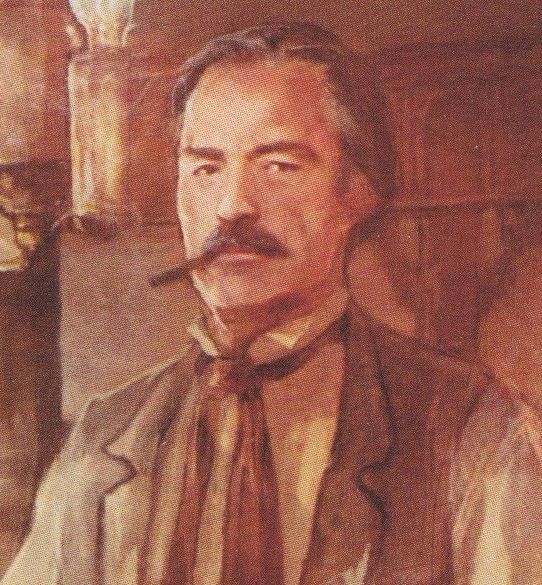
















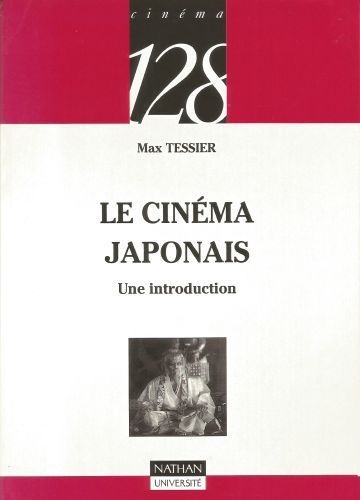
















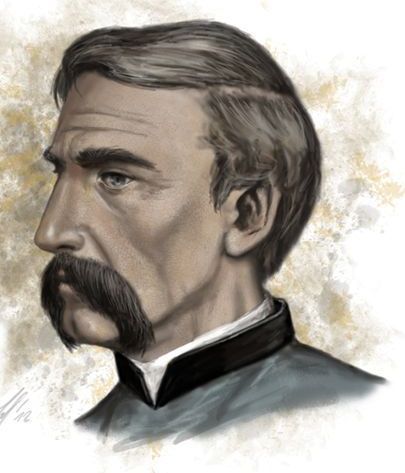














/image%2F1385856%2F20150204%2Fob_660a87_georges-abdaloff-croque-par-christell.jpg)