"Orbitor", de Mircea Cartarescu

CĂRTĂRESCU (Mircea), Orbitor, [Orbitor (Aripa Stîngà)], traduit du roumain par Alain Paruit, Paris, Denoël – Gallimard, coll. Folio Science-fiction, [1996, 1999] 2002, 428 p.
De temps en temps, j'aime bien me laisser guider dans mes choix de lecture. Ainsi, l'autre jour, alors que je me trouvais dans une infââââââme librairie parisienne, je me suis tourné vers le jeune N..., et lui ai demandé de faire le vendeur, de me conseiller un livre vers lequel je ne me serais probablement pas tourné de moi-même. Le jeune homme s'empara prestement et avec la souplesse d'un PETIT CHAT d'Orbitor de Mircea Cărtărescu, ouvrage qu'il me présenta ainsi (sans même me traiter de PUTE) : « C'est bien, y'a pas d'histoire, c'est bien. » Après avoir tourné un regard nauséeux et perplexe en direction de la couverture plutôt, euh, voilà, oui, je me mis à lire le résumé. Le jeune N... m'interrompit bien rapidement, et à très juste titre : « Ça dit que d'la merde ! » Et il me sélectionna un passage, excellent certes, et qui acheva de me convaincre, mais que je peux bien désigner aujourd'hui comme pas représentatif du tout du contenu global du bouquin (le fourbe).
Faut dire, et c'est à la décharge de l'invraisemblable quatrième de couv', cet Orbitor n'est pas évident à résumer. En fait, il est même irrésumable. S'agit-il d'ailleurs vraiment d'un roman ? On est en droit d'en douter. Et, en tout cas, et ce en dépit de la collection, ce n'est pas de la essèfeuh (scandale !), mais bien plutôt le genre de bouquin fou et inclassable que l'on qualifiera à la suite de Francis Berthelot de « transfiction » (je croyais d'ailleurs me souvenir, sans certitude aucune, qu'Orbitor figurait dans les suggestions de lecture de la Bibliothèque de l'Entre-Mondes ; j'ai eu l'occasion de le vérifier depuis).
Mais alors qu'est-ce donc que cet Orbitor ? Difficile à dire. Mélange étrange d'autobiographie onirique, de saga familiale fantasmée (tournant essentiellement autour de la mère de l'auteur, comme de juste), de poème théologico-philosophique (ça, c'est pour les quelques passages chiants), d'ode sinistre à Bucarest (quand on ne s'égare pas à la Nouvelle-Orléans...), et d'hallucination généralisée, portée sur le chromatisme, et notamment les teintes jaunâtres...
Le jeune Mircea nous entretient ainsi de bien des choses au long de son « roman » d'auto-analyse, et, succombant à la logique des rêves, il passe sans vergogne du coq à l'âne, multipliant les récits enchevêtrés et interrompus, s'imbriquant les uns dans les autres, pour constituer une somme aussi aride que fascinante, a fortiori quand l'auteur se dégage du réel pour nous égarer dans un monde imaginaire riche en merveilles et cauchemars, infesté de fantasmes féminins et de papillons fabuleux.
Le style de l'auteur est à l'avenant. Chatoyant, subtil, adepte du mot rare et du chromatisme diffus, il est d'une beauté incontestable, mais qui a à l'occasion de quoi faire peur, tant l'auteur aime à se perdre (et à perdre son lecteur) dans les phrases et les paragraphes interminables, accumulant les propositions dans un délire verbal à deux doigts de la logorrhée.
Autant dire qu'Orbitor est beau. Mais lourd. Mais beau. Mais lourd. Mais beau. Ad lib., ou ad nauseam. Un « roman » particulièrement exigeant, en somme, d'un hermétisme parfois terrifiant, mais pourtant fascinant de long en large. Tout sauf une lecture de plage, quoi. Un livre qui se mérite, mais le jeu en vaut amplement la chandelle, tant, sous le vernis rebutant, se dissimule un vrai beau morceau de littérature contemporaine, fantasque et d'une originalité indéniable, à vrai dire totalement unique en son genre.
Un livre « fou », ainsi que l'auteur lui-même aime bien le désigner, quand il se met en scène en train de l'écrire ; un livre presque illisible, nous dit-il aussi. Certes, certes. Mais avant tout un très beau livre, et c'est bien là tout ce qui importe.
Alors merci, jeune N..., pour cette excellente suggestion. Orbitor est typiquement le genre de livre à côté duquel je serais passé en temps normal. Il valait pourtant assurément le détour. Effectivement, « c'est bien, y'a pas d'histoire, c'est bien ». Mais peut-être n'ai je dit moi aussi, à mon tour « que d'la merde »...
Quoi qu'il en soit, j'avoue que je me ferais bien quelque chose d'un peu plus léger, maintenant, cela dit, parce que bon, hein, oh...

/image%2F1385856%2F20160114%2Fob_cfb8b0_caligari.jpg)








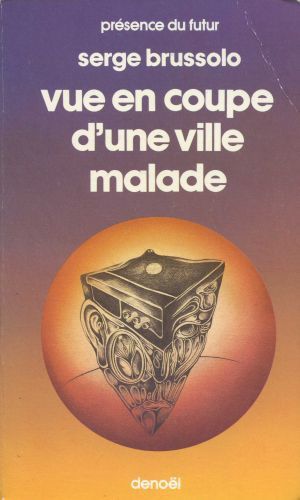









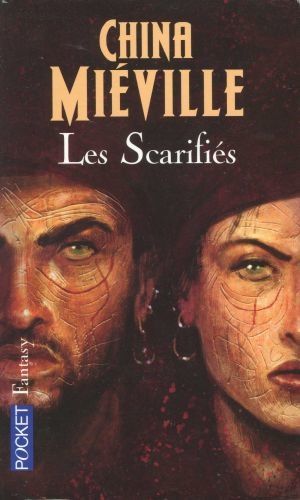

/image%2F1385856%2F20150204%2Fob_660a87_georges-abdaloff-croque-par-christell.jpg)