Allez, un peu d’histoire du Japon, aujourd’hui – ça faisait longtemps... Et pour le coup sur un sujet relativement « pointu », ou du moins est-ce l’effet que peut produire ce livre en français : au Japon, il a pourtant été publié initialement dans une collection de poche, qui, sans en faire le moins du monde un ouvrage léger ou même à ce compte-là de vulgarisation, lui a assuré tout de même un certain écho.
Il faut dire que le sujet des ikki – mot derrière lequel on range, en gros, essentiellement des mouvements de révolte paysans du moyen âge et de l’époque d’Edo, qui peuvent faire penser à nos jacqueries, mais cela va en fait bien au-delà (les paysans n’étaient pas les seuls impliqués, les ikki pouvaient être urbains, etc.) –, ce sujet donc a été beaucoup traité là-bas, et de manières très différentes. Ici, l’introduction de Pierre-François Souyri, auteur notamment d’une très bonne Histoire du Japon médiéval, et qui traduit le présent ouvrage dû au médiéviste japonais Katsumata Shizuo, cette introduction donc se montre particulièrement précieuse, qui permet de se faire une idée de l’historiographie sur le sujet – car elle est complexe, et déterminante pour bien apprécier l’écho que ce (relativement) petit livre a pu rencontrer à sa sortie en 1982.
Les ikki, initialement, n’intéressaient pas les historiens « traditionnels » de Meiji. Ceux-ci avaient hérité de leurs précurseurs imprégnés de néo-confucianisme une conception très événementielle de l’histoire, qui s’intéressait aux « grands hommes » et aux faits politiques. Dans leur conception, les ikki ne pouvaient être, au mieux, qu’un symptôme de « mauvais gouvernement », et du temps de Meiji ils étaient donc fort pratiques pour dénigrer le régime shogunal, mais il n’y avait rien de plus à en dire, et il aurait même été de mauvais goût de le faire : c’était, dans tous les sens du terme, un sujet « vulgaire ».
Mais cette perspective a évolué en même temps que l’approche de la science historique changeait : des historiens progressistes, à la même époque, se sont mis à évoquer le sujet, sous un jour différent, qui ont montré que les ikki ne pouvaient pas simplement être envisagés comme des épiphénomènes, mais avaient leur propre valeur, non négligeable, et traduisaient des réalités sociales et historiques autrement complexes que le tableau bien lisse et focalisé sur l’élite que perpétuaient toujours les historiens traditionnels.
Sans surprise, la matière a été bouleversée par l’historiographie marxiste – surtout après 1918, quand des « émeutes du riz » ont réveillé le souvenir des ikki du moyen âge ou de l’époque d’Edo. Les ikki s’inscrivaient alors dans la logique du matérialisme historique, et étaient un symptôme de la lutte des classes plutôt que du « mauvais gouvernement » à proprement parler. Cette approche a été déterminante et fructueuse, notamment en incitant la discipline historique japonaise à se tourner vers les éléments économiques et sociaux, approche qui a peut-être surtout payé en histoire locale. Car cette approche, à terme, et de manière plus générale, avait ses propres défauts : l’idéologie y jouait une part importante, qui a pu biaiser les recherches, par exemple en mettant trop l’accès sur l’idée de lutte des classes (là où les ikki étaient des mouvements plus divers socialement), ou en postulant l’échec de ces mouvements dans la logique du matérialisme historique. Les travaux précurseurs des années 1920 ou 1930, cinquante ans plus tard, avaient laissé la place à des héritiers un peu trop sclérosés par l’idéologie… et aveugles à certains aspects d’un phénomène trop complexe pour rentrer parfaitement dans des nomenclatures rigides.
D’autres approches étaient pourtant envisageables. À peu près à l’époque où le marxisme faisait son apparition dans la discipline historique au Japon, un autre courant, dans la lignée de Yanagita Kunio, le fondateur de l’anthropologie japonaise moderne, entendait approcher la paysannerie et la ruralité sous un prisme différent. Ces auteurs, très assidus dans l’histoire locale, reprochaient notamment aux historiens marxistes (et sans doute à d’autres parmi leurs précurseurs) de n’envisager le monde paysan qu’au regard de ses crises – dont les ikki étaient probablement l’exemple le plus frappant. Pour ces auteurs critiques, il importait au moins autant et probablement davantage d’envisager la paysannerie dans sa « normalité », dans son quotidien – étudier les ikki était utile, mais se focaliser sur ces mouvements parfois très violents biaisait nécessairement l’approche du phénomène paysan global ; et on ne pouvait sans doute pleinement appréhender les ikki si l’on faisait abstraction des pratiques et des idées du monde paysans hors crises – et c’était bien là ce qu’il fallait critiquer notamment chez les historiens marxistes.
Vers les années 1970-1980, un nouveau courant s’est développé, souvent qualifié d’ « histoire sociale », qui a fait la part des choses dans tout cela. L’ouvrage de Katsumata Shizuo s’inscrit globalement dans cette nouvelle approche, et son analyse des ikki en témoigne : l’auteur n’exclut certes pas les dimensions politiques, économiques et sociales du phénomène, mais celles qui l’intéressent le plus ici tiennent essentiellement aux rituels, à la symbolique et à la pratique, au droit aussi – et c’est en conjuguant ces différentes approches que l’on peut, si l’on y tient, dériver, d’une certaine manière, un discours politique éclairant pour le Japon contemporain et éventuellement au-delà.
Mais, avant d’en arriver là, il faut remonter aux origines. Quand on parle d’ikki, généralement, on fait référence à des mouvements d’ampleur des époques Muromachi et Sengoku ou Azuchi-Momoyama, disons « le moyen âge japonais », puis de l’époque d’Edo, davantage envisagée comme « époque moderne » – et ces deux temps de l’histoire des ikki sont assez différents. Mais, pour Katsumata Shizuo, non seulement il faut remonter bien plus loin, mais, en outre, il ne faut pas se focaliser excessivement sur la seule paysannerie.
En effet, pour l’auteur, ce qui constitue l’ikki à proprement parler, c’est le fait de « jurer ensemble ». Et, à ce compte-là, on peut relever des ikki, datant de Heian (voire de Nara ?) ou de Kamakura, dans d’autres couches sociales que la paysannerie, et qui ont probablement influencé cette dernière dans ses pratiques ultérieures. Il y a alors des ikki de guerriers, si cette dernière notion évolue alors rapidement, mais, ce qui retient le plus l’attention de l’auteur, ce sont les ikki de moines bouddhistes. Dans divers monastères, et non des moindres, on voit en effet des moines jurer, et selon un rituel presque immuable : on émet ensemble une revendication, on l’écrit, tout le monde la signe (et sans distinctions de rang), on brûle la pétition, on en mêle les cendres à de l’eau, et tout le monde boit cette dernière – ce « rituel de l’eau » est très répandu, et on le retrouvera dans les ikki paysans.
Or il y a toute une manière de penser derrière ce rituel. Les moines qui boivent l’eau, consciemment ou pas, font appel à des « souvenirs » plus ou moins exacts du bouddhisme primitif, et en dérivent la valeur supérieure du principe d’unanimité : une décision qui est prise par tous est forcément légitime, en fait on ne saurait concevoir légitimité plus importante – il y a quelque chose, là-bas, du vox populi, vox Dei, encore que cet adage latin trouve probablement davantage à s’appliquer aux ikki paysans ultérieurs, mais justement parce qu’ils perpétueront cette pratique et ce sentiment. Pourtant, la notion évolue – car, bientôt, le principe d’unanimité se transforme en principe majoritaire. Pour les moines, il n’y a pas là de contradiction : la décision prise à la majorité bénéficie de la légitimité de l’unanimité – car ceux qui ont voté différemment se plient à la décision majoritaire, et, dès lors, font tout pour la défendre même si elle ne leur plaisait pas initialement.
Or il faut revenir sur l’idée qu’il n’y a pas de distinctions de rang dans ces ikki de moines, parce qu’il en restera quelque chose dans les ikki paysans – où les tenanciers les plus humbles se retrouveront souvent associés à des petits propriétaires terriens, à des jizamurai, parfois là aussi à des moines, sans que le serment ne témoigne de leurs différences de statut : ils sont tous au même niveau. Et c’est probablement là encore quelque chose qui a pu être influencé par le bouddhisme primitif (je suppose que le Shintô a pu aussi y avoir sa part).
L’auteur voit dans cette pensée de la légitimité et de l’unanimité une forme de principe démocratique qui éclaire la démocratie japonaise contemporaine – mais il aura aussi l’occasion de montrer combien les mouvements de révolte tels que les ikki ont toujours accordé un rôle prépondérant à cette idée d’une légitimité « automatique », d’une certaine manière : du simple fait qu’ils jurent ensemble, les paysans révoltés expriment une légitimité absolue et incontestable – au point de l’incompréhension fondamentale et mutuelle, quand ils doivent faire face à la répression par les autorités, et leur « monopole de la violence légitime », pour citer Max Weber.
Mais, justement, il y a là d’emblée un aspect politique intéressant de ce discours, et qui vient nuancer voire contredire l’approche notamment marxiste des ikki. Celle-ci ne pouvait que relever combien les ikki, ces mouvements populaires, avaient pu effrayer les puissants, et, dans le cadre de l’historiographie japonaise, c’était donc déjà quelque chose : les ikki n’étaient pas que des épiphénomènes symptomatiques d’un « mauvais gouvernement », ils étaient des aspects de la lutte des classes, et parfois étrangement efficaces car finalement organisés dans leur fonctionnement, plutôt que véritablement spontanés ; en se fédérant, les ikki ont pu exercer le véritable pouvoir effectif sur de vastes provinces pendant des années, voire des décennies – et tant pis pour les « grands hommes », l’élite guerrière ; tant pis aussi et surtout pour le mythe encore largement perpétué aujourd’hui d’un Japon par essence « soumis » à ses dirigeants, un des stéréotypes les plus tenaces en la matière… Cependant, l’historiographie marxiste japonaise tendait semble-t-il à conclure à « l’échec » des ikki – pour des raisons idéologiques que je serais bien en peine de détailler outre mesure. L’approche de Katsumata Shizuo est différente – et, dans ce principe démocratique et ce questionnement de la légitimité via l’unanimité, même dégradée en majorité, il voit donc quelque chose qui a pu se montrer déterminant dans l’histoire politique du Japon contemporain, même si d’abord de manière plus ou moins insidieuse.
Mais il s’intéresse avant tout, ici, aux rituels et à la symbolique – car le « rituel de l’eau » n’est pas le seul. Les ikki paysans témoignent d’autres pratiques, mais, dans l’esprit de l’auteur, elles renvoient pour la plupart à cette notion centrale de légitimité. Ainsi, par exemple, il relève que les paysans qui constituent un ikki le font de manière très solennelle, mais en usant d’une symbolique à première vue ambiguë, notamment en ce qui concerne les costumes. Katsumata Shizuo, dans les nombreuses sources locales qui sont à l’origine de son argumentaire, relève que les paysans révoltés usent d’un costume particulier : manteau de pluie, large chapeau conique, parfois une étole blanche qui leur masque le visage. À l’en croire, ces atours vestimentaires ont une signification, les paysans ne les emploient pas seulement parce qu’ils sont « pratiques » et aisément disponibles : ils constituent en fait les attributs d’un personnage qui, d’une certaine manière, « sort du monde », ce dont le tissu qui dissimule leur visage témoigne tout particulièrement, car, bien avant d’être un moyen de se prémunir des investigations des autorités désireuses d’identifier les insoumis, c’était un signe distinctif traditionnel des lépreux (parmi d’autres, dont des vêtements de couleur orange sauf erreur, dont les paysans révoltés se revêtent parfois, d’ailleurs). Mais ce statut « hors-castes », qui pouvait temporairement les associer aux hinin et eta, avait des implications symboliques plus complexes, aux conséquences politiques notables : en fait, si revêtir ce costume excluait de la société des hommes, de manière plus ou moins « magique », il conférait aussi à qui l’arborait des attributs non humains et en fait d’essence supérieure – Katsumata Shizuo relève ainsi que, dans bien des cas, et notamment en lien avec ce costume, les paysans révoltés comme ceux contre lesquels ils s’insurgeaient multipliaient les références aux tengu, ces êtres mythiques tenant de l’homme et du corbeau, et dotés de pouvoirs hors-normes ; le costume, d’une certaine manière, conférait aux paysans ces pouvoirs – mais ils en dérivaient là aussi une forme de légitimité supérieure ; en fait, très concrètement, certaines sources évoquent clairement l’idée que les paysans membres des ikki, au travers de divers rituels, étaient comme « habités » par des divinités, tout bonnement, le temps de leur révolte. La légitimité « automatique » dérivée du principe d’unanimité était ainsi redoublée d’une autre légitimité, d’ordre davantage magico-religieux, mais d’essence tout aussi « supérieure ».
Mais les ikki évoluent – parce que la société japonaise dans laquelle elles germent change, notamment aux plans, pas seulement politique, mais aussi et surtout économique et juridique. Le chaos de la fin de Muromachi, ou de la période dite Sengoku, des « provinces en guerre », incite sans doute les paysans à se fédérer en ikki, puis les ikki entre eux, pour assurer « l’ordre » quand les seigneurs théoriques ne sont pas en mesure de le faire, mais cela va au-delà – et c’est bien pourquoi ce sont d’abord ces ikki sur lesquels on met traditionnellement l’accent (plus tard, ceux d’Edo seront d’un ordre un peu différent).
Les ikki, traditionnellement, à vrai dire ceux des paysans comme ceux des moines, étaient souvent liés aux déprédations commises par de mauvais intendants, préfets, etc., qu’il s’agissait de démettre : les ikki réclamaient le départ de l’administrateur, et, plus qu’à leur tour, ils obtenaient gain de cause. Mais ces déprédations reprochées, au premier chef, étaient souvent d’ordre fiscal : il s’agissait de rejeter des impositions nouvelles ou excessives. Ce trait demeurera tout au long de l’histoire des ikki, mais, vers cette époque, il commence à être associé à d’autres aspects de la question – parce que le rapport à la terre, en même temps que l’économie rurale et la conception même du droit de propriété, évoluent.
En effet, un terme qui revient souvent dans les revendications des ikki est celui du « gouvernement vertueux » : les paysans réclament des autorités, sous cet intitulé, un « acte de grâce », autre moyen de désigner en fait, de manière systématique, l’abolition des dettes et la récupération des terres mises en gage. En effet, vers cette époque, dans les campagnes, certains individus développent une activité de prêt à intérêt – les aubergistes et les brasseurs de saké, notamment… mais aussi certains monastères pas très scrupuleux ! Les paysans, confrontés à un système d’imposition nouveau, sont souvent contraints de recourir à leurs prêts, et s’endettent drastiquement, très vite. Ils forment alors un ikki, réclamant l’abolition des dettes (et, sous Edo, on trouvera certaines allusions significatives au fait qu’il s’agit d’abolir toutes les dettes, pour tout le monde), et la restitution des terres vendues ou mises en gage. Là encore, il leur arrive régulièrement d’obtenir gain de cause – et les autorités anticipent même parfois les revendications ou à vrai dire la simple constitution des ikki en émettant d’elles-mêmes de telles lois de « gouvernement vertueux » (notamment, relève l’auteur, en périodes de crise… ou quand le calendrier, ou tel signe astronomique, laissent entendre que l’année sera « mauvaise », pour des raisons là encore magico-religieuses).
Cela peut nous paraître étonnant, aujourd’hui, mais Katsumata Shizuo explique ce phénomène de manière assez lumineuse : recourant aussi bien à l’Essai sur le don de Marcel Mauss qu’aux études de ses compatriotes sur le droit médiéval, il établit bien que tout cela témoigne d’une conception du droit de propriété, et de l’acte de vente, différente de celles auxquelles nous a habitué le droit contemporain, dans la lignée de l'essor du capitalisme – car c'est bien ce qui se produit alors. Dans ce contexte, il est en fait parfaitement normal que la terre « revienne », qu’on ne la laisse pas « filer », parce qu’elle avant tout liée à la famille, ainsi qu’à l’usage effectif ; et, au fond, le cas du Japon ici n’est pas si différent de celui de la France, qui a connu des institutions comme le retrait lignager – et Marcel Mauss, parmi d’autres, avait étudié le droit coutumier pour le mettre en évidence. On pèse ici combien la conception moderne et actuelle du droit de propriété n’a absolument rien de « naturel » et d’inaltérable, quoi qu'on en dise… Et il faut relever qu’à cet égard l’alliance entre les petits tenanciers et des paysans davantage prospères pouvaient se perpétuer, avec des ennemis communs en la personne des prêteurs – les samouraïs ruraux étant également de la partie, le cas échéant, et parfois des religieux.
Mais cette nouvelle conception du droit de propriété, avec ses corollaires, se développe bel et bien au Japon vers cette époque – et la contradiction insoluble entre cette nouvelle approche et la traditionnelle génère de nombreux ikki.
Qui tendent par ailleurs à devenir plus violents… Les ikki initiaux, ceux des moines notamment, n’étaient certes pas exempts de démonstrations de force : les moines qui manifestaient par milliers, en emportant sur des sortes de palanquins des statues de divinités et de bouddhas (ils n’étaient donc à cet égard pas du tout différents des paysans se changeant plus ou moins en tengu ou se laissant temporairement habiter par des divinités, le rituel avait exactement le même objectif au regard de la légitimité comme de l’intimidation), ces moines donc constituaient un spectacle intimidant mais aussi assez récurrent – ils faisaient souvent plier leurs adversaires de la sorte, mais des violences plus concrètes pouvaient éclater à l’occasion. À vrai dire, ces moines étaient une plaie endémique, notamment aux environs de la capitale – un problème auquel Oda Nobunaga a apporté une solution brutale…
Mais il en allait de même pour les paysans. Initialement, les ikki ruraux se contentaient le plus souvent de menacer de « faire la grève » ou de déguerpir en masse (via le rituel consistant à « étaler les bambous », à la symbolique complexe) ; et les juristes d'alors stipulaient que c'était là un droit inaliénable des paysans. Ces menaces, parfois mises en pratique, sont, au sens juridique, des « violences », mais pas exactement comme nous l’entendons le plus souvent… Or les violences au sens où nous l'entendons couramment se développent – et les ultimes ikki de la période d’Edo franchiront encore une étape en l’espèce, en se montrant parfois sanglants, toujours destructeurs. Cependant, juste après Oda Nobunaga, il faut sans doute mentionner la « chasse aux sabres » menée par Toyotomi Hideyoshi, qui visait à désarmer les paysans – et a constitué une première étape vers l’établissement du système de castes assez rigide du shogunat Tokugawa ; mais c’est une question très complexe, et éventuellement plus ambiguë qu'il n'y paraît, que je ne me sens vraiment pas de développer ici…
Quoi qu’il en soit, les violences des ikki pèsent d’abord essentiellement sur les biens matériels : on s’en prend aux entrepôts monopolisant le riz, aux brasseries, aux auberges, mais donc aussi à certains monastères – très souvent, on y met le feu. Il y avait probablement un aspect très pratique à cet égard : il s’agissait de détruire les documents témoignant des dettes, des prêts et des mises en gage, pour les « invalider »… Parfois, le geste était précédé d’une simple menace, soit une offre de négociation, mais, au fil des siècles, les ikki ne se sont pas toujours embarrassés de cette première étape, incendiant immédiatement les bâtiments qui symbolisaient leur endettement, et en abritaient les preuves concrètes. Mais les destructions pouvaient aller bien au-delà, notamment durant l’époque d’Edo.
Il faut cependant relever une chose, d’importance : ces dégradations ne relevaient qu’exceptionnellement du vol ou du pillage à proprement parler – en fait, un document intéressant (datant d’Edo sauf erreur) fait état du discours d’un meneur qui enjoint ses camarades à ne pas piller, mais bien à « tout casser », texto ; or le même document, en même temps, développe le discours envisagé plus haut quant à la légitimité « automatique » du mouvement, et prend soin d’inclure parmi la classe opprimée qui se révolte absolument tout le monde, paysans de toute condition et guerriers de rang inférieur – et jusqu’à certains petits aristocrates et moines, en réclamant, on l’a vu, un acte de « gouvernement vertueux » qui bénéficierait à tous ceux-là (et notamment, faut-il entendre, pas aux seuls petits paysans – car à ce stade il s’agissait de se faire des alliés… et de les conserver aussi longtemps que possible !). Quoi qu’il en soit, il y a donc des aspects aussi bien matériels que symboliques dans ces destructions.
Maintenant, les violences pouvaient aller bien au-delà, et s’en prendre cette fois aux personnes – de plus en plus fréquemment semble-t-il. Bientôt, incendier l’auberge, la brasserie de saké, etc., ne suffit plus, et la foule des paysans révoltés lynche quantité de prêteurs. Il faut dire que, durant la période particulièrement troublée qui clôt le moyen âge japonais, les seigneurs de guerre montraient l’exemple à cet égard – et les ikki ont été impliqués dans des opérations d’ordre proprement militaire ; on a pu relever, d’ailleurs, qu’en bien des occasions ils ont tenu plus longtemps qu’on ne l’imaginait, repoussant sans vergogne les assauts de seigneurs de la guerre convaincus qu’ils écraseraient sans peine ces paysans en armes, et qui repartaient la queue entre les jambes !
Mais le contexte général de ces luttes a pu avoir un rôle à cet égard : la guerre d’Ônin (1467-1477), tout particulièrement, avec son image si désastreuse, a pu inciter non seulement les paysans à prendre les armes, le cas échéant pour assurer « l’ordre », d’ailleurs ! mais aussi à teinter leur discours d’autres connotations, plus inédites, et pourtant d’une certaine manière dans la continuité de la revendication périodique du « gouvernement vertueux ». C’est que cette dernière expression prend alors un sens plus abstrait, en même temps qu’elle est associée à une autre, de plus en plus fréquente, et tout particulièrement lors de l’époque d’Edo : celle réclamant la « rectification du monde ».
Il s’agit d’un discours politique plus global, aux soubassements religieux marqués – en fait, il y a une composante qu’on pourrait qualifier de « millénariste » dans cette revendication : à maintes reprises, des prédicateurs bouddhistes n’ont pas manqué d’identifier dans l’époque qui était la leur celle de la « Fin de la Loi », comme par exemple dans la deuxième moitié du XIIe siècle, qui a vu le régime aristocratique de Heian s’effondrer et céder la place au Japon des guerriers ; et c'est à nouveau ce qui s'est produit alors, quoi peut-être dans une optique davantage populaire. Comme on l’a vu plus haut, cette approche intervient d’ailleurs tout spécialement lors de périodes de crises marquées, pas toujours seulement politiques d’ailleurs : les grands tremblements de terre suscitent plus qu’à leur tour ce genre d’ikki, qui ajoutent à la symbolique du tengu celle du poisson-chat, animal pris dans sa forme mythique et que l’on rend traditionnellement responsable des séismes, ce qui en fait un symbole moralement ambigu, mais aussi fort adéquat, de la destruction suscitant le renouveau). Ceci, d'autant que ces crises pouvaient simplement être « annoncées » par des phénomènes tels que le passage d’une comète ou le fait d’atteindre une année « mauvaise » dans le calendrier traditionnel (ce qui incitait les autorités et les érudits à mille manœuvres en forme de « tricheries » pour tenter de circonvenir le mauvais sort cyclique – comme la déclaration d’une nouvelle ère…).
Ces derniers mouvements sous Edo avaient donc une ampleur probablement plus vaste que leurs prédécesseurs médiévaux, aux plans matériel et symbolique – ils ont pu, par ailleurs, contribuer à rendre la conception des ikki un peu plus floue, prise globalement. Mais ces émotions populaires ont bientôt eu des conséquences marquées : si elles n’ont pas suscité la restauration de Meiji, elles ont du moins témoigné, toujours un peu plus, des difficultés notamment d'ordre économique rencontrées par le régime Tokugawa, et, de manière très significative, au XIXe siècle, des administrateurs, etc., s’associent à des ikki, voire les génèrent ; dès lors, le processus devant déboucher sur la chute du shogunat devenait plus tangible.
À vrai dire, la restauration de Meiji pouvait constituer, pour certains, une occasion marquée de « rectifier le monde » ; il n’est pas dit que les paysans en aient tant profité – dans l’immédiat du moins. Mais Katsumata Shizuo nuance donc l’idée d’un « échec » des ikki – et pèse leur influence possible sur le Japon contemporain, a fortiori quand il s’est agi, sous Taishô, puis sous Shôwa après 1945, de démocratiser le Japon, sur la base donc de principes parfois anciens, et pas nécessairement de nature purement exogène, comme certains étaient (et sont peut-être toujours ?) portés à le croire.
Ceci, bien sûr, outre l'importante réforme agraire qui suivit la défaite ; en fait de mesure imposée par l'occupant américain, elle n'était pas sans précédents au moins théoriques dans l'histoire du Japon, et Katsumata Shizuo relève à plusieurs reprises que les revendications des ikki tendaient à aller dans ce sens sous Edo.
Bien sûr, je ne suis pas en mesure de juger aussi bien des apports de Katsumata Shizuo que de la pertinence de son analyse, ne disposant absolument pas du bagage pour ce faire – et j'espère d'ailleurs ne pas avoir dit trop de bêtises dans ce compte rendu... Il semblerait que, si le livre a marqué son époque et l’historiographie du Japon médiéval, au-delà d'ailleurs du seul sujet des ikki, il a pu être nuancé depuis (il a pas loin de quarante ans, après tout…) : l’auteur appelait de ses vœux de telles critiques en concluant son ouvrage.
Quoi qu’il en soit, c’est là une lecture très intéressante, et il est appréciable que ce genre d’ouvrages soit disponible en français – à cet égard, il faut d’ailleurs louer encore une fois l’introduction de Pierre-François Souyri, qu’on est porté à juger indispensable en la matière. Très intéressant.


/image%2F1385856%2F20160114%2Fob_cfb8b0_caligari.jpg)


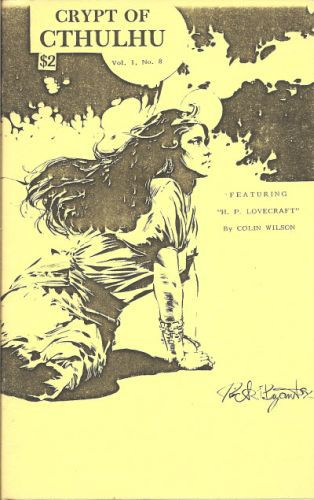
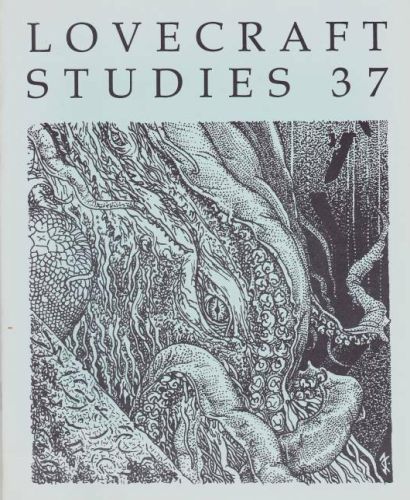
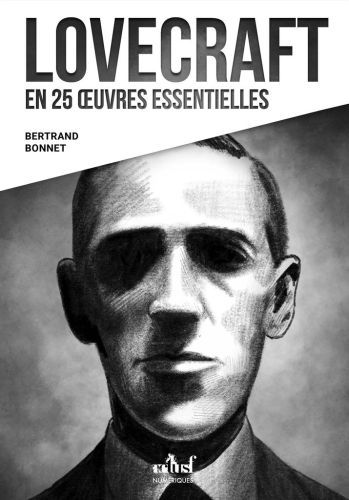
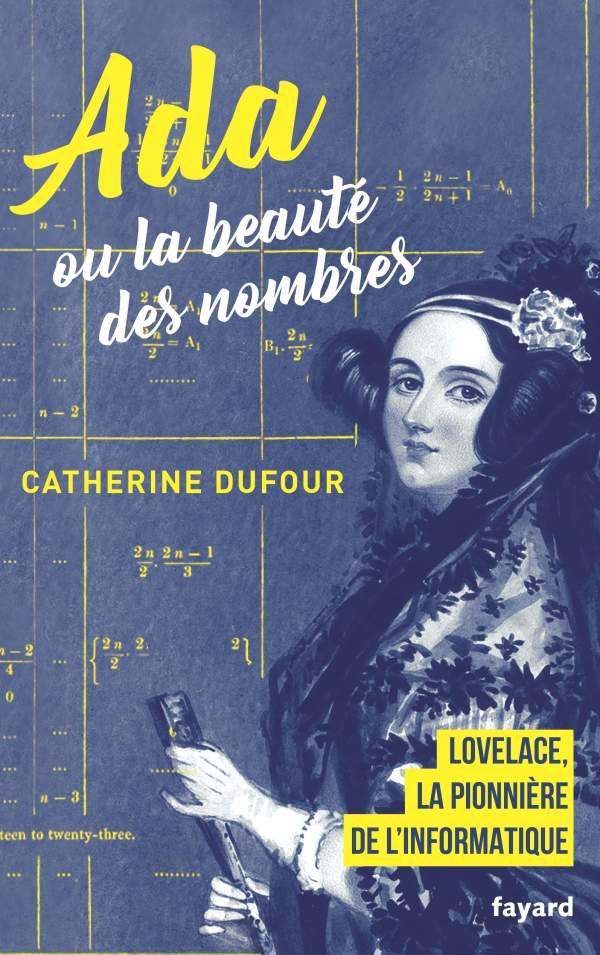
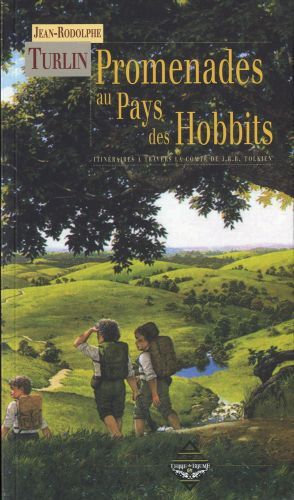

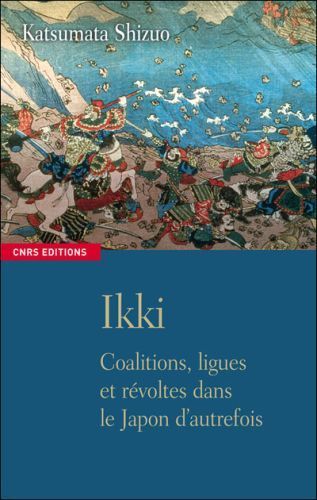



/image%2F1385856%2F20150204%2Fob_660a87_georges-abdaloff-croque-par-christell.jpg)