"Les Manuscrits de Kinnereth", de Frédéric Delmeulle

DELMEULLE (Frédéric), Les Manuscrits de Kinnereth, Paris, Mnémos – LGF, coll. Le Livre de poche Science-fiction, [2010] 2012, 405 p.
Ainsi que je vous en avais fait part il y a de cela quelque temps dans ces pages interlopes, j’avais été plutôt enthousiasmé par La Parallèle Vertov de Frédéric Delmeulle, premier tome des « Naufragés de l’entropie », un roman certes pas révolutionnaire ni totalement réussi, mais assez franchement sympathique. Je ne vais pas revenir ici sur son complexe cheminement éditorial, qui explique sans doute bien des choses. Juste noter qu’était sorti presque immédiatement chez Mnémos le deuxième (et pour l’instant dernier…) tome de la série, Les Manuscrits de Kinnereth, repris aujourd’hui en poche (sous la nouvelle maquette dégueulasse du Livre de poche Science-fiction). Du coup, allez, hop, je me suis dit que je pouvais bien tenter l’expérience, que le monsieur Delmeulle le valait bien, et tout ça.
…
Oui, je suis naïf, des fois.
Mais n’allons pas trop vite, et commençons par introduire le propos.
(Attention, ce petit résumé, à l’instar du livre, est farci de noms bizarres, mais l’auteur aime bien ça, visiblement.)
Tout commence lorsqu’un certain Théodore Masterson – le narrateur, employé par l’ONU – vient rendre visite aux deux historiens que sont Yove et Sphinx – Sphinx, ça ne saute pas aux yeux dit comme ça, est une femme, et l’ancienne compagne de Child Kachoudas, le héros de La Parallèle Vertov – pour leur remettre de mystérieux manuscrits trouvés dans le désert du Néguev et remontant au premier siècle après Jean-Claude. Ces manuscrits – semble-t-il écrits par l’évangéliste Jean – rapportent une vie de Jésus un peu différente de celle que l’on connaît par le Nouveau Testament, mais, surtout, contiennent des indices sur la disparition de Child. En fait, on y trouve carrément – de manière codée, comme de bien entendu – des coordonnées indiquant où se trouve le Vertov, le fameux sous-marin nucléaire soviétique transformée en machine à voyager dans le temps. Et notre trio de se mettre en route pour Israël, accompagné par Dadka, le père de Child, et ses potes du Swamp Thing, un groupe de rock psychédélique pour quinquagénaires bedonnants (John Lee, Bassman, Lapin), et même – tant qu’on y est – Emma, la fille adolescente de Child et Sphinx. Et, de révélations en révélations, le petit groupe pas si petit que ça de se retrouver en Palestine à l’époque de la crucifixion du Christ…
Le thème, ainsi que vous le savez déjà, n’est pas franchement neuf en science-fictionnie : on pense tout naturellement à Voici l’homme de Michael Moorcock – auquel il est d’ailleurs fait directement allusion, de même qu’à « La Patrouille du temps » de Poul Anderson – ou encore au moins convaincant à mon sens mais pas totalement inintéressant Jésus vidéo d’Andreas Eschbach. Autant dire que Frédéric Delmeulle, dans Les Manuscrits de Kinnereth, marche sur un terrain foulé par nombre de prestigieux prédécesseurs, mais aussi un terrain miné. Et – on ne va pas le cacher plus longtemps – il saute dessus à pieds-joints avec un enthousiasme débridé pour le coup quelque peu navrant.
Le fait est là : Les Manuscrits de Kinnereth est un roman raté. Ça, c’est la version polie, celle à laquelle j’aimerais bien pouvoir me tenir du fait de la sympathie que m’avait inspiré l’auteur pour son premier roman. Mais du fait d’une intrigue mollassonne et pas crédible pour un sou – j’y reviendrai – qui se traîne péniblement jusqu’à une conclusion ridicule et bavarde qui, pour le coup, m’a rendu furax, je suis bien obligé de constater que ce second tome des « Naufragés de l’entropie » n’est pas seulement « pas bon » : il est à chier tout mou, oui. Et c’est bien triste. Car on est bien loin ici de tout ce qui faisait le charme de La Parallèle Vertov ; on n’en retrouve rien de ce qui faisait l’intérêt (tout relatif, mais bien réel néanmoins).
Commençons par le GROS problème de ce roman : la suspension d’incrédulité qui passe à la trappe. On n’y croit jamais. Rien de ce qui se passe dans ce roman n’est crédible. Du postulat de départ, pourtant cliché, au final puéril et couillon, rien, absolument rien, ne convainc le lecteur. Mais je m’en tiendrai ici à deux exemples : on ne voit franchement pas ce que le Swamp Thing et Emma viennent faire dans cette galère (et on se pisse dessus lors d’une scène de poursuite en bagnole qui mériterait de figurer dans une anthologie du pire), et on s’époumone devant ces quidams qui, aussitôt débarqués dans la Palestine du début de notre ère, se retrouvent sans difficulté aucune, là, comme ça, tout naturellement, à converser en latin avec leurs nombreux interlocuteurs. Je passe sur la fin du roman, émanant tout droit d’un cerveau adolescent porté sur le simili-blasphème à la con. Mais c’est gratiné.
Et, accessoirement (ou pas), c’est atrocement bavard. On ne compte pas, tout au long du roman, les dialogues d’exposition : Masterson met des chapitres et des chapitres à présenter les manuscrits tout en dissimulant l’existence et le rôle du Vertov au début du roman, tandis que la fin – oui, vraiment, elle m’a énervé – se résume à une longue, atrocement longue explication de son plan diabolique par le meuchant. Ajoutons que ce bavardage, en sus de l’absence totale de crédibilité déjà mentionnée, pèche étrangement en étant « trop écrit », et donc mal écrit.
Du coup, on s’ennuie – et arrivé à la fin, on s’énerve carrément. La franche érudition du roman, qui ne saurait faire de doute et aurait pu racheter bien des choses en temps normal, ne le sauve très certainement pas, tant elle est maladroitement utilisée. De même pour la tentative de mise en abyme du genre.
Le bilan est donc là, triste mais difficilement contestable : roman au mieux raté, au pire tout pourri du cul, Les Manuscrits de Kinnereth vient foutre en l’air tous les espoirs que l’on pouvait placer en son auteur après La Parallèle Vertov. J’ai encore du mal à m’en remettre… Passez votre chemin, ce bouquin ne vaut vraiment pas la peine qu’on s’y arrête. Et, pour le plus grand bien de son auteur, il mérite de sombrer illico dans l’oubli le plus total, comme un truc un peu honteux, un péché de jeunesse, peut-être. Pardonnez-lui, mon Dieu, il faut espérer qu’il ne savait pas ce qu’il faisait… Parce que sinon, c’est grave.

/image%2F1385856%2F20160114%2Fob_cfb8b0_caligari.jpg)






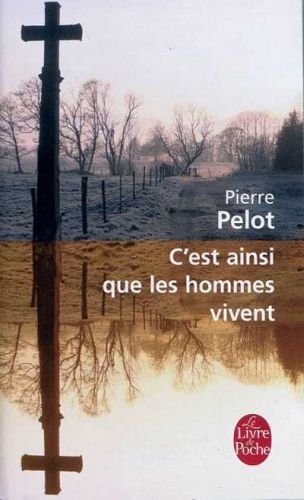

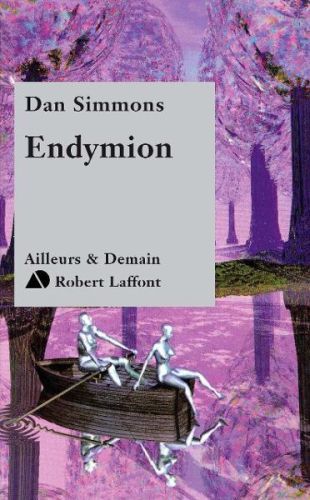

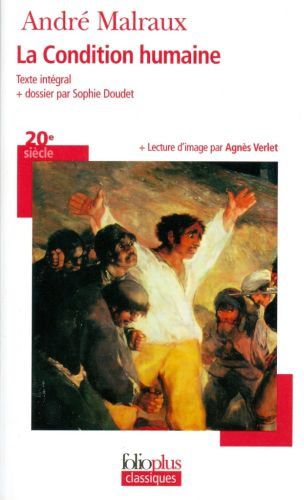


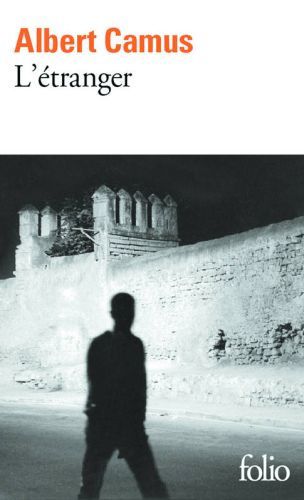




/image%2F1385856%2F20150204%2Fob_660a87_georges-abdaloff-croque-par-christell.jpg)