Ghostmaker, de Dan Abnett
ABNETT (Dan), Ghostmaker, in ABNETT (Dan), Gaunt’s Ghosts, vol.1: First and Only – Ghostmaker – Necropolis, Nottingham, Games Workshop – Black Library, coll. Warhammer 40,000 – Gaunt’s Ghosts, [2000] 2016, [édition électronique]
Retour aux romans Warhammer 40,000, et plus précisément à la série « Gaunt’s Ghosts », avec le deuxième volume, toujours signé Dan Abnett : Ghostmaker (en françouais faiblard simplement Les Fantômes). Comme son prédécesseur First and Only, je l’ai lu dans un omnibus reprenant les trois premiers titres de la saga, éventuellement rassemblés sous le titre de « trilogie de la Fondation » (mais c’est pas exactement du Asimov – boum takatakatak boum piou-piou blam). First and Only, ceci dit, ne m’avait pas forcément hyper emballé… Mais voilà : Ghostmaker encore moins. Et là ça devient quand même sacrément problématique.
La structure de Ghostmaker est un tantinet tordue, même si rien d’insurmontable – le truc, c’est que le bouquin est en fait une sorte de fix-up, et il semblerait bien que ce soit le cas au sens strict, c’est-à-dire que Dan Abnett y aurait rassemblé plusieurs nouvelles antérieures, consacrées aux différents membres du régiment des Fantômes de Gaunt, avec un vague liant pour en faire un roman. Ce qui ne marche pas hyper bien, des fois…
La structure, disais-je : Ghostmaker n’est pas, ou pas totalement, la suite de First and Only ; après une mise en bouche bien terne et qui n’appelle pas vraiment à beaucoup de développements (enfin, j'y reviendrai brièvement quand même), on commence véritablement le roman en remontant en arrière, au moment crucial de la fondation du régiment, sur Tanith, précisément quand, suite à une bêtise du commandement de la croisade dans les mondes du Sabbat, les forces du Chaos déboulent sans prévenir et ravagent la planète. L'anéantissent, même... Bizarrement, cet événement séminal est ici traité de manière très expéditive. Il y a tout de même deux moments clefs : quand le « gamin » Milo laisse de côté ses binious pour sauver Ibram Gaunt, et quand votre commissaire préféré récompense la quasi-mutinerie de son régiment à peine formé avec les débris de ce qui restait, en filant des grades à ceux qui étaient venus se plaindre auprès de lui de ce qu’il les avait privés de l’honneur de mourir pour Tanith (bande de crétins…) ; se plaindre, oui, et plus si affinités – ou plutôt le contraire... Mais c’est ainsi que le gentil Corbec devient colonel, et le vilain Rawne major, de manière passablement invraisemblable ; dans Ghostmaker plus encore que dans First and Only, on insiste beaucoup sur la relation amour/haine entre Gaunt et Rawne, qui laisse présager d’un moment dans la série, plus ou moins lointain, où le major butera le commissaire, ou sans doute plus exactement tentera de le faire, à moins qu’il ne trouve la rédemption d’une manière ou d’une autre. Dans les deux cas, ce serait de toute façon lourdingue… et ça l'est déjà.
Mais, rétrospectivement, on peut si l’on y tient remonter aux premières scènes hors Tanith : l’idée, qui perçait déjà dans First and Only, c’est bien sûr que, même dans ces conditions impossibles, Gaunt a su faire des survivants de Tanith un vrai régiment, très efficace, notamment dans les missions de repérage et d’infiltration, et a également su, ce qui était au moins aussi compliqué, s’attirer le respect puis éventuellement la sympathie de ses hommes.
Et c’est là qu’on en arrive au gros du roman, le fix-up à l’intérieur, dont le propos est de s’attarder sur chacun des principaux membres du régiment, au fil de récits les mettant individuellement en valeur, récits qui obéissent à une progression a priori chronologique des théâtres d’opérations : les premiers, sauf erreur, renvoient à une époque antérieure aux événements de First and Only, mais, progressivement, telle ou telle allusion nous laisse entendre que les récits les plus tardifs ont cette fois lieu après le premier roman de la série. Cette structure, en définitive, prolonge plus qu’elle ne contredit le principe de base, très « film de guerre », de la « bande de frères d’armes », répétitif mais indéniablement approprié dans le contexte de cette série focalisée sur un régiment.
Par ailleurs, ces « nouvelles » sont (vaguement) liées entre elles par des événements cette fois clairement postérieurs à First and Only : l’assaut de la croisade sur Monthax, un monde du Sabbat totalement ravagé par le Chaos. J’y reviendrai en fin de chronique, mais, pour l’heure, il faut surtout noter que les très brèves séquences de transition, qui ont lieu juste avant Monthax (au stade du transit, eh, et de la préparation), ou sauf erreur déjà durant l'assaut (?), ces séquences donc ont avant tout pour fonction, systématiquement, d’introduire le personnage qui sera au cœur de la « nouvelle » qui suivra immédiatement ; mais la dernière de ces histoires individuelles constitue en même temps une introduction bien plus marquée et cruciale, à l’ultime chapitre, consacré à la plus folle bataille jamais menée par le régiment de Tanith (en attendant comme de juste la suivante).
Mais cette structure, très mécanique finalement, n’est pas sans défauts, et de deux ordres : le premier, qui n’a rien d’inattendu dans un fix-up, est la disparité des récits le composant – certains sont bons, d’autres beaucoup moins… Et c’est lié, parfois (souvent ?), à l’intérêt intrinsèque du personnage au cœur du récit. Larkin, éventuellement Bragg ou Corbec, ou Mkoll ou le médecin Dorden, l’aide de camp Milo sans doute, peuvent susciter d’emblée mon attention, et gagner en caractère grâce au traitement particulier de Ghostmaker – ça m’a particulièrement frappé dans la « nouvelle » consacrée à Larkin « le fou », car sa folie n’était jusqu’alors pas vraiment palpable : elle le devient ici, mais avec ce qu’il faut d’ambiguïté pour assurer que le personnage y gagne bel et bien individuellement, sans devenir incohérent dans le contexte du régiment ; clairement, cette histoire a été mon moment préféré dans Ghostmaker – quand le sniper est confronté à ses démons, patientant auprès de la statue d’un ange… qui a l’idée saugrenue de lui parler, et de questionner ses intentions. C’est une bonne histoire – et, indépendamment de la structure de Ghostmaker, c’est une bonne nouvelle.
« Try Again » Bragg gagne en épaisseur, si l’on ose dire, dans un récit très madmaxien à l’ambiance assez soignée – il s’agit avant tout de nous montrer que le bonhomme n’a rien d’un imbécile, même si tout le monde sauf Gaunt semble le croire ; dans l’absolu, on va dire que ça n’est pas très très subtil, hein, mais ça fonctionne.
Corbec, lui, demeure le type plutôt sympa, mais plutôt malin, aussi – au sens où il sait compter avec les circonstances ; un talent tactique qui justifie en définitive son grade. Ghostmaker donne vaguement l’impression de se répéter plus tard avec l’histoire assez proche consacrée à Caffran… sauf que cette fois on a l’impression que c’est la stupidité qui paye, et ça ne joue pas exactement en sa faveur. « De l’audace, encore de l’audace, toujours de l’audace », admettons, mais là… Plus sympathique, il y a certes Dorden, mais, plus encore que pour Corbec, ce récit qui lui est consacré n’apporte finalement rien de neuf : il est Dorden, bon…
Mais si Rawne, un personnage que je n’apprécie donc pas, s’en tire plutôt pas si mal du seul fait que le cadre de son histoire est cool (un monde enneigé, un océan de glace même, et des Orks dans la tempête), certains personnages qui m’intéressent bien davantage ne bénéficient pas forcément plus que ça du traitement Ghostmaker, ceci parce que les histoires les concernant peinent à convaincre : Mkoll, par exemple, l’éclaireur, met certes en avant la compétence du Premier et Unique Régiment de Tanith dans son domaine, et ça change agréablement des brutes qui tirent en rafale en permanence, mais son histoire est pour le coup un peu trop badass – ce qui nous ramène d’ailleurs à d’autres séquences, antérieures, où les hommes de Gaunt massacrent du space marine du Chaos bien trop facilement ; si les plus redoutables soldats de la galaxie peuvent être abattus aussi aisément, quel est leur intérêt ?
C’est un problème assez similaire qui se pose concernant Milo – que nous sommes portés à suspecter d’être un psyker non déclaré depuis le premier tome ; l’arnaque à laquelle il participe est plutôt sympa sur le moment, c’est classique mais bien fait et même assez jubilatoire, mais l’enseigne se débarrasse bien trop facilement, par la suite, de l’attention menaçante de l’inquisitrice Lilith (un personnage très décevant de manière générale), et le « truc » qu’il révèle (hypocritement, peut-on supposer) suffit à la leurrer quand il ne leurre pas un lecteur en tant que tel censément bien plus crédule...
Mais je parlais d’un défaut d’un second ordre… et il est bien autrement gênant, car il agit sur la durée. En effet, la mise en valeur de tous ces personnages passe systématiquement par de longues scènes de bataille – Milo (comme de juste, il n'est alors pas soldat) est la seule exception dans tout le roman. Et, oui, OK, je suis au courant, merci : 1°) c’est du Warhammer 40,000, et 2°) c’est du « Gaunt’s Ghosts », donc une série focalisée sur un régiment, dans un monde où (jingle) il n’y a que la guerre. Mais là c’est tout de même lassant – parce qu’il n’y a vraiment que de ça du début à la fin (Milo excepté, donc).
C’est d’autant plus lassant que le traitement très « premier degré » de Dan Abnett, certes à propos dans le contexte facho++ de Warhammer 40,000, devient vite étouffant, pénible, creux (le style très utilitaire et en même temps démonstratif de l’auteur en rajoutant une couche). Récemment, je vous causais de Fulgrim, de Graham McNeill, qui était autrement plus malin (et divers) à cet égard – mais, en outre, les batailles narrées dans ce cinquième tome de « The Horus Heresy » étaient bien autrement palpitantes, et variées, que celles que l’on subit tout au long de Ghostmaker…
D’autant que le bonhomme Abnett est semble-t-il porté à se répéter de roman en roman : ici encore, comme dans First and Only juste avant bordel, une part non négligeable de « l’intrigue globale » (peut-être un bien grand mot ici) tourne autour de la rivalité meurtrière entre les Tanith et un autre régiment, en l’espèce le « Royal Volpone », des « sangs-bleus » qui se la pètent grave, et indirectement les artilleurs de Ketzok – si le rôle, contraint et forcé, de ces (pauvres) derniers produit quelques scènes intéressantes, je dois avouer que les gniards militaires qui s’entretuent dans le bac à sable, à force, je vais avoir du mal, hein… Là, ça commence, quand même...
Le grand chapitre final ne se montre pas beaucoup plus convaincant, hélas, voire bien moins encore. Cette énième bataille, en dépit de son caractère surréaliste-badass affiché (au point en fait où les cadres de l’administration impériale la passeront sous silence, et donc par là même les exploits les plus invraisemblables des Fantômes de Gaunt), pèche par trop d’endroits : une vague malhonnêteté concernant les participants (qui m’a d’ailleurs rappelé, par sa lourdeur roublarde, le MacGuffin sempiternellement retardé de First and Only), des personnages pas à la hauteur de leur rôle supposé (Lilith en tête), ce genre de choses…
En fait, c’est sans doute que nous sommes à nouveau confrontés à une mécanique très (trop) apparente, car cette grande scène obéit à des motifs flagrants, qui feraient sens dans l'absolu, mais qui sont plus ou moins habilement mis en scène, et plutôt moins que plus hélas. Il s'agit, pour partie, de rapprocher en dernier recours les Tanith et les Royal Volpone (sinon, ça aurait vraiment été exactement comme dans First and Only…), mais surtout, du fait d’une diablerie de psykers, de donner aux Fantômes de Gaunt l’occasion de se battre pour Tanith – même si ça n’est qu’une illusion. Ce qui nous renvoie bien sûr au début du roman, et « justifie » en dernier ressort les histoires des différents Fantômes de Gaunt, pour assurer en définitive leur compétence, leur unité, leur fraternité. Une idée intéressante dans l'absolu – mais traitée aux gros sabots, et ça ne convainc donc guère.
First and Only était une déception relative – Ghostmaker est à nouveau une déception, mais on peut faire sauter le qualificatif charitable, cette fois… Le divertissement bourrin est certes bourrin, et c'est peu dire, mais ne divertit guère. Larkin et sa statue ne sauvent pas les Fantômes de Gaunt, à cet égard. Conséquence : Necropolis, le tome suivant, sera celui de la dernière chance. Heureusement, j’en ai lu du bien à peu près partout, voire plus que ça. Alors espérons...

/image%2F1385856%2F20160114%2Fob_cfb8b0_caligari.jpg)








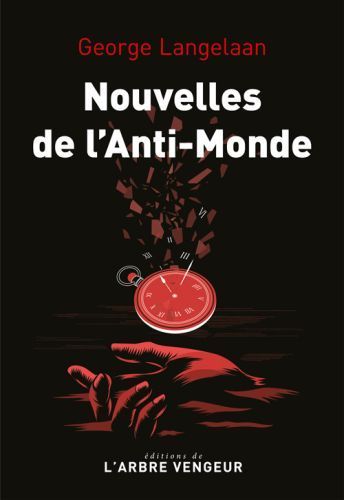



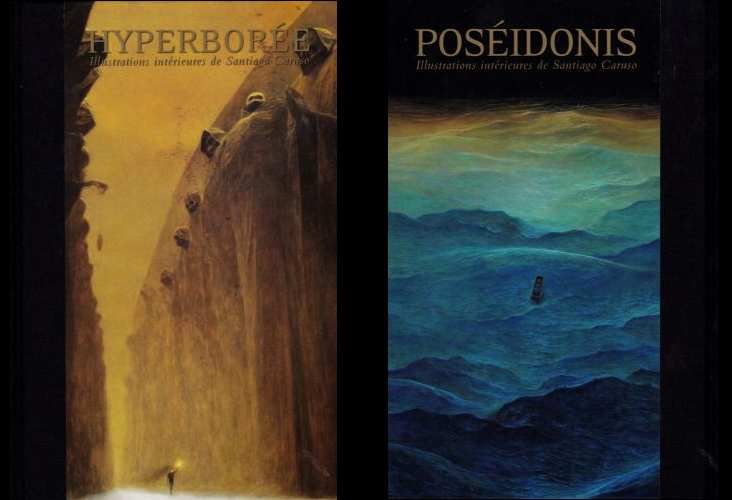


/image%2F1385856%2F20150204%2Fob_660a87_georges-abdaloff-croque-par-christell.jpg)