"Décomposition", de J Eric Miller

MILLER (J Eric), Décomposition, [Decomposition], traduit de l’américain par Claro, Paris, Le Masque, [2005] 2008, 204 p.
La communication. Voilà ben que’que chose de mystérieux (ma bonne dame). Tenez, prenez ce Décomposition de J Eric Miller, un auteur ricain dont je n’avais jamais entendu parler (mais là, pour une fois, je ne dis même pas honte sur moi, parce que visiblement j'étions pas le seul). Un bouquin sans vaisseaux spatiaux ni barbare armé d’une putain de hache à deux mains ni monstre indicible et redneck tortionnaire de blondes dans une cabane au fond de la forêt dedans : vous avouerez qu’a priori, ça n’a rien de séduisant. C’est traduit par Claro, c’est au Masque. Bon… À vue de nez, voilà bien le genre de bouquin à côté duquel je serais passé en temps normal. Mais voilà, les éditions du Masque se sont montrées fort habiles dans leur stratégie de communication : dans le cadre du Grand Complot International Contre Moi, elles ont engagé deux sinistres et perfides individus pour faire la propagande de ce court roman sur le ouèbe, à la seule fin que je l’achète et que je le lise (si c’est pas mesquin, franchement). Les coupables se nomment Fabrice Colin (quelqu’un qu’il écrit des trucs bien) et Raoul Abdaloff (un ignoble gauchiss’ qui fait aussi des photos). Les deux n’ont pas tari d’éloges sur la chose. Avec tout le respect que je leurs dois, ça n’aurait probablement pas suffi pour me convaincre : ils font après tout quotidiennement ou presque l’éloge de plein de trucs bizarres avec des mots compliqués dedans ; et c’est à cause de celui dont le patronyme ne me semble pas très français que j’ai lu La Théorie des cordes, ce qui montre bien que ce n’est pas toujours à bon escient. Mais voilà, le second, qui a la ruse du comploteur communiste, et semble-t-il sur la suggestion du premier (tout aussi coupable, donc), a axé sa communication, tant sur un forum interlope que je ne nommerai pas pour ne pas faire de publicité au Cafard cosmique, qu’au cours d’une mémorable chronique de l’infréquentable Salle 101 (où l’on a par ailleurs émis des remarques douteuses pour ne pas dire déviantes sur cette merveille qu’est Le Roman de Renart, comme je les y prends), il a axé sa communication, disais-je, sur cette formule imparable (en gros) :
« Dans ce roman, il y a des cadavres, des poules et du caca. »
…
Ça, c’était un coup bas, ou je ne m’y connais pas.
Bien évidemment, avec un pitch pareil, je ne pouvais que me rendre dans une librairie où l’on vend des livres de pas-science-fiction pour m’emparer de la chose (en bavant, en gesticulant et en émettant des sons improbables).
Cela dit, en fait de cadavres, il y en a surtout un (bon, un et demi, on va dire) ; et en fait de poules, il y en a surtout une ; par contre, y’a beaucoup de caca. Et de sang et de vomi et de foutre (aaaaah, foutre, rhaaaaa). Mais j’y viens.
Ce n’est pas à vous, mes très chers lecteurs, que j’apprendrai que toutes les femmes sont des putes.
(D’ailleurs, j’aurai bientôt en principe l’occasion d’y revenir.)
(Oui, moi aussi, j’essaye de faire dans la communication, tant qu’à faire.)
(Mais j’ai peut-être raté une leçon ou deux.)
Donc. La narratrice/héroïne de ce roman, comme toutes les femmes, est à l’évidence une catin. Elle est d’ailleurs très belle (enfin, en tout cas, elle nous le dit régulièrement). Et passablement superficielle, pour ne pas dire conne (non, ça, c’est moi, mais j’ai peut-être mauvais fond, après tout). Un jour, peu de temps après le décès de son gniard Danny Boy (oui, parce qu’elle a commencé tôt, en plus), elle avait rencontré un type vach’ment bien, du nom de George. Intelligent, gentil, doux, très bien, vraiment. Bon, d’accord, peut-être un peu bedonnant, un peu mou, pas très causeur, pas très porté sur la flatterie, pas le plus talentueux des amants, sans doute… Mais bon : un type bien, merde !
…
Pffff. Toutes les mêmes.
Bien sûr, elle l’a jeté comme une vieille chaussette pour tomber dans les bras de Jack. Jack aussi est intelligent, certes ; d’ailleurs, il écrit des livres, alors, hein, bon. En plus, il est beau comme un dieu grec, Jack, plus expansif, et terriblement bien membré.
Enfin, il était. Parce que Jack était aussi un gros con. Ou un connard, plus exactement. Et notre héroïne a fini par le tuer (ça, c’est les gonzesses, hein…). Elle a fourré le cadavre dans le coffre de sa voiture, et s’est mise à tracer la route. Elle quitte ainsi la Nouvelle-Orléans, peu avant que Katrina y déboule pour diminuer la proportion de nègres et de pauvres dans la population américaine (où l’on voit bien que l’on a tort de donner des noms de femmes aux ouragans : les pondeuses, elles, contribuent à augmenter la proportion de nègres et de pauvres).
(Pardon.)
… Elle se dit qu’elle va rejoindre George, qui vit à Seattle (sur une carte, oui, effectivement, ça fait loin). Et comme dans tout bon conte de fées, tout va bien se passer (elle ne cesse de le répéter, après tout), George va l’accueillir à bras ouverts, ils vont se marier et avoir beaucoup d’enfants.
Oui, elle est un peu paumée. Ce qui explique pas mal de chose, sans doute, au-delà de l’incongruité de ce projet « féerique ». On ne peut pas dire qu’elle soit vraiment en cavale, d’ailleurs. Non, elle roule, et elle pense. A George, bien s… mmmh… à Jack, surtout. Elle devrait pas, mais c’est plus fort qu’elle. Et elle s’arrête régulièrement, sur une aire d’autoroute paumée au milieu du vide, dans un motel pourri sentant l’Amérique profonde, dans une station-service isolée, ou, pourquoi pas, sur la bande d’arrêt d’urgence, au mépris des insultes et des klaxons furibonds de ses concitoyens motorisés. Et là, elle ouvre le coffre, et elle regarde Jack. Il en est au stade de la rigor mortis. Mais il ne bandera plus jamais (elle a vérifié, il a la bite toute molle ; tant pis). Et, bientôt, il va commencer à se décomposer. Et ça va sentir. Pas très bon. Tiens, ça a commencé, d'ailleurs.
En attendant, notre héroïne a besoin d’un compagnon de route. Un vrai, pas ce salaud de Jack. Qui est mort de toute façon, alors, bon. Sur un coup de tête, elle s’en prend à un camion plein de poules destinées à finir en nuggets. Justicière de la route, elle les libère, et elle en prend une ; ça sera sa copine, elle va l’appeler Petite poule (elle est très imaginative) (ah, oui, les autres poules, en s’échappant, se font massacrer sur l’autoroute, et ça gicle de partout). Petite poule n’est pas très causeuse, cela dit. Et elle sent un peu, elle aussi. Et c’était probablement pas une très bonne idée de l’enfermer avec Jack : même mort, il était quand même mieux avec ses deux yeux. Il avait de beaux yeux, Jack. Ce salaud. Va falloir remédier à ça.
C’est en gros comme ça que débute ce court road movie/book. Bien sûr, au fil des nombreuses ellipses, elle va rencontrer plein de gens durant son voyage, comme un condensé d’Amérique, quelque part entre Jésus et les solderies pornos. Des flics, des rivales, des jeunes, des vieux, des qui mangent du poulet. Des gens qui s’aiment. D’autres qui s’aiment moins. Et puis elle pense, surtout (la route est monotone) ; elle devrait penser à George, mais elle a du mal à se concentrer ; alors elle pense à Jack, mais aussi à Danny Boy, à ses parents… à sa vie, quoi. Et la petite princesse n’a pas exactement vécu un conte de fées ; oh, rien d'indicible, hein... justement... Elle pense à l’amour, aussi. Et au cul. À la difficulté de tout concilier, sans doute. Et elle en parle, sans euphémismes, sans arrière-pensées ; juste un rêve en ligne de mire.
Au début, c’est assez drôle, sans jamais verser dans le presse-bouton, et un peu irréel. Très vite, ça devient avant tout tragique. Sans jamais abuser des effets là non plus. Et c’est toujours très cru, et même sordide. Et, étrangement, ça n’en devient que plus poignant et authentique. À un point impressionnant, à vrai dire, et avec un naturel désarmant, poétique et déprimant. On s’y attache, à cette petite conne ; on l’écoute nous parler de ses histoires, de ses plans cul, de ses courses au Wal-Mart, et on se met à bien l’aimer, à se glisser dans sa peau, presque. Et à regarder de ses yeux fatigués mais maquillés la vie et le monde tout autour. Et c’est dur, et triste.
Et beau. Bizarrement beau.
Mais triste.
Autrement dit, si je n’irais pas jusqu’à en faire un chef-d’œuvre incontournable, c’est effectivement un bon bouquin, faussement simple malgré son canevas minimaliste et totalement dénué d’originalité. Rien d’un polar ou d’un thriller, non, et finalement rien de vraiment drôle non plus ; une tranche de vie cruelle et juste, et qui touche au cœur autant qu’aux tripes.

/image%2F1385856%2F20160114%2Fob_cfb8b0_caligari.jpg)



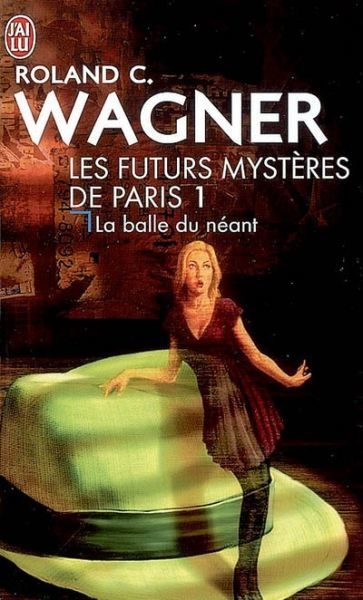



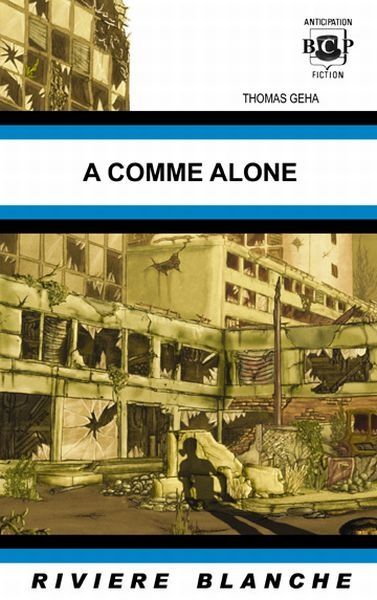


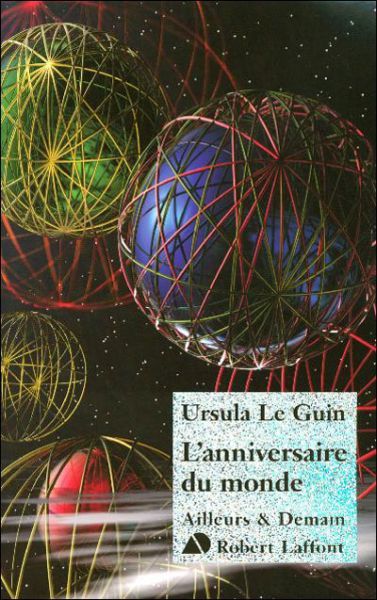

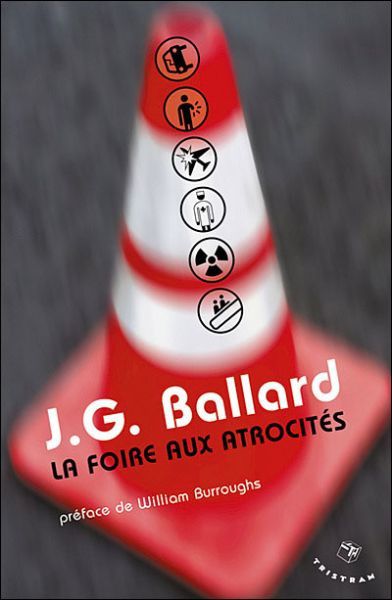

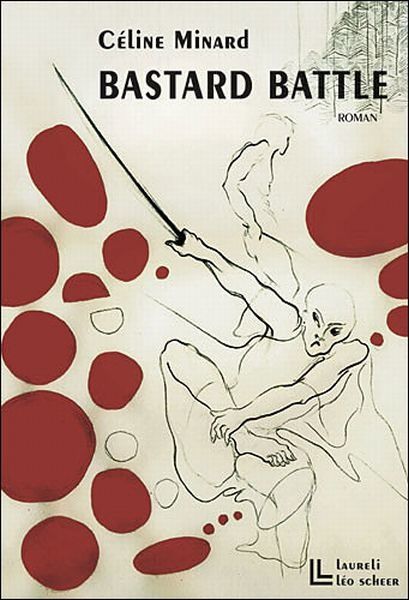

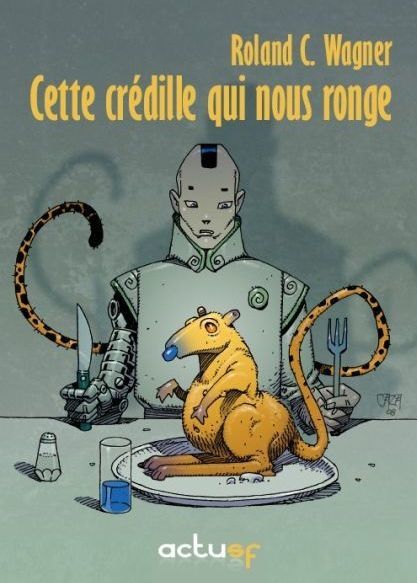



/image%2F1385856%2F20150204%2Fob_660a87_georges-abdaloff-croque-par-christell.jpg)