"L'Etoile du matin", de Wu Ming 4

WU MING 4, L’Étoile du matin, [Stella del mattino], traduit de l’italien par Leila Pailhès, Paris, Métailié, [2008] 2012, 356 p.
Sous le nom de « Wu Ming » se cache un collectif de quatre jeunes auteurs italiens, qui publient des ouvrages signés ensemble (comme par exemple Manituana, dont on m’a dit le plus grand bien), ou bien écrits individuellement, mais en gardant cette désignation, assortie d’un numéro. Ainsi, j’avais déjà fait l’acquisition de Guerre aux humains de Wu Ming 2, sans avoir encore eu le temps de m’y mettre (mais va falloir, un jour ou l’autre). L’Étoile du matin est semble-t-il le premier roman publié en solo par Wu Ming 4. Et, autant le dire de suite, c’est un grand, et même un très grand roman, à la lecture duquel je me suis régalé.
Il faut dire que son postulat comme le « casting » sont des plus alléchants… Nous sommes à Oxford, en automne 1919. Dans la vieille ville universitaire, nous faisons la connaissance de trois jeunes gens, tous trois rescapés de la Première Guerre mondiale qui les a passablement traumatisés, et tous trois destinés à devenir des intellectuels renommés et des grands noms des lettres britanniques. Il y a ainsi Robert Graves (que, honte sur moi, j’avouais ne pas connaître avant la lecture de ce roman…), qui est déjà un poète à la réputation grandissante, et publiera plus tard d’importants essais sur la mythologie ; C.S. Lewis, dit « Jack », alors fervent rationaliste et athée (ça changera au contact notamment du suivant…), déjà poète, mais pas encore l’auteur à succès de SF et de fantasy que l’on sait ; et, last but not least, J.R.R. Tolkien, qui a déjà écrit les premiers contes qui constitueront plus tard les récits du Premier Âge, mais est bien loin de s’imaginer en colossal auteur du non moins colossal Seigneur des Anneaux. Ces trois jeunes gens ne se connaissent pas vraiment, voire pas du tout (l’amitié entre Lewis et Tolkien ne débutera qu’ultérieurement), mais, on le voit, ils ont pas mal de points communs.
Et tous trois, dans le cadre feutré d’Oxford, vont être amenés à côtoyer plus ou moins un autre jeune homme, également rescapé de la guerre, également destiné à devenir un grand nom de la littérature anglaise, un ancien archéologue qui ne se contente pas d’exprimer un intérêt pour les mythes, mais qui en est devenu un, plus ou moins malgré lui, une légende vivante à la réputation sans pareille : le colonel T.E. Lawrence, alias Lawrence d’Arabie… Robert Graves deviendra un de ses proches, et lira les premiers jets des futurs Sept Piliers de la sagesse (dont j’avais entamé la lecture il y a fort longtemps, ça serait une bonne idée que de terminer un jour ces fascinantes mémoires…) ; J.R.R. Tolkien le rencontrera à l’occasion, plus ou moins par hasard, dans un musée, devant une vitrine contenant… des anneaux, et finira par y reconnaître son Túrin Turambar (voir notamment Les Enfants de Húrin) ; C.S. Lewis, quant à lui, sans le connaître, deviendra sa Némésis…
Tout cela à la lumière de l’étoile du matin aux noms multiples : Vénus, Lucifer, Eärendel… Tout un programme se dissimulant derrière ces diverses désignations.
Vous, je sais pas, mais moi, j’ai trouvé ça plus qu’alléchant. Surtout pour deux de ces quatre personnages il est vrai : j’ai déjà eu l’occasion de m’exprimer pour ce qui est de Tolkien (et je note que, finalement, même si cela n’a probablement rien d’indispensable, la lecture préalable de la biographie de Humphrey Carpenter m’a été utile) ; quant à Lawrence, c’est un personnage qui m’a toujours fasciné, le dernier des héros dans un sens (depuis que je suis gamin, j’ai vu et revu le film classique de David Lean des dizaines de fois, avec toujours le même plaisir, voire de plus en plus à chaque fois ; et j’avais donc entamé la lecture des Sept Piliers de la sagesse, mais…).
Et l’on retrouve bien ici cette fascination pour la légende vivante, avec ce qu’elle a sans doute d’imposture – oui, Lawrence d’Arabie est à bien des égards une icône forgée par le journaliste américain Lowell Thomas, en tripatouillant parfois la vérité pour lui conférer un vernis qu’on aurait envie de qualifier d’hollywoodien, au prix peut-être d’un léger anachronisme – et de part d’ombre – « Urens » cache bien des choses, sur la piste desquelles se lance Lewis, et, surtout, il traîne la culpabilité d’avoir peut-être trahi Fayçal, Auda et les Arabes en général, en leur vendant la liberté et l’indépendance quand Anglais et Français avaient négocié les accords Sykes-Picot pour se partager les anciennes possessions de l’empire turc…
Mais c’est justement une belle occasion d’interroger la notion de mythe, obsession semble-t-il du groupe Wu Ming en général comme des personnages de ce roman. Il s’agit bien, ici, de « transformer le monde en le racontant ». L’exergue du roman, empruntée à Pline le Jeune, est éloquente : « Pour moi, j’estime heureux ceux à qui les dieux ont accordé le don, ou de faire des choses dignes d’être écrites, ou d’en écrire de dignes d’être lues ; et plus heureux encore ceux qu’ils ont favorisés de ce double avantage. »
Encore que « heureux » prête à débat… Tous, ici, Lawrence au premier chef bien sûr, mais les trois autres également, sont des êtres en souffrance. La guerre et son cortège d’horreurs les ont traumatisés (dimension surtout sensible chez Graves, qui s’en est fait le poète mais veut abandonner ce thème, ce que ses admirateurs digèrent plus ou moins, mais aussi chez Tolkien, marqué à vie par la disparition brutale de deux des membres du TCBS, hanté par leurs spectres, et qui, du coup, laisse reposer dans un tiroir ses contes perdus pendant l’année que dure le roman). Mais cela va au-delà. La grandeur des personnages et de leur œuvre est toujours mise en regard, avec une profonde adresse et une remarquable sensibilité, avec leur quotidien parfois misérable ; chez Lewis, surtout, porteur lui aussi d’une grande culpabilité, c’est particulièrement troublant. Sans parler bien sûr de Lawrence, qui cristallise tous ces thèmes dans sa figure bigger than life, et réclame la punition…
Roman profond sur le mythe et la réalité, et les rapports ambigus qu’ils entretiennent, L’Étoile du matin est également une belle réflexion sur l’acte d’écrire, sur ses difficultés intrinsèques, et sur le merveilleux pouvoir des mots (belle épiphanie, quand Lawrence le « révèle » au philologue Tolkien…). Et il constitue lui-même à cet égard une impressionnante réussite : doté de personnages extrêmement humains et campés avec une délicatesse et une sensibilité des plus notables, superbement écrit, d’une plume majestueuse et puissante on ne peut plus appropriée au sujet, d’une intelligence indéniable, qui ne verse heureusement jamais ni dans le didactisme, ni dans la froideur, mais sait bien au contraire la conjuguer à l’émotion, le roman de Wu Ming 4 passionne et fascine. Le pari était un peu dingue, et indéniablement risqué, mais l’auteur italien a su user avec talent de ses extraordinaires personnages et de la richesse de sa thématique. Et L’Étoile du matin est une merveille, destinée à marquer durablement. Lisez-moi ça tout de suite, c’est un ordre.

/image%2F1385856%2F20160114%2Fob_cfb8b0_caligari.jpg)








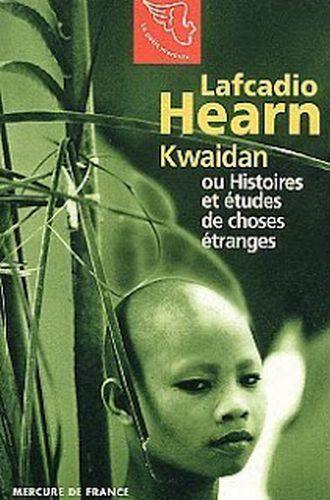

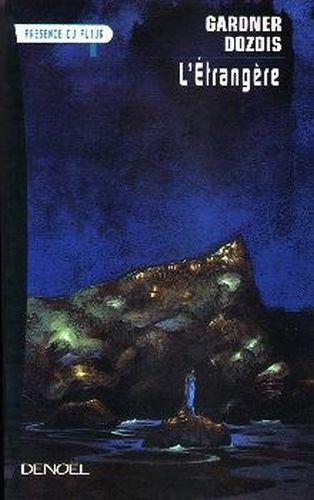







/image%2F1385856%2F20150204%2Fob_660a87_georges-abdaloff-croque-par-christell.jpg)