"Physiognomy", de Jeffrey Ford

FORD (Jeffrey), Physiognomy, [The Physiognomy], traduit de l’américain par Jacques Guiod, Paris, J’ai lu, coll. Science-fiction, [1997, 2000] 2002, 253 p.
De Jeffrey Ford, je n’avais lu jusqu’à présent que quelques nouvelles ici ou là (enfin, dans Fiction, si je ne m’abuse), qui m’avaient laissé plus ou moins de souvenirs. Mais un libraire (nécessairement perfide) m’avait fortement engagé à lire ce roman, qui a reçu le Wolrd Fantasy Award 1998. Un roman dont je ne savais à peu près rien en en entamant la lecture, si ce n’est qu’il tournait autour de cette fameuse pseudo-science qu’est la physiognomonie, appliquée en l’occurrence à la criminologie.
Nous sommes dans un monde autre, placé sous la férule du Maître Drachton Below, génial inventeur de la Cité impeccable, et qui a hissé la physiognomonie au rang de science de gouvernement. Cley est Physiognomoniste de Première Classe. Et c’est un personnage parfaitement odieux, débordant de mépris pour ses concitoyens, qu’il ne saurait envisager que comme des êtres nécessairement inférieurs.
Le Maître en personne lui confie de temps à autre des enquêtes, et le charge cette fois de se rendre dans le Territoire, à Anamasobie, minable petite ville qui confère tout son sens à l’expression si galvaudée de « trou du cul du monde ». On y a en effet dérobé le fruit du Paradis terrestre, lequel, dit-on, pourrait bien accorder l’immortalité (aussi le Maître entend-il bien le récupérer à son avantage exclusif). Cley se rend donc sur place afin de « lire » l’intégralité de la population de ce bled pourri, et de déterminer ainsi qui est le voleur et où est passé le fruit magique.
Là-bas, Cley tombe sur une populace répugnante qu’il juge particulièrement stupide et croulant sous les tares – il suffit de les regarder du bon œil, il n’est même pas forcément nécessaire de sortir ses instruments de physiognomonie pour ce faire. Il y a cependant une exception, d’autant plus troublante qu’il s’agit d’une femme (or les femmes, ainsi qu’on le sait, sont des êtres nécessairement chétifs et défectueux) : Arla semble en effet – horreur glauque – être aussi intelligente que belle, et Cley la charge de devenir son assistante dans cette enquête, dans la mesure où elle ne manque pas de connaissances en physiognomonie.
Mais tout ne se passe pas comme prévu, loin de là. Entre deux injections de « pure beauté » (ou deux sarcasmes particulièrement douloureux à l’encontre des pauvres habitants d’Anamasobie), Cley se met à rencontrer quelques difficultés, et il se pourrait bien qu’il ait perdu son aptitude pour la physiognomonie…
La quête du voleur à Anamasobie occupe en gros les cent premières pages du roman. Et celles-ci sont véritablement excellentes. Le roman de Jeffrey Ford déborde d’idées et d’astuces, et le caractère particulièrement dégueulasse de Cley contribue énormément à la qualité de la chose : c’est un salaud magnifique comme je les aime. Ajoutons que la plume de Jeffrey Ford est des plus savoureuses, tant dans les répliques cinglantes et méprisantes que dans les descriptions très perfectionnées et précises du fait du recours systématique à la physiognomonie.
Mais les choses changent ensuite radicalement. En effet [SPOILER ?], après l’aventure à Anamasobie, Cley va être déporté dans des mines de souffre, une colonie pénitentiaire singulièrement kafkaïenne. Là, il va progressivement prendre conscience de l’horreur de son métier et des dramatiques conséquences que son activité a pu avoir. Et quand [SPOILER] il va être libéré par le Maître, contre toute attente (c’est d’ailleurs plus ou moins convaincant…), il va devenir un ennemi acharné du régime de Drachton Below, et se lancer dans une longue et périlleuse tentative de rachat.
Disons les choses franchement : à cet égard, le projet de Jeffrey Ford ne m’a pas séduit, et m’a même quelque peu déçu… Après les cent premières pages proches de la perfection, cette histoire de rédemption est tout de même un peu convenue, et, si les idées brillantes ne manquent pas par la suite, qui font que l’on lit toujours ce roman avec un indéniable plaisir, on ne peut s’empêcher, de temps à autre, de regretter l’odieux personnage qui nous régalait dans les premières pages de sa boursouflure et de son mépris.
Impression un brin mitigée, donc, même si c’est peut-être pour de mauvaises raisons : encore une fois, tout ceci est très subjectif, et tient à ma relative déception à l’égard du projet de l’auteur. J’ai trouvé le début du roman excellent, la suite simplement bonne. Ce qui place déjà Physiognomy au-dessus du lot, incontestablement. Mais, en tournant la dernière page, je n’ai pu m’empêcher d’émettre quelques regrets, et de me dire que Jeffrey Ford a peut-être quelque peu gâché un sujet en or. Bon, j’ai aimé, hein… Mais voilà : c’est simplement bon, au final, quand le début laissait présager bien davantage.

/image%2F1385856%2F20160114%2Fob_cfb8b0_caligari.jpg)










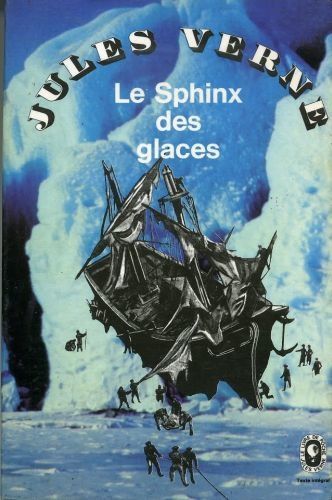





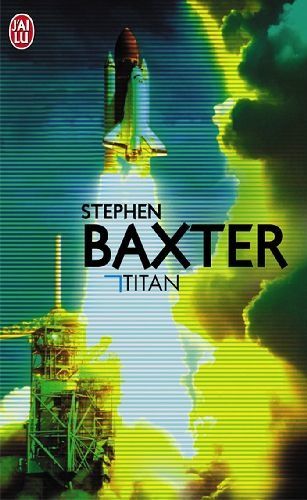

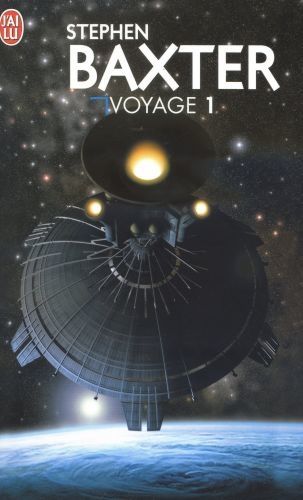
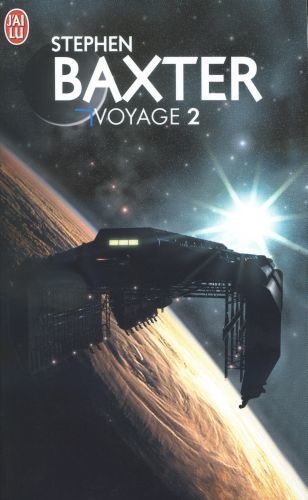

/image%2F1385856%2F20150204%2Fob_660a87_georges-abdaloff-croque-par-christell.jpg)