Gunnm Last Order, vol. 2 et 3 (édition originale), de Yukito Kishiro

KISHIRO Yukito, Gunnm Last Order, vol. 2 (édition originale), [Ganmu Rasuto Ôdâ 銃夢 Last Order], traduction depuis le japonais [par] David Deleule, Grenoble, Glénat, coll. Seinen manga, [2000, 2011] 2019, 336 p.

KISHIRO Yukito, Gunnm Last Order, vol. 3 (édition originale), [Ganmu Rasuto Ôdâ 銃夢 Last Order], traduction depuis le japonais [par] David Deleule, Grenoble, Glénat, coll. Seinen manga, [2000, 2011] 2019, 305 p.
Retour à Gunnm Last Order, la suite/rectification de la cultissime série Gunnm par son auteur lui-même, Kishiro Yukito. Je ne vais pas revenir dans les détails sur la raison d’être et le caractère controversé de ce développement plus ample que prévu, je vous renvoie pour cela à ma chronique du premier tome. Cela dit, cette réception critique souvent boudeuse n’a pas manqué de m’affecter quand je me suis dit que je pouvais bien tenter l’expérience des tomes 2 et 3… Et, le résultat… Eh bien, à vrai dire, j’ai plutôt apprécié cette lecture, même si elle s’est ouverte sur un gros facepalm, et s’est plus ou moins conclue… disons sur l’anticipation d’un gros facepalm tout proche (ou même deux). Surtout, la lecture de ces deux tomes m’amène à m’interroger sur mes attentes au regard de cette série, mais tout autant sur celles des autres lecteurs, et ce qui peut les différencier – voire les opposer.
Ça commence plutôt mal, trouvé-je – avec la conclusion du gros combat amorcé à la fin du tome 1, un décalage éditorial déjà caractéristique de la série initiale. Le combat en lui-même est plutôt honnête, c’est ce qui l’entoure qui me gave : les notes de bas de page à la con, moins nombreuses que dans mettons The Ghost in the Shell de sinistre mémoire, mais aussi creuses et pénibles, et la surdose associée de techno-mystico-bla-bla – attention les yeux et les oreilles, Desty Nova, en bon commentateur sportif, a quelque chose d’important à vous dire (p. 14) :
Dans le plasma, les mouvements des différentes ondes magnéto-soniques ou acoustiques ioniques forment régulièrement des pics d’une grande amplitude qu’on appelle « solitons ».
[Note de bas de page : Soliton : onde solitaire. Onde qui se propage sans se déformer et sans déperdition d’énergie lors de la collision avec d’autres ondes. Les tsunamis sont un type de soliton.]
Gally a utilisé le plasma pour transmettre son Hertzscher Hauen à partir des solitons magnétohydrodynamiques qui s’y trouvent.
Dans un contexte normal, les mouvements ondulatoires devraient perdre de leur énergie à cause de l’amortissement cyclotron…
Mais un événement a amplifié l’énergie des ondes par la résonance… Pour schématiser, elle a renversé la puissance magnétique de Sarchmod contre lui et lui a renvoyée sous forme de solitons.
Si je devais le nommer, j’appellerais cela…
UN SOLITON DE PLASMA !
C’est dans ces circonstances qu’on plaint le traducteur – sauf que pas vraiment, parce que son boulot est assez dégueulasse de manière générale, au moins autant que dans Gunnm, alors que la nouvelle traduction était censée être un atout de cette réédition… En fait, cette citation en témoigne, et en plusieurs endroits – où c’est le français qui coince.
Je ne peux pas, dans l’absolu, exclure la parodie – mais ce genre de trucs est balancé avec un aplomb total et dans un contexte qui laisse bien croire qu’il s’agit de quelque chose de parfaitement sérieux.
Disons-le, si j’avais dû me payer un autre passage du genre dans les cent pages qui suivaient, j’aurais bazardé ce tome 2 pour ne plus jamais y revenir.
Mais, subitement, tout change.
Gally est toujours obsédée par le sort de Lou, sa « collègue » de Zalem du temps de Gunnm. Ce qui fournit un prétexte un peu fumeux mais qui en vaut bien un autre pour la suite des opérations. Dans la perspective transhumaniste de cet univers, Gally découvre que la personnalité (et, plus ou moins seulement, la mémoire) de Lou a été stockée quelque part dans Jéru, soit l’autre extrémité de l’ascenseur spatial dont Zalem constitue la base flottante dans l’atmosphère terrestre. Ni une, ni deux, et sans vraiment s'embarrasser des implications aussi bien éthiques que scientifiques de sa quête, Gally décide donc de gravir « l’Échelle de Jacob » (ou le Ladder) pour se rendre dans l’espace – la motivation essentielle de Kishiro Yukito dans Gunnm Last Order. Et, là, elle va découvrir un univers tout autre.
C’est le caractère essentiel du tome 2, dès lors : une longue exposition d’un univers très complexe, et pour ainsi dire totalement indépendant de ce que nous connaissions jusqu’alors de la Terre, Kuzutetsu et environs, et même de Zalem. Et Kishiro Yukito s’en donne à cœur joie, introduisant avec un luxe de détails tout un environnement à l’échelle du système solaire, riche en habitats fantasques (cités flottantes vénusiennes, stations orbitales titanesques, relais aux points de Lagrange, et même une sorte de sphère de Dyson en construction autour de Jupiter), aux relations diplomatiques tendues et plus subtiles qu’il n’y paraît, et en personnages qui, pour plusieurs d’entre eux, ont atteint un stade de développement relevant largement de la post-humanité.
Autant dire, à tous ces degrés, d’excellentes idées de science-fiction, du genre que je n’espérais plus dans cette série, surtout après les illuminations charabiesques à répétition de Desty Nova.
Et ceci même si une prémisse essentielle de cet univers, la mathusalisation, soit une politique délibérée de la part des transhumains peu ou prou immortels pour empêcher la naissance ou le développement de nouvelles générations humaines susceptibles un jour de les remplacer, ceci donc même si cette prémisse me laisse un peu froid voire sceptique, pas tant pour le fond (admettons…) que pour son traitement passablement gnangnan. Et je relève aussi, bien sûr, que ces longues dissertations scientifiques, technologiques, politiques, métaphysiques, etc., sont inévitablement accompagnées d’une foultitude de notes de bas page, par chance moins creuses que celles envisagées plus haut.
Par ailleurs, tout cet univers est riche en personnages plutôt bien conçus, car plus complexes qu’ils n’en ont tout d’abord l’air, et qui bénéficient tous d’un character design irréprochable : ainsi Aga M’Badi (couverture du tome 3), ex-héros devenu le patron du Ladder, un personnage qui suinte la puissance à tous les niveaux et n’en est que plus inquiétant, ou encore le hacker égocentrique et misanthrope Ping Ü (couverture du tome 2) et les robots qui l’environnent, mais aussi bien d’autres, d’importance comme la délégation martienne anachronique qui rapproche enfin Gally/Yoko de sa planète natale déchirée par la guerre civile (avec des bons gros cons de nazis de l’espace dedans), ou plus secondaires, comme les représentants de la République de Vénus, de l’Union des Régions du Système Jovien ou de la Fédération Orbiterrienne, tous singuliers et désireux de forcer leur propre agenda, radicalement incompatible comme de juste avec tous les autres.
(Je mets de côté Sechs en chibi psychopathe, pourquoi pas.)
Je n’ai pas seulement été agréablement surpris par cette tournure inattendue : avec quelques bémols çà et là, je l’ai adorée.
Kishiro Yukito y consacre beaucoup de soin et de temps – cette longue mise en place occupe l’essentiel du tome 2 et un bon tiers, ou une petite moitié, du tome 3. La médaille a son revers : durant toutes ces pages, il y a somme toute très peu d’action, et a fortiori de combats. À la fin du tome 2, dans ses petits gags « Petites scènes de la mise au placard », l’auteur en fait l’aveu : « Deux épisodes de combat mis au placard qui sont offerts ici à ceux qui trouvent que Gally ne s’est pas beaucoup battue dans ce tome 2 ! » Et c’est peu ou prou une constante des quelques critiques que j’ai pu lire çà et là sur le ouèbe : trop de bla-bla, pas assez d’action, on s’ennuie.
Et c’est là que je me rends compte, donc, combien mes attentes peuvent différer de celles de bien des lecteurs de Gunnm et de Gunnm Last Order – et je précise au cas où : je ne fais pas ici dans le jugement de valeur ! Je tente seulement un constat qualitativement aussi neutre que possible. Mais voilà, quant à moi, je ne me suis pas du tout ennuyé durant cette longue mise en place ; elle est bavarde, certes, mais à bon droit et je ne parlerais pas de bla-bla pour autant – le bla-bla, en ce qui me concerne, ce sont les héros combattants qui ressassent « mon adversaire est vraiment très très fort je ne vais jamais pouvoir le battre ! » en serrant la mâchoire, avant de faire usage d’un nouveau super-pouvoir (pompeusement nommé sur le vif, comme de juste) qui leur assure la victoire, et les personnages secondaires qui commentent les bastons en direct, peu ou prou micro en main. Le bla-bla, surtout, ce sont les fumisteries mystiques de Desty Nova, le mélodrame à un demi yen, les notes de bas de page absconses et qui ne servent absolument à rien.
Gunnm et Gunnm Last Order sont des mangas d’action, bien sûr. Je ne vais certainement pas me plaindre que ces séries abondent en scènes d’action… Elles font indéniablement partie de leurs atouts, et j’ai pris bien du plaisir à lire les combats les plus apocalyptiques dont ces séries sont capables. Mais cette « pause » ne m’a pas déplu, loin de là.
Là où j’ai fait la moue, c’est devant les promesses de l’auteur d’y « remédier » : durant une bonne partie du tome 2, Kishiro Yukito multiplie les effets d’annonce, sur le mode « Oui, certes, il n’y a pas beaucoup de combats en ce moment, mais ça va revenir ! », et, hélas, en se repliant sur un artifice « de sécurité » : l’imminence d’un grand tournoi – qui, allez, va décider du sort de tout le système solaire ; parce qu’il n’y a personne de mieux à même de résoudre les embrouilles politico-diplomatiques d’un univers complexe que le vainqueur d’un tournoi d’arts martiaux, de toute évidence.
Misère…
La BD japonaise populaire, en ce qui me concerne, a vraiment un problème avec ces tournois – une figure du nekketsu, m’avait-on appris il y a quelque temps de cela. Ils sont partout. Ils sont la raison qui m’a fait décrocher de Dragon Ball, notamment, avec le Tenkaichi Budokai comme expédient fainéant auquel on revient toujours quand il importe de relancer la machine et qu'on n'a pas grand-chose à dire – en jouant toujours plus absurdement de la logique pernicieuse de la montée en puissance. Gunnm, la série initiale, en était d’ailleurs affectée en au moins une occurrence : l’arc du motorball (tomes 3 et 4), que j’avais détesté… et qui figure pourtant parmi les plus mémorables de la série voire de l’histoire du manga, à en croire bien des lecteurs. J’aime les combats qui se justifient, et qui font avancer l’histoire – mais ces tournois, ça me gave à peu près systématiquement…
Par chance, cependant, Kishiro Yukito, à ce stade, repousse sans cesse l’échéance : il y a de la marge entre l’annonce et la réalité du tournoi. Ce qui me convient très bien. Par chance aussi, quand le tome 3 commence à se rapprocher dangereusement dudit tournoi, l’auteur fait en sorte de lui constituer comme un prologue tactique qui, scénaristiquement, ne tient absolument pas la route, c’est certain, mais qui autorise effectivement quelques scènes de combat réussies, palpitantes et bien menées (quand bien même, dans leur structure, elles sont tristement classiques : le gros boss pour le final, d’abord les sidekicks arrogants qui se font défoncer en n’en revenant pas, les héros qui serrent les dents devant le pouvoir largement supérieur du boss, etc.) ; et on a bien sûr le commentateur télé, hein…Mais si le tournoi à proprement parler doit adopter cette forme, je suppose qu’il n’est pas exclu que je trouve à m’en accommoder, même si le principe du tournoi me paraîtra toujours aussi débile.
Quoi qu’il en soit, j’ai été très agréablement surpris par ces deux tomes – que j’ai trouvés d’un niveau très solide, davantage à vrai dire que certains tomes de Gunnm. Ceci en dépit d’une entrée en matière relativement laborieuse, et des nuages noirs qui se dessinent à l’horizon (spatial – des nuages noirs dans l’espace, euh…). Car il y en a au moins deux : le tournoi est une chose, mais Kishiro Yukito a quelque chose de bien pire sous le coude, potentiellement – en effet, vers la fin du tome 3, l’auteur commence à insérer dans son histoire… des vampires. Et là je crois que les retours sont unanimes, pour ce que j’en ai lu, aussi bien chez ceux qui se sont d’emblée montrés hostiles à l’entreprise de Gunnm Last Order que chez ceux qui se sont montrés plus charitables, voire initialement enthousiastes : quand les vampires débarquent, tout cela sombre dans le grand nawak le plus affligeant… Ce qui n’inspire pas exactement confiance pour la suite des opérations, hein ?
Cela dit, la bonne surprise relative de ces tomes 2 et 3 m’incitera à poursuivre avec au moins le tome 4. Et on verra bien…
Oh, une dernière chose : ces deux volumes, comme le premier, se concluent chacun sur une histoire courte de Kishiro Yukito totalement indépendante de Gunnm, et antérieure à vue de nez – et c’est une excellente idée, même si le résultat convainc plus ou moins. Le tome 2 s’achève ainsi sur Dai Machine, une sorte de shônen de science-fantasy un peu trop hystérique formellement pour me convaincre tout à fait (notamment dans la récurrence plutôt lourdingue des déformations faciales ultra-expressives), outre que le propos globalement technophobe n’est pas exactement des plus fins – cela dit, à titre disons « documentaire », c’est une lecture assez intéressante, qui annonce certaines dimensions de Gunnm, même si de manière moins subtile (et enthousiasmante) que Hito (le peuple volant), qui concluait le tome 1. À la fin du tome 3, nous avons Astre abyssal, qui joue dans un tout autre registre, en mêlant SF transhumaniste (déjà) et horreur voire body horror un peu à la Itô Junji – le propos demeure, disons techno-sceptique, mais de manière un peu plus futée car juste un peu plus ambiguë ; j’ai bien aimé, pour le coup.

/image%2F1385856%2F20160114%2Fob_cfb8b0_caligari.jpg)


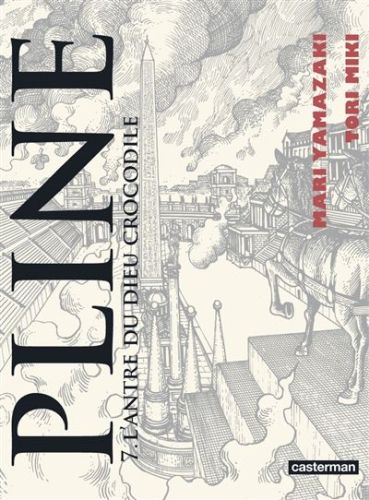
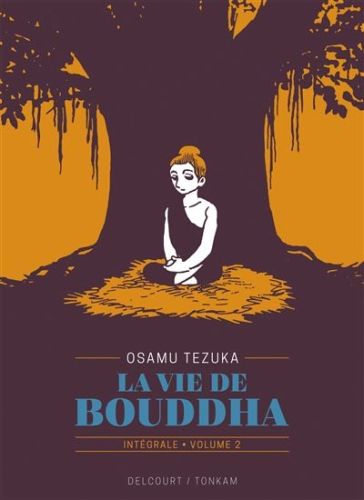
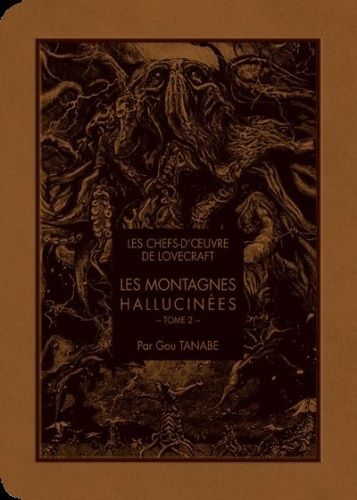
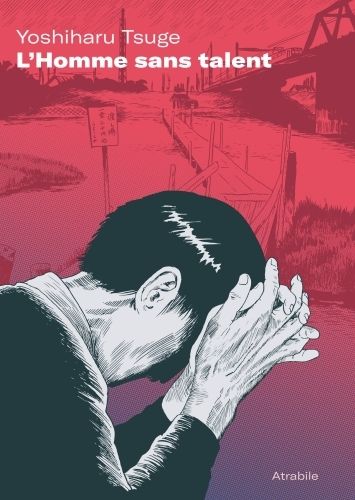

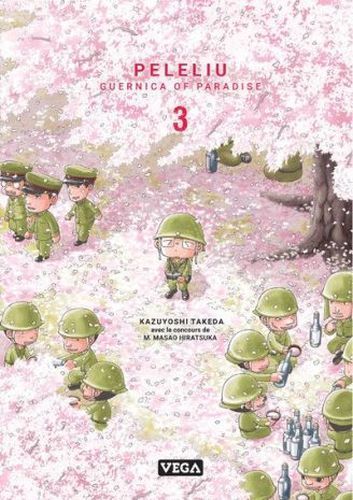



/image%2F1385856%2F20150204%2Fob_660a87_georges-abdaloff-croque-par-christell.jpg)