Le Bouddhisme, d'Henri Arvon
ARVON (Henri), Le Bouddhisme, Paris, PUF, coll. Que sais-je ? – Quadrige/Grands Textes, [1951] 2007, 146 p.
Attention, contient en introduction de longues bêtises très personnelles...
Je m’étais procuré il y a quelque temps de cela ce petit ouvrage – un classique dans son genre, initialement paru dans la collection « Que sais-je ? » en 1951, depuis réédité plus de vingt fois dans la fameuse collection encyclopédique des Presses Universitaires de France, avant d’être repris en 2007 en « Quadrige », comme « Grand Texte ». Je me disais que, si je voulais espérer « comprendre » quoi que ce soit au Japon et à sa culture, il me fallait avoir quelques bases à ce sujet, ou me rafraîchir la mémoire – tout compte fait, parce qu’un prétexte un peu saugrenu est toujours utile, si je l’ai lu aujourd’hui, c’est en guise d’introduction à La Vie de Bouddha, de Tezuka Osamu...
Mais cet article ne sera probablement pas tant une chronique à proprement parler que l’occasion d’émettre quelques réflexions très personnelles, probablement un peu creuses aussi, voire risibles, mais bon. C’est que, le bouddhisme et moi… C’est une histoire… compliquée, disons.
Si je n’ai jamais vraiment éprouvé de sentiment religieux à proprement parler, je ne suis certes pas étranger aux crises métaphysiques, aux grandes questions existentielles, celles qui nouent le ventre et plongent dans le malaise, par exemple au spectacle des étoiles, quand on se pose LA question, qui ne trouve jamais de réponse : qu’est-ce que je fais là, bon sang ? Et comment puis-je être là ? La conscience, le temps, l’espace, l’histoire, les autres…
Argh.
Mais, donc, le bouddhisme, quand j’étais ado, suscitait ma curiosité. Si je n’ai jamais adhéré à cette foi, et ne le ferai pas davantage aujourd’hui, ça n’en était pas moins une conception du monde qui me parlait davantage, intellectuellement, que les religions du Livre, qui ont toujours suscité, au mieux mon incompréhension perplexe, au pire mon hostilité agacée : la révélation sans expérience mystique, le rapport au créateur qui doit être adoré parce que créateur, la nécessité du culte, l’idée d’un dieu « bon » quand le monde et la vie ne sont porteurs que de souffrance, l’exhortation à la soumission absolue (peu d’histoires me révoltent autant que celles du sacrifice d’Isaac ou de Job), la bigoterie dogmatique et haineuse de gens qui prétendent adhérer à une religion d’amour quand ils ne sont que des brutes trop ravies de trouver une justification à leur détestation de l’autre, les innombrables atrocités commises au nom d'un Père jaloux et tyrannique, le fondamentalisme qui récuse le discours scientifique… Entre autres choses. Beaucoup trop d'autres. J’ai voulu lire les deux Testaments et le Coran, pour le même motif de volonté de comprendre un minimum le monde occidental, pour le coup, mais, hors Nouveau Testament, et dans la douleur, je ne suis jamais parvenu bien loin, même en m'y reprenant à plusieurs fois. Et puis… Il y avait comme un sentiment esthétique, en fait : j’ai toujours trouvé ces religions laides, je crois que c’est le mot – dans leur brutalité dogmatique qui imprègne tant leur imaginaire par ailleurs si pauvre…
En même temps, même agnostique et athée, j’ai toujours admis que ces religions, par quelque miracle (aha), avaient pu produire de belles choses, très belles mêmes – et la Bible n’en est d’ailleurs pas exempte, qui comprend l’étonnant Cantique des Cantiques ; au-delà, les cathédrales me font vibrer, les petites chapelles aussi, et tant d’œuvres d’art et de livres en des siècles d’histoire… Et, dans ces œuvres, l’expression du sentiment religieux peut me transporter et me toucher, oui – du Durtal En route de Huysmans (je n’y croyais pas moi-même !) au qawwalî de Nusrat Fateh Ali Khan, dont, confession peut-être un peu couillonne, mais moins ironique qu’il n’y paraît, j’ai écouté les « louanges à Dieu » en boucle après chaque attentat islamiste majeur, pour me rappeler que l’Islam, comme les autres religions, pouvait certes être odieux, mais aussi être beau, sublime même – il y a hélas eu un certain nombre d’occasions de le faire ces dernières années… Le questionnement mystique, surtout, me parle en dépit du bon sens – comme de juste, c’est bien le propos ; et la lecture de Kafka, par exemple, m’a à son tour noué le ventre, comme le spectacle des étoiles quand se pose LA mauvaise question.
Ado naïf, le bouddhisme me paraissait exempt des tares évoquées, en tout cas – ou moins affecté par elles, du moins. Seulement… Que savais-je du bouddhisme ? En réalité, rien – je n’ose même pas écrire « pas grand-chose », ce serait déjà beaucoup trop. Le bouddhisme me séduisait parce qu’il était autre, « exotique », distant des religions du Livre qui me paraissaient si oppressantes et laides, et beaucoup trop proches. Et parce que je n’en avais qu’une image « vague ». Mais c’en était donc une conception largement infondée : le bouddhisme que je croyais trouver séduisant, c’était un bouddhisme d’Occidental, mythifié, rationalisé en même temps, au mépris le cas échéant de la complexe histoire de cette foi particulièrement multiforme ; c’était surtout ce bouddhisme athée dont on disait toujours, de manière pavlovienne, qu’il était « plus une philosophie qu’une religion ». En même temps, je ne m’y abandonnais pas, je ne pouvais tout simplement pas le faire – d’autant que je percevais plus ou moins combien ce bouddhisme à l’occidentale pouvait aisément virer, disons, au « développement personnel », par exemple sur la base d’un zen de pacotille, et le développement personnel me hérisse et m’agace au plus haut point, sans que je sois bien en mesure de dire pourquoi ; la pseudo-sagesse des aphorismes « profonds » calibrés pour les réseaux sociaux dans une égale mesure. Et si le bonhomme m’était plutôt sympathique par certains aspects, je ne me sentais certes pas de sombrer dans l’adoration du Dalaï-lama, et, pire encore, de ses apôtres français – pour le coup, l’aspect proprement religieux du bouddhisme devenait ici plus flagrant, et, si je n’étais pas certain que le Dalaï-lama était « un Jean-Paul II comme les autres », pour reprendre des mots lus sauf erreur dans Charlie Hebdo il y a bien longtemps de cela, je sentais bien qu’il y avait quelque chose qui coinçait, à titre personnel, et, derrière le bonhomme, une théocratie en exil en même temps que des superstitions déconcertantes.
En fait, ce trouble le concernant a joué, parce que je sentais bien qu’il ne pouvait pas être « le pape des bouddhistes », comme on le disait trop hâtivement, et que c’était forcément beaucoup plus compliqué que cela. De fait, ça l’était, ainsi que mes premières lectures sur le sujet l’ont bientôt démontré de la plus violente manière – j’ai le vague souvenir d’un petit bouquin au format plus ou moins « Que sais-je ? », mais dans une autre collection axée elle aussi sur la vulgarisation scientifique, et qui mettait l’accent sur le bouddhisme en tant que religion universelle de salut, au travers d'une analyse précise mais qu'à l'époque je ne pouvais trouver qu'intimidante ; je n’y ai pas compris grand-chose, du coup, même si la distinction entre le Petit et le Grand Véhicules, surtout, était déjà un pas de géant au regard de ma méconnaissance absolue du sujet. Quoi qu’il en soit, ce petit livre a produit un effet immédiat : si j’en ai retenu quelque chose, sur le moment, c’était surtout que le bouddhisme était bel et bien une religion, et que, de toute évidence, je n’étais pas bouddhiste, ne le pouvais pas et ne le pourrais jamais.
Bien plus tard, quand j’ai commencé à m’intéresser à la culture japonaise, ce rapport au bouddhisme a encore eu l’occasion d’évoluer, au regard des spécificités, nombreuses, du bouddhisme nippon. Mais, dans un premier temps, c’était clairement l’incompréhension qui dominait : je n’avais absolument rien panné aux extraits du Shôbôgenzô du moine zen Dôgen lus dans l’anthologie Mille ans de littérature japonaise, et en avais bien trop hâtivement conclu qu’il n’y avait de toute façon rien à y panner ; quant à l’amidisme, il me faisait l’effet d’un bouddhisme contaminé par le paradis livresque, et l’idée même que le salut pouvait être assuré par la simple répétition d’une formule magique vide de sens me répugnait – comme une superstition poussée à l’extrême ; Nichiren, enfin, ajoutait à cette dernière tare un exclusivisme haineux qui rapprochait encore un peu plus la spiritualité bouddhique de tout ce que je détestais dans les religions du Livre…
Mais des lectures et relectures plus tardives ont fait plus que nuancer ce tableau initial, elles l’ont en fait totalement invalidé : relisant Mille Ans de littérature japonaise, je n’ai certes à peu près rien panné à Dôgen une fois de plus, mais j’ai cette fois au moins compris qu’il y avait bel et bien quelque chose à y panner – quelque chose d’extrêmement subtil et avancé, témoignant bien de ce que le rapport du zen à la raison était autrement plus complexe que ce que mille anecdotes, ou mille fois la même, sur la base des mêmes kôans, tendaient à laisser croire. Quant à l’amidisme, j’ai découvert par la suite combien, dans sa simplicité apparente, il reposait sur une réflexion philosophique complexe et éventuellement subversive – ici, je renvoie notamment à l’Histoire du Japon médiéval, de Pierre-François Souyri, et à ses pages passionnantes sur l’effervescence de la pensée religieuse japonaise à cette époque (qui m’a renvoyé à ce que l’Europe avait connu aux environs des XIIIe et XIVe siècles, soit plus ou moins à la même époque, un sujet qui m’avait étonné et passionné dans une autre vie). Bon, Nichiren, par contre, toujours pas… Mais Les Notes de l'ermitage de Kamo no Chômei continuaient cependant à me fasciner, en contrepartie, magnifique exemple adapté au bouddhisme nippon d'une religion suscitant de belles choses...
Bref, il était bien temps de me repencher sur la question – pour me rafraîchir un peu la mémoire, et repenser certains sujets, sur la base d’un bagage un peu différent et d’une expérience forcément différente elle aussi. Ce petit livre « classique » d’Henri Arvon était-il le plus approprié pour cela ? Ça n’est pas certain… Car, aussi « classique » soit-il, cet ouvrage de vulgarisation a un biais, que l’auteur ne dissimule en rien : il s’agit d’envisager le bouddhisme comme sujet historique, et avec une certaine distance ; or le bouddhisme qui séduit le plus l’auteur, ainsi qu’il le dit d’emblée, c’est surtout la doctrine originelle : il avoue « un intérêt passionné […] au spectacle étrange d’une religion athée et d’un athéisme qui veulent étreindre l’Absolu ». De fait, le bouddhisme tel qu’il est envisagé par Henri Arvon a pour cette raison quelque chose de ce bouddhisme « d’Européen » que je mentionnais plus haut (celui qui envisage cette foi au prisme avant tout de la philosophie, certes pas celui qui a viré au développement personnel pseudo-zen !). Et le reste de la bibliographie de l’auteur va dans ce sens, lui qui a surtout été connu, en dehors de cet ouvrage, pour avoir beaucoup publié sur son sujet de prédilection qu’était l’anarchisme, mais auquel on doit également ajouter d’autres livres portant sur l’athéisme, sur Feuerbach, etc.
Et puis, disons-le, cet ouvrage, dont la première édition date donc de 1951, accuse un peu le poids des ans, parfois : outre que, soixante-dix ans plus tard, le monde a bien changé, on y trouve à l’occasion des stéréotypes qui ont eu la vie dure (le Chinois essentiellement conservateur et xénophobe, le Japonais qui copie sur son voisin, etc.), mais aussi des jugements de valeur pas moins troublants (dans les enthousiasmes, ainsi le bouddhisme à son apogée en Inde, comme dans les rejets, il n’est qu’à voir le mépris affiché et revendiqué avec lequel l’auteur traite le tantrisme en général et le bouddhisme tibétain en particulier).
(Oh, au passage, il faut noter que l’auteur consacre pas mal de pages à un thème particulier, qui est celui de la misogynie dans le bouddhisme, et ce dès l’enseignement de Bouddha lui-même, pour ce que l’on en sait ; si ces passages n’ont formellement rien de militant à proprement parler, leur récurrence, même relativement détachée, me laisse supposer que cela n’avait rien d’innocent de la part d’Henri Arvon.)
Une lecture à prendre avec des pincettes, donc – loin d’être inintéressante, cela dit, dès l’instant que l’on a ces biais éventuels en tête ; et l’ouvrage satisfait autrement aux critères de la collection « Que sais-je ? », en offrant un panorama assez complet de la question, vulgarisé mais pas simpliste, et à vrai dire même assez dense à l’occasion, tout particulièrement d’ailleurs dans la première partie, passionnante heureusement, qui traite du terreau dans lequel le bouddhisme originel a germé : le védisme, le brahmanisme, et les notions d’âtman-brahman, de samsâra et de karma ; au passage, tout cela s’est montré immédiatement utile dans la lecture des premiers chapitres de La Vie de Bouddha de Tezuka, ce qui tombait plutôt pas mal, puisque c’était bien le but.
Après quoi les passages consacrés à la… eh bien, à la vie de Bouddha, donc (en posant la question de l’existence réelle du Bouddha historique, mais pour y apporter une réponse sans l’ombre d’un doute positive – ce qui m’a rappelé un certain « débat » concernant le Jésus historique, mais c’est une autre… histoire), sont un peu déconcertants en même temps que pertinents, qui tentent de faire le tri entre faits et légendes ; car la vie de Siddharta Gautama a été rapidement mythifiée, en même temps que le sage arborait toujours un peu plus les traits un peu paradoxaux d’une divinité – pour le coup, ici, et contrairement à ce que l’on pourrait tout d’abord croire, le Petit Véhicule n’a pas forcément attendu le Grand ; il me faudra revenir sur cette question quand je chroniquerai la BD de Tezuka (en même temps que la question corollaire, plus insidieuse peut-être : aurais-je seulement pu lire une « Vie de Jésus » au même format ?).
Cela dit, l’exposé de la vie du Bouddha s’efface bientôt devant celui de son enseignement. Et c’est là, dans cette approche, impliquant quelques reconstitutions, de ce que pouvait être le bouddhisme originel, que se manifeste effectivement « l’intérêt passionné » de l’auteur, évoqué plus haut – le « sermon de Bénarès » offrant un socle à l’exposé des « quatre saintes vérités » : « l’universalité de la douleur, l’origine de la douleur, la suppression de la douleur et le chemin qui conduit à la suppression de la douleur ». Or ces « vérités » se passent très bien de causes premières, ou en tout cas de la nécessité d’un créateur et de l’existence de Dieu ou des dieux ; l’enseignement du Bouddha historique ne les nie pas forcément, c’est plutôt qu’il choisit de ne pas accorder d’importance à ces matières indécidables – et cette souplesse favorisera sa diffusion en Asie, dans un registre syncrétique, en même temps qu’elle pourra expliquer pourquoi « l’identification » des masses à la foi bouddhique ne sera jamais totale. Mais, pour le coup, cet agnosticisme (et éventuellement seulement athéisme), de même que le pessimisme sous-jacent (à relativiser cependant, car le salut est offert à qui prend conscience de la nature du monde, c’est-à-dire de la souffrance universelle, et agit, si c’est bien le mot, en conséquence), correspondent bien aux éléments qui me parlaient « dans l’absolu » dans les représentations que je me faisais du bouddhisme, et c’est semble-t-il donc également le cas pour l’auteur – à noter, dès ces exposés sur la doctrine originelle du bouddhisme, Henri Arvon ne manque pas d’établir des passerelles avec Schopenhauer, notamment, et indirectement Nietzsche (sans même parler de Socrate, bien sûr, mais pour de tout autres raisons – à vrai dire, des développements assez nombreux sont consacrés aux rapports avec le monde grec, via les conquêtes d’Alexandre le Grand, mais aussi un ouvrage classique du Grand Véhicule qui voit un moine bouddhiste exposer avec conviction et pertinence sa doctrine au roi grec Ménandre). Il faut enfin relever ce que le bouddhisme pouvait avoir de subversif, aussi, du temps des brahmanes, en exposant une conception du monde qui, sans forcément rejeter en bloc le système des castes (là encore, il s’agissait plutôt, ai-je l’impression, de considérer la question comme secondaire voire futile), minait pourtant de toutes parts ses soubassements idéologiques (et ça, pour le coup, c’est semble-t-il un thème central dans la BD de Tezuka, en tout cas dans les chapitres que j’en ai lu pour l’heure).
Mais une autre question cruciale se pose – qui entre en résonance, de manière peut-être un peu paradoxale, avec la lecture que je mentionnais plus haut et qui mettait l’accent sur l’idée du bouddhisme comme religion universelle de salut : Henri Arvon, pour sa part, outre qu’il met en avant la dimension subjective et d’une certaine manière intime du bouddhisme originel, insiste plus qu’à son tour sur le caractère essentiellement monacal de l’enseignement de Siddharta Gautama – le « sermon de Bénarès » n’est pas le sermon sur la montagne prononcé par Jésus devant une large foule, il ne s’adresse en vérité qu’à cinq moines qui se font bientôt les disciples de l’orateur, et c’est là peu ou prou la totalité de l’auditoire ; des représentations ultérieures pourront chambouler cette image, en convoquant des foules d’hommes mais aussi d’animaux (ainsi donc dans la BD de Tezuka) venus entendre la bonne parole d’un Bouddha d’ores et déjà divinisé, après avoir assisté à sa naissance mythique, mais l’auteur insiste sur cette dimension originelle, et qui laissera des traces dans l’histoire du bouddhisme – ainsi notamment au Tibet, où, nous disait l’auteur en 1951, peut-être une personne sur cinq était dans les ordres… mais la Chine maoïste venait à peine d’envahir ce qui était alors considéré comme une théocratie. Sans aller jusqu’à cet extrême bien épineux, l’idée d’un bouddhisme ésotérique (au sens de « destiné avant tout à des initiés », qui sont les moines) persistera face à des conceptions davantage universelles (l’histoire religieuse du Japon en témoigne d’ailleurs régulièrement), et les moines font bel et bien partie des « joyaux » du bouddhisme, avec le Bouddha lui-même et son enseignement.
À vrai dire, l’auteur montre bien comment tout cela porte en germes aussi bien les succès remportés par la foi nouvelle que les revers parfois cinglants qu’elle a subis, au cours de la longue histoire de sa diffusion. Car, et sans surprise, très tôt après la mort du Bouddha historique, et éventuellement contre ses ultimes recommandations à ses disciples, la foi évolue, et drastiquement le cas échéant. Cette évolution est envisagée en deux temps : d’abord de manière, disons, théorique (les Véhicules), ensuite de façon plus concrète au regard de l’histoire aussi bien que de la géographie.
Les appellations des Véhicules sont par essence biaisées : c’est le Grand Véhicule qui s’est qualifié comme tel, et qui a employé l’expression de « Petit Véhicule » pour désigner ses adversaires, avec un certain mépris. Par ailleurs, il faut une fois de plus souligner combien le bouddhisme est une religion plurielle – probablement bien plus que les religions du Livre, qui ont pourtant connu leurs lots de schismes : les Véhicules constituent des ensembles englobants, mais qui ne doivent pas faire perdre de vue combien les « sectes » (au sens d’écoles) du bouddhisme sont diverses, au point où il vaudrait bien mieux parler des bouddhismes.
Quoi qu’il en soit, le Petit Véhicule demeure pour ce que l'on en sait le plus proche de l’enseignement originel du Bouddha – sans lui correspondre parfaitement, car il a fallu très tôt adapter la foi nouvelle, la faire évoluer ; de fait, l’enseignement du Bouddha comporte des lacunes, et de complexes questions théologiques ou en tout cas métaphysiques se posent, au regard desquelles il peut paraître insuffisant, voire un peu embarrassé – les disciples, puis ceux de ces derniers, etc., entendent y remédier, et la littérature bouddhique se développe, avec en outre la rédaction de canons en plusieurs langues. Et ce que l’on appellera ultérieurement le Petit Véhicule développe des traits propres à une foi, pas seulement à une philosophie : la vie du Bouddha est donc très tôt mythifiée, et le développement du culte des reliques en fournit l'illustration la plus éloquente peut-être, à moins que ce ne soit seulement la plus navrante... Tout ceci sera repris par les courants ultérieurs, bien sûr. Maintenant, l’essence de la réflexion religieuse dans le Petit Véhicule demeure la même que dans le bouddhisme primitif : la souffrance universelle, etc., mais aussi le caractère monacal, le cas échéant, qui ne pénètre pas forcément les foules, du coup. L’idée maîtresse est toujours celle d’un salut sous forme de libération de la souffrance, accessible par le détachement – un salut que le dévot pourra atteindre de son vivant (un point particulièrement épineux des querelles doctrinales), mais qui est en tant que tel intime, voire subjectif : le croyant se sauve lui-même, mais il ne peut rien faire pour les autres (tout au plus leur transmettre la parole de Bouddha, à charge pour eux et eux seuls de trouver eux-mêmes le salut). L’auteur revient régulièrement sur l’idée de non-intervention, au prisme notamment de la non-violence, et il évoque nommément l’ahimsa, un concept de la philosophie indienne antérieur au bouddhisme, et que Gandhi, assassiné trois ans avant la première parution de cet ouvrage, avait contribué à populariser de par le monde.
C’est là une manière positive d’envisager la question… mais on peut aussi la percevoir de façon bien plus critique, et c’est la une raison essentielle au schisme qui oppose bientôt le Grand Véhicule au Petit. Les nouveaux penseurs reprochent à leurs aînés ce qu’ils perçoivent comme une forme d’égoïsme, et ils ne goûtent guère la passivité qui semble les caractériser. Ils ne peuvent certes adresser ces reproches au Bouddha historique lui-même, qui, de modèle à imiter, avait déjà et très vite tourné à la figure divinisée à adorer, de même que les bouddhas à sa suite, mais ils se focalisent dès lors sur d’autres figures : celles des bodhisattvas – soit ceux qui auraient pu atteindre l’éveil, mais ont choisi de le différer afin d'aider les autres à accéder à l’éveil. C’est une idée généreuse et touchante, si elle s’éloigne de la doctrine originelle du bouddhisme, au point éventuellement de la contradiction. Mais s’il faut revenir aux sentiments esthétiques que la religion peut susciter, j’avoue trouver cette idée… belle, depuis que j’en ai pris conscience il y a quelques années de cela ; et Henri Arvon, même porté à préférer, intellectuellement, un bouddhisme « athée » primordial, exprime ici le même sentiment, en des termes parfois lyriques à vrai dire. Cependant, mais c’est sans doute lié, cette évolution en a accompagné ou suscité d’autres, pour produire une religion au plein sens du terme, souple cela dit, mais où la notion de divinité n’était plus « écartée » désormais ; en fait, il s'agissait surtout de s'adapter aux traditions religieuses locales, où tout devait être envisagé comme compatible avec le bouddhisme, afin de le justifier, quitte à opérer un tour de passe-passe en assimilant telle ou telle divinité avec tel ou tel bouddha ou bodhisattva. À ces deux titres, le Grand Véhicule a évolué vers la religion universelle de salut évoquée plus haut, même si ce n’était peut-être pas systématique non plus, du fait de la perpétuation, même sous des oripeaux plus chatoyants, d’un bouddhisme ésotérique et d’une tradition monacale.
Quant au Véhicule de Diamant, ou tantrique, qui a toujours été le plus mystérieux et hermétique à mes yeux… Eh bien, il le demeure après cette lecture. C’est que Henri Arvon ne s’étend finalement guère sur la question, considérant d’une part qu’en fait de troisième Véhicule il s’agissait plutôt d’une version… disons « dégénérée » du Grand Véhicule, et d’autre part, ce que traduit cette idée de dégénérescence, qu’il s’agissait d’un mouvement fondé essentiellement sur des superstitions d’ordre magico-religieux, à vrai dire à cet égard tenant peut-être plutôt d’une autre religion que du bouddhisme à proprement parler, et a fortiori s’il s’agit de le comparer au bouddhisme primitif, ou, à défaut d’une connaissance suffisamment établie de celui-ci, au bouddhisme du Petit Véhicule. Comme dit plus haut, l’auteur ne juge pas nécessaire, quand il en traite, de faire l’économie de jugements de valeur assez cinglants : tout lui répugne dans cette foi aux antipodes des élégantes et subtiles métaphysiques des grands penseurs bouddhistes. La question demande cependant à être creusée – notamment au regard du bouddhisme tibétain, qu’avant cela je ne rattachais pas nécessairement au Véhicule de Diamant (ce qui témoigne bien de mon ignorance en la matière).
Les chapitres consacrés à la diffusion géographique du bouddhisme, et à son évolution historique dans des environnements très divers, sont tout à fait passionnants – même si, là encore, ils ne sont pas exempts d’opinions un peu tranchées. Toutefois, ils sont surtout empreints d’une analyse plus globale qui m’a l’air tout à fait pertinente, sur les raisons donc des succès aussi bien que des échecs du bouddhisme en Asie méridionale et orientale. À vrai dire, ce thème est d’autant plus marqué que l’auteur met en avant combien des pays où le bouddhisme, fût un temps, était particulièrement florissant, ont vu au fil des siècles cette foi dépérir et même disparaître – avec deux exemples primordiaux, qui sont d’abord et avant tout l’Inde, son terreau pourtant, ensuite l’Indonésie (je crois qu’il nous faudrait peut-être aussi nous poser la question, même en des termes un peu différents, de la Chine, mais Henri Arvon ne la traite pas sous cet angle ; j'y reviendrai). Dans le cas de l’Inde, l’auteur retrouve des accents lyriques quand il décrit la grande époque du bouddhisme dans son pays natal élargi aux dimensions d’un sous-continent, et la figure charismatique d’Açoka le Pieux répond aux docteurs de la foi les plus inspirés ; mais il relève en même temps comment le syncrétisme auquel le bouddhisme était porté a pu lui nuire dans ce contexte, autorisant une réaction hindouiste le cas échéant, tandis que l’Islam intégrerait plus tardivement l’équation, beaucoup moins conciliant (et il joue indubitablement un rôle moteur dans la disparition du bouddhisme en Indonésie, aujourd'hui le premier pays musulman au monde) ; mais il faut aussi compter avec d’autres abâtardissements peut-être plus insidieux, et Henri Arvon semble donc juger que le plus notable et en même temps le plus regrettable concerne le tantrisme – il en dérive cependant quelques paragraphes intéressants portant sur le bouddhisme tibétain mais aussi mongol, et j’aurais apprécié, pour le coup, d’en lire davantage, avec peut-être un peu moins de passion.
Mais le gros des développements, ici, porte sur les aires géographiques et culturelles du Petit et du Grand Véhicules. L’auteur oppose un bouddhisme méridional, du Petit Véhicule, qui domine essentiellement dans l’Asie du Sud-Est, avec la Thaïlande et plus encore la Birmanie (ou Myanmar) comme centres principaux (pour ce qui est de ce dernier, la crise des Rohingyas nous rappelle aujourd’hui que certains stéréotypes concernant les bouddhistes non-violents sont particulièrement infondés…), et un bouddhisme septentrional, du Grand Véhicule, incluant notamment la Chine, la Corée et le Japon (je ne reviendrai pas sur ce dernier, ayant eu l'occasion d'en discuter ailleurs). Mais le cas chinois est probablement le plus important, où l’auteur poursuit son analyse sur les avantages et les inconvénients de la souplesse éventuellement syncrétique du bouddhisme au regard d’autres traditions religieuses – en l’espèce, le confucianisme et le taoïsme ; cependant, si le second s’en est très bien accommodé, les deux fois pouvant être jugées complémentaires (mais l’auteur insiste avant tout sur la dimension superstitieuse et magico-religieuse du taoïsme dans des termes qui peuvent rappeler son peu d’estime pour le bouddhisme tantrique), le premier s’y est montré plus qu’à son tour hostile.
Or il faut prendre en compte ici les vicissitudes politiques de l’histoire de la Chine : selon l’auteur, le bouddhisme y a essentiellement prospéré durant les périodes où le pouvoir politique appartenait essentiellement à des « étrangers », en y incluant par exemple les Wei et les Yuan (ces derniers mongols), car ils étaient somme toute d'un statut équivalent eux-mêmes, tandis qu’il était amoindri voire combattu ouvertement dans les périodes où le pouvoir redevenait essentiellement chinois, quand le mouvement réactionnaire, désireux de rejeter tout ce qui n’était « pas chinois », y incluait sans l’ombre d’un doute le bouddhisme, contre lequel il jouait la carte du confucianisme – le cas le plus flagrant étant celui de la dynastie Ming, qui a eu un impact considérable en l’espèce. Cependant, je me demande si cette analyse n’a pas ses limites, puisque aux Ming ont succédé les Qing, mandchous, sans que le bouddhisme n’y effectue véritablement son retour (mais peut-être parce que la réaction Ming s’était avérée trop décisive pour qu’on y revienne).
Surtout, se pose la question de la Chine contemporaine, avancée plus haut : dans ses lapidaires données statistiques en annexes, Henri Arvon répond par un point d’interrogation à la question du nombre de bouddhistes en Chine (il fait de même pour la Corée et le Vietnam, ou plutôt les), mais il semble considérer sans l’ombre d’un doute que ces pays demeurent bouddhistes, voire essentiellement bouddhistes. Maintenant, ce livre date originellement de 1951 – soit deux ans à peine après la proclamation de la République Populaire de Chine, un an après l’invasion du Tibet et le déclenchement de la guerre de Corée, cette dernière ne devant s’achever que deux ans plus tard, tandis que la guerre au Vietnam se poursuivrait encore 24 années (on parlait encore d’Indochine française à l’époque, et la bataille de Diên Biên Phu n’aurait lieu que trois ans après !). Et je tends à croire, du coup, que la question se pose aujourd’hui en d’autres termes, tout spécialement dans le cas chinois – enfin, je n’en sais rien, mais ici ce « Que sais-je ? » ne nous est clairement d’aucune utilité, disons…
Avec ces quelques bémols, et les quelques précautions à prendre évoquées plus haut, ce petit ouvrage de vulgarisation demeure intéressant et instructif. Il m’a rafraîchi la mémoire sur certains points, un peu éclairé sur d’autres. Ce qui me laisse de la marge, c'est peu dire, mais c’était sans doute une lecture utile – a fortiori donc avant d’entamer la lecture de La Vie de Bouddha de Tezuka, on verra bien ce qu’il sera alors possible d’en dire…

/image%2F1385856%2F20160114%2Fob_cfb8b0_caligari.jpg)
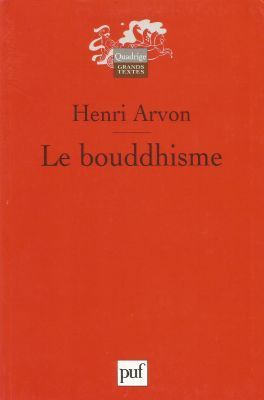


/image%2F1385856%2F20201027%2Fob_e27ed3_la-guerre-du-pavot.jpg)
/image%2F1385856%2F20200713%2Fob_a414dc_ecran-noir-04.jpg)
/image%2F1385856%2F20200618%2Fob_3ca18a_la-mort-du-fer.jpg)
/image%2F1385856%2F20200612%2Fob_f373f3_les-miracles-du-bazar-namiya.jpg)
/image%2F1385856%2F20150204%2Fob_660a87_georges-abdaloff-croque-par-christell.jpg)
Commenter cet article