A Clash of Kings, de George R.R. Martin
MARTIN (George R.R.), A Clash of Kings, New York, Bantam Books, coll. Fantasy, [1999-2000] 2011, 1009 p.
A Clash of Kings, deuxième tome de la monumentale saga de George R.R. Martin « A Song of Ice and Fire » (« Le Trône de fer » chez nous), parvient à être encore plus dodu que son déjà volumineux prédécesseur A Game of Thrones. Je dois avouer, moi qui suis dans l’ensemble amateur de formats moins intimidants, qu’il ne m’est pas forcément évident de m’embarquer dans de telles expéditions littéraires au long cours ; disons que cela réclame un minimum de motivation. Mais le fait est que j’ai lu A Game of Thrones avec beaucoup de plaisir, et que la drogue a fait son effet, au-delà de mes bêtes préventions de lecteur souvent rétif au roman-fleuve. À vrai dire, je n’ai finalement guère attendu après ma lecture du premier tome pour m’enfiler le deuxième, désireux que j’étais de retrouver les Sept Royaumes de Westeros et leurs intrigues politiques capillotractées…
Au-delà de toute menace de spoiler (cette terrible malédiction qui n’a jamais été autant pratiquée d’un côté et blâmée de l’autre que pour cette série au succès phénoménal et par nature riche en rebondissements), on peut bien dire que le titre se montre éloquent. Car il s’agit bien ici de confrontations entre différents rois, revendiquant plus ou moins la même couronne et le trône inconfortable qui se trouve en dessous. Ceci dit, pour présenter un peu plus en détail ce deuxième volume, il m’est indispensable de renvoyer à quelques événements majeurs du premier : vous êtes prévenus…
La mort du roi (usurpateur qui plus est) Robert Baratheon a en effet plongé les Sept Royaumes qui n’en font qu’un dans le chaos le plus total. « Son fils » Joffrey Baratheon lui a succédé, avec le soutien considérable des Lannister via sa mère, la reine et régente Cersei… mais les soupçons (fondés) de bâtardise portant sur l’infect roitelet aussi gâté que sadique ont ouvert la voie à d’autres prétendants. Le plus logique étant sans doute Stannis Baratheon, le frère cadet de Robert, son successeur par défaut en l’absence d’enfants légitimes, et qui argue de ce fait pour se proclamer roi ; mais le dernier de la fratrie, Renly Baratheon, fait bizarrement de même, en ne s’embarrassant guère de prétentions de légitimité… et il est bien plus populaire que son aîné. Un usurpateur, donc, il ne se prive pas de le rappeler ; et, au-delà de la mer, il faut mentionner Daenerys Targaryen, la dernière descendante de la dynastie qui avait en son temps institué le royaume, et n’en avait été chassée que par la révolte de Robert Baratheon (soutenu notamment par Eddard Stark) ; autrement plus fine et charismatique que son défunt frère l’abject Viserys, la jeune femme aux dragons cherche, au bout du monde, des appuis pour retourner à Westeros…
Et des rois, il y en a encore d’autres, aux prétentions éventuellement un brin différentes. Il y a bien sûr, tout au nord des Sept Royaumes, le mystérieux « roi derrière le Mur », Mance Rayder, qui suscite l’inquiétude de la Garde de Nuit (avec notamment en son sein Jon Snow, bâtard d’Eddard Stark). Juste en dessous, Robb Stark, fils aîné du défunt Eddard, reprend le titre de « roi dans le Nord » ; il ne siège cependant pas à Winterfell (où se trouvent ses frères Brandon, l’infirme, et le tout bébé Rickon), mais mène l’assaut contre les Lannister (avec l’aide des Tully, sa famille maternelle). Enfin (et là je révèle un tout petit peu des événements de ce deuxième tome, attention), Balon Greyjoy, autrefois rebelle, profite du chaos ambiant pour reprendre un titre royal, à la plus grande satisfaction de son répugnant fils Theon, jusqu’alors « otage » des Stark…
Ça en fait, du monde… Je résume à gros traits, mais cela suffit sans doute à donner une idée du gros bordel politico-militaire (car cette dernière dimension fait ici vraiment son apparition) qui afflige Westeros. Les Sept Royaumes ravagés par la guerre deviennent le théâtre d’atrocités sans nombre, que les prétentions des divers rois auto-proclamés ne sauraient excuser en aucune manière. La guerre y est comme de juste horrible, et horribles sont ses à-côtés, massacres gratuits et trahisons honteuses qui font le quotidien d’un royaume qui a largement passé le bord de l’éclatement et se précipite vers l’effondrement pur et simple.
George R.R. Martin, au risque de rappeler une évidence, est un brillant conteur. Aussi complexe l’intrigue soit-elle, elle reste toujours lisible, et l’on s’y retrouve sans souci ; tout au plus peut-on citer quelques chapitres un poil plus confus dans la mesure où ils insèrent dans une trame déjà complexe des événements imprévus ou des personnages moins marquants : ainsi, l’histoire du point de vue de Theon Greyjoy peut laisser perplexe pendant un temps ; c’est vrai également, et probablement davantage encore, des chapitres mettant en avant Davos Seaworth, au service de Stannis Baratheon…
L’intrigue, pourtant, est dans l’ensemble plus resserrée que dans A Game of Thrones. Pas pour ce qui est du volume, non… Mais les différentes trames se rejoignent à mes yeux plus régulièrement, les différents chapitres-points de vue ne sautant pas systématiquement du coq à l’âne, et on se disperse ainsi moins dans des trames parallèles – même s’il en reste, et des non négligeables, telles les aventures de Jon Snow au-delà du Mur, où la tragique descente aux enfers d’Arya Stark (tantôt garçonne, tantôt Cosette).
On y retrouve par ailleurs avec un grand plaisir ces si brillants personnages du premier tome (et plein d’autres qui déboulent, parfois fort intéressants, comme Renly et Brienne). Mes chouchous, sans surprise, sont de même que dans A Game of Thrones les plus « complexes » (relativement, si vous y tenez) : je citerais notamment Daenerys Targaryen, si charismatique au-delà de sa fragilité de femme exilée, et plus encore le merveilleux Tyrion Lannister : l’astucieux nain devient ici la « Main » de son neveu le roi Joffrey, et il faut au moins ça pour compenser bêtise de ce dernier et la main-mise aveugle de la reine régente Cersei ; haï de tous, de sa famille qu’il sert pourtant au mieux comme de la populace tirant argument de sa difformité pour en faire le type-idéal du mauvais conseiller (fourbe, nécessairement fourbe), Tyrion a beau être dans le camp le plus relativement « méchant » du roman, par la force des liens du sang, il n’en est pas moins étrangement émouvant, un « trickster » qui cache sous ses tours pendables une authentique humanité… Sympathique, finalement !
Notons par ailleurs que, si A Clash of Kings reste pour l’essentiel dans la ligne très « réaliste » de A Game of Thrones, le surnaturel s’y montre tout de même un peu plus présent ; rien que de très classique dans l’ensemble, mais cela contribue utilement à faire évoluer l’intrigue et à donner du cachet à l’univers.
Je ne prétendrai pas pour autant que ce deuxième volume se montre aussi bon que le premier, ou qu’il en tient toute les promesses. J’ai envie de le placer un petit cran en dessous, quand bien même j’ai pris énormément de plaisir à sa lecture : il s’agit à n’en pas douter d’un divertissement de qualité, bien au-dessus du lot, un témoignage de l’art astucieux du talentueux conteur qu’est George R.R. Martin. Il me semble cependant que les ficelles de son métier ressortent un peu plus ici que dans A Game of Thrones, ou peut-être plus exactement qu’il en use ici de certaines qui sont un peu trop grossières à l’occasion. On a beaucoup rigolé sur la prédilection de l’auteur à tuer ses héros, mais ce n’est pas encore vraiment le cas ici… Par contre, (oui, attention, spoiler, là), il fait ici dans la « fausse mort », ce qui a toujours tendance à m’agacer un poil ; pourtant, l’usage de ce procédé est probablement justifié par le cadre même de l’intrigue, avec ses nombreux hors-champs et ses rumeurs qui traversent un pays en proie au chaos, où finalement plus personne ne sait qui fait quoi et de quoi le lendemain sera fait… Alors sans doute ne puis-je véritablement pour l’instant me montrer trop sévère à cet égard.
On verra bien ce qu’il en est de la suite, donc ; j’ai eu de bons échos du troisième tome : petite pause, mais je ne vais pas tarder à me lancer dans A Storm of Swords…

/image%2F1385856%2F20160114%2Fob_cfb8b0_caligari.jpg)
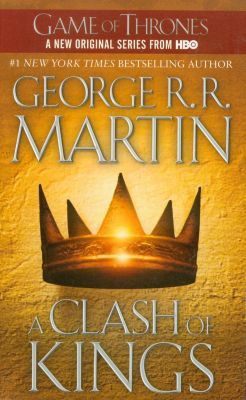










/image%2F1385856%2F20150204%2Fob_660a87_georges-abdaloff-croque-par-christell.jpg)