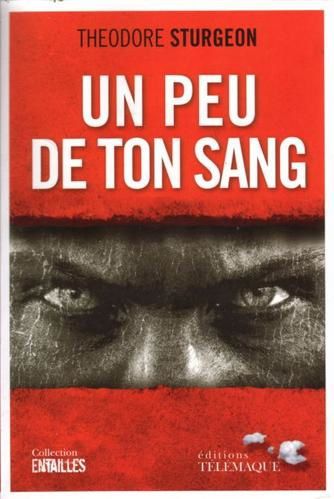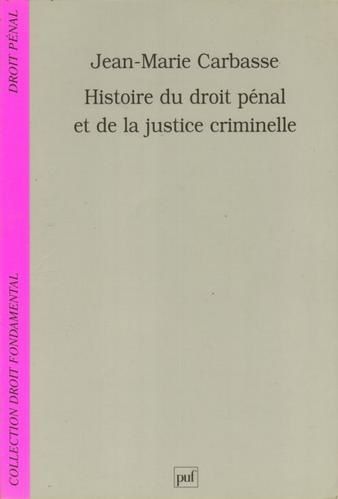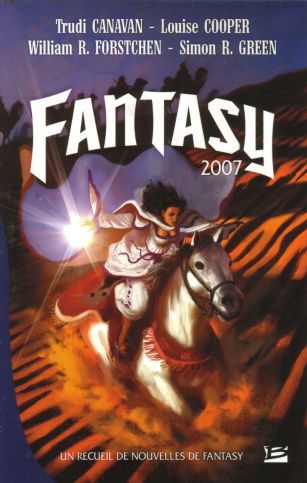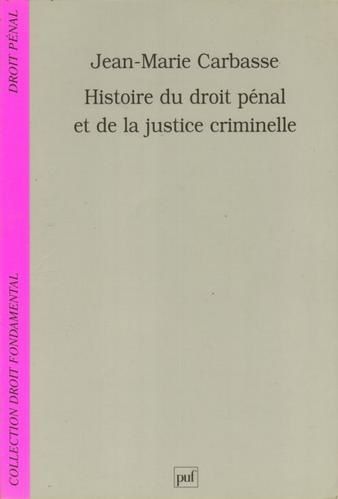
CARBASSE (Jean-Marie), Histoire du droit pénal et de la justice criminelle, Paris, PUF, coll. Droit fondamental / Droit pénal, 2000, 445 p.
Histoire du droit pénal et de la justice criminelle. Un titre alléchant, ou je ne m’y connais pas ! Précisons d’emblée (il y en a à qui ça pourrait faire un choc) que non, pour une fois, ce n’est pas de la science-fiction, malgré la couverture moche et grise (avec un bandeau rose ? quelle drôle d’idée…) ; ce n’est d’ailleurs même pas de la fiction tout court, quand bien même, à vue de nez, ce titre serait à même de séduire les ersatz de Houellebecq et autres amateurs d’Amélie Nauthomb.
Eh oui, incroyable, Nébal a décidé de se remettre à bosser. Et quoi de mieux, pour partir sur de bonnes bases (ou pour s’en écœurer illico), que de revoir les fondamentaux avec un bon vieux manuel ? Sauf qu’un manuel, c’est potentiellement chiant… Pas celui-là, pourtant, et ce pour au moins trois raisons : 1° c’est une matière passionnante (ça, ça n’engage que moi, mais si si, je vous jure) ; 2° c’est un manuel publié par le PUF, dans sa collection Droit fondamental, et on peut donc s’attendre à la présentation aérée et bien pensée typique du genre, où l’indispensable se distingue aisément de l’approfondi ; 3° Jean-Marie Carbasse, que l’on peut bien qualifier de « big boss » en matière d’histoire du droit, a une plume simple et concise, plutôt agréable, ce qui est loin d’être le cas de tous les auteurs de manuels…
Revenons un instant sur le titre : Histoire du droit pénal et de la justice criminelle. Vaste programme, dont on voit assez mal comment il pourrait être traité en 450 pages. C’est qu’il y a ici une double erreur à ne pas commettre : commençons par préciser que l’histoire à laquelle se livre Jean-Marie Carbasse est en fait essentiellement « française » ; mais cela implique néanmoins de commencer par Rome, puis, au Moyen-Age, passée l’époque franque, de franchir à nouveau les frontières du royaume à l’occasion, quand les juristes, redécouvrant le droit romain à travers l’exhumation du Corpus juris civilis, bâtissent un jus civile fondé sur cette ratio scripta (que de latin…) à prétention universelle.
On aurait tort, cependant, de vouloir appliquer ce schéma de manière générale à l’ensemble de la matière, d’en faire une lecture « universaliste », largement teintée d’évolutionnisme : erreur largement commise encore de nos jours, hélas, et qui laisse ici ou là quelques traces. C’est ce que l’on peut voir, notamment, dans les premières pages de cet ouvrage : ainsi, on présente souvent un stade primitif de la justice criminelle reposant sur la vengeance purement privée, tempéré ultérieurement par l’autorité politique et/ou religieuse avec ce qui constitue alors indéniablement un progrès, à savoir la « loi du Talion » (eh oui, « œil pour œil, dent pour dent », c’est un progrès, dans la mesure où il y a une limitation à l’ampleur de la vengeance, imposée de l’extérieur). Généralement, par la suite, on distingue plusieurs étapes, au cours desquelles la vengeance privée se transforme progressivement en vengeance publique, puis en justice publique (l’aspect purement vindicatoire, « rétributif », étant remplacé petit à petit par la pure défense sociale et l’amendement du délinquant), jusqu’à aujourd’hui, où tout est beau, tout est merveilleux ; ben tiens… C’est en fait un peu plus compliqué que ça. Et si la formule célèbre selon laquelle « l’histoire du droit pénal est celle d’une constante abolition » tend à se vérifier en France dans les grandes lignes, le manuel de Jean-Marie Carbasse permet bien de saisir son caractère de lieu commun, d’une puissance rhétorique certaine, mais finalement très contestable dans les faits. L’histoire du droit pénal en France (mais, cette fois, on peut supposer que c’est également le cas ailleurs) est en effet celle d’incessants allers-retours entre libéralisme et répression, justice publique et justice privée, rétribution, défense sociale et amendement.
Ce manuel est constitué de trois parties d’importance inégale, découpées en chapitres fonctionnant selon le schéma habituel de la collection (l’indispensable en gros caractères, avec une présentation très aérée, puis une section « Pour aller plus loin » en petits caractères qui piquent les yeux, avec moult références bibliographiques et approfondissements de telle ou telle thématique).
La première partie, « De l’époque romaine aux temps féodaux » (pp. 27-122) est d’un abord à mon sens assez délicat, notamment dans son premier chapitre, « Le droit pénal romain » : sa compréhension implique des connaissances de base en matière d’histoire des institutions et du droit romains, et reste pour le moins dense. Elle obéit, cependant, au schéma défini plus haut : la vengeance privée de l’époque monarchique est remplacée progressivement par la vengeance publique, puis par la justice publique, au cours de la République et de l’Empire. Pourtant, le droit pénal est loin de perdre en sévérité à mesure que les siècles défilent : bien au contraire, dans son stade ultime du Bas-Empire, c’est à un droit pénal extrêmement strict que l’on a affaire ; le développement de la procédure extraordinaire et inquisitoire (ceux qui seraient interloqués par ces termes peuvent se reporter à mon article miteux sur quelques éléments de l’histoire du droit romain) aboutit à un droit très sévère, recourant à l’occasion à la torture en guise de mode de preuve, et connaissant nombre de châtiments corporels (l’influence chrétienne n’ayant d’ailleurs guère tempéré ces aspects).
« De l’époque franque au XIIe siècle », la situation est bien différente. La chute de l’Empire romain d’Occident et la désagrégation des notions de droit public comme du pouvoir effectif de l’autorité royale ont entraîné une privatisation du droit pénal : la vengeance privée est tout d'abord de règle ; elle sera progressivement tempérée, néanmoins, devenant véritable justice privée, avec notamment les fameuses compositions pécuniaires des coutumes germaniques (le Wergeld, ou « prix de l’homme ») visant à apaiser les conflits, quitte à en passer par l’évaluation « économique » de la vie humaine, chose à laquelle le droit romain se refusait (sauf, bien entendu, pour ce qui était des esclaves). La justice est bientôt accaparée par les seigneurs, qui y voient une prérogative à l’intérêt essentiellement financier ; les abus des seigneurs sont néanmoins atténués par l’Eglise et l’autorité royale se reconstituant progressivement (d’autant que le droit de punir paraît fondamentalement politique ; la mainmise sur la justice est au centre des préoccupations royales, ainsi qu’en témoignent la fameuse « main de justice » du roi, le sceau figurant le roi justicier, ou, sur le plan anecdotique, saint Louis sous le chêne de Vincennes). Au sein des différentes justices (seigneuriales, royales, ecclésiastiques, municipales), la procédure est largement accusatoire, et reposant sur une sorte de « présomption de culpabilité » ; dans cette société qui a presque totalement oublié les règles de la procédure romaine, les modes de preuve sont dits « irrationnels », entendons par-là qu’ils font appel, contre l'avis de l'Eglise, à l’intervention divine (mais peut-être, plus subtilement - voire rationnellement -, faut-il y voir avant tout la conviction de la partie au procès de cette intervention divine, créant un contexte psychologique permettant malgré tout à ce mode de preuve superstitieux d'aboutir à la révélation de la vérité...) : les serments purgatoires, et surtout les fameuses ordalies, unilatérales ou bilatérales, la plus célèbre et la plus durable étant bien entendu le duel judiciaire, plébiscité par la noblesse (on parlait alors de « bataille », ce qui est pour le moins révélateur).
La deuxième partie, « Le droit pénal de l’ancien régime, XIIIe – XVIIIe siècles » (pp. 123-350), occupe le cœur de l’ouvrage. En quatre chapitres thématiques (« Juridictions et procédures » ; « Les pouvoirs du juge pénal » ; « Le système des peines » ; « Le châtiment des crimes »), on assiste à la mise en place de la justice publique, avec l’accaparement du droit pénal par l’autorité royale reconstituée, et nombre d’emprunts au droit romain redécouvert. La procédure, ainsi, perd de son caractère accusatoire pour devenir de plus en plus inquisitoire. A cet égard, le droit pénal de l’ancien régime est caractérisé par deux traits bien particuliers, en opposition complète avec ce que nous connaissons aujourd’hui. Tout d’abord, les juges sont soumis à un rigoureux système de preuves légales : il leur est interdit de faire appel à leur intime conviction, ils ne peuvent condamner qu’en présence d’une preuve « complète ». C’est ce qui explique le recours à la torture, la « question » redécouverte dans le droit de Justinien… Mais, parallèlement, il n’y a pas de système de peines légales : les peines sont arbitraires. Depuis le XVIIIe siècle, le terme « d’arbitraire » est connoté péjorativement, comme traduisant un abus de pouvoir, un véritable « caprice » hors de tout contrôle. La réalité, cependant, était bien différente : « l’arbitraire » désigne la capacité des juges à « arbitrer » les peines, c’est-à-dire à les moduler en fonction des circonstances ; l’impératif de justice, la doctrine, l’influence de l’Eglise, la législation royale, fournissent par ailleurs un cadre dans lequel s’exerce cet arbitraire, qui n’est donc pas « intégral ». Les châtiments ne sont d’ailleurs pas laissés à la libre appréciation des juges, mais sont généralement prédéfinis. Pour ce qui est de la peine capitale (par ailleurs beaucoup moins fréquente que ce que l’on imagine généralement), les modalités d’exécution les plus atroces (enterré vivant avec le cadavre de la victime, noyé, bouilli – ce dernier supplice s’appliquait notamment aux faux-monnayeurs) sont abandonnées assez rapidement pour laisser la place, essentiellement, à la décapitation (privilège de la noblesse), la pendaison, la roue (qui s’applique notamment aux voleurs) et le bûcher (pour les crimes contre l’ordre moral et la religion ; la portée purificatrice de ce châtiment ne fait aucun doute).
Un point important, néanmoins, est celui de l’exemplarité des peines : les châtiments sont terribles, et visent spécifiquement à effrayer les « méchants » pour les dissuader de commettre un crime. Cet impératif de dissuasion, sempiternellement rappelé dans les textes, justifie une véritable mise en scène de la justice, aboutissant parfois à ces bizarreries, qui nous paraissent si absurdes aujourd’hui, que sont les procès de cadavres ou d’animaux. C’est d’ailleurs l’occasion de revenir sur l’arbitraire des juges, avec la pratique du retentum : cette clause du jugement, secrète et à la discrétion des juges, ordonnait au bourreau d’offrir une mort rapide au condamné, par exemple en étranglant préalablement le condamné au bûcher, ou en assénant un premier coup mortel au roué ; mais, l’exécution devant constituer un spectacle, le bourreau n’en continuait pas moins son office sur le cadavre (brûlé, ou battu, tous les os brisés un à un). On voit ainsi que la justice pénale de l’ancien régime, à travers les supplices, ne relevait pas d’un triste sadisme visant à faire souffrir autant que possible le condamné : il s’agissait avant tout de faire peur, de terrifier, d’écœurer, pour dissuader.
Ici, j’ai d’ailleurs envie d’ouvrir une parenthèse. Régulièrement, Jean-Marie Carbasse revient sur des thématiques qui constituent autant de critiques implicites du célèbre Surveiller et punir. Naissance de la prison de Michel Foucault (ou plus exactement, peut-être, d’une mauvaise lecture, hélas courante, de cet ouvrage incontournable). Michel Foucault avait très bien vu l’importance de l’exemplarité des peines, le caractère spectaculaire de la justice d’ancien régime. Son ouvrage s’ouvre ainsi par une fameuse description riche en détails de l’abominable supplice de Damiens (au passage, je vous renvoie à mon compte rendu du numéro du Visage vert consacré aux « amateurs in suffering », qui revenait largement sur ce thème). Mais il s’agit là d’un procédé rhétorique, certes très efficace et laissant une impression durable sur le lecteur, mais assez contestable sur le plan de la démonstration : le supplice de Damiens est en effet un cas-limite, qui ne saurait être représentatif de la justice d’ancien régime ; le régicide, par définition, était une infraction extrêmement rare (trois cas en deux siècles), et appelant une sanction particulièrement terrible (et clairement définie par la législation) : aussi le supplice de Damiens, s’il est un moyen très pertinent d’illustrer le caractère spectaculaire de la justice pénale d’ancien régime (c’était indéniablement son but, et les gens y sont bien venus, en nombre, comme à un spectacle ; là encore, voyez Le Visage vert) ne saurait constituer une représentation fidèle de la sévérité de la justice criminelle d’alors ; le châtiment est ici clairement démesuré (il a d'ailleurs choqué à l'époque même), et on ne trouve pas en temps normal ce genre d’atrocités. Si la législation est de plus en plus sévère jusqu’au XVIIIe siècle, il ne faut en outre pas oublier que ce caractère s’explique en bonne partie par son inefficacité…
Nous en arrivons ainsi à la troisième et dernière partie, « Naissance du droit pénal contemporain » (pp. 351-425). Jean-Marie Carbasse commence par montrer que la justice criminelle, emportée par l’esprit du siècle, tendait justement à devenir moins sévère à l’époque des Lumières : les scandales suscités – très légitimement – par Voltaire à propos des condamnations de Calas et du chevalier de La Barre, par exemple, concernent là encore essentiellement des exceptions, d’autant plus scandaleuses, mais qui autorisent pour cette raison la réflexion sur les nécessaires modifications à apporter au droit pénal, pour qu’il se débarrasse de ses traits les plus « gothiques » (pour reprendre l’expression d’alors ; mais cette barbarie était en fait très romaine…). Les grands réformateurs du droit pénal – on retiendra notamment Montesquieu, puis, et surtout, Beccaria et Bentham, mais on pourrait en citer bien d’autres – accompagnent ainsi un mouvement plus vaste visant, non pas tant à atténuer les rigueurs de la justice criminelle (quand bien même l’optique utilitariste de Beccaria et Bentham a cette conséquence), qu’à en changer les fondements.
C’est ainsi que la réforme pénale se trouvera au cœur de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, et que l’on reviendra totalement sur les deux caractéristiques majeures du droit pénal d’ancien régime évoquées plus haut : d’une part, on abandonne le système absurde des preuves légales – et sa conséquence, la torture, de toute façon de moins en moins employée au cours du XVIIIe siècle – pour laisser la place à l’intime conviction des juges (et éventuellement du jury populaire) ; d’autre part, l’arbitraire sempiternellement vilipendé cède la place au système des peines légales : dans une perspective légicentriste, c’est désormais la loi qui est au cœur du droit, elle qui définit précisément l’infraction et la peine applicable, sans possibilités de modulations perçues comme « capricieuses », et donc nécessairement injustes ; le juge doit être « la bouche de la loi », selon le mot de Montesquieu, un automate, une machine – c’est bien l’esprit du temps ! –, qui applique automatiquement une sanction précise et prédéfinie à une infraction précise et prédéfinie (ce système entraînera cependant bien des abus durant la Révolution et le début du XIXe siècle, le jury préférant parfois procéder à des « acquittements scandaleux » plutôt que de condamner le prévenu, même indéniablement coupable, à une peine qui lui semblait excessive mais qu’il ne pouvait pas moduler ; d’où l’importance de la grande réforme de 1832 concernant l’appréciation des circonstances atténuantes, permettant à nouveau de moduler la peine « vers le bas » – ce qui rend d’autant plus absurde les réformes populistes actuelles à base de « peines plancher », mais je m'égare… –, puis d’autres réformes effectuées dans une optique similaire, comme le sursis introduit par la loi Bérenger à la fin du XIXe siècle ; sur Bérenger, je vous renvoie à ma note sur La République des faibles).
On retrouve ici Michel Foucault. L’inefficacité de la dissuasion spectaculaire par l’atrocité des supplices, ainsi que les plaidoyers des réformateurs en faveur de l’utilitarisme et les idées libérales alors dominantes (notamment celles concernant l’éducation), aboutissent à un chamboulement total de l’échelle des peines. Les peines corporelles sont presque totalement abandonnées, à l’exception de la peine de mort (quand bien même on discute dès la Révolution de son abolition, dans la foulée de Beccaria ; parmi les plus fervents abolitionnistes, à l’époque de la Constituante, il y a notamment Robespierre), puis de la mutilation des parricides (qui ressuscite dans le Code Napoléon, mais sera rapidement supprimée) ; les idées d’amendement, voire de réinsertion, ainsi que « l’utilité sociale », conduisent parallèlement au développement de l’institution carcérale. Il faut ici rappeler que la prison, auparavant, ne constituait pas en principe une peine, mais seulement un moyen préventif, destiné à s’assurer de l’accusé dans l’attente de son procès (c’est un héritage du droit romain). Pourtant, dès le Moyen-Age, l’Eglise, en plaçant au premier chef de ses préoccupations l’amendement du pécheur, condamne régulièrement à la prison dans les cours ecclésiastiques – la réclusion solitaire est censée favoriser la réflexion du condamné sur ses actes. On voit donc que l’objectif « éducatif » de la prison du XIXe siècle avait des origines plus anciennes que ce que l’on affirme généralement. On notera également que, très exceptionnellement, l’emprisonnement pouvait constituer une sanction d’ordre pénal dans le droit laïque, essentiellement au travers de la justice retenue (on peut citer l’exemple de Fouquet ; mais se pose aussi la question très particulière, et souvent mal comprise là encore, des lettres de cachet). La « naissance de la prison » évoquée par Michel Foucault est donc à relativiser ; ce que l’on doit en retenir, c’est surtout la généralisation de l’emprisonnement en tant que mode de sanction, destiné, alternativement ou en même temps, à protéger la société (c’est l’impératif de défense sociale, que l’on retrouvera avec les criminalistes italiens, et qui fonde l’école de la « nouvelle défense sociale », plus libérale, et majoritaire dans la doctrine depuis les années 1950), à « rééduquer » le coupable pour favoriser sa réinsertion (question au centre de toute la réflexion pénitentiaire abondante au cours du XIXe siècle, avec Tocqueville, etc. ; les résultats, hélas, sont plus que douteux, la prison constituant le plus souvent une sorte d'école du crime...), et à rendre sa peine « utile », notamment par le travail (ce qui va de pair avec l’objectif éducatif ; parallèlement à la prison se développent en effet les travaux forcés, adaptation moderne de l’ancienne peine des galères – mais qui trouvait un précédent romain avec la terrible condamnation aux mines –, et la déportation destinée à « mettre en valeur » les colonies, sur le modèle anglais de Botany Bay).
L’ouvrage de Jean-Marie Carbasse aborde nombres de thématiques passionnantes, on le voit, et qui peuvent intéresser au-delà des seuls étudiants ou enseignants en histoire du droit ou en droit pénal. Et il y aurait bien d’autres choses à retirer de cet excellent manuel, sans doute, mais je m’en tiendrai pour ma part là. Parce qu’il est temps que je me mette à bosser, tout de même.