"Uncollected Prose and Poetry 3", de H.P. Lovecraft

LOVECRAFT (H.P.), Uncollected Prose and Poetry 3, edited by S.T. Joshi & Marc A. Michaud, introduction by S.T. Joshi, West Warwick, Necronomicon Press, 1982, 44 p.
Ce petit recueil fait de bric et de broc rassemble divers textes qui étaient devenus difficilement trouvables, quand bien même il ne s’agissait pas forcément « d’inédits ». On y trouve donc de la fiction, de la poésie, et – surtout, on ne va pas faire de mystères – des essais, courant le long de l’ensemble de la carrière de Lovecraft.
Pas grand-chose à dire sur la fiction. On trouve tout d’abord un « Discarded Draft of « The Shadow over Innsmouth » » fragmentaire (des versos épars), qui nous présente un état antérieur d’une des plus célèbres nouvelles de Lovecraft. Peu de choses à noter cependant, en dehors de la présence d’un personnage de curé polonais qui disparaîtra de ce texte pour réapparaître dans « La Maison de la sorcière » et d’un passage sur l’observation par le narrateur des bijoux « manufacturés » à Innsmouth qui sera largement remanié dans la version finale. Intérêt assez minime, donc, si ce n’est pour les exégètes les plus jusqu’au-boutistes. « The Battle That Ended the Century », ensuite, est une petite blague rédigée avec Robert H. Barlow que j’avais pu lire en français dans le Cahier de l’Herne consacré à Lovecraft. Le texte en lui-même ne présente que peu d’intérêt ; tout au plus peut-on s’amuser, dès lors que l’on connaît un tantinet la biographie de Lovecraft, à identifier les différents personnages mentionnés sous des noms fantaisistes, certains évidents, d’autres franchement capillotractés…
Suivent cinq poèmes – et là je ne peux qu’avouer une fois de plus mon incapacité à en livrer une critique convenable… – dont le plus intéressant à mon sens, mais sans que je sache véritablement expliquer pourquoi au-delà du pur ressenti, me paraît être le long « To an Infant ». « Earth and Sky » et « On Religion » sont des illustrations du matérialisme de l’auteur (y compris dans ses inspirations antiques, Lucrèce notamment) et de son athéisme. « Hellas » est, une fois n’est pas coutume, une ode à la Grèce antique, quand bien même les humanités de Lovecraft l’ont dans l’ensemble surtout poussé à faire l’éloge de la gloire de Rome. Reste enfin « Festival », seul exemple ici de poésie « weird », qui n’est pas sans charme…
Cela dit, à s’en tenir là, ce recueil n’aurait à mon sens pas grand intérêt. Ce qui change la donne, ce sont les quatre essais repris en fin de volume, et qui forment la majeure partie de ce Uncollected Prose and Poetry 3. Les deux premiers sont autobiographiques : « The Brief Autobiography of an Inconsequential Scribbler », rédigé à la demande d’un collègue du « journalisme amateur » alors que Lovecraft n’avait pas encore entamé la partie la plus substantielle de sa carrière, témoigne de sa modestie – poussée à l’extrême – mais aussi de son humour, particulièrement dans ses anecdotes enfantines relatives à la poésie et plus particulièrement aux vers libres. C’est toujours la modestie qui domine dans « What Amateurdom and I Have Done for Each Other », bilan plus tardif que l’on pourrait résumer par cette sentence éloquente : « What I have given Amateur Journalism is regrettably little; what Amateur Journalism has given me is–life itself. » Ce qui, au-delà de la tendance à l’auto-flagellation assez caractéristique de l’auteur, est sans doute assez lucide. Le plus long texte de ce recueil est « Cats and Dogs » (également connu sous le titre derlethien « Something About Cats »). Sujet frivole s’il en est, proposé par un club d’amateurs, mais qui offre à Lovecraft l’occasion de rédiger une dissertation très amusante dans sa mauvaise foi hénaurme et sa provocation délibérée ; Lovecraft, bien sûr, est du côté des chats, et s’étend à longueur de pages sur les vertus indéniables de la gent féline, quand il ne témoigne que de mépris pour les cabots. En résumé : « The dog is a peasant and the cat is a gentleman. » Aussi les chats sont-ils des animaux pour gentlemen (qui ne sauraient se prétendre leurs « maîtres ») là où les chiens sont favorisés par l’odieuse plèbe démocrate prisant les fausses vertus de servitude et de dépendance… En lisant ce texte, je n’ai pu m’empêcher de me demander ce que Lovecraft aurait bien pu penser du Culte des Chats sur Facebook, sans doute guère aristocratique… Mais passons ; en dépit de son sujet invraisemblablement couillon, cet essai est sans doute, et pas seulement en raison de sa longueur, la pièce de résistance de ce petit recueil. Reste enfin « Notes on Writing Weird Fiction », bref texte énumérant quelques conseils à destination des apprentis « fantastiqueurs » ; le plus significatif à l’égard de l’écriture lovecraftienne est sans doute celui qui fait du temps une donnée fondamentale du « weird », et intime donc de rédiger au préalable deux synopsis, l’un dans l’ordre des événements, l’autre dans celui de leur narration.
Un recueil fourre-tout, donc, d’un intérêt variable. Les essais l’emportent indéniablement sur le reste, et « Cats and Dogs » est bel et bien celui qui fait la plus forte impression. Aussi n’aurai-je qu’un mot pour conclure : miaou.

/image%2F1385856%2F20160114%2Fob_cfb8b0_caligari.jpg)


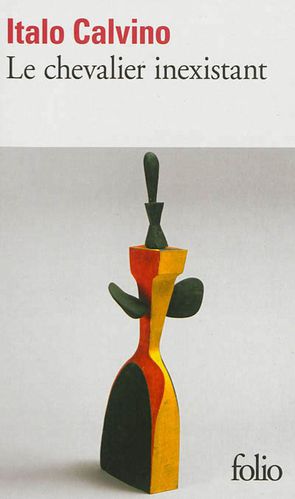




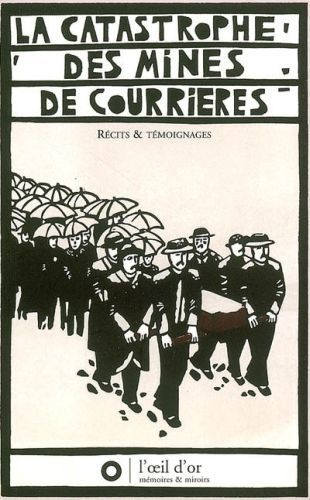
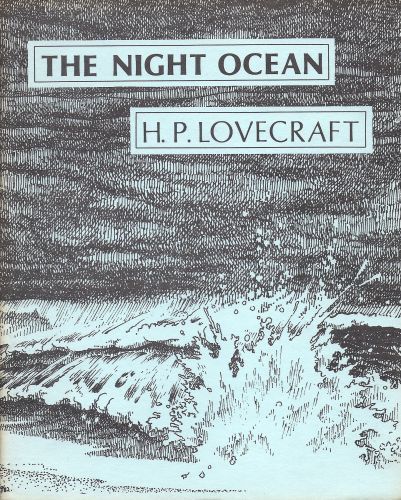
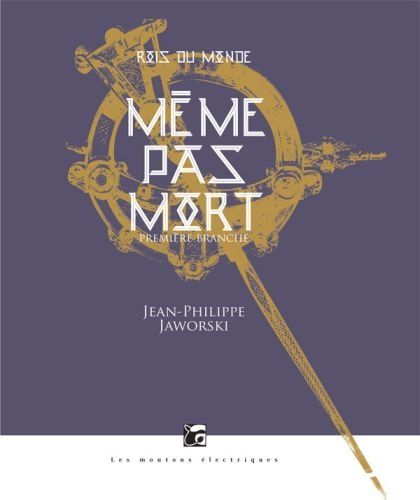

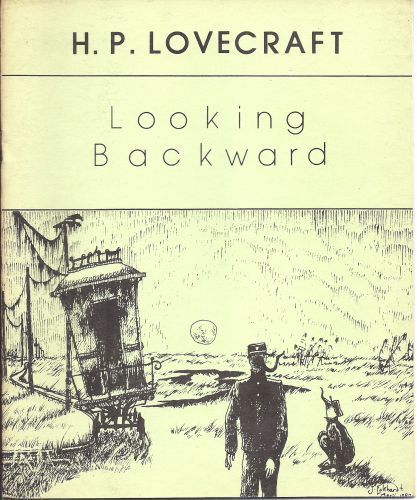
/image%2F1385856%2F20150204%2Fob_660a87_georges-abdaloff-croque-par-christell.jpg)