Sur les frontières
Sur les frontières, 2015, 80 p.
Je vous avais parlé il y a peu du très chouette jeu de John Grümph La Lune et Douze Lotus, tout récent. Quand je me le suis procuré sur Lulu, je me suis dit, tant qu’à faire, que je pouvais aussi jeter un œil à quelques autres jeux « amateurs » ou « indépendants », comme vous voudrez, disponibles sur le même site, les tout récents également Sur les frontières de Manuel Bedouet (illustré par John Grümph, d’ailleurs), dont je vais vous causer aujourd’hui, et Brygandine de James Tornade, mais aussi, plus vieux, La Cité Sans Nom et Tranchons & Traquons. Un mélange d’authentique curiosité et d’impulsions plus ou moins bienvenues, l’occasion en tout cas de voir d’un peu plus près certaines des choses qui se font en jeu de rôle indépendant de par chez nous.
On a pas mal parlé de ce Sur les frontières récemment (en tout cas sur le forum de Casus NO, pour ne pas le nommer), et le pitch me plaisait bien. Les joueurs y incarnent des enfants (au début, en tout cas : 12 ans) issus de bonnes familles aristocrates, envoyés aux frontières de l’immense empire de Naëscence, au dirigeant immortel, pour y devenir des adultes… en s’y confrontant aux dures réalités d’un monde qui n’est probablement pas tout à fait ce qu’ils croyaient – c’est peu dire. L’idée, toute simple, me séduisait bien, là, comme ça. D’autant que je ne pouvais m’empêcher d’envisager tout cela au travers d’un filtre esthétique napoléonien… qui m’a par ailleurs rappelé, sans qu’il y ait forcément de lien direct, Les Soldats de la mer, le chef-d’œuvre d’Yves et Ada Rémy. Je ne saurais vous dire pourquoi, c’est venu comme ça.
Impossible de s’étendre davantage sur l’univers, dans tous les sens du terme : ce court livre n’en dit pas grand-chose de plus (on peut d’ailleurs se demander si ce qu’il en dit est réllement « utile »…) ; tout ou presque, en fait, est à définir : le meneur fait sa part, bien sûr, en dessinant au départ à gros traits une communauté frontalière – il se doit pour cela de répondre à une petite liste de questions –, mais les joueurs aussi participent de cette création, tout d’abord en évoquant des rumeurs parcourant ladite communauté, puis – à partir de la fin de la première partie – en définissant éventuellement des PNJ, notamment ceux qui rempliront les rôles cruciaux d’Amis et d’Ennemis pour leurs personnages (le système leur permet en outre d’influer sur le récit, via les points de Destin, j’y reviendrai).
Outre ce pitch, plutôt sympathique, et ce mécanisme de création d’univers, intéressant dans sa dimension collaborative, Sur les frontières se singularise – au-delà du seul système au sens le plus strict, j’entends – par quelques autres traits éventuellement déconcertants de prime abord. Déjà, l’étrange idée pour un jeu de rôle qu’il y a un (et un seul) « gagnant » : un seul des enfants envoyés sur les frontières parviendra à transcender sa destinée – l’objectif ultime – pour devenir un « Héros ». Certes, cela ne fait pas du jeu, pour autant, une compétition – et heureusement ; mais ça m’a perturbé vaguement, moi qui m’en tenais à la vieille et belle idée qu’il n’y a pas de gagnant dans un jeu de rôle… Bon, pourquoi pas. Je ne suis pas certain que ça joue tant que ça sur le récit et le roleplay, de toute façon.
Reste que la notion de destin (défini par le joueur à la création de perso) est ici essentielle, dans le fond comme dans la mécanique, qui repose entre autres sur une jauge de six « points de Destin », amenés à disparaître au fur et à mesure – on utilise lesdits points dans des circonstances précises, avant certains jets de dés notamment –, en constituant une sorte de compte à rebours (faute de meilleure comparaison, et histoire de se référer à quelque chose de connu, j’aurais envie de dire que cela tient un peu d’un mélange entre les notions de Santé Mentale et d’Aplomb dans L’Appel de Cthulhu). Quand un joueur n’a plus de points de Destin, il a « perdu », au sens où son destin s’est accompli malgré lui – quel que soit celui-ci (ça n’a rien de nécessairement « fatal », même si l’ambiance du jeu se veut « tragique ») ; concrètement, il perd son « Don » (j’y reviendrai) et devient un « Compagnon ».
Par ailleurs – et ça ça m’a paru vraiment bizarre, et je ne suis probablement pas le seul dans ce cas –, les joueurs persistent sous forme de fantômes après leur mort (on ne se précipite donc pas sur une nouvelle feuille de perso…), et, si leurs interactions sont par nature limitées, ils peuvent cependant toujours utiliser leurs points de Destin restants pour venir en aide aux personnages survivants, que ce soit, par exemple, pour un jet de dés crucial, ou, de manière plus intéressante sans doute, en influant sur le cours de la narration (connaître une information utile, connaître une personne qui peut aider, disposer d’un objet approprié). Plus d’un, en faisant part de son expérience de lecture, a craint à ce sujet que le jeu devienne ennuyeux pour ceux qui « incarnent » (…) ces fantômes… et je dois avouer en faire partie. Mais bon : faut voir, j’imagine.
Les personnages sont définis très simplement, par des phrases et autres traits (une Devise, un Don surnaturel…), et seulement trois caractéristiques chiffrées (Âme, Corps, Esprit). Celles-ci servent pour tous les jets de dés. Le système, très simple – on jette un dé, on ajoute ou pas une caractéristique, on détermine le nombre de succès en fonction du résultat, que l’on compare alors au nombre de succès réclamé par l’action – repose notamment sur la distinction entre « circonstances favorables » (surnombre, possibilité d’user d’un trait… on jette alors deux dés et on garde le meilleur) et « circonstances défavorables » (en sens inverse, on jette deux dés et on garde le moins bon). Ça coule sans doute tout seul – on ne peut pas dire en tout cas que le système vient perturber le rythme du récit, et c’est tant mieux. Je note cependant que les combats, quand il y en a, sont très rapides et très violents : un personnage qui prend une blessure est « blessé », à la deuxième il est « mutilé », et à la troisième… hop, il est mort (chacun de ces statuts ayant une conséquence sur les jets ; « l’humiliation » et la « déchéance », hors combat, ont des conséquences du même ordre).
La notion essentielle, pour le meneur comme pour les joueurs, est celle de « Moment » : ce sont ces épisodes qui participent du chamboulement des perspectives des personnages, central dans Sur les frontières. Douze de ces Moments sont définis : quand un personnage les franchit tous, il devient donc un « Héros » et « gagne ». Les Moments servent par ailleurs à l’expérience (de manière assez bien vue).
Quand je suis sorti de ma lecture, il y a de cela quelques jours, je n’ai pu m’empêcher de m’interroger sur l’aspect « dédié » du système, sur son adéquation parfaite au jeu dans tous ses aspects, et me suis demandé s’il n’y aurait pas eu moyen de faire quelque chose de plus… pertinent, disons. L’aspect vaguement « tactique » des combats, notamment, me laissait un peu sceptique. À la réflexion, pourquoi pas ? Ça demande sans doute à être essayé, au-delà du caractère un peu abstrait du jeu sur le papier… Il me semble cependant que seuls les points de Destin et les Moments entrent pleinement en adéquation avec les principes narratifs et ludiques de Sur les frontières… mais bon. Pourquoi pas… Ma seule crainte, maintenant, concerne à vrai dire la manière de concevoir et interpréter les Moments ; les indications données par le bouquin sont assez lapidaires – mais comment en dire plus ? –, et demandent sans doute à être mûrement réfléchies, pour qu’un Moment se révèle véritablement important… sans être artificiel pour autant. Là, il y a sans doute du boulot tant pour le meneur que pour les joueurs. Mais j’imagine qu’avec quelques efforts et avec un peu de « bon sens », cela devrait passer.
Sur les frontières, au final, me fait donc l’effet d’un « petit » jeu (il est fait pour tenir en une campagne de six à dix séances a priori, quelque chose comme ça, et la rejouabilité n’est peut-être pas son point fort) très intéressant. Probablement pas « parfait », si tant est que cela veuille dire quelque chose, mais disons « perfectible ». Sans se montrer « révolutionnaire » (même si les idées du « gagnant » et du fait de jouer les « fantômes » me laissent un poil perplexe – n’y a-t-il pas là comme une certaine « gratuité » tranchant sur les jeux de rôle dits « traditionnels » sans que cela soit véritablement utile ? Je ne fais que me poser la question, hein), le jeu de Manuel Bedouet comprend suffisamment de bonnes idées pour qu’on y jette un œil, et même deux, voire – tiens donc – pour qu’on y joue. Je n’en ferais peut-être pas une priorité pour ma part – si tant est que je sois en mesure d’établir des priorités, hein… –, mais, à l’occasion, ça me dirait bien quand même.

/image%2F1385856%2F20160114%2Fob_cfb8b0_caligari.jpg)



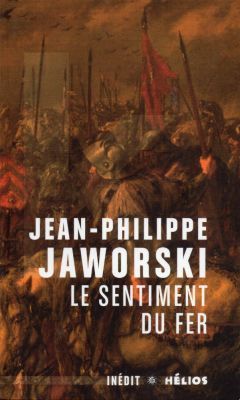
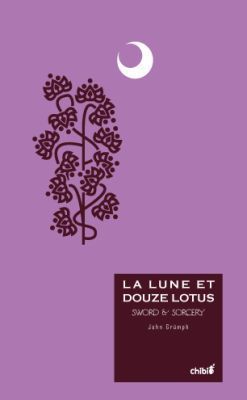
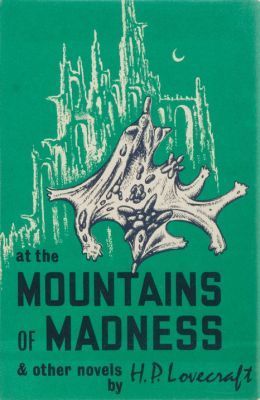


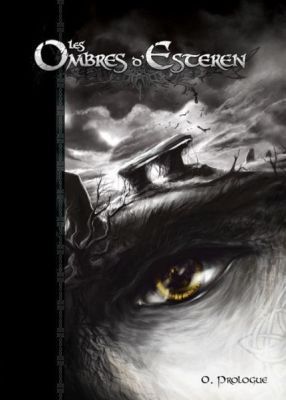
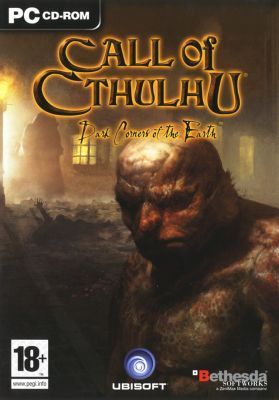

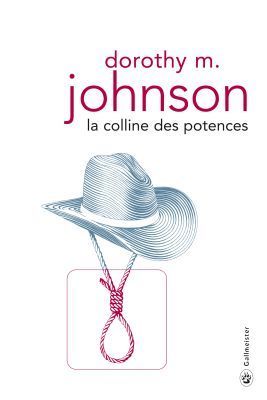
/image%2F1385856%2F20150204%2Fob_660a87_georges-abdaloff-croque-par-christell.jpg)