CR Imperium : la Maison Ptolémée (23)
Vingt-troisième séance de ma chronique d’Imperium.
Vous trouverez les éléments concernant la Maison Ptolémée ici, et le compte rendu de la première séance là. La séance précédente se trouve ici.
Tous les joueurs étaient présents, qui incarnaient donc Ipuwer, le jeune siridar-baron de la Maison Ptolémée, sa sœur aînée et principale conseillère Németh, l’assassin (maître sous couverture de troubadour) Bermyl, et le Docteur Suk, Vat Aills.
…
Hélas, il y a eu un problème technique : l’enregistrement de la séance a foiré… Impossible, donc, de faire un compte rendu aussi détaillé que d’habitude. Suit un résumé, mais suffisamment ample, finalement, ouf, de ce qui s’est produit au cours de cette vingt-troisième séance.
I : L’AUTOPSIE DE L’HOMME MORT DEUX FOIS
[I-1 : Bermyl, Vat Aills : le Vieux Radames] Bermyl a fait transférer la dépouille du Vieux Radames au service du Docteur Suk, Vat Aills, au Palais de Cair-el-Muluk.
[I-2 : Vat Aills : le Vieux Radames] Le docteur se livre à une autopsie du cadavre, dont il sait qu’il a été retrouvé devant son domicile, dans un quartier pauvre de Cair-el-Muluk ; il a été tué la veille. Vat constate de multiples blessures à l’arme blanche, dont l’interprétation est d’abord un peu ambiguë – mais tout laisse à croire que le vieux « charpentier » a été tué rapidement, probablement d’un unique coup de couteau porté de face et en pleine gorge ; par contre, on s’est ensuite acharné sur le cadavre, dans le but de le dégrader, semblerait-il (nombreuses balafres, perforations tout aussi nombreuses, mais aussi œil crevé, oreille à demi arrachée, parties génitales littéralement broyées…). Le Docteur Suk en vient à supposer que, même si les nombreux coups donnent une impression de lynchage, il n’y a sans doute eu qu’un seul assassin – qui a tué sa cible en un coup, puis ainsi « maquillé » la scène.
[I-3 : Vat Aills : le Vieux Radames] Mais, ces blessures fatales mises à part, comme de juste, le corps donne plutôt l’impression d’un homme en bonne forme – il n’exprime pas du tout la vieillesse du personnage (ses cheveux et barbes blancs et ses rides relèvent presque de la « cosmétique », à cet égard), alors que c’était bien de vieillesse que le Vieux (…) Radames était mort environ deux ans plus tôt… Il fait « plus jeune », d’une certaine manière – il n’a d’ailleurs certainement pas des « mains de travailleur », et semble plus globalement libéré des afflictions normalement dues à l’âge. Le corps semble même « nettoyé », et son système immunitaire est en béton – en cela, il évoque d’une certaine manière les faux « zélotes de la Maison Arat » capturés dans le campement des Atonistes de la Terre Pure lors de l’émeute ; ce n’est pas tout à fait la même chose, le Vieux Radames n’est pas qu’une coquille, mais, dans le procédé, c’est probablement assez proche. L’analyse toxicologique, enfin, ne relève rien de spécial – si ce n’est par l’absence : il n’y a pas le moindre résidu de zha, drogue de consommation courante sur Gebnout IV, et tout particulièrement chez les individus religieux – profil semblant correspondre à celui du défunt.
II : ENQUÊTE DE VOISINAGE
[II-1 : Vat Aills, Bermyl] Vat Aills et Bermyl décident alors d’enquêter sur les lieux du crime. Ils se rendent dans un quartier pauvre de Cair-el-Muluk, caractéristique avec ses immeubles pouilleux d’une dizaine d’étages où s’entassent les plus démunis, et s’étonnent quelque peu du calme dans ces rues, en principe bien autrement animées. Ils devinent une certaine méfiance de la population…
[II-2 : Vat Aills, Bermyl : le Vieux Radames] Le Vieux Radames avait une échoppe au rez-de-chaussée d’un immeuble de rapport ; un escalier au fond de la petite boutique permet d’accéder à un petit appartement au premier étage, sans passer par les communs de l’immeuble, accessibles juste à côté. La terre battue devant la boutique ne présente pas de traces du meurtre.
[II-3 : Vat Aills, Bermyl : le Vieux Radames] C’est bien l’échoppe d’un « charpentier », qui était aussi « menuisier » et « ébéniste », mais autant qu’un artisan peut l’être dans ce recoin défavorisé de Gebnout IV, planète par ailleurs pauvre en bois, et qui, logiquement, en réserve donc en principe l’usage à des clients fortunés, se fournissant auprès d’artisans autrement qualifiés et reconnus – le Vieux Radames, s’il travaillait bien (quelques pièces d’exposition dans la boutique en témoignent), n’avait pour matière à travailler qu’un mauvais bois, de récupération, et sa clientèle était probablement un peu « parvenue ». Ceci étant, la poussière et la disposition des biens exposés comme des outils laissent supposer que cela fait bien longtemps que personne n’a travaillé ici. Il n’y a par ailleurs pas de traces de lutte, au rez-de-chaussée du moins.
[II-4 : Bermyl, Vat Aills] Bermyl et Vat gagnent l’étage, la partie habitation, pour poursuivre leur enquête. Mais Bermyl entend du bruit en dessous… et, plutôt que de tenter la discrétion, il lance : « Y a quelqu’un ? » Apparaît une vieille bonne femme, méfiante et agressive, qui leur demande ce qu’ils foutent là… Qui sont-ils ? La police est déjà passée ! Bermyl parvient à la calmer et à lui exposer la situation sans trop en dire. La bonne femme, sans doute guère instruite, ne comprend pas la signification du diamant au front du Docteur Suk, que tous deux avaient indiqué dans l’espoir de gagner ainsi sa confiance ; en fait, elle l’avait tout d’abord pris pour un bubon… Mais Bermyl lui fait donc comprendre que c’est là un symbole de probité, entre autres choses – ils ne comptent certainement pas faire le moindre mal à qui que ce soit, et on peut leur parler en toute confiance. D’abord hésitante, l’intruse accepte enfin de répondre à leurs questions, mais pas ici – pas dans la demeure du mort, ça ne se fait pas !
[II-5 : Bermyl, Vat Aills] La bonne femme les entraîne dans son propre logis – dans le même immeuble, mais il faut passer par les communs : elle fait office de « concierge », sans forcément en avoir le titre. Son appartement témoigne de sa pauvreté ; y vagissent sans cesse quatre marmots visiblement sous-alimentés, et pour certains malades – ce sont ses petits-enfants, qu’elle garde quand sa fille et son gendre se rendent à leur travail.
[II-6 : Bermyl, Vat Aills] La discussion ne donne tout d’abord pas grand-chose, et Bermyl comprend que le témoin ne parlera que contre rémunération : il avance une bourse bien remplie sur la table. La femme se montre de suite plus loquace.
[II-7 : Bermyl, Vat Aills : le Vieux Radames] Bermyl mène l’interrogatoire. Il commence par la « résurrection » du voisin. Oui, le Vieux Radames était mort il y a deux ans de cela, à peu près, mais il était « revenu » quelques mois plus tard. Ce qui avait d’abord suscité la panique, bien sûr, mais les choses n’ont pas tardé à s’arranger, le discours religieux se mettant de la partie, et le vieux bonhomme étant plus que jamais sympathique – et, oui, plus sage, comme on le disait ; la multiplication des autres cas sur cette période a fini par convaincre les habitants pauvres de Cair-el-Muluk que ce nouvel état des choses était finalement « normal », et qu’il n’y avait pas lieu de craindre ces morts ressuscités, bien au contraire.
[II-8 : Bermyl, Vat Aills : le Vieux Radames] Bermyl en vient maintenant à l’assassinat du Vieux Radames (au prix d’une deuxième bourse). Oui, elle était là au moment du meurtre ; elle ne l’a pas vu, mais elle a entendu les coups de couteau – le Docteur Suk s’en étonne, ça n’est tout de même guère bruyant… mais la bonne femme dit que les cloisons sont fines, et ajoute, avec un brin de mépris, qu’à vivre dans ce quartier mal famé elle a assurément eu bien des occasions d’apprendre à reconnaître le bruit que fait une lame plongée dans la chair… Par contre, elle répète qu’elle n’a rien vu – et ne semble pas mettre en avant d’éventuels cris de la victime assassinée.
[II-9 : Vat Aills, Bermyl] Vat Aills détourne un peu la conversation – évoquant l’état déplorable de la marmaille : à l’en croire, on frôle la maltraitance… Mais ce jugement sévère est en fait une manière d’offrir ses services de médecin à leur hôtesse ! Bermyl, dans l’immédiat, se montre plus conciliant : il comprend que d’autres bourses délieront la langue de la vieille femme, et ne se montre pas économe.
[II-10 : Bermyl, Vat Aills : le Vieux Radames] Oui, en fait, elle en sait un peu plus… Elle croit savoir qui est le coupable : elle avait vu, quelque temps avant, le Vieux Radames entrer dans son échoppe avec un autre « comme lui », un « revenu » (elle n’en dit pas plus concernant l’identité précise du suspect, et ne se montre guère plus utile concernant sa description – pas de quoi faire un portrait-robot, semble-t-il ; la seule chose dont elle est certaine, c’est donc ce statut de « revenu »). Ils ont discuté un moment – elle percevait de vagues marmonnements, rien de plus : oui, les cloisons sont fines, mais quand même pas au point de rendre intelligible une conversation chez les voisins… d’autant plus, à vrai dire, que les habitants de l’immeuble, à force, tendent par la force des choses à ignorer ce qui se dit à côté, ce n’est plus pour eux qu’un bruit de fond. Mais ils ont discuté un moment, oui. Puis ils sont sortis… et la bonne femme a alors entendu l’agression. Elle a attendu un peu avant de sortir voir ce qui se passait, histoire de ne pas finir en victime elle aussi ; mais quand elle a gagné la rue (déserte ?), il n’y avait plus que le cadavre du Vieux Radames, étalé devant sa boutique – son agresseur avait disparu… Mais elle semble donc bien confirmer qu’il n’y avait qu’un seul assassin, qui était « l’un d’eux » : il n’y a pas eu de lynchage, certainement pas.
[II-11 : Vat Aills, Bermyl] Impossible sans doute d’en tirer davantage. Avant de partir, le Docteur Suk tire de sa sacoche des antalgiques et antibiotiques – pour les enfants. Tous deux laissent alors la bonne femme, perplexes quant à ces nouveaux développements… Bermyl se demande s’il faut déduire de cela qu’il y aurait un ou des courants dissidents parmi les morts ressuscités – y auraient-ils en fait des alliés ?
III : TANT DE COMPLOTS…
[III-1 : Ipuwer, Németh] Ipuwer est désireux de s’entretenir à nouveau avec sa sœur Németh – laquelle erre dans ses jardins, caressant distraitement ses beaux tureis ; elle est visiblement accablée par les inquiétants développements des derniers jours.
[III-2 : Ipuwer, Németh : Apries Auletes, Ngozi Nahab, Dame Loredana, Ra-en-ka Soris, Soti Menkara] Ipuwer fait part à Németh de ses craintes concernant le chef de la police, Apries Auletes – notoirement corrompu, et aux ordres de Ngozi Nahab. Comment gérer ce sinistre personnage ? Pourrait-il apporter quelque chose aux Ptolémée, en l’état ? Servir de « messager », d’une manière ou d’une autre ? Ou faut-il le limoger, au risque que cela suscite des tensions avec la Maison mineure Nahab ? Une Maison mineure, certes, mais puissante, et sans doute les Ptolémée ont-ils déjà suffisamment d’ennemis comme ça… Or le fiasco de la mission de Bermyl à leur encontre a probablement déjà incité les Nahab à suivre de près les actions des Ptolémée. Ngozi ne s’est pas encore manifesté pour l’heure, mais que faut-il en déduire ? Et qu’en est-il des deux autres Maisons mineures commerçantes, les Soris et les Menkara, qui semblent s’être alliés justement contre les Nahab ? Il serait bon, comme le disait Dame Loredana, de « compter leurs alliés »… Mais Ra-en-ka Soris et Soti Menkara sont-ils fiables ? Le premier semble avoir rendu service aux Ptolémée concernant les « bizarreries » sur la lune de Khepri ; mais la seconde, pour être très discrète dans toutes ces affaires, n’inspire pas forcément la confiance…
[III-3 : Ipuwer, Németh] Ipuwer spécule donc à tout va… Mais Németh n’en semble que plus distraite. Elle gratouille la tête de ses tureis, les yeux dans le vague – cette politique interne des plus retorse l’épuise…
[III-4 : Ipuwer, Németh : Linneke Wikkheiser] Ipuwer change alors de sujet, et avance le nom de leur « invitée » Linneke Wikkheiser – ce qui « réveille » aussitôt Németh : elle semble éprouver une haine viscérale pour l’arrogante « princesse »… Mais les spéculations vont sans doute trop loin : Ipuwer mentionne la vague idée avancée plus tôt de la faire assassiner, mais tous deux savent très bien que ce n’est pas une solution : ils seraient, et à bon droit, des coupables tout désignés, et ne peuvent se le permettre… Ipuwer en est en fait parfaitement conscient : il n’a évoqué cette possibilité que pour l’exclure aussitôt – mais il avance alors que Németh, peut-être, pourrait présenter ses excuses à la Wikkheiser ? Ipuwer n’est guère doué pour ce genre de « manipulation » ; de toute façon, il n’y croit pas davantage que sa sœur… Et il n’en a même pas envie : aucune intention de complaire à la pimbêche ! Impossible, de toute façon, de la rallier avec une promesse de mariage ; s’il était possible, par contre, de l’inciter à faire un faux pas… Ou de la rendre malade, ou folle ? Son idée enthousiasme Ipuwer – Gebnout IV ne manque certainement pas de vilaines bestioles et de pathologies exotiques à même de sérieusement diminuer une étrangère de la haute…
[III-5 : Ipuwer, Németh : Linneke Wikkheiser] Rien n’est encore décidé à cet égard – mais le frère et la sœur s’accordent pour qu’Ipuwer se rende prochainement à Memnon ; sous couvert le cas échéant de présenter « ses » excuses à Linneke Wikkheiser… et peut-être de soulever devant elle l’hypothèse d’un conflit entre les deux personnages à la tête de la Maison Ptolémée ?
IV : NÉCROMANCIE SYMPATHIQUE
[IV-1 : Bermyl : « Lætitia Drescii »] Bermyl, obnubilé par cette idée d’une possible dissidence au sein des « ressuscités », décide de se rendre en personne, et seul, à « l’abattoir », qui fait également office de chambre mortuaire, où il avait perdu la trace de « Lætitia Drescii » et rencontré, en masse, plusieurs de ces morts qui ne l’étaient plus… Sur ses gardes, Bermyl s’assure qu’on ne le suit pas, mais ne constate par ailleurs aucune attention particulière à son égard, y compris parmi les ouvriers de l’abattoir.
[IV-2 : Bermyl : Khnem] Au dernier étage, où sont conservés les cadavres, Bermyl ne constate pas le moindre attroupement suspect, contrairement à sa dernière visite. Mais, alors qu’il déambule entre les tables où sont allongés les morts, l’un d’entre eux se relève soudainement, et lui dit, dans un grand sourire, qu’il l’attendait ! Son nom est Khnem…
[IV-3 : Bermyl : Khnem ; Namerta] Khnem est bien plus loquace que les morts précédemment rencontrés sur place par Bermyl – au point, en fait, qu’il n’est pas toujours évident de le suivre dans son discours volubile. Mais, en substance, il explique que Bermyl est « pris en considération » par leur « communauté » : en effet, Namerta semble l’apprécier tout particulièrement… Ce qui, précise plus ou moins malgré lui Khnem, n’est d’ailleurs pas sans provoquer quelque tension parmi les fidèles. Aussi Bermyl est-il simplement « surveillé », pour l’heure…
[IV-4 : Bermyl : Khnem ; le Vieux Radames] L’assassin, désireux de jauger l’efficacité de cette surveillance, demande à Khnem s’il sait où il se trouvait deux heures plus tôt. Et le mort, bonhomme, de répondre aussitôt : « Oui, chez le Vieux Radames… » Bermyl lui demande alors si la mort du Vieux Radames, ou peut-être sa résolution, aurait un rapport avec son intégration au sein de leur communauté, mais Khnem esquive la question : il redoute visiblement d’en avoir trop dit… et, de crainte de commettre d’autres faux pas, il se ferme complètement.
[IV-5 : Bermyl] Bermyl n’a plus qu’à prendre congé. Il rentre au Palais, perplexe… et ne peut s’empêcher d’imaginer, derrière chaque fenêtre ou presque, un macchabée qui surveille ses moindres faits et gestes !
V : SERIOUS GAME
[V-1 : Ipuwer : Labaris Set-en-isi, Ludwig Curtius, Mandanophis Darwishi] Après dîner, Ipuwer et son vieil ami Labaris se rendent dans un salon de détente du palais, où se trouvent déjà le maître d’armes Ludwig Curtius et le maître de cour Mandanophis Darwishi, occupés à siroter quelque breuvage alcoolisé.
[V-2 : Ipuwer : Labaris Set-en-isi] Mais Ipuwer et son ami ne sont pas là pour boire – ou pas seulement. Le jeune Set-en-isi avait esquissé devant le siridar-baron l’intérêt qu’il vouait à une nouvelle façon de jouer au chéops – en se basant sur des contraintes délibérément acceptées, portant sur les effectifs de départ comme sur leur capacité d’action, etc. Globalement, il s’agit donc de « jouer un rôle » : on ne gagne pas dans l’absolu, sur la base abstraite du jeu « normal », mais en fonction du « camp » incarné, qui a ses objectifs propres, de même qu’il a des méthodes propres, des atouts et des limitations divers et pas forcément équilibrés, etc.
[V-3 : Ipuwer : Labaris Set-en-isi] Par exemple, dit Labaris, à supposer qu’Ipuwer incarne, disons, la Maison Ptolémée, il bénéficierait d’un certain nombre de ressources d’ordre économique, ainsi que d’avantages technologiques se traduisant en jeu par de plus grandes options de déplacement ou d’action de ses pièces ; en contrepartie, celles-ci seraient assez peu nombreuses, et les plus « militaires » globalement un peu plus faibles que leurs contreparties dans d’autres « camps » mieux lotis à cet égard… Il s’agit de refléter l’état de la Maison Ptolémée, avec ses forces et ses faiblesses, et de même pour l’antagoniste.
[V-4 : Ipuwer : Labaris Set-en-isi] Labaris continue sur sa lancée : Ipuwer n’a qu’à jouer, comme de juste, la Maison Ptolémée… Quant à lui, eh bien, il n’a qu’à jouer « le pire ennemi des Ptolémée » ! Quel est-il donc ? Ipuwer ne répond pas… Mais il avance qu’un cas particulièrement absurde pourrait l’aider à comprendre les implications de cette nouvelle manière de jouer : par exemple, il pourrait lui-même jouer les Ptolémée, oui, et Labaris pourrait jouer… la Guilde ? Ce qui ne manque pas de faire sourire Labaris : la toute-puissante Guilde spatiale ! Que des atouts, aucun inconvénient : le cas est effectivement absurde, parce que personne ne pourrait l’emporter contre les Navigateurs…
[V-5 : Ipuwer : Labaris Set-en-isi] Ipuwer suggère alors une partie plus « raisonnable » (mais absurde quand même, bien sûr, ce n’est qu’un jeu !) : Labaris n’a qu’à jouer la Maison Wikkheiser. Forte partie, les Wikkheiser sont bien plus puissants que les Ptolémée, à peu de choses près sur tous les plans… Mais c’est déjà plus envisageable, et cela permet d’exposer plus concrètement les mécanismes du jeu – lequel devient ainsi plus limpide, à mesure que les deux joueurs, pesant les avantages et handicaps de chaque camp, se mettent d’accord sur le genre d’adaptation des règles de base qu’implique cette nouvelle manière de jouer.
[V-6 : Ipuwer : Labaris Set-en-isi] Mais, quand les deux amis se lancent enfin dans une partie, c’est en envisageant encore une autre hypothèse ludique : Ipuwer joue bien les Ptolémée, mais Labaris joue quant à lui une alliance entre les Maisons mineures Nahab et Arat. Après s’être mis d’accord sur les adaptations (Labaris prend d’abondantes notes, dans chaque hypothèse, pour « formaliser » quelque peu tout cela, et peut-être à terme publier ses propres règles), les deux joueurs, doués pour le chéops traditionnel, apprennent peu à peu les subtilités qu’implique cette variante – ils commettent bien des erreurs, mais s’en rendent compte ; ils sauront les éviter ultérieurement. Ipuwer trouve cette approche du jeu très instructive… C’est très amusant que de simuler ainsi des affrontements – aussi improbables voire absurdes soient-ils, bien sûr ! Ce n’est qu’un jeu…

/image%2F1385856%2F20160114%2Fob_cfb8b0_caligari.jpg)





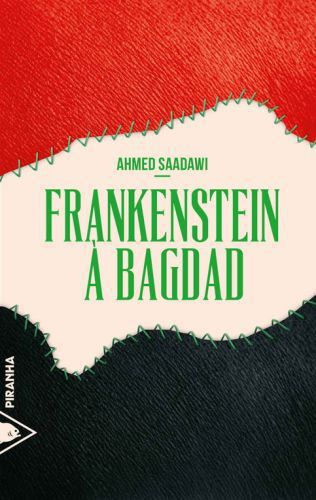

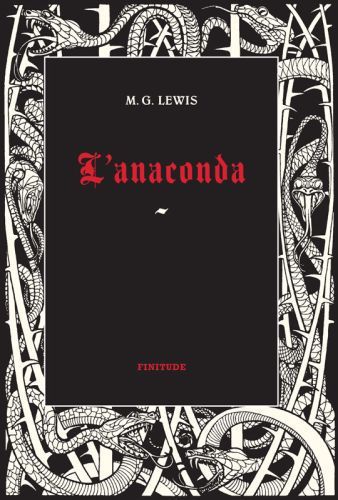

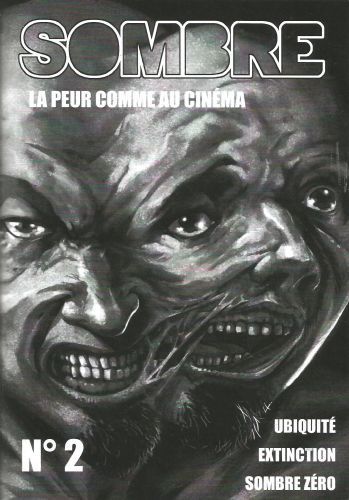


/image%2F1385856%2F20150204%2Fob_660a87_georges-abdaloff-croque-par-christell.jpg)