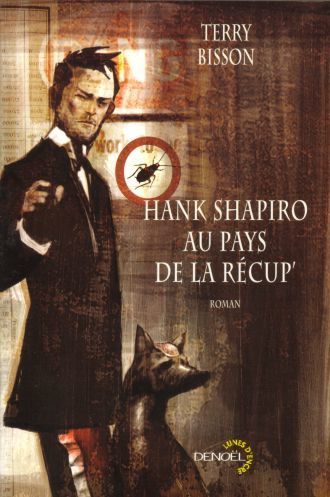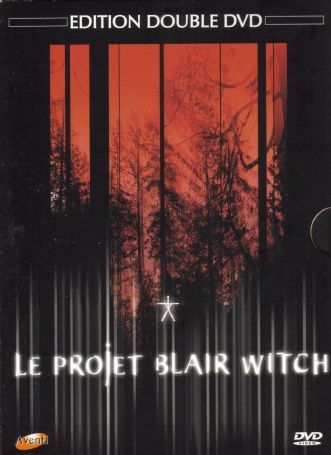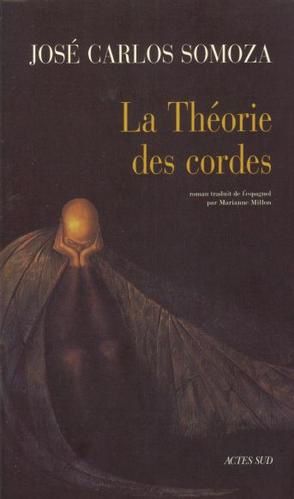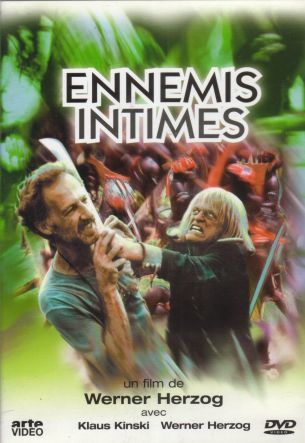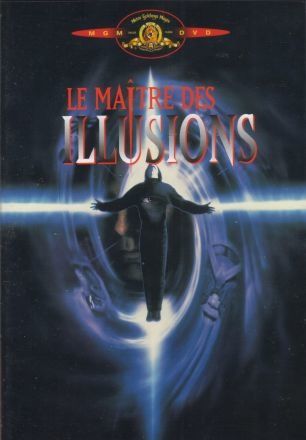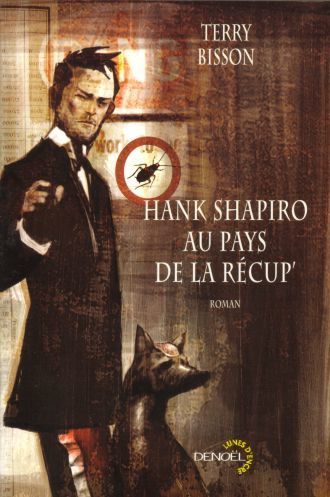
BISSON (Terry), Hank Shapiro au pays de la récup’, traduit de l’américain par Gilles Goulet, Paris, Denoël, coll. Lunes d’encre, [2001] 2003, 277 p.
Camarades artistes, ça peut plus durer. Le disque dur de l’humanité est saturé, il n’y a plus de mémoire libre. Et c’est dramatique pour les artistes, comme vous vous en rendez compte tous les jours. Comment placer un nouveau roman, aussi extraordinaire soit-il, si les gens continuent de lire Flaubert et Joyce ? A quoi bon s’échiner sur une toile sublime, si le quidam n’a que les noms de Monet et Picasso en tête ? De même pour la musique, si l’on en reste à Mozart et aux Beatles… Non, ça peut plus durer. Camarades artistes, il est temps d’agir.
Ca a dû commencer comme ça. On en est bientôt arrivé à des attentats – la destruction de toiles du musée d’Orsay dans un incendie criminel a donné le signal. Les Alexandrins (« pour l’incendie, pas pour la bibliothèque ») ont commencé à faire parler d’eux. Et, progressivement, leur vision des choses a gagné quelques célébrités, des critiques, des universitaires. Des hommes d’affaires, aussi. Et il y a eu enfin institutionnalisation, avec la création du Bureau des Arts et Divertissements et l’officialisation du système de la récup’.
Hank Shapiro, justement, est un agent du B.A.D., et plus précisément un « roi de la récup’ », comme on dit. Son boulot, exigeant beaucoup de diplomatie, consiste à se rendre chez les individus que lui désigne son ardoise électronique chaque matin, pour y récupérer des œuvres d’art « condamnées à mort » par les autorités (un système aussi équitable que possible, avec une certaine dose d’aléatoire pour qu’on ne puisse parler d’injustice) ; aujourd’hui, un livre de SF de Walter M. Miller Jr., une VHS d’un western avec Clint Eastwood (probablement égarée dans un vieux carton), un tableau de Rockwell (pas Norman, un autre), etc. Hank Shapiro fait son boulot consciencieusement, et, même s’il y a toujours de temps à autre un aigri inconscient pour se plaindre du système (« Sinatra est immortel ! »), ça ne lui pose pas vraiment de problème ; il faut bien faire quelque chose…
Un jour, il doit récupérer un 33 tours d’Hank Williams. Et la pochette l’interloque, lui rappelle de vieux souvenirs. Ca ne lui était jamais arrivé jusqu’alors, mais il est pris d’une fâcheuse envie d’écouter ce disque, et donc d’enfreindre la loi. Pour cela, il lui faut d’abord trouver un tourne-disques ; une documentaliste, Henry (pour Henrietta), l’aiguille vers Bob l’Indien, un contrebandier qui devrait être à même de satisfaire ses désirs. Et tout dégénère : une descente de police, une fusillade – Hank est blessé, et Bob l’Indien meurt. Pire que tout, si Hank récupère la pochette du Hank Williams, le vinyle, quant à lui, ne s’y trouve plus ; or il n’a toujours pas pu l’écouter, et il lui faut le récupérer avant la fin du mois s’il veut conserver son boulot. Et notre héros de s’embarquer ainsi pour un étrange périple à travers les Etats-Unis, vers l’Ouest, avec à ses côtés sa chienne cancéreuse Homer artificiellement maintenue en vie, un cafard espion mécanique amoureux, une Henry plus dépressive que jamais (il faut dire que cela fait huit ans et demi qu’elle est enceinte) et le cadavre de Bob l’Indien – ressuscité temporairement si besoin est – à la recherche de ce foutu disque, qui doit être quelque part entre les mains d’un des 76 autres Bob l’Indien, sans doute ; ah, et puis Henry veut retrouver Panama, aussi, un artiste alexandrin (mais de l’incendie, ou de la bibliothèque ?), le père de son enfant encore à naître. Bref, elle est loin, la petite vie tranquille du fonctionnaire Hank Shapiro…
Premier roman de Terry Bisson que je me tape. Ben j’espère que plein d’autres vont suivre. Je ne sais pas grand chose de l’auteur ; à vrai dire, j’ai lu ce roman un peu au pif, armé du Petit guide à trimballer de la S.F. étrangère de Jérôme Vincent et Eric Holstein (de chez ActuSf). Je cite : « Terry Bisson n’aime pas George Bush. Il n’aime pas non plus la peine de mort. Ni même l’esclavagisme, le racisme, l’ultra-libéralisme, l’intervention américaine en Irak… Et il le dit, fait assez rare pour un auteur américain. De quoi lui assurer une popularité immédiate auprès des éditeurs et des lecteurs français. D’autant plus que Terry Bisson a non seulement du talent mais aussi un humour féroce. De quoi faire rire et réfléchir. » Peux pas mieux dire.
Effectivement, c’est à la fois hilarant et pertinent. Hilarant parce que, il faut bien l’avouer, après un début classique évoquant énormément Fahrenheit 451, ça part vite en vrille, dans un délire total où tout est permis. D’où bien des personnages dingues et des situations farfelues qui ne manquent pas de faire exploser de rire le lecteur.
Mais pertinent aussi. Mine de rien, Terry Bisson, que ce soit dans les chapitres consacrés à Hank ou dans les digressions historiques et un brin didactiques qui les entrecoupent, soulève des questions fort intéressantes avec ce Hank Shapiro au pays de la récup’ (ou, si l’on préfère le titre original, The Pickup Artist). On ne peut s’empêcher, très vite, de voir au-delà du délire apparent pour s’interroger sur la situation de l’art dans notre société, et, plus encore, sur celle du marché de l’art. A l’heure où le téléchargement, légal ou pas, change progressivement la donne pour ce qui est de la commercialisation des produits artistiques, où le numérique évacue peu à peu le support matériel et où les médias jouent à fond la carte de l’éphémère, de la mode musicale au nom plus improbable encore que celui de la précédente six mois plus tôt (pratique fort courante du côté de la perfide Albion) à la star « à la carte et au vote » des innombrables émissions de real TV, on est bien en droit, effectivement, de se poser la question : où en est l’art ? Où va-t-il ? Qui peut prétendre au statut « d’immortel » ? Et la réponse à ces multiples questions ne saurait en définitive être aussi tranchée que l’on pourrait le croire au premier abord.
A vrai dire, l’univers décrit par Terry Bisson dans ce roman de 2001 tend à certains égards à devenir finalement assez concret : je me souviens, par exemple, de cet « artiste » qui, récemment, avait essayé de détruire « l’urinoir » de Duchamp à coup de masse ; au-delà de l’effet médiatique et du « concept » (pas forcément au-delà, d’ailleurs, maintenant que j’y pense…), ne peut-on pas comparer cette attitude à celle des premiers Alexandrins ou Eliminateurs – des artistes – incendiant le musée d’Orsay ? Face aux tentations réactionnaires de certains, selon lesquels rien ne saurait être intéressant aujourd’hui, et qui font dès lors l’éloge d’un classicisme extrémiste (« retournons à l’antique, ce sera un progrès »), on trouve à l’autre bord un excès tout aussi perfide dans une volonté illusoire de faire abstraction du passé (les Beatles, c’est de la merde ; la figuration, c’est de la merde ; la littérature du XIXe, c’est de la merde, etc.) en prônant la nouveauté à n’importe quel prix… Transfigurée par la culture de masse et le rôle déterminant du numérique et d’Internet, c’est finalement l’éternelle querelle des anciens et des modernes qui se poursuit, et l’extrémisme, en la matière, peut conduire aux actions les plus absurdes – pas forcément la destruction « physique » des œuvres (quoique…), mais on n’en est pas toujours bien loin. Les incendiaires des deux bords sont parmi nous.
Rien à voir, ceci dit, avec les pompiers pyromanes du classique de Ray Bradbury. Le monde décrit par Terry Bisson ne donne pas, dans l’ensemble – même si la récupération empiète nécessairement sur les libertés individuelles –, l’impression d’un cauchemar totalitaire. Non, c’est bien notre société démocratique qui génère ces institutions délirantes ; derrière, il y a bien des réunions, des délibérations, la constitution de règles précises, aussi équitables et non arbitraires que possible (beau challenge !). En façade, il y a une absurdité bureaucratique toute kafkaïenne (oh le joli cliché !), qui fait sourire mais n’en est pas moins profondément tragique, et que nous connaissons à vrai dire déjà pas mal : voyez le pauvre Shapiro confronté aux répondeur automatiques, quand tout ce qu’il souhaite, c’est prendre des nouvelles de sa chienne à l’agonie… Et, tout derrière, il y a un autre pouvoir, sans doute le vrai pouvoir. L’homme d’affaires, « M. Bill » (avec son empire numérique, tiens tiens), n’est pas le simple observateur qu’il prétend être ; la récupération le sert ; comme elle sert des célébrités sur le retour, qui ne désirent rien d’autre qu’un dernier moment de gloire, prolonger de quelques minutes leur quart-d’heure warholien. La dissimulation, l’hypocrisie, la mauvaise foi, la naïveté, l’égoïsme parasitent nécessairement les intentions affichées, et les révolutionnaires, parfois, commencent un peu tard à se poser des questions, et à ne plus se contenter de répéter à longueur de manifestations des slogans préfabriqués (par qui, d’ailleurs ?) ; rien d’étonnant, dès lors, à ce que des Alexandrins de l’incendie se transforment en Alexandrins de la bibliothèque ; rien d’étonnant, non plus, à ce que les plus extrémistes des terroristes clamant haut et fort leur attachement à la subversion, finissent par devenir les plus efficaces et inconscients des auxiliaires des autorités…
La mesquinerie est à vrai dire omniprésente, le refus de faire face à une vérité gênante suscitant des échappatoires ridicules, et l'on retrouve ici encore un désir factice d’immortalité hautement problématique. Hank, ainsi, refuse de voir sa chienne mourir : le CupperTM la maintiendra donc en vie, même si elle n’est plus tout à fait la même chienne qu’avant, surtout quand elle se met à parler… Henry veut toujours croire que Panama reviendra auprès d'elle : aussi se gave-t-elle de HalfLifeTM pour que leur bébé reste bien tranquille dans son ventre. Depuis plus de huit ans. Le même HalfLifeTM peut donner une illusion d’immortalité, ainsi, dans un sens, que l’improbable LastRitesTM, originellement conçu pour ressusciter temporairement les morts afin d’en obtenir l’indispensable dernière confession ; une drogue à accoutumance, Bob l’Indien en fait bientôt l’expérience, lui qui n’est plus totalement mort que la plupart du temps… Si tout ça se vend et engendre des bénéfices, c’est que ça doit être utile, non ? Même si aucun des personnages du roman n’utilise ces produits de la manière initialement prévue…
Bref. Un roman riche, fou, drôle et intelligent. Court et rythmé. Un vrai petit bonheur, qu’on aurait tort de refuser.