
EWERS (Hanns Heinz), Edgar Allan Poe, suivi de « The Raven » d’Edgar Allan Poe, [Edgar Allan Poe], traduit de l’allemand par Élisabeth Willenz, traduction allemande [de « The Raven »] de Hanns Heinz Ewers, traduction française de William L. Hughes, Cadillon, Le Visage Vert, coll. Essai, [1905, 1991] 2009, 94 p.
Bon, je ne m’en suis jamais caché, hein : la lecture d’Edgar Allan Poe a tendance à m’ennuyer un brin. Cela ne m’empêche certes pas de reconnaître son importance dans l’histoire des lettres et plus particulièrement de la littérature fantastique, mais le fait est qu’il n’a que rarement suscité mon enthousiasme débridé. Par contre, nombre de mes auteurs fétiches – au premier rang desquels H.P. Lovecraft, bien sûr – l’ont bel et bien placé au pinacle, sans doute à raison ; et je suis curieux, du coup, de lire ce que ces auteurs ont pu en penser.
Il est vrai, cependant, que je ne puis prétendre être connaisseur de l’œuvre de Hanns Heinz Ewers. Je crois juste l’avoir lu au détour d’un ou deux numéros du Visage Vert. J’étais néanmoins curieux de cette brève publication (aux éditions du Visage Vert, donc…), d’autant plus que l’on m’avait assuré qu’un béotien tel que moi, qui n’éprouve guère d’admiration pour Edgar Allan Poe, y trouverait malgré tout son compte. Et je peux bien d’ores et déjà le dire : c’est tout à fait vrai. Malgré mes préjugés concernant le sujet, c’est avec un grand plaisir que j’ai lu ce bref essai de critique littéraire à la plume tout à fait délicieuse (et merveilleusement rendue, comme de juste, par l’excellente Élisabeth Willenz). Et si je ne peux toujours pas prétendre, au sortir de cette lecture, partager l’enthousiasme de l’auteur pour son objet d’étude, j’en ai tout de même fortement apprécié l’analyse, et je ne peux que m’avouer vaincu par l’édition qui complète le volume du célèbre « Corbeau », en anglais (inimitable…), en allemand par Ewers (là, je suis bien incapable d’apporter le moindre jugement) et enfin en français par William L. Hughes (bof).
Il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce bref essai qui prend prétexte d’une déambulation dans l’Alhambra pour dresser le portrait littéraire d’Edgar Allan Poe. Trop, sans doute, pour ce compte rendu, avec le risque de sombrer dans la paraphrase, ce qui serait pour le coup particulièrement absurde. Je n’en relèverai donc que quelques points saillants, qui m’ont particulièrement interpellé (en notant cependant déjà que les quelques éclairages biographiques apportés par Ewers, concernant le grand amour de Poe, m’ont fait mieux comprendre, moi, l’ignorant, l’importance que j’avais déjà relevée sans en connaître la raison du thème de la « morte-vivante » dans l’œuvre du poète…).
L’essai s’ouvre largement sur un cri de colère d’Ewers à l’encontre des biographes de Poe, notamment Grimswold et Ingram, et j’avoue avoir trouvé cette dimension tout à fait intéressante, et, hélas, toujours actuelle. Ewers s’insurge en effet contre la tendance à juger du génie de son sujet en fonction… de sa moralité, et plus précisément de sa consommation d’alcool. Ici, j’ai envie de procéder à une longue citation :
« Il buvait. – Il ne buvait pas ! Voilà comment les Anglais se querellent au sujet de leurs poètes ! laissant Milton mourir de faim, volant à Shakespeare l'œuvre de toute une vie, fourrageant de leurs doigts crochus dans les histoires de famille de Byron et de Shelley, répandant leur venin sur Rossetti et Swinburne, condamnant Wilde au bagne et montrant du doigt Charles Lamb et Poe... parce qu'ils buvaient !
« Je suis finalement heureux d'être allemand ! Nos grands hommes, eux, avaient le droit d'être... immoraux. « Immoraux », c'est-à-dire pas exactement moraux au sens où l'entendent les bons citoyens et les curés. Lorsque l'Allemand dit : « Goethe fut notre plus grand poète », il sait bien que sa conduite ne fut pas absolument irréprochable, mais il ne lui en tient pas vraiment rigueur. L'Anglais, quant à lui, affirme : « Byron était immoral, par conséquent ce n'était pas un grand poète. » Il n'y a qu'en Angleterre que le mot de Kingsley, cet abject ratichon moralisateur, sur Heine pouvait devenir proverbial : « Ne parlez pas de lui... cet homme était mauvais ! »
« Lorsqu'il n'y a cependant plus d'autre issue, lorsque tous les peuples alentour célèbrent et aiment ces poètes anglais « immoraux », l'Anglais se voit bien contraint d'en parler à son tour et alors... il ment. Loin de renoncer à son hypocrisie, le voici qui proclame : « De nouvelles investigations ont montré que cet homme n'était absolument pas immoral, bien au contraire : il était de la plus haute moralité, son âme n'était que pureté et innocence ! » Et c'est ainsi que ces fourbes d'Anglais ont racheté l'honneur de Byron. Il ne nous faudra plus attendre très longtemps avant que Saül Wilde ne se transforme en saint Paul ! Ainsi, pour Poe, la relève d'un Grimswold fut assurée par celle d'un Ingram : « Mais non, il ne buvait absolument pas ! »
« À présent, les Anglais peuvent reconnaître Edgar Allan Poe, dès lors qu'on lui a officiellement décerné un certificat de bonne moralité ! »
Au-delà de l’attaque anti-anglaise sans doute bien de son temps, il me semble qu’il y a là quelque chose de très juste, que l’on a hélas pu constater dans bien des domaines ; jusqu’à Sade que l’on cherche ainsi à « réhabiliter » ! Et je pourrais bien sûr revenir ici sur Lovecraft…
Mais je n’en tire pas les mêmes conclusions qu’Ewers : en effet, s’il ne fait en aucun cas l’apologie de l’alcoolisme comme vecteur authentique de création artistique, s’il ne dit pas que Poe était un génie parce qu’il buvait, ce qui serait tout aussi absurde que les accusations et dénégations qu’il stigmatise à bon droit, il n’en a pas moins tendance à considérer que Poe n’était pas alcoolique, disons, « dans le vide », mais qu’il y avait bien une corrélation, sinon une causalité directe, entre sa consommation d’alcool et sa production littéraire. C’est à mon sens une erreur, un héritage des « paradis artificiels » malgré tout ; à mon sens, l’alcoolisme de Poe est une donnée extérieure, et ce n’est que rarement et sans doute indirectement que l’on peut établir un lien entre cet alcoolisme et l’art du poète. Mais Ewers évoquait Wilde, à juste titre, et je ne me lasse pas de répéter cet aphorisme issu de la préface de Dorian Gray : « Un livre n’est point moral ou immoral. Il est bien ou mal écrit. C’est tout. » Et c’est bien entendu toujours aussi vrai aujourd’hui.
Il faut dire que, chez Ewers, cette analyse de l’alcoolisme de Poe débouche sur une sorte de théorie littéraire. Trois points me paraissent importants : tout d’abord, pour Ewers, la création artistique est une souffrance, voire une torture, et il s’insurge contre ceux qui prétendent que l’on peut créer quelque chose de valable sans douleur… Ensuite, cela débouche sur un certain « élitisme », et Ewers ne mâche pas ses mots à l’encontre des « imposteurs » qui singent les grands poètes, et de ceux qui « consomment » leurs œuvres, tels ces touristes dans l’Alhambra qui ont avec eux leurs best-sellers du temps et le consultent comme un Baedeker. Enfin, on aboutit à un idéalisme forcené :
« L'action n'est rien – la pensée est tout. La réalité est laide et rien ne saurait justifier l'existence de la laideur. Les rêves, eux, sont beaux, et ils sont vrais car ils sont beaux.
« Voilà pourquoi je crois aux rêves comme à l'unique réalité. »
Mazette. C’est bourrin, tout de même. Passablement provocateur, sans doute, peut-être plus encore à l’époque qu’aujourd’hui, quand bien même nous vivons dans une ère tragique où les mots de « réalisme » et de « matérialisme » se sont vus accoler les connotations les plus vulgaires (pour ne pas dire les plus « cyniques », autre terme dévoyé…). En tant que tel, ce n’est sans doute pas à prendre totalement au sérieux, et cela m’a rappelé, pour le coup, les aphorismes de Wilde dans l’immortelle préface citée plus haut.
Quoi qu’il en soit, ce texte, aussi contestable soit-il – et honnêtement je ne vois personne capable de prétendre y adhérer à 100 % –, est d’une lecture tout à fait intéressante. Et puis, il faut bien le reconnaître, la plume est là, qui mérite à elle seule le détour, aussi belle qu’agressive, délicate dans ses admirations et d’une violence extrême dans ses détestations.
L’essai d’Ewers, ainsi, remplit sans doute sa mission : il séduit et interroge, au-delà des affinités que l’on peut ressentir pour la vie (hors-sujet ?) et l’œuvre de Poe. Si l’on y ajoute l’époustouflant « Corbeau » qui complète le volume, et les superbes et nombreuses illustrations qui émaillent ce petit ouvrage, on ne peut que se féliciter de cette publication tout à fait intéressante, voire admirable ; oui, même moi, le vilain hérétique, le temps de cette lecture, j’ai eu le sentiment, sinon de comprendre Poe, du moins de comprendre l’enthousiasme qu’il a pu susciter ; et mine de rien, ce n’était pas si évident que ça (et Baudelaire n’y était jamais parvenu en ce qui me concerne, Lovecraft tout juste)…


/image%2F1385856%2F20160114%2Fob_cfb8b0_caligari.jpg)










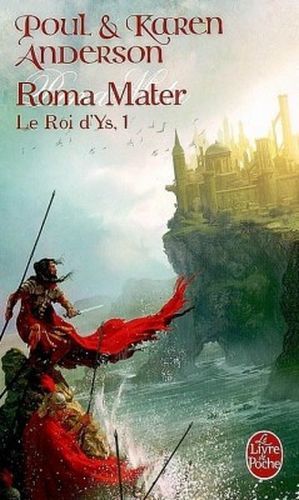

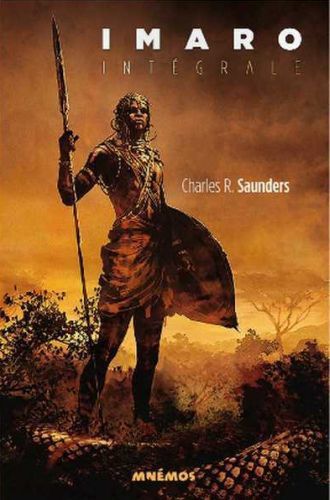





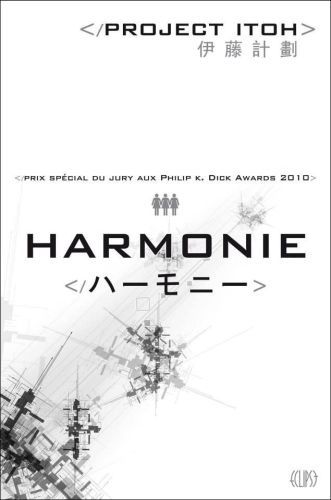

/image%2F1385856%2F20150204%2Fob_660a87_georges-abdaloff-croque-par-christell.jpg)