"Six Photos noircies", de Jonathan Wable

WABLE (Jonathan), Six Photos noircies, [Paris], Attila, 2013, 193 p.
C’est un fait : je suis influençable. Le concert de critiques élogieuses, vantant l’originalité du projet et la maestria du style, et brandissant en guise de figures tutélaires d’immenses noms de la littérature en général et du fantastique en particulier (Borges en tête), le fait qu’Attila ne m’ait jamais déçu jusqu’alors, quelques avis autorisés, enfin, m’affirmant sans l’ombre d’un doute que ce livre était fait pour moi, tout cela justifiait, j’imagine, ma lecture de ces Six Photos noircies, premier « roman » (?) du jeune Jonathan Wable.
Je suis influençable, oui ; mais il y a des limites. Et après avoir longuement peiné sur ces moins de 200 pages, je ne peux que m’inscrire en faux : non, ce n’est pas spécialement original (mais bon, ça, c’est pas dramatique) ; non, le style n’a franchement rien d’exceptionnel (et souffre même à mon sens de quelques fâcheuses maladresses…) ; les influences ont bon dos, mais ne justifient rien ; et, oui, Attila, pour une fois, m’a déçu. Bilan : non, désolé, ô avis autorisés, mais ce livre n’était très probablement pas pour moi… Je n’irais peut-être pas jusqu’à le qualifier de « mauvais » dans l’absolu, mais voilà : moi, je, me, myself, I, je me suis fait chier comme un rat mort à la lecture de ces Six Photos noircies ; et même davantage, sans doute, puisque ledit rat, étant mort, n’a pas à s’infliger ce genre de pensum.
‘tain, j’ai niqué le suspense, là…
Bon. Essayons quand même de dire quelques mots de ce livre, à mi-chemin entre roman et recueil de nouvelles, dans la mesure où il est constitué de vingt tableaux (je crois avoir lu ici ou là le terme « vignette », qui me paraît très pertinent) largement indépendants les uns des autres, quand bien même on y retrouve presque systématiquement deux personnages, le biologiste Valente Pacciatore (qui prend toujours six photos de ce qui l’intrigue, donc) et le médecin Tirenzio Perochiosa, confrontés à chaque fois à des phénomènes étranges, et régulièrement funèbres, aux quatre coins du monde (chaque vignette est désignée par un toponyme), à une époque que l’on supposera être la fin du XIXe siècle. Nos deux « héros » – bien grand mot pour des figures aussi vides, pardon, « abstraites » – observent ainsi (ils ne font guère plus) créatures bizarres et morts glauques dans une succession d’images tenant sans doute plus du surréalisme et du grotesque que du fantastique au sens courant.
Il y a quelque chose de très visuel dans Six Photos noircies – mais après tout le titre est en lui-même assez éloquent à cet égard. C’est là la force de ce « roman », j’imagine (et cela n’a sans doute rien d’étonnant, les premiers textes le composant ayant été rédigés pour accompagner des peintures d’Hélène Delprat). Je l’admets : oui, il se dégage parfois de ces pages une certaine beauté macabre pas désagréable, évoquant finalement plus des poèmes en prose qu’autre chose.
Mais je n’ai pas saisi l’intérêt de la chose. Ce « roman » décousu au possible, où le récit est réduit à peau de chagrin, passe d’image en image, ou plus exactement de photo en photo, comme un antique projecteur de diapositives (on est très loin du cinéma). Alors, oui, de temps en temps, c’est joli… Mais, je sais pas vous, moi j’ai toujours trouvé ça chiant, les sessions diapos… Et c’est bien l’effet que Six Photos noircies m’a fait.
Ce qui aurait pu sauver à mes yeux ce premier livre, en accord avec le projet global, c’est évidemment le style. Et j’ai entendu et lu beaucoup de belles et bonnes choses à propos de la plume de Jonathan Wable. Ce qui dépasse franchement ma compréhension (mais voyez l’adresse de ce blog). Non, je ne comprends pas l’enthousiasme affiché de nombreux critiques pour l’écriture de Six Photos noircies ; pour ma part, elle m’a paru bien terne, au mieux : parfois balourde, à vrai dire… et peut-être aussi un tantinet prétentieuse, ou disons m’as-tu-vu.
Impression qui s’applique à l’ensemble du « roman », au fond comme à la forme. À ce propos, le « résumé » auquel je me suis livré plus haut ne doit pas vous tromper : Pacciatore et Perochiosa ont beau faire dans l’investigation de l’étrange, ils n’ont guère en commun avec les plus fameux enquêteurs occultes de la littérature fantastique (a fortiori celle des pulps). Ils n’ont à vrai dire ni assez d’âme ni assez de corps pour évoquer qui que ce soit. Je n’ai rien, dans l’absolu, contre la littérature en creux, mais là, j’ai tout de même le sentiment que Jonathan Wable a poussé la chose un peu trop loin…
Aussi n’ai-je au final pas grand-chose à dire de positif quant à ce premier roman survendu, et qui n’était décidément pas pour moi. Non, je ne comprends pas l’enthousiasme pour ce truc plein de vide, qui abuse d’effets de manche pour rien. Pire : je me suis emmerdé comme c’est pas permis à la lecture de ces Six Photos noircies, que je n’ai poussée jusqu’au bout qu’en raison de mon masochisme littéraire.
Mais ayé, fini ! Je vais enfin pouvoir passer à autre chose !
Ouf.

/image%2F1385856%2F20160114%2Fob_cfb8b0_caligari.jpg)







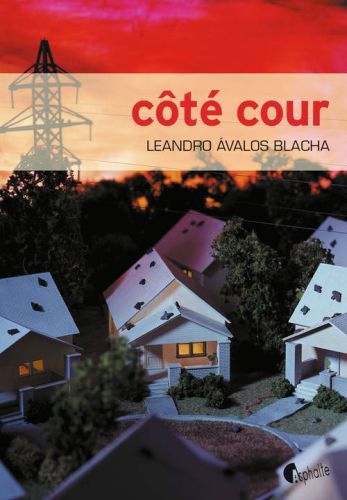

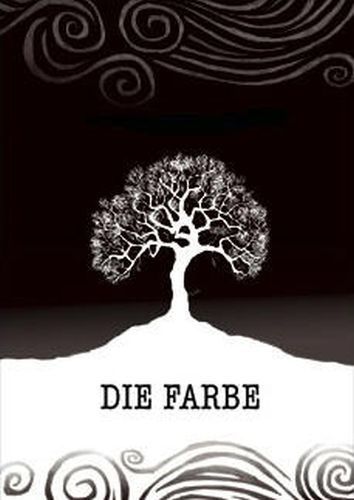
















/image%2F1385856%2F20150204%2Fob_660a87_georges-abdaloff-croque-par-christell.jpg)