JOSHI (S.T.), (ed.), A Weird Writer in Our Midst : Early Criticism of H.P. Lovecraft, New York, NY, Hippocampus Press, 2010, 263 p.
Tiens, un petit peu de critique lovecraftienne, ça faisait longtemps... Avec cet étonnant volume, coordonné par l’inévitable ou presque S.T. Joshi, qui constitue une somme de documents à même de ravir l’amateur ou un peu plus que ça puisque affinités – le revers de la médaille étant que, plus que jamais, je crains que tout cela ne laisse sur le carreau bon nombre d'autres lecteurs, même portés sur Lovecraft et les lovecrafteries…
LA PART DES MYTHES
La légende s’est tôt emparée de la figure de Lovecraft autant que de son œuvre. Enfin, tôt… Avec un bémol de taille : après la mort du bonhomme… Mais c’est presque un lieu commun.
L’objet de la présente compilation est de se replonger dans la réception peu ou prou immédiate de Lovecraft (pour l'essentiel dans les années 1930 et 1940) – et, le cas échéant, de tordre le coup à certains mythes, mais plus encore de voir comment d’autres mythes ont pu être mis en place, et, régulièrement, perdurer de manière inattendue. Des exemples ? Le « Mythe de Cthulhu », bien sûr (voyez notamment ici, ici, et ici), fondé sur la « black magic quote », que j’ai déjà eu maintes fois l’occasion d’évoquer – merci August Derleth, surtout ; l’idée du « Reclus de Providence », aussi, forcément – au point où il est difficile de revenir à la source de cette imposture (même si, à vrai dire, Lovecraft lui-même n'y est pas pour rien...) ; ou encore l’image de cet homme dont l’œuvre la plus aboutie serait sa propre vie – selon la formule de Vincent Starrett, très vite systématique !
Parallèlement, certaines idées reçues sont sans doute à tordre – concernant par exemple la réception de l’œuvre dans les pulps : j'ai été tout particulièrement intéressé, ici, par la partie centrée sur les courriers des lecteurs de Weird Tales (surtout) et Astounding Stories. Mais c’est sans doute dans la suite que les éléments les plus étonnants sont à relever – à partir des compilations de Lovecraft effectuées par August Derleth et Donald Wandrei après la mort de l’auteur, sous l’étiquette spécialement créée dans cette optique des éditions Arkham House : en ressort une étonnante diversité dans l’accueil – où les fans de la première heure peuvent à l’occasion se montrer plus sévères que ceux de la génération suivante, où la critique académique ou dans la presse la plus prestigieuse n’est pas aussi unilatéralement hostile qu’on le dit souvent, ce genre de choses… Mais il est vrai que ce lectorat « secondaire », gobant sans le moindre recul tout ce que Derleth et quelques autres pouvaient prétendre concernant la vie et l’œuvre de Lovecraft, a eu sa part, essentielle, dans le colportage des mythes dès lors systématiquement rapportés jusqu’à ce que la nouvelle critique lovecraftienne fasse un peu le ménage dans les années 1970…
Il faut ici préciser quelque chose – qui m’a paru un peu regrettable : cette compilation ne prétend pas à l’exhaustivité, ayant surtout rassemblé des documents, sinon oubliés, du moins rarement ou jamais repris par la suite. Du coup, des articles essentiels manquent à l’appel, car jugés trop « connus » – et c’est surtout le cas pour la cruelle recension d’Edmund Wilson, « Tales of the Marvellous and the Ridiculous » (New Yorker, 24 novembre 1945), qui est en quelque sorte le mètre-étalon de la critique « légitime » hostile à Lovecraft ; on s’y réfère d’ailleurs à l’occasion… Bizarrement, cette raison ne semble pas avoir autrement affecté Joshi pour un certain nombre de textes également connus, voire davantage encore – ainsi, sauf erreur, plusieurs articles de Derleth. Il est vrai que, si ces articles avaient fait défaut, le caractère lacunaire de l’ouvrage aurait été autrement frappant, et, à bien des égards, il aurait été incompréhensible ; mais, tout de même, l’article de Wilson aurait à mes yeux tout autant eu sa place ici…
L’idée est donc plutôt de mettre à la disposition des textes généralement moins connus – mais, avouons-le, d’un intérêt intrinsèque régulièrement limité. Nombre de ces articles ne valent en effet rien pour eux-mêmes – nombreux sont même ceux qui s’avèrent complètement à côté de la plaque, ou ridicules pour quelque autre raison… Leur intérêt réside, a posteriori, dans la représentation de Lovecraft qu’ils contribuent à générer puis entretenir – et c’est à ce titre-là que leurs nombreuses approximations ou même inexactitudes se révèlent enrichissantes, là où certains jugements à l’emporte-pièce, dans un sens ou dans l’autre, figurent de précieux témoignages d’une histoire littéraire sans doute plus complexe que ce que l’on est souvent porté à croire.
Les textes ici rassemblés sont de format variable, allant de quelques lignes à peine pour les extraits du courrier des lecteurs de Weird Tales ou Astounding Stories, à la dizaine de pages pour les articles les plus bavards (bavards, oui : en effet, ce n’est pas parce qu’ils sont plus longs qu’ils sont pour autant plus pertinents, et c’est même régulièrement le contraire – médite, graphomane Nébal, médite !). Dès lors, il m’est bien évidemment impossible de décortiquer le recueil pièce par pièce – ouf. Vous l'échappez belle, hein ?
Avançons tout de même quelques éléments, prélevés çà et là, qui, à défaut de rendre parfaitement compte de l’ouvrage, donneront je l’espère une idée de ce que l’on peut en retirer.
SOUVENIRS DE LOVECRAFT
La compilation rassemble ces (très) divers textes sous cinq étiquettes générales – dont la distinction peut parfois être limite spécieuse, sur le tard du moins.
La première de ces étiquettes porte sur les « souvenirs » concernant la personne même de Lovecraft – c’est, en tant que tel, sans doute la partie du recueil la moins enthousiasmante, toute empathie mise à part dans ces témoignages régulièrement émus sinon émouvants. J’ai tendance à croire qu’ils ne font véritablement sens qu’à la condition d’envisager ensuite les développements qu’ils susciteront éventuellement, soit qu’il s’agisse de reprises sans autre vérification, soit qu’il s’agisse, le cas échéant, d’en prendre le contrepied.
À la limite, j’imagine que l’on peut y relever avant tout que certains de ces témoignages – déjà ! – sont plutôt suspects : dans ce sens, ils témoignent, ainsi que certains articles plus orientés vers la critique qui paraîtront dans la foulée des recueils d’Arkham House, de ce que le « mythe » Lovecraft nait en même temps que se développe un bien improbable « culte » pour son œuvre.
Dans cette optique, les témoignages hautement suspects de deux dames de la même famille, Muriel E. Eddy, l’épouse de C.M. Eddy, Jr. (qui avait fréquenté Lovecraft et lui avait soumis au moins quatre textes à « révision », voyez ici et ici, et qui, sauf erreur, devait également travailler avec le maître sur l'essai The Cancer of Superstition, commande de Houdini restée inachevée du fait de la mort du prestidigitateur), et leur fille Ruth M. Eddy, sont peut-être les plus intéressants, paradoxalement ou pas – le dernier tient même de la nouvelle, à certains égards, entendre par là « fantasme »…
LA CRITIQUE DU VIVANT DE LOVECRAFT
La deuxième partie porte sur la critique du vivant de Lovecraft – hors simples mentions dans le courrier des lecteurs de tel ou tel pulp, ça, on y reviendra juste après. Il n’y a pas forcément grand-chose, en fait… Mais c’est sans doute l’occasion de repérer les noms de quelques camarades, que l’amateur aura déjà notés dans les biographies de Lovecraft ou dans sa correspondance – même si, de ceux-là, seul Frank Belknap Long a eu un semblant de postérité (devant toutefois beaucoup à Lovecraft, et c'est peu dire).
On notera que le premier article critique portant sur Lovecraft, dû à Reinhart Kleiner et datant de 1919, porte sur la poésie de l’auteur – comme de juste.
La fiction, c’est, plus ou moins dans la foulée, W. Paul Cook qui s’en charge – et pour cause là encore : ledit Cook a été pour beaucoup dans la décision de Lovecraft de se remettre à écrire de la fiction, avec « Dagon », « The Tomb », etc. Pour la forme, je relève d’ores et déjà que ce fan de la première heure, qui a donc eu, qu’on s’en souvienne ou pas, une importance cruciale dans l’orientation de l’œuvre lovecraftienne et donc dans sa postérité, sera par la suite un des premiers à rejeter la tendance rampante au « culte » lovecraftien (c’est son expression), et notamment les publications d’Arkham House – même les toutes premières ! –, car elles ne s’embarrassaient pas suffisamment à son goût de trier le bon grain de l’ivraie…
Pas grand-chose de plus à relever ici – même s’il y a quelque chose d’un peu visionnaire, le cas échéant, dans l’article de Vrest Orton « A Weird Writer is in Our Midst », qui donne du coup son titre à ce recueil. Le dernier article de cette section, « What Makes a Story Click ? », signé J. Randle Luten, est à vrai dire une bonne occasion de ricaner – et, pour ceux qui en douteraient, l’occasion de vérifier que l’on n’a certes pas attendu l’émergence de la blogosphère pour pondre des articles « critiques » parfaitement ineptes ainsi que d’une étonnante prétention…
COURRIERS DE LECTEURS
Suit une longue partie consacrée aux réactions de lecteurs, dans les colonnes mêmes de leurs revues de prédilection (du vivant de Lovecraft, mais aussi après, du fait des republications régulières) ; sans surprise, l’essentiel de ces lettres provient de « The Eyrie », la rubrique du courrier des lecteurs de Weird Tales – avec quelques compléments, bien moins nombreux, dans Astounding Stories. Cette partie est des plus instructive et enrichissante, de manière globale.
Elle est aussi, disons-le, l’occasion de voir les effets d’un éventuel copinage, qui pouvait parfois passer au-dessus de la tête des lecteurs lambda du temps, j’imagine… En tout cas, nombreux parmi ceux qui ont fait part de leur enthousiasme dans « The Eyrie » sont les lecteurs ou éventuellement auteurs avec lesquels Lovecraft était en correspondance… ou qui deviendraient du coup bien vite de ses correspondants (un exemple en particulier : Robert E. Howard – j’ai eu l’occasion d’en causer ailleurs). Notez que je ne réfute en rien la sincérité de ces témoignages ! Mais ils sont parfois amusants, pris avec un certain recul (et pas uniquement en ce qui concerne le seul Lovecraft, d’ailleurs : Henry Kuttner qui dit bien aimer Lovecraft, mais préférer quand même C.L. Moore, c’est assez mignon…). Et ils témoignent, sans vraie surprise, de ce que le fandom en gestation avait déjà des traits de grande famille – ou de microcosme, je ne sais quelle expression est la plus appropriée…
En tout cas, la majeure partie, et de loin, de ces retours de lecteurs sont éminemment positifs : même quand Farnsworth Wright s’est mis à rejeter texte sur texte de Lovecraft, les échos favorables parmi les lecteurs demeuraient – appelant aussi bien à la publication de nouveaux textes qu’à la reprise d’autres plus anciens mais jugés parmi les meilleurs jamais publiés par le pulp ; et sans doute à bon droit ? Ça n’a rien d’une évidence – mais le « culte » ultérieur avait ici quelques présages et, même si Lovecraft n’avait pas alors la popularité d’un Seabury Quinn, par exemple, il semblait néanmoins considéré comme un des plus brillants auteurs de la revue, et peut-être même le premier d’entre eux. Bémol éventuel : je ne sais pas à quel point la compilation par S.T. Joshi est exhaustive ou pas… Il peut donc y avoir un (sacré) biais.
En tout cas, le contraste est marquant, qui oppose le courrier des lecteurs de Weird Tales à celui d’Astounding Stories – et qui relève en partie d’une querelle de chapelles hélas appelée à perdurer dans le petit monde des littératures de l’imaginaire, opposant fantasy/fantastique et science-fiction. Et là aussi, je redoutais un biais – du fait de la présentation à vue de nez partisane qu’en livre S.T. Joshi dans son introduction : il oppose en effet d’emblée le courrier des lecteurs de Weird Tales, globalement de bonne tenue, ou tolérable, et celui d’Astounding Stories, largement plus « pauvre »… Connaissant les affinités globales d’un Joshi, je supposais là aussi un biais ; mais, pour le coup (est-ce le fait de sa sélection, encore une fois ?), à la lecture des extraits ici repris, on ne peut que lui donner raison ; et si les lecteurs de Weird Tales n’étaient peut-être pas toujours très regardants, un certain nombre de ceux d’Astounding Stories se montrent tristement bornés, et en même temps sans doute bien moins exigeants encore en termes de qualité littéraire (ce qui à vrai dire ressort de la rédaction même de leurs lettres)… et, d’un point de vue critique, ils tendent bien davantage à se contenter d’un lapidaire « c’est bien » ou « c’est pas bien », ce dernier étant souvent accolé à un tout aussi têtu « ce n’est pas de la science-fiction » (rappelons que les textes en cause sont At the Mountains of Madness – à noter qu’une lettre de « The Eyrie », je ne me souviens plus de son auteur, appelait l’air de rien, ou plutôt via des allusions cryptiques, Farnsworth Wright à publier ce texte qu’il avait refusé… – et « The Shadow Out of Time ») ; par ailleurs, on discute au moins autant les illustrations que les textes...
Ceci étant, il ne faut pas généraliser ce constat – et le courrier d’Astounding Stories, quand il parvient à s’élever au-dessus des banalités coutumières, est peut-être plus enrichissant ici, dans la mesure où il oppose, et parfois vertement, admirateurs et détracteurs de Lovecraft, ou du moins des textes science-fictifs de Lovecraft. Si « The Eyrie » était peu ou prou unanime (dans les courriers « critiques », je ne relève guère que celui de cet amateur de « ghost stories » expliquant que les nouvelles de Lovecraft ne sont pas de bonnes « ghost stories », parce qu’elles rompent avec la tradition du genre – eh bien, comment dire…), la rubrique correspondante d’Astounding Stories est autrement plus clivante et même sanguine – et, en faisant la part des choses, on y trouve des points soulevés assez intéressants, dans les deux camps d’ailleurs.
Une note pour le principe, aussi : j’ai été surpris de voir revenir régulièrement, dans Astounding Stories, chez les défenseurs du texte, un appel du pied pour que Lovecraft écrive une suite à At the Mountains of Madness, portant sur l’expédition Starkweather-Moore… Auraient-ils apprécié Par-delà les Montagnes Hallucinées ?
LA CRITIQUE AU SEIN DU FANDOM
La quatrième partie porte sur la critique de Lovecraft au sein du fandom – qui se voit ainsi opposée à la critique du monde littéraire… Tous jugements de valeur mis à part, dont je ne suspecte pas nécessairement S.T. Joshi, je trouve cette distinction un brin spécieuse – de manière tout particulièrement flagrante quand des noms passent d’une rubrique à l’autre… Mais c’est bien ainsi que l’on aborde la critique posthume, très tôt liée aux publications d’Arkham House (pour l’essentiel – mais en fait, après un temps de réaction, d’autres maisons d’édition sont de la partie, et reçoivent leur lot de critiques, bonnes ou mauvaises).
Quoi qu’il en soit, l’intérêt à mes yeux principal de ces deux parties jumelles consiste surtout à voir comment des « mythes » concernant Lovecraft et son œuvre se sont très tôt – vraiment très, très tôt ! – mis en place, éventuellement du fait d’une sentence un peu irréfléchie tout d’abord (c’est ainsi que j’ai tendance à interpréter la phrase de Vincent Starrett sur Lovecraft qui serait lui-même, en tant que personnage, son œuvre la plus aboutie – mon point de vue est bien sûr à débattre), mais bientôt reprise pour argent comptant, et systématiquement encore…
Ceci étant, il est d’autres déformations qui sont plus suspectes et redoutables – et, bien sûr, cela vaut surtout pour la « black magic quote », qui apparaît dans un article de Derleth... de juin 1937 ! Quoi, trois mois à peine après la mort de Lovecraft ? Cette citation apocryphe (allez, je vous la redonne : « All my stories, unconnected as they may be, are based on the fundamental lore or legend that this world was inhabited at one time by another race who, in practising black magic, lost their foothold and were expelled, yet live on outside ever ready to take possession of this earth again. » Il faut y ajouter, mais cette fois de la plume du seule Derleth, l’assimilation de cette conception générale à la théologie chrétienne et au discours portant sur la chute de Satan et le Jardin d’Eden) sera hélas promise à un long avenir : parmi les articles qui suivent, très nombreux sont ceux qui citent à leur tour cette « forgerie », et aucun ne la remet en cause… même si plus d’un relève à quel point cette citation, de la part d’un athée et matérialiste notoire, avait quelque chose de « surprenant » ! Mais il faudra attendre l’avènement de la nouvelle critique lovecraftienne dans les années 1970 (en fait après la mort de Derleth, il n’y a pas de hasard…) pour que la véracité de cette citation soit enfin mise en cause… et enfin balayée comme le mensonge (plus ou moins conscient) qu’elle était ; je vous renvoie donc aux études à ce sujet contenues dans Dissecting Cthulhu, ainsi que dans The Rise, Fall, and Rise of the Cthulhu Mythos.
Il en va de même pour un certain nombre d’autres mythes – d’autant plus inexplicables, le cas échéant, que l’on voit des personnalités bien placées pour en connaître la fausseté (parmi les correspondants de Lovecraft au premier chef) laisser passer ces traficotages… et même, éventuellement, y participer à leur tour ! Ainsi, bien sûr du « reclus de Providence »… Dans cette optique, il faut sans doute mentionner ces anecdotes systématiquement rapportées, cette fois pas fausses en elles-mêmes, mais qui participent bien du « mythe » en construction : Lovecraft détestait la mer et les fruits de mer, il adorait les glaces et en mangeait des quantités invraisemblables, il ne supportait pas le froid et même la simple fraicheur, il adulait par-dessus tout les chats… Autant de choses qui, au fond, ne nous apprennent à peu près rien d’utile sur le bonhomme, mais permettent d’en dessiner à gros traits une caricature (même sympathique) appelée à perdurer – un schéma bien pratique, dont on ne s’éloignera guère, à tel point qu’aujourd’hui tout fan de Lovecraft connaît ces différents aspects de son comportement, là où des traits autrement essentiels sont laissés dans l’ombre – ce qui est parfois préférable, certes, tant le risque est grand qu’on les déforme à leur tour…
Toutefois, il est un autre aspect important à noter dans ces recensions fandomiques : elles sont sans doute bien moins unilatérales que celles figurant dans le courrier des lecteurs de Weird Tales. Comme dit plus haut concernant W. Paul Cook, il y a même parmi les amateurs originels de Lovecraft une tendance à dénoncer le « culte » qui s’est développé autour de l’auteur après sa mort – critique qui apparaît notamment devant certains choix éditoriaux d’Arkham House qui, après le programme originel (déjà ambitieux !) de compléter le « best-of » qu’était censément The Outsider par un deuxième volume de fictions (avec quelques compléments), Beyond the Wall of Sleep, puis un unique (et étonnant dans ce contexte, trouvé-je) volume de Selected Letters, tend en fait à repousser ce terme en éditant d’ici-là des Marginalia et autres textes, de Lovecraft ou de ses camarades, toujours plus « mineurs » ; tandis que les Selected Letters, entreprise de longue haleine, connaîtront en définitive cinq volumes – couvrant certes une part infime de l’abondante correspondance du gentleman de Providence. Le culte bourgeonnant s’accompagne donc de sa contestation, et les rôles ne sont pas aussi clairement définis qu’on pourrait le croire à première vue.
Il suffira somme toute de quelques années pour asseoir une réputation de Lovecraft comme « classique » dans son genre, quel que soit ce genre à proprement parler – ce qui, à son tour, suscitera la controverse : un exemple éloquent, bien que tardif au regard des autres documents ici reproduits, l’article du jeune John Brunner intitulé « Rusty Chains » et les réponses qui lui furent adressées par Sam Moskowitz, Fritz Leiber et Edward Wood – des textes que j’avais déjà lus (ainsi que d’autres dans cette compilation, d’ailleurs, par exemple de Hyman Bradofsky et bien sûr August Derleth) dans le fort sympathique volume édité par James Van Hise, The Fantastic Worlds of H.P. Lovecraft.
LA CRITIQUE « LÉGITIME »
Ces aspects fandomiques, éventuellement inattendus d’ailleurs, sont en outre à adosser à d’autres critiques – émanant cette fois de la « communauté littéraire », dit Joshi ; autant dire, mais ça c’est moi, de la critique littéraire « légitime ». C’est une partie intéressante à plus d’un titre – mais déjà, comme dit plus haut, parce qu’elle est en fait bien moins unilatérale que ce que l’on pourrait croire de prime abord, a fortiori si l’on a en tête le sévère article d’Edmund Wilson cité plus haut, un peu la pierre de touche de la critique « officielle » portant sur les œuvres de Lovecraft – dans les quelques années ayant immédiatement suivi sa mort en tout cas.
En fait, si certains aspects reviennent régulièrement dans ces articles – raillant volontiers la suradjectivation lovecraftienne, on ne leur en voudra pas, mais il y aurait d’autres exemples –, d’autres sont en fait tout aussi récurrents, mais autrement positifs. Un T.O. Mabbott, par exemple, alors reconnu comme une autorité sur Poe, loue globalement l’œuvre lovecraftienne – à ses yeux, Lovecraft, avec qui il avait brièvement échangé, figure sans doute et dès cette époque le plus impressionnant des héritiers du poète au corbac, et par ailleurs un des rares à l’avoir vraiment « compris ».
Si assez nombreux, dans cette rubrique, sont ceux qui ne peuvent concevoir la littérature « weird », de fantasy et/ou de science-fiction (éventuellement accolées voire assimilées) que comme, au mieux, une paralittérature, sinon une sous-littérature, même eux semblent ne guère douter que, dans ce registre « que Lovecraft avait fait sien », il était bien d’une habileté remarquable – on parlera alors du gentleman de Providence comme d’un « petit maître »…
Certains, cependant, commencent à comprendre que cette littérature-là peut constituer un objet d’étude sérieux, et éventuellement, soyons fous, une forme de littérature aussi valable qu’une autre. Ici, Robert Allerton Parker étudie les pulps, et, un peu plus tard, J.O. Bailey livre probablement une des premières études critiques « sérieuses » sur la science-fiction en tant que genre : l’article du premier, l’extrait de l’ouvrage du second, qui sont ici rapportés, ne sont pas des plus enthousiasmants pour un lecteur contemporain, et, tout particulièrement dans le cas de Bailey, le contenu proprement critique peut paraître assez « mince » (l’auteur paraphrase longuement At the Mountains of Madness et « The Shadow Out of Time », plus qu’il ne les analyse à proprement parler), mais une étape est sans doute franchie ; et, dans les deux cas, Lovecraft est considéré comme un auteur essentiel – et pleinement dans le genre.
Cette critique « légitime », qu’elle soit favorable ou pas, est toutefois peut-être aussi édifiante par ses failles que par ses qualités… Ainsi que je l’ai avancé plus haut, nombreux ici sont les chroniqueurs qui reprennent sans la moindre hésitation les affabulations plus ou moins fandomiques (et tout particulièrement celles, ô combien néfastes donc, d’un August Derleth), qu’ils ne se sentent sans doute guère de « vérifier » ; on peut difficilement leur en vouloir, j'imagine. Mais, à côté, certains articles sont tout simplement… mauvais. Parfois au point d’en devenir drôles, tant le manque de sérieux qui les caractérise ressort de manière particulièrement fâcheuse ! Difficile de ne pas ricaner, ainsi, devant la très brève recension de Beyond the Wall of Sleep dans la New York Times Book Review (1944), due à un certain William Poster : en à peine plus d’une page, le critique écrit systématiquement « Cthulu » pour « Cthulhu » (bon, OK…), « Nyarlothep » pour qui vous savez, « Clark Wandrei » pour « Donald Wandrei » (sans doute fusionné avec Clark Ashton Smith…), etc. Là encore, les blogs, c’est pas si pire, hein…
Pour l’anecdote, on y trouve aussi une très brève recension par Algernon Blackwood, mais figurant originellement dans une correspondance parfaitement privée – sa place ici est donc sans doute critiquable… L’auteur anglais n’est pas très fan, disons.
ET POUR LE PLAISIR…
Notons d’ailleurs que l’ouvrage se conclut sur quelques très brefs jugements « indépendants » de personnalités ; parmi les « maîtres modernes » identifiés par Lovecraft dans Supernatural Horror in Literature, outre Blackwood donc, nous trouvons également M.R. James, moqueur, ou encore Lord Dunsany, plus charitable – et supposant que Lovecraft avait créé ses récits des « Contrées du Rêve » de manière autonome, minimisant sa propre influence ; ce qui est en partie vrai au départ… mais par la suite l’influence de l’aristocrate irlandais avait été revendiquée par Lovecraft, et sans la moindre ambiguïté.
Un autre nom à relever enfin, dans cette bizarre conclusion : celui de Jean Cocteau – et je suis content : c’est la première fois que je lis directement (enfin, en anglais, broumf...) la fameuse remarque du Français sur Lovecraft qui gagne à être traduit dans la langue de... Maupassant, disons. Amusant par ailleurs – ou un brin consternant ? – de noter que Cocteau cite Lovecraft, pour La Couleur tombée du ciel…aux côtés de L’Atlantide et les Géants de Denis Saurat, et de Lueurs sur les soucoupes volantes d’Aimé Michel. Je vous renvoie à ce que Michel Meurger a pu écrire sur cet étrange état d’esprit de l’intelligentsia française d’alors, qui mettait sans sourciller dans un même panier ésotérisme et science-fiction – Lovecraft tout particulièrement en a fait les frais (voyez notamment l’article « ʺAnticipation rétrogradeʺ : primitivisme et occultisme dans la réception lovecraftienne en France de 1953 à 1957 », dans Lovecraft et la S.-F./1).
CONCLUSION
Finalement, on peut en retenir pas mal de choses, de ce bouquin, hein… Même si je suppose décidément que cet ouvrage s’adresse avant tout aux acharnés dans mon genre. En fait, son optique assez particulière (dans le sens où c’est largement une étude des représentations et tout particulièrement de la construction d’un mythe, même si bien d’autres aspects pourraient être mis en avant) nécessite peut-être un minimum de bagage pour être pleinement appréciée – bagage dont je ne dispose pas forcément, d’ailleurs : outre ce qui concerne Lovecraft, une meilleure connaissance de l’histoire des pulps, puis de l’édition de SF en volume, enfin de la perception de la SF en tant que genre durant les années 1940, et les relations entretenues entre les différents genres de l’imaginaire alors, sont autant de prérequis ou presque pour bien appréhender la chose – et sur ces terrains je suis plus qu’à mon tour défaillant…
Mais la lecture demeure instructive. Et, pour pasticher la fameuse sentence de Vincent Starrett qui revient très régulièrement dans ces pages, non, Lovecraft n’est pas lui-même son œuvre la plus aboutie – mais il est peut-être bien l’œuvre la plus aboutie d’une critique en gestation, comme un prérequis avant d’aborder les textes... Aussi, en fait de citations, je vais conclure avec un gros classique : « When the legend becomes fact, print the legend. » Au pire, ça excitera des amateurs ultérieurs…

/image%2F1385856%2F20160114%2Fob_cfb8b0_caligari.jpg)







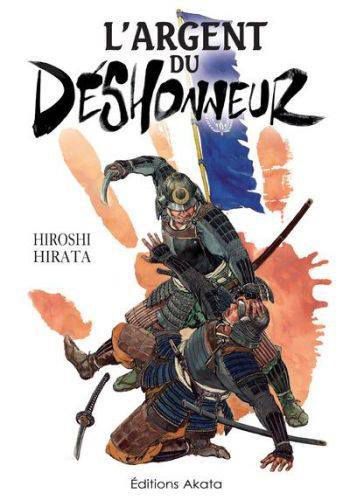




/image%2F1385856%2F20150204%2Fob_660a87_georges-abdaloff-croque-par-christell.jpg)